
Euskara, la langue des Basques
§ de euskara.euskadi.net §
Seconde partie
|
|
Euskara, la langue des Basques
§ de euskara.euskadi.net §
Seconde partie
|
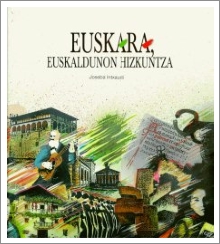 |
|
|
|
Lecteurs en temps de guerre : Voici comment la revue madrilène La Ilustración Española y Americana (novembre 1874) voyait les lecteurs basques à l’époque de la dernière guerre carliste. A partir du XIXème siècle, l’école permit progressivement aux classes populaires de surmonter elles aussi l’analphabétisme. |
A l’époque contemporaine, le milieu social des locuteurs basques a connu de grands changements, des changements économiques, démographiques, politiques, culturels et linguistiques qui se sont produits simultanément. Pris dans ce tourbillon, le cadre social de la langue est devenu de plus en plus changeant: trois ou quatre guerres, la révolution industrielle, les migrations, l’exode rural et l’urbanisation, la scolarisation, le service militaire, les nouveaux médias, les bouleversements institutionnels et politiques... le tout en même temps. La géographie de l’euskara -son aire linguistique- comme ses locuteurs -la population bascophone- ont été modifiés en profondeur. En fait, les deux siècles écoulés entraînèrent un revirement complet de la situation sociolinguistique. Ébranlée par de tels changements, la société basque a voulu enrayer l’extinction évidente de la langue par de courageuses actions tous azimuts: tantôt en dénonçant les nombreuses attaques et injustices dont l’euskara faisait l’objet, tantôt en renforçant et en alimentant la conscience linguistique de la population, en créant des fonctions et des institutions chargées de la défense du basque, en animant diverses activités tant au sein du peuple que dans le monde plus fermé de la culture.
|
Mais on demande (ici, au Parlament) plus, pour la langue catalane, qu’un simple usage dans la vie quotidienne, dans la vie privée; on demande que le gouvernement, que l’État lui reconnaisse un caractère officiel dans toutes les démarches administratives, mais il s’agit là d’aborder un problème des plus délicats. Comte de Romanones, Président du Gouvernement |
Les doutes de Romanones (texte) : Celui qui avait été Premier ministre des gouvernements de la monarchie n’avait pas d’idée très précise, semble-t-il, sur la politique linguistique que devait adopter le gouvernement espagnol. Cependant, la langue basque devait lui apparaître comme quelque chose de bien réel et de vivant au sein de la société qu’il fréquentait lors de ses villégiatures estivales (Saint-Sébastien, Oiartzun). Mais, de par leur mentalité politico-linguistique, les politiciens espagnols, dans leur majorité (1916), étaient assez insensibles à de telles revendications culturelles. |
|
|
Lecteurs d’Argia : Dans les années 1920-1930, les paysans avaient des familles nombreuses. A défaut de radio et de télévision, les paisibles veillées d’hiver pouvaient être consacrées à la lecture des revues basques. D’ailleurs, ce type de publications comptait probablement plus de lecteurs en milieu rural qu’en milieu urbain. |
Enfin, il faut rappeler qu’à l’époque contemporaine, le Pays Basque n’a pas disposé des instruments politiques appropriés, y compris quand il y avait volonté politique, pour concevoir et mener à bien un projet linguistique général et complet. Néanmoins, l’attachement des Basques pour leur patrimoine linguistique se renforça, comme le prouvent toutes les manifestations pour défendre la langue et le fait qu’ils financèrent plus souvent qu’à leur tour les actions entreprises pour accroître le rôle social de l’euskara. Depuis le XIXème siècle jusqu’à nos jours, militer en faveur de l’euskara a été, pour beaucoup d’individus et de groupes, une forme d’activité permanente et de dévouement constant grâce auxquels de remarquables projets ont pu devenir réalité.
|
|
La nouvelle Députation de Biscaye (1897) : Les institutions "forales" basques et les nouveaux organismes surgis des guerres carlistes (en particulier, les députations: Conseils Généraux) ne se préoccupèrent qu’épisodiquement de la situation de marginalisation et de persécution dont souffrait la langue basque. A l’initiative des mouvements culturels et politiques du Pays, quelques décisions importantes, mais limitées, furent pourtant prises en faveur de l’euskara. Ci-contre: nouveau Palais de la Députation de Biscaye (1897). |
L’entreprise avortée des siècles passés, et l’euskarisme qui s’est développé peu à peu depuis deux cents ans, constituent les deux éléments-clés qui doivent nous guider dans l’élaboration d’un plan structuré de sauvegarde de la langue basque reposant sur les bases suivantes: • une conscience linguistique et des revendications bien vivantes, • un corpus de l’euskara actualisé en permanence, • des institutions sociales et politiques pour la langue, • de nouveaux usages littéraires et sociaux... Au cours du siècle et demi écoulé de 1789 à 1936, de louables efforts ont été effectués au Pays Basque, mais ils n’ont pas suffi à stopper le recul provoqué par les nouvelles circonstances historiques. Ce recul s’explique, évidemment, par l’ampleur de l’offensive à l’extérieur du Pays Basque, mais aussi par la négligence de nombre de bascophones. A l’aube de l’époque contemporaine, la majeure partie des zones bascophones n’étaient pas bilingues, ou l’étaient dans une très faible proportion. Aujourd’hui, en revanche, le bilinguisme s’est généralisé dans tout le Pays Basque. Face à cette situation inédite, l’avenir de la bascophonie -sommes-nous vraiment condamnés à délaisser notre propre langue et à devenir ni plus ni moins que de simples hispanophones ou francophones- dépend désormais des bascophones mêmes, des hispanophones qui vivent au Pays Basque et de tous ceux qui, dans la mesure de leurs moyens, interviendront pour favoriser ou entraver le processus de redressement linguistique.
|
|
Napoléon III (1870) : En France, depuis que la Révolution eut durci la politique officielle vis-à-vis des langues vernaculaires (à partir de 1793), tous les régimes suivirent —plus ou moins activement— la même orientation. La politique de Napoléon III (1851-1870) ne fit pas exception à la règle. Toutefois, lorsqu’il était jugé opportun de faire prendre au discours politique des accents plus populaires, des proclamations bilingues, comme celle que nous présentons, firent leur apparition. |
L’époque contemporaine a constitué une période de changements rapides, y compris pour les langues, et cette accélération de l’histoire entraîna des conflits importants. N’oublions pas, par exemple, que les plus grandes révolutions politiques (France, Russie, Chine) ont eu lieu précisément à cette période. La France et l’Espagne se sont trouvées emportées par ce courant de transformations. La France a d’abord vécu les sanglants événements révolutionnaires, puis l’expérience napoléonienne, et enfin les projets politiques du libéralisme bourgeois. L’Espagne, de son côté, dut faire face à des guerres successives et de nombreux soulèvements militaires tout au long du XIXème siècle, à quoi il faut ajouter des changements socio-économiques plus profonds: le désamortissement, le chemin de fer, une révolution industrielle plus ou moins réussie... Le Pays Basque, quant à lui, ne pouvait faire abstraction du contexte international et affronta, à sa manière et avec ses propres moyens, les vicissitudes historiques. Après les éclaboussures de la Révolution française (guerre de la Convention, 1793), notre territoire vit passer les troupes de Napoléon. Puis ce fut la période troublée des guerres carlistes. Beaucoup endurèrent également l’exil politique et la mise au ban de la société. L’un d’eux, José María Iparragirre, fait figure de symbole. De plus, nous avons dû participer, des deux côtés des Pyrénées, aux guerres espagnoles et françaises: qui ne connaît, dans notre littérature, "Solferino-ko Itsua" (l’Aveugle de Solferino: Elizanburu, 1864) écrit pour commémorer cette célèbre bataille au cours de laquelle quelque 40.000 Français, Sardes et Autrichiens laissèrent leur vie?
Entre flux et reflux successifs, Euskal Herria connut, au XIXème siècle, les événements historiques les plus décisifs jamais survenus depuis le Moyen-Âge. Et il va de soi que l’euskara, dans sa dimension sociale, supporta aussi les lourdes conséquences de ces temps difficiles, étant donné qu’en principe, les États disposaient désormais d’instruments beaucoup plus efficaces pour orienter le développement des langues.
Qu’ils aient légiféré en faveur de langues officielles, ou simplement ignoré l’existence et le problème des langues non officielles, le fait est qu’en Espagne comme en France, les régimes et gouvernements qui se sont succédés aux XIXème et XXème siècles ont toujours suivi une politique linguistique déterminée. Ainsi, la monarchie espagnole s’accrocha au projet de monolinguisme hérité du XVIIIème siècle et, au siècle suivant, les grandes lignes de cette politique ne furent pratiquement jamais remises en question. Les lois, dans leur esprit, et les pratiques politico-administratives tendaient toutes vers un seul et même but: imposer, de façon détournée, la langue de l’administration centrale et en développer l’usage. L’État espagnol tenta d’y parvenir, moins par des dispositions légales précises, que par une politique consistant à occulter et ignorer le problème des langues non officielles.
|
|
La France était-elle réellement francophone ? (1792. Carte,1864) : D’après ce qu’il ressort d’une enquête officielle de 1792, sur les 27,5 millions d’habitants que comptait la France à l’époque, 12 millions n’utilisaient pas le français dans leur vie quotidienne. Quelque quatre-vingts ans après la Révolution, plusieurs millions de personnes continuaient à parler d’autres langues que le français: dans certaines régions, le pourcentage de la population non francophone était toujours très élevé, et plus encore si on inclut ceux qui n’utilisaient pas le français régulièrement. |
Durant de longues décennies, aucune demande en faveur d’une langue ne parvint au pouvoir central, à l’exception de quelques initiatives qui passèrent presque inaperçues. Nous avons un exemple significatif, quoiqu’isolé, en la personne du Labourdin D. J. Garat qui, en tant que ministre, soumit à Napoléon un projet audacieux de reconnaissance de l’identité basque dans lequel figurait la prise en considération politique du fait linguistique (1808). Dans l’État espagnol, ce furent les partis nationalistes qui abordèrent ce problème avec la vision politique la plus claire. En Catalogne, les revendications linguistiques firent l’objet de quatre textes remarquables. Celui rédigé en 1885 constitua la première manifestation d’un catalanisme politiquement uni: il y était demandé au jeune roi Alphonse XII un statut officiel pour le catalan dans le cadre du régime monarchique restauré par Cánovas (1874-1923). Dès lors, cette revendication sera indissociable des grands événements politiques. Pour la deuxième fois, la demande de statut officiel fut présentée à la reine à l’occasion des Jeux Floraux de 1888.
|
Une langue universelle est, dans son genre, ce que la pierre philosophale est en chimie. -Mais au moins on peut uniformer la langage d’une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise, qui en fut pas pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociales eet qui doit être jaloux de consacrer au plutôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté. Rapport GREGOIRE (1794), Convention Nationale. |
La politique linguistique de la Révolution Française (Textes, 1794) : Comme nous l’avons dit, au cours des premières années de la Révolution française, les langues locales eurent aussi leur place dans les documents du gouvernement central, et il existe plusieurs exemples de textes officiels traduits en euskara. C’est sur le rapport de l’Abbé Grégoire qu’un projet de substitution linguistique est abordé. Bertrand Barère, membre du Comité du Salut Public, nous laissa aussi son texte cité en référence. |
Elle fut également reprise comme mot d’ordre des mouvements sociaux de 1916 et 1924. Le texte politique Les Bases de Manresa, par exemple, stipulait que "le catalan sera la seule langue officielle en usage en Catalogne et dans les relations de cette région avec le pouvoir central" (1892). Il devenait donc évident qu’en Espagne, les revendications linguistiques faisaient désormais partie du discours de forces politiques qui étaient en train de s’affirmer socialement et que, dans un futur proche, l’exigence d’une nouvelle politique pourrait aller en s’amplifiant.
|
Je veux parler du peuple basque. Il occupe l’extrémité des Pyrénées-Occidentales qui se jette dans l’Océan. Une langue sonore et imagée est gardée comme le sceau de leur origine et l’héritage transmis par leurs ancêtres. Mais ils ont des prêtres, et les prêtres se servent de leur idiome pour les fanatiser; mais ils ignorent la langue française et la langue des lois de la République. Il faut donc qu’ils l’apprennent, car, malgré la différence du langage et malgré leurs prêtres, ils sont dévoués à la République qu’ils ont déjà défendue avec valeur le long de la Bidassoa et sur nos escadres. Rapport BARERE (1794) Comité de Salut Public. |
|
|
La langue, instrument "Foraliste" : L’Alavais R. Becerro y de Bengoa (1845-1902) et le Guipuzcoan J. I. Iztueta utilisèrent presque les mêmes termes pour expliciter la dimension politique de la langue basque: "Une fois l’euskara mort, les Fueros disparaîtront à leur tour; mais, si l’euskara vit, les Fueros ressusciteront", concluait le premier des deux. |
Mais, reprenons le cours de l’histoire de France et remontons pour cela à
l’Ancien Régime et, plus particulièrement, au règne de Louis XIV. À cette
époque, la couronne concentra ses efforts sur les territoires récemment annexés
où elle essaya de marginaliser les langues locales et d’imposer -avec plus ou
moins de fermeté- le français. Il était permis de penser que le changement de
régime, provoqué par la Révolution de 1789, allait orienter la politique
linguistique dans une autre direction. En fait, malgré quelques hésitations
initiales, on redressa la barre pour garder le cap déjà fixé. Une fois élaboré
le nouveau projet de "nation" propre à l’État révolutionnaire, la seule option
linguistique possible était celle qui faisait du français la langue nationale.
Pour faire face à toutes les menaces, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des
frontières, il était primordial pour la Révolution d’assimiler les différents
peuples de France au nom d’une République une et indivisible. À cet effet, il
fallait résoudre le problème des langues de l’Hexagone. Dès le début, les
décisions prises furent contradictoires: par exemple, l’année même de la
création de l’office des traductions à Paris (1790), il était ordonné que les
textes officiels fussent proclamés en français, du haut de la chaire, après la
messe dominicale. Linguistiquement parlant, la France était assez peu
"française", et une enquête officielle fut réalisée (1790-1792) afin de
recueillir assez d’informations pour appréhender la situation réelle et pouvoir
intervenir conformément à l’option politique retenue. A l’issue de l’enquête, la
situation décrite dans le rapport de l’abbé Grégoire permit de définir les
grandes lignes de la politique future. À partir de 1793, l’attitude libérale qui
avait prévalu jusque là fut abandonnée, et les mesures appropriées furent prises
pour faire du français la seule et unique langue nationale, les langues locales
étant reléguées au niveau de patois, voire considérées comme ennemies du régime.
De fait, une bonne partie de la France pouvait faire l’objet de cette politique linguistique: l’Alsace, le Roussillon, la Bretagne, le Pays Basque ainsi que d’autres territoires présentaient l’"anomalie" de disposer d’une langue propre. Les recensements par communes faits au cours des années 1806-1808 donnaient, par exemple, 108.000 bascophones pour le Pays Basque Nord et en Bretagne 967.000 bretonnants, tandis que les germanophones, flamandophones et italophones atteignaient conjointement le chiffre de près de 10 millions (B. Oyharçabal, 1991); les occitanophones n’étaient pas comptabilisés comme tels, sans doute en raison du caractère néo-latin de la langue d’oc, proche du français, ce qui aurait empêché l’affirmation de son autonomie linguistique (ils parlaient -on aurait pu supposer- un patois de plus du français). "Le combat contre les langues locales de l’hexagone apparaît-il comme un combat pour la culture et contre l’ignorance, comme un combat laïc et républicain" (J. L. Calvet). Ainsi fut-il décidé que le français devait s’étendre à tout l’Hexagone, les dirigeants n’ayant pas eu la faiblesse de reconnaître un quelconque caractère officiel aux autres langues. En résumé, il apparaît que des critères idéologiques et politiques semblables ont conditionné la politique linguistique des deux États -espagnol et français- qui se partagent le Pays Basque, jusqu’à ce que la IIème République en Espagne, et la loi Deixonne (1951) en France, y apportent, ne serait-ce que ponctuellement et partiellement, quelques modifications.
À la conquête du pouvoir Pour étudier la place occupée par l’euskara dans les institutions publiques aux Temps Modernes et à l’époque contemporaine, il convient de distinguer d’emblée, comme nous l’avons déjà fait plus haut, la langue parlée de la langue écrite. Dans les zones bascophones (territoires ou communes), le basque était utilisé pour les tâches quotidiennes. À cet égard, la majeure partie du Pays Basque était unilingue et il était tout bonnement inconcevable qu’il en fût autrement.
|
|
Ahetze (Labourd) : Dans de nombreux villages basques, les mairies ont assez souvent conservé des documents et des actes rédigés en euskara. Celui que nous présentons ici vient d’Ahetze (Labourd), le village natal du bertsolari Mattin. Cette tradition, qui trouve son origine dans les premières années de la Révolution, s’est maintenue pendant un certain temps (1790-1822). |
|
|
Commission en faveur de l’euskara : Les Juntes de Guipuzcoa, convoquées à Arrasate (= Mondragón), créèrent en 1830 une commission chargée des affaires économiques de la province et des besoins de la langue basque. |
En ce qui concerne les institutions, nous devons là aussi faire une distinction en fonction du niveau considéré. La situation n’était pas la même selon qu’il s’agissait d’institutions locales, ou d’institutions provinciales ou territoriales. Au sein de ces dernières, il était plus fréquent que la langue parlée ne fût pas le basque, surtout s’il y avait des fonctionnaires étrangers au Pays qui ne connaissaient pas l’euskara: dans ce cas, et suivant les époques et les lieux, la langue utilisée pouvait être le castillan, le français ou le gascon.
Il advint occasionnellement qu’au niveau des services administratifs, l’obligation de prendre en compte la langue locale fût expressément formulée. Dans certains cas, le choix d’une langue alla même jusqu’à créer des situations conflictuelles. Rappelons-nous ces mandataires qui prétendirent imposer des règles contraignantes à l’encontre des bascophones unilingues, ou ces citoyens basques qui en étaient arrivés à exiger le droit de s’exprimer en euskara.
|
|
À la conquête du pouvoir : Les guerres carlistes du siècle dernier apparaissent clairement comme une lutte pour la conquête du pouvoir politique. Pour le bas peuple, regroupé sous la bannière des "Fueros", il s’agissait entre autres choses de défendre —plus ou moins consciemment— l’identité et la particularité d’Euskal Herria. Les sceaux de la haute cour de justice et des postes du gouvernement carliste présentés ici en sont la preuve éclatante. |
Tout cela s’applique à la langue parlée. En revanche, en ce qui concerne la langue écrite, les habitudes linguistiques furent tout autres. Les lois "forales" ne furent pas rédigées en basque, mais en plusieurs langues romanes: le Fuero navarrais était écrit en roman navarrais; les Fueros d’Alava (1463), de Biscaye (1452, 1526) et de Gipuzkoa (1397, 1696) en castillan, et ceux d’Iparralde en gascon (Labourd, 1514; Soule, 1520; Basse-Navarre, 1611). En conséquence, à quelques exceptions près, les documents officiels continuèrent à être rédigés dans les mêmes langues et, à partir de 1620, en français au Pays Basque Nord. Au XIXème siècle, cet héritage officiel hispanisant va être mis en question, tandis que la possible reconnaissance de l’euskara au sein des institutions va prendre une nouvelle tournure. Par exemple, le règlement des Juntes de Biscaye fut changé. À l’époque de la première guerre carliste, et immédiatement après, l’habitude fut prise de fournir une explication orale, en basque, des affaires traitées (1833, 1839, 1841). En 1841, Ulibarri demanda que le procès-verbal des séances quotidiennes fût rédigé en euskara. Dans le même registre, il fut également décidé (1844) de traduire en basque les discours du corrégidor représentant le roi, décision qui entra en vigueur en 1846. Pour cela, il fallut demander la création de postes de traducteurs. Entretemps, le nombre de comptes rendus et de rapports présentés aux Juntes de Biscaye en euskara ne cessa d’augmenter.
|
|
L’immigration ouvrière : Les mines de Biscaye et l’industrie sidérurgique attirèrent de nombreux immigrants. Hélas, le Pays Basque n’offrit pas aux nouveaux venus les possibilités d’accéder à ses propres valeurs culturelles ni à sa langue, d’une part parce que les moyens d’euskarisation faisaient défaut et, d’autre part, parce qu’il ne restait guère de place pour ce type d’échanges culturels dans la dure vie quotidienne des ouvriers. Ci-contre: vue des mines des Encartaciones, zone qui attira la première vague d’immigration ouvrière. |
Une telle reconnaissance officielle apparaît dans le règlement de 1854 qui stipulait que, dès lors, "les séances commenceront par la lecture des dossiers et documents en castillan, et les délibérations auront lieu dans les deux langues, jusqu’à ce que les représentants aient une vision suffisamment claire des questions abordées". Le règlement intérieur des juntes traduit donc, de façon explicite, la nouvelle attitude adoptée par les institutions sur le plan linguistique. Bien que nous ne disposions pas de données exactes sur la situation dans les Députations et les communes, il est permis de penser que l’influence du milieu social basque y était importante même si, par exemple, la volonté d’imposer aux fonctionnaires de savoir l’euskara confinait à l’illégalité (1886). Ne nous étendons pas sur ce qui s’est passé dans les autres territoires basques, mais abordons plutôt la politique des institutions en ce qui concerne la situation de la langue dans la société.
|
|
La grande bourgeoisie basque : Pendant la révolution industrielle, la bourgeoisie la plus influente du Pays Basque n’entretint aucun type de relations avec le monde euskariste. Peut-être que le basquisme ne parvint pas à attirer à lui cette force sociale. Toujours est-il que, parallèlement au problème linguistique dans la classe ouvrière, la langue basque a souffert du manque de soutien de la part de la bourgeoisie. Ci-dessus: monument au chef d’entreprise Chávarri à Portugalete. |
|
|
Les parlementaires (1931) : "La Minorité Basco-navarraise" constitua le groupe politique le plus prometteur de tous ceux que les euskaristes avaient eu jusque là à Madrid. Hélas, le travail de ces parlementaires et de leurs successeurs ne suffit pas pour conférer à la langue basque un caractère officiel définitif. C’est l’autonomie, obtenue pendant la guerre, qui allait donner, pendant quelques mois, un statut officiel à l’euskara. Archives de la Fondation Sabino Arana. |
En réalité, il devenait de plus en plus évident, au fil du temps, que l’euskara traversait une conjoncture difficile, et que la détérioration flagrante de son statut au sein de la société basque devait faire l’objet de l’attention des pouvoirs publics. En 1832, Ulibarri demanda aux Juntes de Biscaye la création d’une Académie de l’euskara, composée de vingt-quatre membres, et destinée à protéger la langue des dangers qui l’attendaient. De même, les Juntes de Gipuzkoa réunies à Arrasate (1830) décidèrent, sur proposition d’Erro, politicien érudit, de donner naissance à une Comisión Auxiliar de la Diputación para el Fomento de la Industria, Comercio y de la Lengua Vascongada (Commission Adjointe à la Députation pour l’Encouragement de l’Industrie, du Commerce et de la Langue Basque). Les juntes considéraient donc qu’il leur incombait de traiter le problème linguistique comme n’importe quel sujet politico-économique.
Au cours des décennies suivantes, ces mesures, ainsi que d’autres adoptées par les institutions les plus importantes, allaient servir à enrayer un processus qui portait atteinte au patrimoine du peuple basque. Tout ce qui se rapporte à l’enseignement, en particulier, occupa une grande place. La volonté politique de défendre l’euskara s’exprima plus nettement dans la vie institutionnelle, avec l’émergence de la Renaissance Basque (Eusko Pizkundea).
L’euskara, langue nationale (textes) La Révolution Française (1789) souleva en Europe une série de problèmes politiques qui allaient se répercuter tout au long de l’époque contemporaine. Avec la proclamation des droits individuels du citoyen, une nouvelle relation socio-politique entre propriété et pouvoir s’instaura dans la société européenne. L’autorité politique et économique, détenue jusqu’alors par la couronne et ses alliées, l’aristocratie et l’Église, passa aux mains de la bourgeoisie. Cette classe, en plein essor, se retrouva à la tête de la révolution industrielle commençante: les premiers bénéfices tirés de l’industrie et la redistribution des terres (désamortissement des biens inaliénables) permirent la constitution rapide de fortunes nouvelles. Ce fut précisément la bourgeoisie qui, sous la monarchie comme en république, joua le rôle historique principal dans l’Europe des XIXème-XXème siècles. À côté, l’histoire du prolétariat a été celle d’une classe sacrifiée et résignée qui, lentement, a dû conquérir ses droits sociaux et améliorer sa situation jusqu’à atteindre un certain niveau de vie.
|
|
J.M. Iparragirre (1820-1881) : Iparragirre est surtout célèbre pour être l’auteur de "Gernikako Arbola", mais nous lui devons également deux chansons à la louange de la langue: "Gora euskera" créée en l’honneur du lexicographe Aizkibel, et "Arren, ez bedi galdu euskera" (= Plaise à Dieu que l’euskara ne se perde pas). De toute évidence, lui aussi contribua activement à faire évoluer la mentalité de la société par rapport à la langue. |
Les changements économiques du siècle dernier eurent de nombreuses conséquences sur la vie des langues européennes: tout d’abord, la redéfinition politicoéconomique des frontières d’États qui détermina, en même temps, les fonctions linguistico-culturelles desdites limites; deuxièmement, l’organisation de l’appareil de contrôle et de gestion de l’État qui consista, en particulier, à établir de nouvelles modalités pour la formation et la sélection des fonctionnaires, et à généraliser le service militaire; troisièmement, l’orientation idéologique imposée à la société par l’État réorganisé qui exploita, à cet effet, les possibilités de l’école et les médias; quatrièmement, la réaffirmation, de la part des petits peuples et nations sans État, de leur volonté, leur conscience et leur identité nationales; enfin, comme conséquence du point précédent, le désir des États centralisateurs de ramener ces minorités ethniques rebelles sur la voie déjà tracée... Inévitablement, les langues européennes non officielles allaient être impliquées dans la trame même de ces projets et programmes contradictoires. Le Pays Basque ne pouvait faire exception à la règle.
L’offensive contre les fueros basques, attaqués dès le XVIIIème siècle, se fit plus virulente à l’époque contemporaine: au Pays Basque Nord, les institutions "forales" disparurent l’année même de la Révolution (1789), et les trois provinces d’Iparralde, noyées dans un département plus vaste, perdirent leur personnalité politique. Dès lors, pour le régime jacobin et centralisateur de Paris, il n’existerait plus, du point de vue administratif, ni Pays Basque ni euskara. Le Pays Basque n’allait être qu’un simple territoire géographique à enfermer dans le cadre strict d’une seule et unique politique linguistique nationale, comme nous le verrons plus loin.
La partie sud-pyrénéenne du Pays, au terme d’une agonie politique plus longue, perdit tout ce qui restait de ses "Fueros" à la fin de la dernière guerre carliste (1876). La restauration de la monarchie, avec Alphonse XII et Cánovas, n’était certes pas le moment propice pour sauvegarder les institutions traditionnelles dans la mesure où elle survint justement après la défaite militaire du Pays Basque. L’ampleur du désastre provoqua une grave crise de conscience dans la génération de cette époque. Désormais, quel serait le futur d’Euskal Herria? En outre, après tant d’années de déclin et dans un climat aussi hostile, quel avenir pouvaiton prédire à la langue basque? Une fois les Fors perdus, l’euskara survivrait-il comme élément d’identité du peuple basque?
|
EUSKARA ANTATZEN
Gora, gora euskera! Biotzean gurutza, eskuan bandera esan lotsarik gabe euskaldunak gera!
Pakean bizitzeko gure mendietan euskera itz egin bear da batzarre denetan. (...)
“Gora euskera”, 1856 J. M. IPARRAGIRRE |
EUSKARA KANTATZEN
Galdu dirade oitura onak galdua degu euskera... ola bagaude, eun urte barru galdu da gure izena! Erro, Aizkibel zirran bezela erakuslerik gaur ez da. Gure euskera...ai! galtzen bada gu... euskaldunak ez gera!
Arren, ez bada galdu euskera, nere anaia maiteak! G altzen badugu... galduak gera gu eta gure semeak. Beti euskeraz itz egin, bada, oso zaar ta gazteak, esan ez dedin denok gerala euskaldun biotz gabeak.
“Arren, ez bedi galdu euskera” J. M. IPARRAGIRRE |
Au milieu des conflits sociaux qui agitaient la société basque, chacun s’efforça de trouver à sa façon, tant dans l’économie que dans le domaine culturel ou politique, des solutions nouvelles ou actualisées, attitude qui présentait l’inconvénient de disperser les forces disponibles. En effet, les magnats étaient intéressés au plus haut point par les débouchés existant à l’extérieur du Pays Basque, et il fallait s’assurer ce marché potentiel par une présence efficace et amicale au niveau du pouvoir central. De même, pour certains intellectuels, réussir à l’étranger signifiait toucher un public infiniment plus vaste que celui que le petit Pays Basque pouvait leur offrir.
Tout cela, outre l’absence de lignes directrices euskaristes sur le plan social et culturel, explique pourquoi il fut très difficile d’esquisser un projet national conçu au sein même d’Euskal Herria dont la société était de plus en plus composite et linguistiquement débasquisée. Ceux qui détenaient le pouvoir politique, économique et social, et qui n’étaient pas tous basques d’origine, manquèrent de volonté pour entreprendre résolument un redressement linguistique; les masses ouvrières immigrées n’eurent pas l’occasion d’apprendre l’euskara; en revanche, les bascophones partaient pour l’étranger ou vivaient dans des villes de plus en plus hispanisées. Pour finir, sur les problèmes relatifs à la langue, les décisions les plus importantes n’étaient plus prises au Pays Basque, mais ailleurs.
Mais, après quarante ans d’efforts et au terme de la dictature de Primo de Rivera (1930), des voix s’élevèrent à Madrid, en chœur avec les revendications catalanes, pour exiger un changement de politique linguistique. Enfin la IIème République apporta à la langue basque une reconnaissance officielle, quoique tardive et éphémère (1936- 1937), et l’héritage encore vivace de la tâche accomplie par la Renaissance Basque (1876-1936) permit au Pays de persévérer malgré la guerre civile et la répression qu’il allait subir (1937-1975).
Chants pour l’euskara (Iparragirre)
Entre autres choses, le carlisme basque du XIXème siècle prit l’euskara sous sa protection. Les carlistes manifestèrent leur sympathie pour la langue basque de diverses façons au cours de la dernière guerre (1873-1875). En fait, ils faisaient preuve de l’intérêt que les groupes politiques et idéologiques accordent parfois à la langue: c’est-à-dire que d’aucuns voyaient dans l’euskara un instrument qui, utilisé à l’adresse de masses populaires unilingues, facilitait la diffusion de leur propre idéologie tout en formant une barrière linguistique contre la propagande libérale. D’une certaine manière, la langue était pour eux un moyen de plus dans la lutte politique.
Cependant, étant donné que le carlisme était en même temps un mouvement populaire et que le peuple basque était essentiellement euskarophone, il n’est pas surprenant que les carlistes basques, ou une partie d’entre eux, aient été, dans le contexte de l’époque, des euskaristes convaincus à qui la langue apparaissait comme une manifestation culturelle de la spécificité historique basque.
Les Juntes carlistes, et plus encore les rapports et commissions sur l’école et l’enseignement, témoignent d’une préoccupation constante pour la langue basque, tant en Biscaye qu’en Gipuzkoa. Quelquefois, l’initiative en faveur de la défense du basque ne venait pas des dirigeants, mais du peuple (comme ce fut le cas, par exemple, en 1875 aux Juntes de Gipuzkoa). Par ailleurs, les arguments invoqués dans les journaux carlistes étaient, dans certains cas, exposés dans un style quasiment "abertzale": "Il faut concevoir un système éducatif [...] qui confère un lieu privilégié au basque car la langue est un des nœuds qui resserre les liens du patriotisme et de l’amour national", lançait un journal carliste de Bilbao (1871).
Mais, nous ne devons pas oublier que, avant même ces déclarations politiques pré-abertzales, dès 1850 approximativement, plusieurs initiatives révélèrent l’inquiétude suscitée par la situation en vigueur, à un moment où se faisait sentir le désir d’approfondir la connaissance et l’étude de la langue basque. C’est à cette époque qu’on commença à tirer des archives où elles étaient restées, quelques-unes des grandes œuvres en basque encore inédites (Lizarraga, Gerriko, Agirre) et à les publier. Pour illustrer cette pré-Renaissance Basque, citons au moins quelques-uns des nomsclés qui ont marqué notre histoire au XIXème siècle: en premier lieu, les nobles figures d’Antoine d’Abbadie et de L.-L. Bonaparte, ainsi que celle, plus populaire, de J. M. Iparragirre.
|
|
Le palais d’Abbadie (Hendaye) : Antoine d’Abbadie (décédé en 1897), surnommé le "Père des Basques", fut un homme du monde qui, en tant que géographe, astronome et linguiste, jouit d’un grand prestige dans les cercles académiques français desquels il faisait partie. Explorateur et scientifique, il passa plusieurs années en Ethiopie et vécut également au Brésil. Ce savant fortuné élit domicile à Hendaye (Arragorria), dans ce palais construit pour lui par le célèbre Viollet-le-Duc (1862-1870). D’Abbadie fut l’un des rares Basques qui consacra sa fortune au mécénat en faveur de l’euskara. |
Antoine d’Abbadie (1810-1897), bien que né en Irlande, était fils de Souletin. Après de longs voyages de par le monde, il rentra au Pays et y vécut épris d’Euskal Herria et de l’euskara. D’Abbadie, estimé et admiré en France et en Europe, établit sa résidence à Hendaye. Il contribua avec générosité à faire refleurir la poésie basque, tant financièrement qu’en organisant des concours de poésie (1853), d’abord au nord des Pyrénées, puis des deux côtés. Tous les grands hommes de lettres de l’époque, Elizanburu, Etxahun, Arrese Beitia entre autres, puisèrent dans ces concours leur réussite et leur reconnaissance sociale.
A l’instar d’Abbadie qui avait parrainé la célébration de concours poétiques et littéraires, le Prince Louis-Lucien Bonaparte (titre de Prince accordé en tant que membre de la famille impériale) encouragea, par une œuvre plus discrète et de plus grande portée, les travaux d’investigation, de traduction et de recherche de matériaux. Nous devons à L.L. Bonaparte (1813-1891) les premières informations systématiques de la dialectologie basque. Loin de travailler seul pour son propre compte, il chercha à travers tout le Pays Basque les personnes susceptibles de lui fournir les informations dont il avait besoin. Auréolé du prestige social et économique dont il jouissait, il s’assura le concours de nombreux collaborateurs et fit paraître maintes publications. Quelques-unes des bases les plus solides de la bascologie allaient être posées grâce à Bonaparte qui, non seulement, avait une connaissance exceptionnelle de l’euskara, mais aima la langue basque et montra comment l’aimer.
Dans des perspectives différentes, d’Abbadie comme Bonaparte propagèrent l’amour de l’euskara et luttèrent pour sa réhabilitation sur le plan intellectuel et social, offrant de la sorte, d’une manière anticipée, une justification culturelle au futur nationalisme basque.
|
|
Carte des dialectes basques, de L.L.Bonaparte : En matière de dialectes basques, les premières descriptions systématiques sont dues à L.-L. Bonaparte. Ses cartes sont le fruit de plusieurs voyages (1856, 1857, 1866, 1867 et 1869), de nombreuses années de travail et de multiples collaborations. Bonaparte a joué un rôle éminent dans le développement de la bascologie en général, et de la dialectologie basque en particulier. Sur les 219 publications qu’il consacra aux langues européennes, 68 (31,05% du total) portent sur des textes basques. Le récent Congrès International de Dialectologie (octobre 1991) a été organisé, à l’initiative de la Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia, en hommage à l’œuvre bascologique de Bonaparte et pour commémorer le centenaire de sa mort. A cette occasion, un recueil intitulé Opera Omnia Vasconice (Bilbao: Euskaltzaindia, 1991. 4 vols.) a été édité. Cet ouvrage réunit tous les travaux que Bonaparte effectua personnellement, ou inspira à ses collaborateurs, à l’exception de quelques textes qui n’ont pas été retenus pour diverses raisons exposées dans la présentation. La commémoration de ce centenaire s’est également accompagnée d’un autre Congrès de Dialectologie (Université du Pays Basque) et de la parution de publications intéressantes pour les spécialistes de L.-L. Bonaparte comme, par exemple, GONZALEZ ECHEGARAY, C.; ARANA MARTIJA, J.A. (1989): Catálogo de los manuscritos reunidos por el Príncipe Luis-Luciano Bonaparte que se hallan en el País Vasco, et ARANA MARTIJA, J.A. (1991): "Bibliografía bonapartiana", in: Euskera, 1991, XXXVI, 127-297. |
|
|
J. Iturralde y Suit (1840-1909) : Historien, écrivain et peintre, ce Navarrais s’efforça à partir de 1868 de regrouper, organiser et renforcer le mouvement euskariste de Navarre. On peut dire que l’"Asociación Eúskara de Navarra" naquit sous le toit d’Iturralde y Suit. Il garda toujours à l’esprit l’ensemble formé par tous les territoires basques et, l’année même de la perte des Fors, il écrivait à Campion alors âgé de vingt-deux ans que la langue d’un peuple était la manifestation la plus significative de son génie propre et spontané. |
Dans la période qui s’étend de la dernière guerre carliste à la guerre civile, la société basque vécut des années de croissance et de remodelage économique et social. En matière d’économie et de démographie, tensions, déséquilibres et rééquilibrages se succédèrent.
|
|
Arturo Kanpion (1854-1937) : Cet écrivain navarrais fut le pilier culturel de la Renaissance Basque. Au centre de ses préoccupations figuraient l’histoire de la Navarre, les institutions basques et leurs droits politiques, mais c’est surtout à la défense de l’euskara qu’il se consacra. Il diffusa son message de jeunesse dans la Revista Eúskara de Pampelune. Sa première grande œuvre en faveur du basque fut la Gramática de los cuatro dialectos (1884) qu’il préfaça par quelques pages vibrantes où, aujourd’hui encore, transparaît l’âme passionnée du polygraphe navarrais. |
L’euskara, comme n’importe quelle langue dans de semblables circonstances, se vit appelé à remplir des fonctions sociales qui n’existaient pas au sein de la collectivité formée par l’ancienne population: en effet, en plus de la révolution industrielle, le Pays Basque dut subir une révolution démographique qui, inmanquablement, affecta le rapport de forces interlinguistique. Pour mieux comprendre tout cela, nous avons réuni ci-après quelques témoignages et données statistiques de l’époque, car nous pensons que la connaissance de ce passé récent n’est pas inutile pour aborder la normalisation future de la langue basque.
|
|
Manterola (1849-1884), Broussain (1859-1921) : José María Manterola, originaire de Saint-Sébastien, eut l’habileté de réunir autour de lui les Basques les plus courageux et, avec eux, de mener à bien une entreprise culturelle féconde: le fruit de son travail et son moyen d’expression fut la revue Euskal-Erria (1880-1918). — Dans la partie nord-pyrénéenne, Broussain exprima très tôt son désir de voir les deux Pays Basques, nord et sud, poursuivre un projet d’avenir commun et en fit part à Azkue dans une longue lettre. Amoureux du basque avant tout, il désirait ardemment l’unification de la langue au-dessus des dialectes et appela de ses vœux la création d’institutions linguistiques, de l’école basque... Tels étaient les espaces de modernité que Broussain souhaitait pour l’euskara. |
On appelle Renaissance Basque (Eusko Pizkundea) le mouvement socio-culturel qui s’est développé entre la dernière guerre carliste (1876) et la guerre civile (1936): cela recouvre soixante ans d’histoire et l’œuvre de deux générations déterminées à trouver une solution à la crise aiguë que traversait le Pays Basque.
Avec la perte des derniers Fors comme conséquence des guerres carlistes, le Pays Basque se retrouva face à une période de réflexion et de travail consacrée à préserver son identité nationale. Cette conjoncture permit aussi d’éclairer la conscience linguistique étant donné que la langue, l’euskara, constituait bel et bien un riche patrimoine à la disposition ou, virtuellement, à la portée de tous. Ainsi, dans le climat de crise qui suivit la guerre, on reconnut la dimension nationale de la langue considérée comme un moyen de sauvegarder la personnalité du peuple basque.
Dans la lignée des précurseurs de la période précédente (1839-1876) (Iztueta, Iparragirre, d’Abbadie, Bonaparte...) et pour faire face aux attaques politiques extérieures comme à l’avalanche d’immigrants, projets et activités nouvelles virent le jour, surtout au sud des Pyrénées: revues culturelles et groupes de travail, fêtes basques et jeux floraux en relation avec la langue (Elizondo, 1879; Durango, 1886), journaux et publications populaires, etc. Dans la zone sous administration française, pourtant en proie aux luttes idéologiques consécutives à la politique post-révolutionnaire, les publications d’expression euskarienne -à partir de postulats plus traditionnalistes- jouèrent également un rôle dans le débat social de l’époque.
Même si les grandes fortunes restaient en marge du mouvement, petit à petit des personnalités prestigieuses du monde culturel firent entendre leur voix ou prirent la plume: à Pampelune et Bilbao tout d’abord, à Saint-Sébastien et Vitoria peu après. Le terrain était donc préparé pour le mouvement "abertzale" sur le point de naître. C’est dans ces années-là (1876-1890) que le nationalisme linguistique trouva sa formulation définitive et que S. Arana l’intégra à son projet politique.
Les efforts culturels et politiques en faveur de la langue devenaient de plus en plus manifestes, la moindre occasion étant mise à profit pour inclure la revendication linguistique dans le programme des campagnes et partis politiques. Bientôt, le mouvement euskariste réalisa qu’il était indispensable de doter l’euskara d’institutions et d’assurer l’unité linguistique de tout le Pays Basque, si l’on voulait vraiment faire revivre une langue à ce point maltraitée.
Il ne fut pas facile de réunir toutes les forces d’Euskal Herria. À plusieurs reprises, le dialogue entre le nord et le sud du Pays se révéla même impossible (1901-1902). Mais, en réponse à l’appel lancé par les députations, le Congrès d’Oñati (1918) trouva finalement une voie qui, au-delà des actions individuelles et privées forcément limitées, allait aboutir à la création d’une institution publique chargée de veiller sur l’euskara: Euskaltzaindia, l’Académie de la Langue Basque (1919).
Sur le plan social, tous ces efforts permirent à l’euskarisme de connaître une relative prospérité dans les années 1927-37. Les succès obtenus, quoique modestes, n’en étaient pas moins significatifs: premières tentatives d’école basque, redécouverte du bertsolarisme, production littéraire accrue, développement du mouvement associatif autour de la langue basque, etc.
|
|
Sabino Arana Goiri (1865-1903) : Sabino Arana fut le principal instigateur du nationalisme basque. La langue occupa une place de choix dans son projet politique et, dans le premier article qu’il publia (Euskal-Erria, 1886), il parlait déjà de la valeur nationale de l’idiome. Comme le montrent ses œuvres complètes, Arana écrivit nombre de textes dans lesquels il tenta de donner à l’euskara plus de dignité et une plus grande place au sein de la société. Au-delà du rôle qu’il joua personnellement, par ses idées et son action, nous devons aussi à Arana, en toute justice, tout ce que ses nombreux partisans ont fait pour la cause basque dans le domaine politique. |
En raison de la nature de la tâche même à accomplir, la nécessité s’imposa, toujours plus évidente, de conjuguer ses efforts et de créer des institutions, comme celles que nous verrons plus loin, destinées à assurer une plus grande protection du basque. Grandes étaient les espérances à cet égard quand, soudain, la nuit de la guerre civile plongea toute la Péninsule dans l’obscurité.
|
|
Grammaire (1884) et littérature (1896) : A l’instar de Larramendi qui, au XVIIIème siècle, avait défendu l’idée d’un euskara culte et écrit, Campión, au sein de la Renaissance Basque, prenant conscience de la dimension nationale de la langue, offrit à tous les bascophiles du Pays une grammaire complète du basque: Gramática de los cuatro dialectos literarios de la Lengua Eúskara (Tolosa, 1884). Par ailleurs, Campión utilisa le conte et le roman pour mettre en évidence les dommages causés à l’euskara par le système scolaire de la même façon que Kardaberaz avait dénoncé, dans son livre de rhétorique, les effets de l’école castillane: Blancos y Negros (roman écrit en 1896). |
Il faut voir dans la valorisation nationale de la langue basque une réaction à des circonstances socio-culturelles et politiques bien définies, en phase avec les divers types de nationalisme et de patriotisme existant à l’époque en Espagne et en Europe. Un Basque d’alors, de la Génération littéraire espagnole de 1898, Miguel de Unamuno devait écrire de sa langue castillanne: "Le sang de mon esprit est ma langue / et ma patrie est là où résonne / souverain son verbe".
La perte des Fors, survenue après la dernière guerre carliste, aggrava le problème de l’identité basque chez ceux qui se préoccupaient de l’avenir du Pays, lesquels finirent par comprendre que ladite identité pouvait se définir à partir de la langue: le fait que l’euskara eût survécu à la disparition des institutions basques montrait bien que la langue était quelque chose de beaucoup plus consistant et persistant, quelque chose que ne pouvaient effacer, malgré la crise sociolinguistique traversée, ni les changements politiques ni les armes, du moins à court terme.
|
|
Euskal-Esnalea (1907-1908) : Durant la Renaissance Basque, les revues du Pays accomplirent inlassablement la mission consistant à réveiller la conscience linguistique du public basque. Certaines d’entre elles, dès les premières pages de leur numéro un, affichaient clairement leurs objectifs euskaristes. Euskal-Esnalea (= Le réveil basque) en est un bon exemple (Tolosa, 1908). |
Si nous prenons en compte l’origine des pionniers de ce nationalisme linguistique, il s’avère que, derrière une motivation politique générale, pointait une autre motivation d’ordre géolinguistique: celle d’une Navarre qui, avec la perte de ses institutions, était en train de perdre son identité linguistique. En effet, la lente agonie de l’euskara avait commencé en Navarre où le basque cédait du terrain chaque année, lorsque le recul s’accéléra brusquement au XIXème siècle. Aussi n’est-il pas surprenant que les plus ardents défenseurs de cette nouvelle interprétation de l’identité basque se soient manifestés précisément en Navarre.
Arturo Campión peut être considéré comme le père de cette idée nationale et linguistique, car nous lui devons de l’avoir formulée, si tôt et de façon si novatrice, tout en la replaçant dans un contexte culturel beaucoup plus vaste. La Gramática de Campión (1884) n’a pas la même signification que les travaux scientifiques aseptisés de Bonaparte ou la grammaire de Van Eys (1879): l’ouvrage grammatical de Campión est essentiellement conçu pour sauver la langue d’un peuple et affermir sa personnalité. La dimension nationale de la langue basque et les conséquences politiques d’une telle optique sont clairement inscrites dans les propos de Campión: l’euskara était une valeur inaliénable du peuple basque.
Cette idée fit son chemin dans la société sous plusieurs formes: les travaux littéraires et l’essai socio-politique, qui virent le jour grâce à la presse et à l’édition de revues et de livres; le soutien aux structures sociales par la création et le financement d’associations euskaristes; l’action politique visant à obtenir pour la langue basque, par l’intermédiaire des partis nationalistes, la protection officielle des institutions.
La réflexion sur l’"agonie", ce mouvement de pensée de l’après-guerre carliste, décrivit et dénonça les injustices dont était victime l’euskara. À cet effet, Campión eut recours aussi bien à l’essai qu’à la narration comme on peut le constater dans des pièces telles que "El último tamborilero de Erraondo", ou dans les pages de Blancos y Negros, en la personne de Martinico. En outre, les publications de l’époque laissent apparaître, dès les premiers numéros, la même doléance sociolinguistique de la part des écrivains.
Le passage à l’étape suivante se fit tout naturellement. Avec l’émergence du parti nationaliste basque (1894), les différents courants euskaristes disposèrent d’un moyen d’expression politique plus opératif. Ils purent ainsi formuler leurs idées de manière plus explicite, sous une forme politique structurée et efficace. La conscience linguistique du Pays Basque parvint alors à un carrefour de son histoire.
Au cours des années qui suivirent, les efforts déployés allaient s’orienter dans cette nouvelle direction. L’idéologie euskariste se répandit, son unité se renforça et les initiatives se multiplièrent. La bascologie, dans sa dimension sociale, trouva également à cette époque les nouveaux guides dont elle avait besoin.
Qu’il s’agît d’intellectuels intervenant à titre individuel ou de groupes de travail œuvrant de concert, le réseau de solidarité pour défendre la langue se densifia. Le Pays Basque, complètement désorienté en 1876, put enfin se retrouver dans des tâches de redressement culturel et redéfinir de nouveaux objectifs communs. Enfin, les valeurs symboliques et sociales de la langue furent réaffirmées et les minorités dirigeantes les gardèrent à l’esprit.
L’euskara, langue nationale
1884
{L’euskara} est le vivant témoin qui fait foi
de notre indépendance nationale jamais
asservie. C’est la racine qui dessine nos
traits et nous distingue des autres, c’est ce
qui fait obstacle à notre complète
assimilation, assimilation si longtemps
recherchée à laquelle on veut nous
contraindre par des moyens détournés
Arturo CAMPION 1884
Il n’y a au monde, j’en suis certain,
de peuple meilleur que celui-ci; aussi,
conservons intacte, la loi de la mère
euskarienne. (...)
Souvenons-nous du doux euskara sans égal
sur la terre, pour continuer, dans le futur, à
être admirés par les étrangers.
Jose MANTEROLA
Extrait du poème “Post Tenebras”
1886
L’euskara est donc l’élément essentiel de
la nation euskarienne; sans lui, les institutions
nationales sont inconcevables. La disparition
de l’euskara causerait irrémédiablement la
ruine de cette nation. (...). Et si nous
n’employons pas toutes nos forces à temps
pour préserver notre patrie d’une fin aussi
funeste, sa causalité est inévitable. (...). Si
l’euskara disparaît, nous ne pourrons plus le
ressusciter; en revanche, tant qu’il existe,
nous pouvons le développer et le répandre (...).
S. ARANA GOIRI
1897
En attendant l’époque bénie où les Basques
jouiront enfin de l’existence nationale à
laquelle ils ont droit par leur langue, leur
race et leurs traditions historiques, en
attendant cet avenir idéal continuez à
travailler. [...]. Il faudra se remuer
beaucoup, faire de nombreuses démarches
avant de réveiller les bonnes volontés
endormies et de susciter un élan de
patriotisme basque. [...]. Pour que nous
puissions obtenir le concours de tous les
Basques qui aiment leur langue nationale,
Travaillons d’abord à répandre l’amour de
l’euskara.
Pierre BROUSSAIN
Vers 1857, à la veille de la révolution industrielle, Hegoalde traversa un moment crucial du point de vue démographique, c’est-à-dire que sa population se mit à croître suivant un taux caractéristique d’une démographie moderne. De ce fait, la partie sud-pyrénéenne d’Euskal Herria passa de 754.883 habitants (1877) à 2.343.503 (1970). Cependant, le rythme et les étapes de cette croissance ne furent pas les mêmes partout et, comme on peut s’en douter, cette évolution eut des conséquences directes sur la répartition de la population bascophone.
|
|
La sectorisation de la population : La révolution démographique entraîna non seulement un accroissement quantitatif, mais aussi un changement des activités de la population. En un siècle et demi, la répartition par secteurs d’activités évolua considérablement, cette évolution se produisant à des dates et à un rythme variables selon la province considérée. En ce qui concerne le secteur primaire par exemple, la courbe de la Navarre et celle des Provinces "Vascongadas" ont, dans un premier temps (1860-1930), divergé pour ensuite converger (1940-1985). Tandis que ces transformations avaient lieu, la langue de la communauté basque, l’euskara, assumait de nouvelles fonctions sociales ou, au contraire, cessait d’en exercer. |
A cet égard, les quatre provinces basques sud-pyrénéennes se répartissent en groupes de deux: d’un côté Biscaye et Gipuzkoa, de l’autre Alava et Navarre. Le développement démographique commença en Biscaye, le rythme de croissance ne s’accélérant en Gipuzkoa qu’à partir de 1900. À l’évidence, de telles transformations sont intimement liées au développement économique de ces deux provinces. À l’opposé, en Alava et en Navarre, la croissance démographique fut freinée par la survivance du système agraire traditionnel -encore prépondérant à l’époque- qui poussa une partie de l’excédent de population à émigrer vers les zones côtières des deux autres provinces. Nous pourrions résumer l’évolution démographique du Pays Basque au cours de la première révolution industrielle par les chiffres suivants: Dans ce tableau, nous constatons qu’en cinquante ans, la population de Biscaye a plus que doublé, tandis que celle de Gipuzkoa a connu un taux de croissance élevé et constant. À l’inverse, la province d’Alava s’est même dépeuplée à un moment, et la population de Navarre s’est maintenue avec difficulté. De fait, la révolution industrielle et démographique ne se produira que beaucoup plus tard dans ces deux dernières provinces (surtout à partir de 1950).
| ANNE | BISCAYE | GIPUZKOA | ALAVA | NAVARRE |
| 1857 | 160.579 | 156.494 | 96.398 | 297.422 |
| 1877 | 189.954 | 167.207 | 93.538 | 304.184 |
| 1897 | 290.665 | 191.822 | 94.622 | 302.978 |
| 1910 | 349.923 | 226.684 | 97.181 | 312.235 |
Outre l’accroissement numérique, la population commença aussi à évoluer en termes de mode de vie et d’activité, passant fondamentalement du monde de l’agriculture et de la pêche à celui de l’industrie et, plus tard, des services. À mesure que s’opérait ce changement socio-économique, la langue basque exerça de nouvelles fonctions et en abandonna d’autres, en gagnant et perdant les diverses opportunités du développement social des décennies suivantes. Cette transformation de la population active a eu une importance capitale, au moins aussi considérable que celle des vagues successives d’immigration. À l’époque, les villes basques accueillaient chaque jour de nouveaux habitants qui venaient aussi bien des alentours que de toutes les régions d’Espagne: entre 1857 et 1930, la population de Bilbao, par exemple, passa de 18.000 à 83.000 âmes, les villes minières et industrielles suivant la même évolution.
|
|
Appel du large et diaspora : Voici une photographie prise dans une maison d’Elizondo (1924) qui pourrait parfaitement symboliser l’émigration basque des années précédentes. Les numéros 1-2-3 vivaient dans la maison d’origine avec leur fils (9): il s’agissait du vieux etxeko jaun et du jeune couple. Tous les autres avaient émigré: 4. A Puebla (Mexique). 5. L’épouse mexicaine du précédent. 6. A Vitoria. 7. A Glasgow (Montana, Etats-Unis). 8. A Ciboure (Labourd). 10. A Toronto (Canada). 11. A Azopardo (Argentine). 12. En Argentine. Source: DOUGLAS, W.A.; BILBAO, J. (1986): Amerikanuak. Los vascos en el Nuevo Mundo. UPV/EHU. Bilbao. |
Dans le même temps, les zones rurales ne pouvaient retenir leurs habitants, ce qui provoqua un grand mouvement d’émigration, vers l’Amérique principalement. Au nord des Pyrénées, le Nouveau Monde fut d’ailleurs la seule destination des émigrants: entre 1832 et 1891, quelque 80.000 Basques traversèrent ainsi l’Atlantique. Sur l’ensemble du Pays Basque, on estime à environ 200.000 le nombre de personnes qui émigrèrent en Amérique.
|
|
Victor Hugo parmi les Basques (1843) : Après un court séjour alors qu’il était enfant (1811), Victor Hugo visita à nouveau le Pays Basque à l’âge de 41 ans. A cette occasion, il se rendit compte de l’attachement si profond des gens à communiquer dans leur propre langue et combien il était facile de gagner la sympathie des habitants en prononçant quelques mots en basque.Le vieux vocable «Navarre» est plus qu’un simple mot. Ici on naît basque, on parle basque, on vit en basque et c’est en basque qu’on meurt. La langue basque est une patrie, presque une religion, allais-je dire, écrivit Victor Hugo en découvrant cette réalité du Pays. |
Beaucoup de ces émigrants venaient de villages ou de bourgs bascophones dont la population se trouva donc réduite d’autant: Etxalar (Navarre) passa de 1.724 habitants en 1824 à 1.397 en 1905; de même, Murelaga (Biscaye) perdit 303 habitants en soixante ans (1860-1920). La crise agricole, un développement capitaliste irrespectueux du milieu naturel et culturel ambiant, la mise en place d’institutions et l’instauration d’une culture et d’une langue étrangères, telles sont quelques-unes des raisons évoquées pour expliquer l’émigration dans ces petites communautés rurales. Ces chiffres, ainsi que d’autres informations du même type, laissent présager des conséquences que le changement démographique allait avoir sur la démolinguistique. Cet accroissement de la population changea, au détriment de l’euskara, le rapport de forces entre bascophones et hispanophones, et ce pour les raisons suivantes:
• Il était impossible d’euskariser les immigrants étrangers, du moins dans le contexte socio-culturel créé par le système en vigueur. • Au même moment, les zones bascophones du Pays Basque connurent un phénomène d’émigration et l’euskara perdit de la sorte un nombre non déterminé de locuteurs.
• Avec la révolution industrielle, la population bascophone s’établit dans des centres urbains de plus en plus grands et hispanisés ou francisés. • Comme conséquence de l’évolution démographique, la frontière entre euskara et castillan s’estompa au Pays Basque, lequel commença à s’hispaniser de l’intérieur. Tous ces facteurs conjugués provoquèrent une chute de la proportion de bascophones par rapport à la population totale: de 52% (Velasco, 1879) à 20,05% (Yrizar, 1973).
Avant la révolution industrielle et démographique, dans les années 1866-1868, L. Velasco, après avoir consulté les informations fournies par d’autres auteurs, fit une estimation de la population du Pays Basque et du nombre de bascophones (voir le tableau ci-joint). Ces chiffres peuvent être considérés comme une des données statistiques les plus sûres de l’époque. La Vasconie dont les données nous sont décrites par territoire, est bien différenciée. Iparralde/Gipuzkoa/Biscaye présentaient une population bascophone très élevée (globalement 82,73 % de la population total était euskarophone); d’autre part, en Navarre, et plus encore en Alava, les bascophones n’étaient déjà plus qu’une minorité (19,98% et 9,59% de leurs populations respectivement). Ces pourcentages reflètent les pertes subies, principalement au XVIIIème siècle en Alava, et dans la première moitié du XIXème siècle en Navarre.
|
La population bascophone (1866-1868) : Les statistiques fournies par l’Alavais Ladislao Velasco (1817-1891) constituent les données les plus dignes de foi dont nous disposions en ce qui concerne le nombre de locuteurs basques au siècle dernier. Il est intéressant de remarquer que, dans l’ensemble Iparralde-Biscaye-Guipuzcoa, 82,73% de la population en moyenne était bascophone. Source: VELASCO, N. (1879): Los Euskaros en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Barcelone. Pages 479-490. ALTADILL, J. (1918): "Provincia de Navarra", in: Geogr. Gen. del País Vasco-Navarro. Barcelone. Page 13. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dès lors, pour savoir ce qui s’est passé au cours du siècle et quart écoulé, il suffit de comparer ces chiffres avec ceux présentés dans la première partie de ce livre. Encore ne faut-il pas oublier que, à la différence de la grande majorité des Basques du XIXème siècle, le Basque actuel est bilingue, c’est donc un bascophone qui connaît aussi le castillan ou le français, alors que le terme d’hispanophones ne recouvre généralement que des unilingues. À cet égard, la situation au siècle dernier était complètement différente. L. Velasco fit quelques remarques importantes au sujet de ces statistiques. Voici, reproduites littéralement, celles qui concernent la situation sociolinguistique en Gipuzkoa: "La langue du peuple est le basque, et les classes supérieures du pays, qui vivent dans les capitales de province et les villes importantes, le parlent aussi, sans toutefois l’utiliser systématiquement dans la vie courante. Sur les 176.297 âmes que comptait la population de Gipuzkoa au moment du recensement, je crois pouvoir dire sans trop me tromper, de par les informations dont je dispose, que 170.000 parlaient le basque et que, parmi ces bascophones, 140.000 faisaient de cette langue un usage exclusif dans leur vie quotidienne".
|
L’évolution de la bascophonie au sud des Pyrénées (1863-1936) : En dépit de certaines contradictions évidentes (en particulier, les chiffres correspondant à 1863 et 1868), les données présentées dans ce tableau sont, d’une façon générale, assez intéressantes pour avoir une idée approximative de l’évolution de la population bascophone au siècle dernier. Ces statistiques proviennent de sources diverses et ont été recueillies par l’auteur de l’ouvrage cité en référence.Source: BELTZA (1978): Del Carlismo al nacionalismo burgués. Saint-Sébastien: Txertoa. Page 141. |
||||||||||||||||||||||||
Il convient de retenir plus particulièrement le commentaire que fait Velasco, à partir des chiffres bruts, sur le choix linguistique dans les couches supérieures de la société, à savoir que l’euskara était également parlé par les personnes aisées des villes et des bourgs, bien que pas toujours utilisé. Par la suite, ces classes sociales allaient modifier leurs habitudes linguistiques.
|
|
Revista Eúskara (Pampelune,1877), Euskal-Erria (Saint-Sébastien, 1880) : Voici deux publications de la Renaissance Basque qui, malgré leurs objectifs communs, suivirent des parcours très différents. La première vit le jour à Pampelune et ne dura pas longtemps, moins longtemps encore que le groupe qui l’anima. C’est l’un des pères de la Revista Eúskara, Iturralde y Suit, qui dessina la couverture d’Euskal-Erria que cette revue de Saint-Sébastien offrit à ses souscripteurs à l’occasion de son premier anniversaire. Cette couverture symbolise l’union des deux centres culturels basques de l’époque, Pampelune et Saint-Sébastien. Manterola, directeur de la revue, y ajouta un commentaire politique dans lequel l’euskara était reconnu comme le lien de l’unité du Pays Basque. |
Pour la société basque, les pertes subies en 1876 eurent l’effet cuisant d’un aiguillon: tout était à recommencer! Une fois les "Fueros" perdus, des personnalités se regroupèrent aux quatre coins du Pays pour accomplir un effort de réflexion collective. Les esprits les plus lucides des Provinces "Vascongadas" et de Navarre prirent part au débat qui s’imposait en période de crise. Fuyant la censure instaurée dans les provinces basques, ils commencèrent par se réunir à Madrid, autour de La Paz (1876-1878). Plus tard, ce sont les journaux des quatre capitales basques qui s’efforcèrent de donner une vision moins conflictuelle de la situation, et de diffuser les idées nouvelles qui permettraient d’aller de l’avant. À l’avant-garde du mouvement, la Revista Eúskara de Navarre (1877-1883) se distingua immédiatement, y compris par ses positions en faveur de la langue basque. Les plus prestigieux écrivains navarrais participèrent activement à la revue, ainsi qu’à l’association qui la protégeait : Campión, Iturralde, Arantzadi, Oloriz, Landa, Obanos, etc.
|
Chantre de l’euskara (Arrese Beitia: poème, 1879) : Peu de textes littéraires nous offrent un témoignage plus vivant de l’euskarisme d’alors que ce poème d’Arrese Beitia (1841-1906) qui, de nos jours, peut sembler sans doute romantique à l’excès, mais traduit bien le sentiment d’agonie éprouvé à l’époque. D’ailleurs, Campión loua avec passion l’œuvre d’Arrese Beitia (1900). |
Des groupes similaires apparurent aussi en dehors de Pampelune et de la Navarre. Comme dans l’ancien royaume, ce sont les revues et les associations culturelles gravitant autour d’elles qui allaient jouer le rôle de points de ralliement. En 1879, Herrán fit paraître la Revista de las Provincias Eúskaras à laquelle collaborèrent, entre autres, Becerro de Bengoa, Apraiz et Baraibar. Par ailleurs, le jeune Manterola lança à Saint-Sébastien Euskal-Erria, revue dont la parution et les travaux allaient être les plus durables (1880-1918), puisqu’elle survécut même à son fondateur disparu en 1884. À Bilbao, la Revista de Vizcaya (1885-1889) refléta les idées et aspirations contradictoires de la société biscaïenne, mais dans une perspective nettement moins euskariste.
Pendant presque quarante ans, il incomba à la Revista Eúskara navarraise d’abord, puis à Euskal-Erria de Saint- Sébastien de conduire, avec la plus grande détermination, la défense des valeurs et des particularités de l’identité culturelle basque et, en premier lieu, de l’euskara. Si, en Navarre, cette attitude répondait à une préoccupation essentiellement théorique, à Saint-Sébastien, elle trouva son expression dans une pratique résolue et des actions concrètes sur le plan social.
A la même époque, au nord des Pyrénées, l’euskarisme suivit d’autres chemins, notamment celui de la résistance aux projets laïques de la IIIème République. L’hebdomadaire Eskualduna (1877), marqué au sceau d’un militantisme passionné, gagna un public de lecteurs nombreux et fidèles, et s’érigea en héraut du conservatisme face à l’obstination radicale et en porte-drapeau de la justice contre l’arbitraire républicain qui menaçait l’euskara (1902).
|
|
Eskualduna (1887) : Cet hebdomadaire de Bayonne connut, en considération du public basque potentiel, un succès phénoménal dès les premières années de sa parution, comme le prouve le nombre, très important pour l’époque, de lecteurs abonnés: 850 (1889), 1.200 (1890), 1.300 (1891), 5.000 (1905), 7.000 (1908), etc. Cela permit à la revue de faire prendre de nouvelles habitudes de lecture aux Basques du nord. Euskalzale (1897-1889) : La revue Euskalzale publiée par Azkue pourrait se définir comme une tentative de vulgarisation des problèmes linguistiques, alors qu’Eskualduna se situerait plutôt au niveau de l’information générale. A travers cette revue illustrée, Azkue, en plus de ses recherches, s’occupa de diffusion culturelle. |
|
|
|
Ce combat, de caractère et d’inspiration sans doute trop traditionalistes, fut néanmoins repris par des personnalités plus jeunes et plus modernes au nombre desquelles était Broussain, écrivain et médecin d’Hasparren. Les idées nouvelles du sud ayant à l’évidence traversé les Pyrénées, la revendication linguistique occupa, cette fois encore, le premier plan du projet linguistique de Broussain. Celui-ci noua d’étroites relations avec Arana tout comme avec Azkue, et exprima à plusieurs reprises son intérêt idéologique et politique pour l’unité de l’euskara et du Pays Basque. Mais le courant de modernité passait également dans l’autre sens, c’est-à-dire du nord au sud. Sous l’influence d’Iparralde, diverses manifestations populaires en faveur de la langue basque (Elizondo, 1879) commencèrent à se tenir dans la partie sud-pyrénéenne. Les villages d’Hegoalde voulaient renouveler l’effort accompli par d’Abbadie, quelque trente ans plus tôt, au nord des Pyrénées. Dans certains cas (comme à Durango en 1886), ces jeux floraux eurent un retentissement considérable et fournirent l’occasion à la société basque d’apporter son soutien aux nouveaux projets culturels.
Les années 1876-1900 donnèrent lieu à un grand renouveau de la valorisation de la langue au niveau idéologique, mais moins sensible sur le plan social et pratique. Dès lors, les euskaristes utilisèrent des prémisses qui leur permirent de développer des argumentations plus élaborées. Ce fut une époque riche en projets et travaux de toutes sortes, trop riche pour être résumée ici.
|
|
Les Fêtes d’Elizondo (1879) : Les premiers jeux floraux célébrés au sud des Pyrénées eurent lieu dans ce village. Les festivités furent organisées conjointement par d’Abbadie, représentant Iparralde, et l’"Association Euskarienne" de Navarre. Le premier prix fut attribué à Arrese Beitia pour son poème "Le dernier adieu à notre mère, l’euskara" après tirage au sort pour le départager d’Iparragirre. |
|
|
Euskara (1886-1896) : La revue portait en sous-titre "Organ für die Interessen der Baskischen Gesellschaft", car il s’agissait d’une publication allemande créée et animée à Berlin. Avant l’apparition de la RIEB au Pays Basque, ce fut la première revue consacrée à la bascologie, ainsi que l’organe d’une certaine "Association Basque". Parmi les collaborateurs de cette revue, figurent des personnalités aussi célèbres que K. Hannemenn, Th. Linschmann, Van Eys, Vinson, Bonaparte. |
A mesure que les années passaient, la distance entre le monde du savoir et la langue populaire, dont l’ennoblissement était une conséquence des travaux de quelques chercheurs, diminua sensiblement au sein de la Renaissance Basque: en somme, la science et le mouvement linguistique et social progressaient ensemble en s’aidant mutuellement. C’est pourquoi, parmi les actions entreprises à cette époque en faveur de la langue, il ne faut pas oublier, à côté des livres, publications et autres revues, les manifestations populaires célébrées à la gloire de l’euskara. Conscients du fait que la langue qu’ils voulaient promouvoir était celle des plus humbles, et que l’adhésion du bascophone moyen était décisive, les bascophiles surent organiser toutes sortes de fêtes pour unir leurs compatriotes autour de l’euskara: concours de bertsolaris, journées de poésie, jours de l’euskara, concours et prix divers tant officiels que privés... Il suffit de voir les travaux d’Abbadie, Campión, Manterola, Aitzol ou Lizardi pour se rendre compte de l’œuvre réalisée de village en village durant cette renaissance culturelle. Dans ce contexte, nous pouvons aussi évoquer la figure de Gregorio Mujika (1882-1931) qui mérite d’être cité pour l’action qu’il mena en faveur de l’euskara dans le cadre de revues et d’activités populaires, et pour le rôle qu’il joua comme orateur et journaliste prompt à encourager et exalter sans relâche la fidélité à la langue. À ce titre, Mujika fut un exemple mémorable. Tous voulurent rehausser le prestige social du basque en comptant sur la sensibilité et l’adhésion de la population, par des actions culturelles empreintes de dignité et de solennité.
|
|
J. Hiriart-Urruty (1859-1915) : Ce journaliste habile et impétueux exerça ses talents à l’occasion des débats et conflits qui éclatèrent en France, dans la première partie (1870-1914) de la IIIème République, entre l’Eglise et l’Etat. Bien que fidèle à ses idées extrêmement conservatrices, il écrivit de belles pages pour défendre l’euskara comme ce "Dugun atxik eskuara" (=Maintenons l’euskara) adressé à l’assemblée diocésaine de Bayonne (1909). |
|
|
Les Jeux Floraux de Durango (1886) : Durango occupe une place privilégiée dans la culture basque. A cet égard, quelques faits méritent d’être rappelés: Kapanaga (+ 1661) y enseigna comme professeur de grammaire; Artzadun, auteur d’un catéchisme (1713) fut le curé de la ville; c’est à Durango que fut édité pour la première fois Peru Abarka (1881); enfin, l’apologiste Astarloa (1752-1805) et son homonyme franciscain (1751-1821) étaient originaires de Durango. Les jeux floraux qui y furent organisés en 1886 reprenaient, sous une forme à la fois culte et populaire, une tradition euskarienne. Ci-dessus: sceau des Jeux Floraux de Durango. |
Par ailleurs, ce sont précisément les revues créées autour du thème central d’Euskal Herria qui eurent la plus grande importance au sein de la Renaissance Basque même si, à leurs débuts, la majorité de ces publications étaient rédigées en castillan. Nous en avons déjà mentionné quelques-unes auxquelles il faut ajouter, pour la partie nord-pyrénéenne, Ariel.·Uscal Herrico Gaseta (publié par l’écrivain A. Chaho, 1848) qui fut le premier journal périodique basque, ainsi que, au sud des Pyrénées, Euskal-Esnalea (1908) et surtout Argia (1921-1936) qui jouit d’une grande diffusion sous la République. C’est dans les pages d’Argia que le journalisme d’Hegoalde s’exprima pour la première fois. Durant la période considérée, il est une autre tendance de l’activité éditoriale basque qui mérite une attention particulière: il s’agit des publications scientifiques relatives à l’euskara. Les revues de bascologie, non seulement au Pays Basque mais aussi à l’étranger, comblèrent un manque jusqu’alors chronique en relançant la recherche avec une méthodologie actualisée, en faisant connaître les progrès de la linguistique moderne et en les appliquant à l’euskara. Voici deux exemples de ce genre de publications: • La première est assez surprenante car elle parut en tant qu’ «Expression des intérêts de l’Association Basque» de Berlin ("Organ für die Interessen der Baskischen Gesellschaft"). Intitulée Euskara (1886-1896), elle vit le jour sous la direction de K. Hannemann et Th. Linschmann. Pendant les dix années de son existence, elle permit de réunir et de diffuser de nombreuses informations sur la langue basque.
• La seconde, appelée communément RIEB (=Revue Internationale d’Etudes Basques, 1907-1936) accomplit en trente ans un immense travail et ouvrit ses colonnes aux plus illustres bascologues. Cette œuvre véritablement internationale est une compilation de la première période de la bascologie, d’où l’importance qu’elle garde encore pour la recherche contemporaine. Rejoignant ceux qui agissaient au sein du peuple en respectant sa volonté, et tirant des livres et des revues les enseignements des spécialistes, les poètes et "bertsolaris" d’alors surent également communiquer la passion de l’euskara à travers leurs chants.
|
|
Julio Urquijo (1871-1950) : La tâche accomplie par Urquijo durant la Renaissance Basque était quelque chose de nouveau pour l’époque, les travaux qu’il rassembla ainsi que ses propres recherches constituant un magnifique patrimoine pour la bascologie future. Les aspects les plus importants de cette œuvre sont: la contribution scientifique de la RIEB, la publication d’auteurs anciens, l’incomparable bibliothèque d’Urquijo et la dimension internationale qu’il donna à la bascologie en utilisant ses relations personnelles et en ouvrant les colonnes de sa revue aux chercheurs étrangers. Grâce à Urquijo et à la RIEB, les scientifiques basques et non basques ont pu travailler en étroite collaboration. |
|
|
W.J. Van Eys (1825-1914) : Ce linguiste de profession naquit à Amsterdam et consacra la majeure partie de sa vie à l’étude de l’euskara. Il effectua deux voyages en Euskal Herria (en 1866 et 1868), mais n’y séjourna pas longtemps. Ses principaux travaux sont un dictionnaire (1873) et une grammaire comparée des dialectes basques (1879). En outre, Van Eys réédita quelques textes anciens. S. Arana avoua être l’un de ses disciples. |
|
|
H. Schuchardt (1842-1927) : C’est l’un des plus grands linguistes des XIXème et XXème siècles, dont la thèse portait sur le vocalisme du latin vulgaire. Professeur d’université à Leipzig, Halle et Graz, il s’intéressa plus spécialement aux langues romanes, mais aussi à l’influence latine sur les langues non romanes. Le basque attira son attention pour cette raison et, après un été passé à Sare (1887), il se consacra entièrement à l’étude de l’euskara. Le livre qu’il publia en 1893, sous le titre Baskische Studien, est l’une des pièces maîtresses de la linguistique basque. |
La Renaissance Basque s’intéressa au problème de la langue et de la société basques à travers divers types de publications: œuvres littéraires en castillan et en français en faveur du Pays Basque et de sa langue (contes, romans, poèmes, essais...), grammaires et dictionnaires destinés à l’enseignement de l’euskara, manuels scolaires, revues scientifiques, pièces de théâtre, bertso-paperak, etc. Tout cela fut la manifestation d’un mouvement social au sein duquel de nombreux euskaristes et bascologues travaillèrent avec acharnement sans compter des œuvres de nature et d’importance diverses.
Aussi, nous voudrions rendre hommage aux chercheurs de ces années-là. Quelques-uns étaient étrangers et, dans certains cas, ne séjournèrent que peu de temps au Pays Basque. Pourtant, ces bascologues éprouvèrent un véritable sentiment d’amour à l’égard de notre langue, qu’elle se manifestât sur les lèvres du peuple ou sous la plume des auteurs anciens. Grâce à eux, nous avons disposé de nouvelles éditions de très vieilles publications épuisées, parfois accompagnées de notes et de commentaires savants. De plus, ils firent publier des ouvrages encore inédits, protégeant et enrichissant de la sorte le patrimoine euskarien qui, en grande partie, était sur le point de disparaître.
Le souvenir de ceux qui menèrent à bien cette œuvre immense doit rester à jamais vivant parmi nous, c’est pourquoi nous souhaitons évoquer ici la mémoire des Anglais W. Webster (1828-1907) et E. S. Dogson (1857-1922); des Allemands qui, après le voyage effectué par W. von Humboldt (1767-1835) au début du XIXème siècle, vinrent au Pays Basque: V. Stempf (1841-1909), H. Schuchardt (1842- 1927) et G. Bähr (1900-1945); des Hollandais Van Eys (1825-1914) et Uhlenbeck (1866-1950); et des Français Vinson (1843-1926), Saroïhandy (1867-1932) et Hérelle (1848-1935). Certains d’entre eux, comme Schuchardt et Uhlenbeck, jouissaient d’une renommée mondiale. Leurs œuvres, outre qu’elles comblaient des lacunes impardonnables, donnèrent à la bascologie un droit de cité dans la communauté scientifique internationale, et ouvrirent la voie aux bascologues étrangers des années suivantes.
Cette énumération ne doit pas nous faire oublier la contribution de nos propres bascologues et, plus particulièrement, celle de deux d’entre eux: R. M. Azkue (1864-1951) de Lekeitio, et Julio Urquijo (1871-1950) de Deusto. Les noms de ces hommes remarquables resteront toujours gravés dans notre mémoire comme synonymes de toute une partie de la bascologie. Azkue était linguiste, folkloriste, compilateur et compositeur de musique, et montra un grand talent dans tous ces domaines. Nous lui devons une œuvre admirable dont ce sera bientôt le centenaire. En ce qui concerne l’euskara, il faut citer au moins deux œuvres historiques qui ont incontestablement marqué la bascologie moderne: le Diccionario Vasco-Español- Francés (1905-1906) et la Morfología Vasca (1923) qui constituent, jusqu’à présent, les ouvrages de référence de tous les bascologues.
|
|
R.M. Azkue (1864-1951) : Prêtre de son état, Azkue n’en voua pas moins sa vie à la langue basque. Après avoir obtenu la chaire d’euskara créée par la Députation de Biscaye à l’Institut de Bilbao, il se plongea entièrement dans la bascologie. Auteur de travaux de recherche et de vulgarisation, de grammaires et de précis, de recueils de textes populaires, il coopéra à l’école basque, à l’Académie —qu’il présida de la création de celle-ci jusqu’à sa mort (1919-1951)— et toucha pratiquement à tout... C’était un travailleur infatigable qui, grâce à sa santé de fer, accomplit une œuvre gigantesque et dont on a écrit qu’«il est, sans doute, l’homme à qui l’euskara doit le plus». |
L’œuvre d’Urquijo, en revanche, s’articula autour de la RIEB. La recherche bascologique doit à cette revue l’estime que lui porta, à partir des premières décennies de ce siècle, la communauté scientifique internationale. Pendant les trente années de son existence (1907-1936), la RIEB, ouverte à toutes les communications de qualité, joua le rôle d’un véritable forum international. Les institutions et la société basques se rendirent parfaitement compte de l’importance de cette publication scientifique dont ils firent, en 1922, l’organe de la Société d’Etudes Basques, bien que Julio Urquijo continuât à en assumer la direction. La bibliothèque personnelle d’Urquijo, d’une valeur inestimable, est une autre de ses œuvres. Constituée au prix de plusieurs années de recherche et grâce à l’aide financière de généreux bienfaiteurs, cette bibliothèque revint à la Députation de Gipuzkoa où tous les citoyens peuvent désormais la consulter.
Ces hommes qui, dans leur passion pour l’euskara, firent preuve d’une curiosité scientifique exemplaire et prirent le soin de se poser tant de questions sur son passé, se montrèrent parfois inquiets quant à l’avenir problématique de la langue basque. Certes, scientifiques, euskaristes et hommes politiques ne réussirent pas toujours à s’entendre et à collaborer de façon satisfaisante. Mais, en dépit des affrontements (entre Arana et Campión, Azkue et Arana, le carliste Urquijo et les nationalistes du PNB (Parti Nationaliste Basque), etc.), tous contribuèrent, consciemment ou inconsciemment, à jeter les bases sur lesquelles construire un avenir stable et prometteur, en oubliant les années d’égarement et de polémiques stériles.
C’est un peu ce qui se passa à Hendaye et Fontarabie en 1901-1902, par exemple, au cours des réunions convoquées dans le but d’unifier le basque écrit à partir de deux traditions littéraires jusque là nettement différenciées, celle du nord et celle du sud des Pyrénées. Les bascophiles -qu’ils fussent linguistes, écrivains, hommes politiques ou simples citoyens- étaient conscients de la précarité de la situation sociolinguistique en vigueur. Aussi, pouvait-on s’attendre raisonnablement à ce qu’un moyen de s’entendre se dégageât. Hélas, ces réunions échouèrent et, au lieu de l’unification espérée, provoquèrent une division qui ne disparut que dans les années 60: ceux d’Iparralde se regroupèrent dans Eskualtzaleen Biltzarra (1901), tandis que ceux d’Hegoalde se réunissaient autour d’Euskal-Esnalea (1907).
Dès lors, chaque groupe suivit sa propre voie vers l’unification, bien qu’à la naissance de l’Académie de la Langue Basque "Euskaltzaindia" (1919), ce fut cette dernière qui se chargea d’établir les règles à respecter. Au sein de la nouvelle institution, au statut officiel, recherche et mouvement euskariste allaient pouvoir coopérer.
Du fait des brusques changements sociaux dont nous avons parlé, quelques conflits linguistiques ne manquèrent pas d’éclater. Et, ces phénomènes sociolinguistiques firent naître, à leur tour, de nouvelles idées sur le problème de la langue. À mesure que les basques prenaient conscience de la dimension politique du rôle social joué par leur langue, et qu’ils formulaient des revendications dans ce sens, ceux qui détenaient le pouvoir ou aspiraient à l’occuper ne pouvaient plus ignorer cette donnée nouvelle.
|
|
Fontarabie (1902) : Les euskaristes des deux côtés des Pyrénées ont toujours ressenti la nécessité d’agir en accord et de surmonter les variantes locales de la langue basque. Mais, ce sentiment a connu des hauts et des bas, notamment au début du siècle. Par exemple, les réunions organisées à Hendaye (1901) et Fontarabie (1902) ne portèrent pas les fruits escomptés. Ci-dessus: panorama de Fontarabie et d’Hendaye à l’embouchure de la Bidassoa. |
Peu à peu, les partis politiques commencèrent à prendre en compte le problème dans leur programme, de sorte que le fait même de ne pas se prononcer apparut bientôt comme une prise de position. Inutile de dire que ce thème figurait en bonne place dans le programme des partis nationalistes. Leur souci majeur consista à définir, en termes politiques, les relations qui devaient exister entre la langue et le système éducatif. Naturellement, le monde de la communication de l’époque n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui et le débat, dans les médias basques, n’eut pas le retentissement que nous lui avons connu par la suite. En revanche, les revendications émanant des structures officielles, comme l’administration ou les services publics, attirèrent toute l’attention du monde politique.
Tant le Gipuzkoan Iztueta que le biscaïen Arrese (1879) et l’alavais Becerro de Bengoa voyaient le futur des "Fueros" et des institutions indissociablement lié à celui de l’euskara, mais rares furent ceux qui envisagèrent la question sous cet angle: "peu nombreux sont ceux qui savent quel est l’élément le plus indispensable à la conservation [des "Fueros"] dans leur intégrité" (Iztueta, 1847). Cela aurait très bien pu être formulé dans l’autre sens, c’est-à-dire qu’il appartenait aux institutions historiques de défendre et protéger la langue et que, par conséquent, elles pouvaient être considérées comme un instrument politique pour définir et promouvoir le projet linguistique approprié. Mais, il restait un long chemin à parcourir avant de parvenir à cette conclusion. En fait, d’une façon générale, à la fin du XIXème siècle, ni le régime de Cánovas en Espagne, ni la IIIème République en France, ne tinrent compte de la langue de la communauté basque. Les pouvoirs centraux poursuivirent leur politique de débasquisation et, dans les institutions qui dépendaient d’eux, la langue basque ne trouva aucun refuge: au contraire, ce sont précisément les institutions publiques qui restèrent les plus fermées à l’euskara. Dans les ministères, les forces armées, les préfectures ou les délégations ministérielles du gouvernement central, le basque était officiellement ignoré, la seule langue en usage étant le castillan ou le français. En outre, au sein des institutions plus ou moins décentralisées relevant d’un même organe gouvernemental (hôpitaux, écoles, chemins de fer, etc.), l’euskara subit une marginalisation similaire. D’après ce que nous savons, sous l’Ancien Régime, les lois écrites au Pays Basque le furent en castillan ou en français. Considérant que c’était là une norme établie, l’Etat central se désintéressa de toute tentative de normalisation officielle de la langue basque, qu’il s’agît des lois ou des règlements qui pouvaient avoir une influence directe sur la vie et le futur de l’euskara. Ce "vide" juridique est, sans conteste, l’élément qui a eu, à la longue, les conséquences les plus graves sur la situation sociolinguistique du basque.
|
|
La Navarre en faveur de l’euskara (1896) : La perte des "Fueros" eut pour effet de resserrer les rangs des Navarrais autour de l’euskara. A partir de 1868, les revendications en faveur du basque se firent entendre de plus en plus fort et, dans ce domaine, Pampelune se montra plus d’une fois solidaire des trois autres Députations basques. Ainsi, en 1896, sur le thème de l’enseignement, la Députation "Foral" de Navarre écrivit en ces termes à celle de Guipuzcoa: La Députation de Navarre [...] est convenue d’intervenir auprès du gouvernement de Sa Majesté pour obtenir qu’il rende obligatoire l’enseignement du basque dans les écoles du territoire basque (11-I-1896). Ci-dessus: le monument aux "Fueros", à Pampelune, portant une inscription en euskara. |
Dans les trente premières années du XXème siècle, les lois promulguées visaient toutes, à quelques exceptions près, à limiter ou interdire l’usage public de l’euskara. Dans ce registre, l’un des règlements les plus durs fut celui de 1902 qui prohibait l’usage de toute langue autre que le castillan, y compris pour l’enseignement du catéchisme. Au sein même des Députations et des Municipalités, la langue administrative écrite était, comme partout ailleurs, le castillan. Bien sûr, il n’en allait pas de même pour la langue parlée qui, dans les zones bascophones, restait l’euskara. Dès que le rapport de forces commença à changer (avec l’apparition des "abertzales" dans le paysage politique, surtout à partir de 1912), on nota de la part des Députations une plus grande ouverture d’esprit pour le fait linguistique. À cet égard, quelques-unes des mesures prises conjointement par les Députations valent d’être signalées: la demande -introduite par les quatre provinces en 1910-1911- faite aux notaires des zones bascophones de connaître l’euskara, la convocation -par les députations de Biscaye et de Gipuzkoa (1918)- du Congrès d’Etudes Basques, la proposition -à l’initiative des quatre provinces (1918-1919)- de création d’une académie, et les efforts accomplis pour fonder une université (1866, 1919, 1921, 1923).
|
|
Les Juntes de Biscaye (1846) : Après la première guerre carliste, à partir de 1840, une nouvelle attitude vis-à-vis de l’euskara se manifesta au sein des Juntes de Biscaye (Assemblée du Territoire). Les comptes rendus des sessions, ainsi que certains documents officiels, furent publiés dans les deux langues, et il fut décidé que les débats se tiendraient également en basque pour permettre à tout un chacun de les comprendre (1854). Le texte présenté ici est un discours du corrégidor, représentant du roi, traduit en euskara. |
|
|
L’euskara dans les municipalités : En considération de la loi, il n’était pas facile de défendre comme légitime le droit d’exiger des fonctionnaires une compétence linguistique appropriée à l’exercice de leurs fonctions. Le choix du secrétaire de mairie de Saint-Sébastien et des percepteurs municipaux donna lieu à de graves affrontements, non seulement à la mairie, mais aussi dans la presse. Ci-dessus: éditorial de protestation de la revue Euskal-Erria (1891). |
En ce qui concerne les décisions prises indépendamment par chaque Députation, c’est en Biscaye et en Gipuzkoa, on s’en doute, qu’elles furent les plus nombreuses. Certaines étaient destinées à faciliter la publication de revues périodiques (Euskal-Erria, Revista de las Provincias) et l’édition de livres (Ardi galdua d’Azkue, en particulier), à encourager auteurs et éditeurs par des subventions; d’autres à s’assurer des compétences linguistiques des fonctionnaires. Par exemple, les candidats à un poste de "mikelete" (gendarme régional de Gipuzkoa) devaient savoir le basque (1900), ainsi que les téléphonistes (1909). De même, pour accéder à la direction du centre de Fraisoro (Ecole Agricole), la connaissance de l’euskara était une condition sine qua non (1912), tout comme il était indispensable de parler basque pour être directeur du service des Eaux et Forêts (1916), etc. La Députation de Biscaye publia d’abondants règlements sur ces deux aspects de la question linguistique (l’aide à apporter, par divers moyens, à l’euskara sur le plan social, et le critère de la bascophonie dans le recrutement des fonctionnaires). Les plus intéressants sont ceux qui touchent à l’école (1917- 1920). Ainsi, parmi les candidats à la direction des "miñones" (gendarmes régionaux d’Alava), la préférence était donnée à ceux qui parlaient basque (1914), le directeur de l’école agricole d’Abadino devait impérativement remplir cette condition (1918), comme les inspecteurs de l’enseignement primaire (1918). Dans un autre domaine, les nouveaux médecins de l’hôpital de Gorliz disposaient d’un délai d’un an, à partir de la date de leur nomination, pour apprendre l’euskara (1919). En 1921, un règlement plus général fut instauré en Biscaye: tous les employés amenés à travailler dans les zones bascophones ou au contact de bascophones devaient obligatoirement savoir l’euskara. Dans les années 1918-1923, à l’époque de la construction des Ecoles de Bourgade (Escuelas de Barriada), il fut généralement demandé aux fonctionnaires de l’enseignement (professeurs) de connaître la langue basque. Cette période illustre parfaitement la position adoptée par la Députation de Biscaye (alors dirigée par des nationalistes), avant la guerre civile, sur le problème de la place du basque dans l’administration. Mais, d’une façon générale, dans le contexte légal en vigueur, ni les Députations, ni les Municipalités d’Hegoalde ne réussirent à mettre sur pied un projet global de redressement de la langue, même si les mesures ponctuelles importantes ne manquèrent pas. Cela fut, à l’évidence, une grave erreur due à l’inexistence d’un programme cohérent de politique linguistique.
|
|
Projets pour une Académie : Au cours du XIXème siècle, la création d’une institution chargée de veiller sur la langue basque fut proposée et réclamée à plusieurs reprises (Ulibarri, Aizkibel, d’Abbadie, Artiñano). Le projet donna parfois lieu à des exposés très détaillés. Tel fut le cas du "Projet d’Académie Basque", œuvre d’Artiñano, que nous voyons ici et que son auteur présenta aux premières "Fêtes Basques" de Durango (1886). |
A mesure que la défense de la langue était définie par les hommes politiques comme un objectif et perçue comme un devoir social, le mouvement basquisant et, plus tard, le mouvement euskaltzale ressentirent l’obligation de créer des institutions privées pour l’euskara. Ces organismes sociaux parvinrent à s’implanter surtout dans les capitales de province, d’abord à Pampelune et Saint-Sébastien, puis à Bilbao. Évidemment, il revenait aux institutions publiques de subventionner les associations euskaristes qui faisaient leur apparition, leurs publications, ainsi que les "ikastolas" (écoles basques) naissantes. Bientôt, les intellectuels et partis politiques "abertzales" inclurent la revendication linguistique dans leurs programmes et mots d’ordre, présentant la défense du basque comme un objectif culturel que tout parti se devait de viser. C’est alors que les premiers concours furent organisés et les premiers prix officiels décernés (par exemple, dès 1882, celui de l’Hôtel de la Ville de Pampelune). Le public euskariste allait ensuite franchir une seconde étape lorsqu’il prit clairement conscience de l’influence directe que les institutions avaient sur la vie de l’euskara, son épanouissement ou sa disparition, et de la nécessité d’ébaucher une nouvelle politique à ce sujet. Au centre de la réflexion, il y avait surtout la question de la scolarisation en basque, et c’est justement dans ce domaine que s’exprimèrent les premières volontés de réforme. Cependant, les possibilités sur ce terrain étant limitées et les résultats aléatoires à cause des difficultés administratives, la nécessité se fit sentir d’une institution à caractère public et technique dédiée à la langue. Cet organisme engloberait la totalité du Pays Basque, resterait à l’écart des partis politiques, mais serait subventionnée par les pouvoirs publics.
|
|
L’Académie, créée par les Députations (1918-1919) : Comme nombre d’initiatives privées avaient échoué et que le nationalisme avait désormais assez d’influence dans les institutions publiques, les Députations prirent la décision de fonder l’Académie et d’en assumer les frais de fonctionnement. Le projet fut d’abord accepté par la Députation de Biscaye, sur proposition des députés Elgezabal et Landaburu (25-I-1918), mais avec l’intention affichée dès le départ de le promouvoir conjointement avec les autres Députations basques. |
A dire vrai, l’idée d’une académie basque venait de loin, aussi ne s’agissait-il pas d’un projet improvisé. L’Alavais d’Abando, Ulibarri, avait déjà demandé aux Juntes de Guernica (1832) de créer une association de vingt-quatre membres chargés de sauvegarder, protéger et moderniser le basque, mais c’est J. F. Aizkibel qui évoqua expressément le besoin d’une académie. Ce dernier insista sur la nécessité d’adapter l’un des dialectes littéraires ou classiques comme euskara standard et, à cet effet, estimait "impérieux le besoin d’une académie composée de Basques qui aient effectué des études spécialisées sur leur propre langue" (1856). Aizkibel demanda aux autorités du Pays de reprendre l’idée à leur compte. Il énumérait pour les convaincre les conséquences culturelles et linguistiques de cette langue commune et compréhensible par tous qui devait être le principal objectif de la nouvelle institution. Au bout d’un siècle ou deux, disait-il, les bascophones, divisés politiquement en deux États, se comprendraient mutuellement, la littérature basque se développerait, nombre de grammaires, dictionnaires et autres ouvrages didactiques seraient publiés et, d’une façon générale, l’espace culturel basque s’élargirait. De même, le capitaine Duvoisin, collaborateur du Prince L.L. Bonaparte, écrivit quelques années plus tard (1862) une lettre à ce propos à d’Abbadie, dans laquelle il insistait sur l’idée que celui-ci avait eu auparavant, et il se proposait de mettre le projet d’Abbadie à exécution. Dans les dix premières années de la Renaissance Basque, nombreux furent ceux qui reprirent ce thème, exprimant par là un sentiment diffus. Manterola regretta l’inexistence d’une telle académie (1880), mais c’est Artiñano qui exposa le projet avec le plus de conviction et de détermination (Durango, 1886) et alla jusqu’à prévoir un règlement: l’institution appelée "Académie Basque" (Academia Bascongada) aurait comme champs d’investigation l’histoire et la langue d’Euskal Herria.
|
|
Les statuts de l’Académie : Les statuts constitutifs d’Euskaltzaindia étaient destinés à régir le fonctionnement interne de cette institution publique de la langue basque. Ils furent rédigés par une commission nommée à cet effet au Congrès d’Oñati. Au terme de ce travail, un communiqué de presse fixa à quinze jours le délai pour faire des suggestions, à partir desquelles Olabide se chargea de rédiger l’avant-projet. Après que les amendements eurent été apportés et que chaque députation eut approuvé le texte qui en résultait, l’Académie de la Langue Basque, appelée "Euskaltzaindia" en euskara, fut définitivement constituée (1919). A partir de l’année suivante, allait commencer à paraître Euskera, la revue officielle de l’Académie. |
A partir de ce moment, dans la mesure où toutes les tentatives échouaient, la conviction se renforça qu’il incombait aux institutions publiques de fonder l’Académie. Un projet de règlement fut donc rédigé à la Députation de Biscaye (1906-1907). À ce sujet, diverses suggestions émanant d’Iparralde et d’Alava (1907) figurent dans la correspondance d’Azkue. En 1913, Euskal-Esnalea réalisa une enquête portant sur les possibilités, l’opportunité et les conséquences probables de la création d’une telle académie. Et toutes les réponses furent unanimement favorables au projet. Enfin, conformément à la décision initiale de la Députation de Biscaye, naquit ce qui serait Euskaltzaindia (1918). Une fois que les autres députations eurent donné leur approbation, le Congrès d’Oñati fut chargé d’effectuer les premières démarches officielles en vue de la fondation de l’Académie, selon la procédure qui lui paraîtrait la plus appropriée. Après diffusion et discussion publique de l’avant-projet de statuts, le texte définitif fut approuvé par la commission ad hoc en novembre 1918, et la toute nouvelle Société d’Études Basques le transmit aux députations qui l’adoptèrent en 1919.
A la demande des autorités provinciales, c’est la Société d’Études Basques qui procéda à l’élection des premiers académiciens, au cours d’une réunion qui rassemblait Azkue, Campión, Eleizalde et Urquijo déjà élus à Oñati, et les directeurs des revues de l’époque. Furent ainsi nommées les huit personnalités qui manquaient au nombre prévu, à savoir: Adema, Agerre, Tx. Agirre, Broussain, Eguzkitza, Intzagarai, Lhande et Olabide (Adema, Broussain et Lhande étaient du Pays Basque Nord). R. M. Azkue fut choisi comme président de l’Académie dont le siège fut fixé à Bilbao.
|
|
Les interdictions de l’État dans le domaine religieux (1902) : En 1902, le gouvernement espagnol interdit l’usage de toute langue autre que le castillan pour l’enseignement du catéchisme. Ce décret de Madrid s’avéra impossible à appliquer dans les faits, pas même par la force, dans la mesure où il ne tenait aucun compte de la réalité sociale, aussi dut-il être aménagé par la suite. La même année, le Gouvernement français prohiba également l’usage de la langue bretonne dans l’enseignement religieux, décision à laquelle la revue Eskualduna (24-X-1902) réagit énergiquement. |
|
|
L’Église et l’euskara : Parallèlement au travail effectué par la hiérarchie catholique et les simples prêtres, l’Eglise chercha aussi à élaborer une réflexion théorique sur ses relations avec la communauté bascophone, de façon à trouver un modus vivendi acceptable. Cet opuscule d’Intxaurrondo contient le texte d’un discours de rentrée des classes au séminaire de Pampelune (1926). |
Deux ou trois siècles avant la Renaissance Basque, l’euskara ecclésiastique et les religieux connurent leurs heures de gloire (Etxepare/Leizarraga, École de Saint-Jeande- Luz/Sare, Larramendi et ses disciples). De plus, dès le XVIIème siècle, l’euskara avait bénéficié dans la pratique du statut de langue officielle au sein de l’Église comme nous l’avons vu plus haut. Cela ne signifie pas pour autant qu’à tout moment, l’Église ait exploité toutes les possibilités offertes par la loi, ni même qu’elle ait fait tout ce qu’il fallait pour parvenir à une normalisation progressive du basque dans la vie et les activités ecclésiastiques. Fidèle à la tradition basque, l’Église se trouva toutefois en première ligne des institutions, et par son histoire et centres institutionnels, en meilleure position qu’aucun autre groupe social pour participer activement à l’ «Eusko Pizkundea» ou Renaissance Basque. Pour présenter l’histoire d’une institution qui a eu une influence aussi déterminante sur le Pays Basque, il faut tenir compte de certaines particularités. En premier lieu, précisons que le terme Église recouvre ici non pas les croyants laïques, mais les prêtres et religieux ainsi que leurs conceptions sociolinguistiques. L’Église et les religieux ont toujours eu, à propos des langues vernaculaires, leur propre pratique et leur propre théorie générale, mais ils les ont utilisées de diverses façons en fonction des circonstances et des changements historiques. Il est donc nécessaire de savoir comment théorie et pratique ont été mises en œuvre concrètement au Pays Basque.
|
|
José Cadena y Eleta : Cet évêque de Vitoria (1905-1913) entretint avec le nationalisme basque de l’époque des relations très difficiles, envenimées notamment par l’interdiction des noms de baptême basques (1911-1913) et de la Historia de Vizcaya de A. Zabala (1910). Parmi tous les évêques de Vitoria, Cadena y Eleta se distingua par sa méfiance et ses mauvaises dispositions. |
Afin de mieux comprendre cet aspect de l’histoire ecclésiastique, et d’évaluer à sa juste mesure l’importance du caractère officiel reconnu au basque par l’institution ecclésiale, nous devons savoir quelle était la "géographie" de l’euskara à l’intérieur même de l’Église, au niveau institutionnel et individuel. Dès la christianisation, la première langue officielle de l’Église fut le latin, et le castillan, le français ou l’euskara ne firent leur apparition que plus tard. Tout au long de la semaine, ainsi que le dimanche, le curé disait la messe et donnait les sacrements en latin. En revanche, la langue basque pouvait être utilisée dans les sermons, les chants, la confession personnelle et de nombreux ouvrages complémentaires de culture religieuse. En outre, l’habitude d’enseigner la catéchèse (la doctrine) en euskara, et de prier, en privé ou en public, en basque était très répandue au Pays. Rappelons que le catéchisme et la prière -avec les cours de l’école religieuse- étaient les circonstances dans lesquelles l’euskara s’exprimait le plus fréquemment au sein de l’Église. C’est pourquoi les conséquences de la moindre négligence, dans ce domaine, ont été particulièrement graves. Par ailleurs, la façon dont la langue a été présentée et mise en valeur et l’usage ethno-culturel qui en a été fait, sur le plan religieux et pastoral, méritent d’être soulignés. Tels sont les points de vue qui ont été pris en compte, parfois conjointement, dans la définition de la politique linguistique de l’Église au Pays Basque.
|
|
Le séminaire de Vitoria (1935) : A partir de 1920 approximativement, le programme d’études du séminaire de Vitoria commença à être modifié (le nouveau programme fut mis en place en 1930). A cette époque, furent créées la chaire d’euskara et de littérature basque, l’Académie "Kardaberaz", etc. La langue basque faisait donc officiellement partie de la formation des futurs prêtres. De plus, le corps enseignant du séminaire comptait dans ses rangs, comme nous pouvons le constater ici, des personnalités telles que J. M. Barandiaran et M. Lekuona. |
Dans les relations de l’Église avec la communauté bascophone, sont intervenus les États auxquels le Pays Basque appartient et qui le gouvernent. Les gouvernements libéraux du XIXème siècle avaient leur propre politique linguistique, au moins en négatif, et la position adoptée par l’Église dans la vie pastorale, avant même qu’elle ne considérât l’euskara comme une valeur ethno-culturelle ou nationale, ne pouvait qu’aller à l’encontre de celle des États. C’est ce qui se produisit en 1902 et 1906 des deux côtés des Pyrénées. En effet, les autorités de Paris comme celles de Madrid essayèrent, sans aucun ménagement, d’influer sur le choix de la langue à utiliser par l’Église dans la prédication et l’enseignement du catéchisme, et ce d’une manière qui pourrait nous sembler aujourd’hui aussi déconcertante que grossière: Madrid interdit d’utiliser l’euskara pour enseigner le catéchisme aux enfants (1902), et le Gouvernement français prohiba le basque dans les sermons dominicaux (1906).
Qu’elle se montrât opposée au pouvoir central comme en Iparralde, ou trop conciliante vis-à-vis de la couronne comme en Hegoalde, la hiérarchie catholique ne pouvait occulter le problème linguistique. Mais, la mentalité des évêques ne les prédisposait pas du tout à comprendre la montée irrésistible de l’euskarisme dans le peuple. Jusqu’à l’arrivée de l’évêque Muxika (1928) à Vitoria, ce diocèse n’eut personne à sa tête qui comprît vraiment le problème de l’euskara. Ainsi, les mesures autoritaires prises par Cadena y Eleta entre 1910 et 1913, à propos du baptême et des noms basques, se révélèrent en fait, au bout de quelques années, totalement disproportionnées.
|
|
Père Dámaso de Intza (1886-1986) : Parmi les Ordres religieux, ce sont la Compagnie de Jésus et l’Ordre des Capucins qui se distinguèrent, avant la guerre, pour leur contribution à l’euskarisme. La figure du père Dámaso mérite d’être évoquée ici. Ce capucin, qui compila toutes sortes de matériaux linguistiques, améliora le texte du catéchisme et participa à la publication de revues (Zeruko Argia, 1919), symbolise à lui seul un siècle entier de travail. |
A mesure que le nombre d’«abertzales» augmentait parmi les ecclésiastiques (n’oublions pas que l’Ami Basque du capucin Ibero date de 1907), le mouvement euskariste se fit plus actif et plus efficace et commença à porter ses fruits tant dans les ordres religieux que parmi les prêtres diocésains, sous la forme de revues et de publications diverses. D’abord, ce sont des groupes de travail qui se formèrent comme Jaungoiko-zale (1912) puis, comme l’initiative était bien accueillie dans la société, la culture basque trouva peu à peu sa place dans les séminaires: Barandiaran et Lekuona enseignèrent au séminaire de Vitoria à partir de 1920; les capucins publièrent les travaux de Bera et Arrigarai; les jésuites commencèrent à éditer Jesus-en Biotzaren Deya (1916), etc.
Au cours des années suivantes (souvenons-nous du Congrès d’Oñati en 1918), l’euskara bénéficia d’une plus grande reconnaissance de la part de l’Église. Durant l’épiscopat de Muxika à Pampelune, se produisirent deux événements significatifs qui portent la marque du bon sens de cet évêque intégriste mais bascophone: le père Intza fut chargé de rédiger une nouvelle version du catéchisme en basque (1927) afin d’en moderniser la langue et, plus symptomatique encore, le discours de M. Intxaurrondo à la rentrée des classes au séminaire de Pampelune, en 1926, traita des critères de la doctrine sociale de l’Église sur l’usage des langues et, en particulier, de l’euskara.
Ce changement d’attitude fit qu’à la veille de la guerre civile, de nombreux religieux œuvraient en faveur de la culture basque, non seulement en dispensant une instruction pastorale en basque, mais aussi dans le cadre d’activités extra-ecclésiastiques diverses. Nombre de prêtres, par exemple, jouaient un rôle de promoteur, d’animateur ou de conseiller au sein d’associations de défense de la langue: l’Académie de la Langue Basque, la société Euskeltzaleak, les publications et revues, la Société d’Études Basques, etc. En plus des noms déjà mentionnés, nous pourrions ajouter ceux de: Artzubiaga, Olabide, Azkue, Aitzol, Tx. Agirre, Estefania, Donostia, etc.
Pourtant, même pendant la période de plus grande ouverture, l’Église continua de réserver presque exclusivement au castillan certains domaines institutionnels parmi les plus importants: l’enseignement et la vie en commun dans les séminaires, la vie quotidienne des établissements religieux (monastères, couvents, résidences), l’enseignement dans les collèges religieux, etc. Et une certaine négligence finit par se faire sentir aussi sur le plan pastoral comme le dénonça Eusko Ikaskuntza dans le diocèse de Pampelune (1933, 1934). Dans ces pratiques internes aux institutions et cette minorisation linguistique, se manifestait clairement la piètre estime dans laquelle était tenue la langue de la communauté bascophone. Mais, en tout état de cause, la tâche accomplie par maints ecclésiastiques, de leur propre chef ou à la demande de leur hiérarchie, laissa un important volume de travaux.
|
|
Les ikastolas de Saint-Sébastien (1914) : Ci-contre: comité de patronage des ikastolak Koruko Ama (vers 1928?) avec D. Mateo Muxika au centre. Grâce à l’appui de groupes sociaux comme l’Eglise ou la haute classe moyenne de Saint-Sébastien, et à la générosité personnelle de Miguel Muñoa (à droite de l’évêque), il fut possible de faire vivre cette structure éducative qui disparut quand la guerre éclata. |
Étant donné que les pouvoirs centraux français et espagnol légiféraient et imposaient leurs lois à l’ensemble du Pays Basque, le problème de l’école se posa bientôt avec plus d’acuité. "Pour un instituteur laïc de la IIIème république dont l’horizon politique était limité par La Marseillaise anti-cléricale de Léo Taxil, l’alsacien, le breton et dans une moindre mesure le basque, l’occitan, le catalan, le corse seront des langues anti-républicaines et des langues de curés" (L.-J. Calvet). Quant au collège de Mauléon, le sous-préfet demandait de "tirer de l’ignorance un peuple qui, n’ayant qu’un idiome particulier, ne [pouvait] guère établir de relations avec le reste de la Nation" (1802).
En France, ce sont les lois Guizot (1833) et Falloux (1850) et les actes législatifs de Ferry (1879-1882) qui servirent à réformer le système scolaire et à définir les règles du jeu entre État et enseignement libre. Les discussions les plus fréquentes tournèrent autour du problème des écoles confessionnelles, tandis que celui des langues était considéré comme réglé: aucune langue n’existait en dehors du français.
Du côté espagnol, c’est la loi Moyano (1857-1970) qui réorganisa le système scolaire et définit les responsabilités en matière d’enseignement. Naturellement, les hommes politiques donnèrent un grand écho au problème du choix de la langue et, les Députations, après s’être consultées, adressèrent à la reine une Instancia (1857) relative à la nouvelle loi, qu’elles considéraient comme portant atteinte à leur privilège, dans laquelle elles faisaient état des dommages que ladite loi pouvait causer à l’euskara. Au cours des années suivantes (1859, 1874), le désaccord porta essentiellement sur cette question: qui était responsable de la nomination des maîtres? À partir de 1876, les Députations, conformément à leurs prérogatives respectives, s’efforcèrent d’orienter l’école vers des solutions moins préjudiciables à l’euskara, ou du moins, d’atténuer les effets néfastes, mais hélas inévitables, de la loi.
Nous ne pouvons retracer ici l’histoire détaillée de l’introduction du bilinguisme au Pays Basque par l’intermédiaire d’un système scolaire officiellement hispanophone et unilingue qui, de plus, servit de moyen de répression de l’euskarophonie. Pour avoir une idée sommaire de l’obscurantisme qui inspirait une telle politique, il suffit de reprendre, à titre d’exemple, ce que disait le règlement de la commission sur l’enseignement primaire de Saint-Palais
en Iparralde: "Il est interdit aux élèves de dire des grossièretés et de parler basque. Les élèves doivent parler français, y compris pendant les récréations". Ainsi, les bonnes manières et l’euskara étaient incompatibles à l’école d’après les membres de cette commission qui, d’ailleurs, étaient eux-mêmes basques... La haine de sa propre langue était, on le voit, quelque chose de bien réel.
L’école se retrouva donc coupée de la société qui l’entourait et ne parvint même pas à atteindre son but en matière d’alphabétisation, ce qui aurait peut-être été possible si les autorités s’étaient montrées plus souples en admettant le bilinguisme dans le cadre scolaire. En 1872, 60 à 74% des habitants d’Iparralde étaient encore analphabètes, alors qu’il y en avait moins de 50% dans l’ensemble du Béarn voisin. En revanche, au sud des Pyrénées, le taux d’analphabétisme ne dépassait pas 29% en 1900 et tomba à 11% trente ans plus tard. Même si l’influence de l’interdiction de l’euskara sur l’analphabétisme n’a pas été suffisamment étudiée, de nombreuses informations nous permettent d’imaginer le coût social et pédagogique que cette décision politique a entraîné.
Dans un tel contexte, la revendication pour une école basque, ou au moins bilingue, n’était pas nouvelle: Ulibarri, Iturriaga, Hiribarren, Astigarraga et d’autres en avaient déjà formulé la demande à leur époque, et les efforts faits dans ce sens par l’État carliste pendant la guerre (1873-1875) sont tout aussi révélateurs.
La Députation de Gipuzkoa devança les autres en réussissant à rétablir les prérogatives des municipalités et des Députations dans la nomination des maîtres d’école. En outre, elle prit l’initiative de convoquer les autres députations basques à ce propos: les quatre députations se réunirent donc à Pampelune en 1898. Cette volonté politique se manifesta jusqu’en 1920 approximativement, puis s’exprima dans le cadre des projets pour le statut d’autonomie. Toutefois, la seule Députation qui parvint à obtenir de véritables responsabilités dans ce domaine fut celle de Navarre. En effet, en 1914, le gouvernement central reconnut à la province le droit de nommer individuellement les candidats aux postes d’instituteurs.
Le combat linguistique à l’école
1820
Dis-moi:
Comment est-ce possible,
qu’attendons-nous?
Nous parlons basque,
mais notre école est en castillan!
Cela est une sombre machination
destinée à nous perdre.
J. P. Ulibarrri (1775-1847)
1833
J’ai exigé des instituteurs
l’abolition entière de l’usage
de la langue basque en classe.
Un inspecteur académique de Mauléon
1846
Nos écoles en Pays Basque
ont particulièrement pour objet
de substituer la langue française au basque.
Le préfet des Basses-Pyrénées
|
|
La première ikastola de Navarre (1933) : L’association navarraise "Euskeraren Adiskideak" entreprit de nombreuses actions en faveur de la langue basque. L’une d’elle consista à créer une ikastola. La photo ci-contre montre les enfants et les institutrices le jour de l’inauguration. |
Parmi les nombreuses raisons avancées en faveur de l’autonomie des Députations et des municipalités, une de celles qui revenaient le plus souvent était qu’il fallait, en ce qui concerne l’enseignement, avoir une connaissance approfondie de la réalité d’Euskal Herria et de sa situation linguistique. C’est ce que les représentants basques répétaient inlassablement dans toutes les réunions à Madrid. Et, petit à petit, à partir de la réflexion sur l’enseignement primaire, le projet d’une nouvelle école basque prit forme: nouvelle parce qu’elle décrivait, exigeait et utilisait des méthodes pédagogiques innovatrices, et basque parce qu’elle voulait être une école où l’on travaillerait aussi en euskara.
La meilleure définition de cette nouvelle école fut donnée par Eduardo Landeta, lequel conçut aussi les niveaux de bilinguisme scolaire. Ses idées et celles de beaucoup d’autres furent discutées dans les réunions et les publications de la Société d’Études Basques. Aussi, dès 1918, se trouvait-il déjà des volontaires prêts à mettre en œuvre ces projets naissants.
|
|
Eduardo Landeta (1862-1957) : Ce fut un théoricien et un technicien remarquable, ainsi qu’un administrateur efficace du secteur de l’éducation qui dépendait de la Députation de Biscaye. Entre 1905 et 1909, il publia ses réflexions politiques et pédagogiques dans la revue Euskalduna. Dans les années 1910-1917, il s’efforça d’améliorer l’enseignement public et prit part aux commissions techniques formées à cet effet au sein de la Société d’Etudes Basques et de la députation de 1917 à 1936. Landeta exposa ses idées sur les langues à l’école dans ses travaux de 1918 et 1923 (au Congrès d’Oñati, dans le bulletin de la Société d’Etudes Basques et, enfin, dans Yakintza en 1933). |
Deux faits importants illustrent la volonté de compenser la faiblesse relative des institutions politiques en matière de pouvoir et de protection de la langue: la construction des Écoles de Bourgade (Escuelas de Barriada) en Biscaye, et la naissance de l’Ikastola d’avant-guerre, qui connut un certain développement, mais très localisé.
Comme elles ne disposaient pas d’un réseau de centres scolaires du même type qu’en Biscaye, les autres Députations n’avaient pas de vrai pouvoir sur le plan de l’éducation. Néanmoins, faisant valoir les "Conciertos Económicos" (Concertation Autonome de la Fiscalité) et divers accords conjoncturels, elles s’arrangèrent pour avoir leur mot à dire sur le problème de l’école (1900, 1901, 1911-13) et finirent par avoir quelques responsabilités qui leur permirent de combler les vides laissés par la scolarisation centrale. Peu à peu, le rôle des Députations se révéla déterminant puisque, en 1918, l’aide accordée aux écoles de Biscaye par les Municipalités s’élevait à 729.000 pesetas, tandis que celle de l’État ne dépassait pas 268.000 pesetas.
Sous les directives de techniciens euskaristes aussi qualifiés que pouvaient l’être Eleizalde, Landeta et Azpeitia, la Députation de Biscaye (1919-1936) tenta de répondre aux besoins négligés par l’État: en dix ans (1920-1932), furent construites 125 écoles de bourgade qui regroupaient 6.321 élèves (1933-1934). À cet égard, nous ne pouvons passer sous silence la polémique que ces écoles déchaînèrent dans le monde politique. En 1919, lorsque les nationalistes perdirent la majorité, la présidence de la députation passa à la Ligue Monarchiste qui fit une autre interprétation du modèle linguistique et réduit considérablement la place de l’euskara. Mais, la force du contexte linguistique était telle que le basque ne perdit pas son rôle éducatif, jusqu’au moment où la situation devint encore plus difficile sous le régime de Primo de Rivera (1925).
L’Ikastola (école où on enseigne en basque) tire son origine de cette expérience socio-pédagogique des écoles de bourgade, ainsi que d’autres épisodes plus anciens et plus sporadiques. Les critiques formulées à propos de l’école publique au Pays Basque poursuivaient un même but: dénoncer le traitement réservé à la langue basque. Arana avait publié de nombreux articles à ce sujet (1894-1901) et Azkue, qui avait blâmé très durement le maître castillan dans sa pièce de théâtre Vizcaytik Bizkaira (1895), en vint à ouvrir par la suite son propre collège (1896). Mais, le précurseur fut Campión dont les critiques figurent tant dans ses œuvres politiques (1877) que littéraires. Telles furent les personnalités les plus marquantes dans ce domaine.
|
|
Les livres de textes : Dès avant la guerre civile, se fit sentir le besoin de manuels scolaires, lequel poussa divers auteurs et institutions à faire les premiers pas. Il s’agissait d’éditions honorables et très bien présentées qui tentèrent des expériences encore inédites sur la langue basque. Ci-dessus: texte de I. López Mendizabal illustré par Txiki. |
Ce sont les mouvements politiques et les intellectuels (à ce titre, se distinguèrent particulièrement la Société d’Études Basque, en tant qu’institution culturelle, et en son sein, le père Altzo, Urabaien, etc.) qui rendirent possible la naissance de l’Ikastola: cela commença à Saint-Sébastien avec la fondation par les Muñoa (1914) de l’école de Notre-Dame du Chœur. En Navarre, la première ikastola ouvrit ses portes durant la République, sous les auspices de l’association Euskeraren Adiskideak.
Dans ces deux types de scolarisation (écoles de bourgade et Ikastola), la nécessité de disposer de textes scolaires se fit très vite sentir. Aussi, plusieurs auteurs publièrent-ils, de leur propre initiative ou à la demande des institutions, un certain nombre de manuels d’inégale valeur. En Biscaye, les premiers ouvrages destinés aux écoles de bourgade furent rédigés à la suite d’un concours public (1918). En Gipuzkoa, au contraire, ce sont des auteurs et des maisons d’édition privées qui, dès le début, se chargèrent de ce travail.
Après la guerre, les euskaristes préoccupés par la tâche éducative allaient trouver dans ce passé récent un modèle de référence adapté à leurs besoins.
|
|
Anthologies populaires des campagnes militaires : A l’instar de tant d’autres événements ou célébrations, les inquiétudes et les souffrances du service militaire inspirèrent divers bertso-paperak. Ceux qui furent conservés par écrit ou dans la mémoire collective ont été recueillis dans des collections comme "Auspoa". Ils reflètent les préoccupations du jeune Basque au début de l’obligation du service militaire: la guerre d’Afrique (1859-1862), la guerre de Cuba (1895-1898), poèmes du service militaire... |
Au XXème siècle, après la perte des fueros, le service militaire obligatoire fut imposé aux jeunes Basques (en Iparralde, sous la IIIème République; en Hegoalde, après la guerre carliste). Conformément à la loi de 1876, les provinces basques allaient être obligées de fournir un contingent d’hommes pour services militaires ou spéciaux (art. 2). Cette obligation eut un grand retentissement dans les villes et villages et leurs familles car les jeunes euskarophones étaient contraints, de ce fait, à quitter le Pays Basque pour des régions inhabituelles et non bascophones.
La littérature populaire de l’époque se fit l’écho de cette nouveauté d’ordre social et les bertso-paperak (= feuillets imprimés reproduisant des poèmes à caractère informatif ou social, et vendus sur les marchés et les foires) commentèrent les anecdotes de la vie de régiment dans de lointaines garnisons. Un petit exemple de ces textes nous est fourni par la collection de littérature populaire "Auspoa": Afrikako gerra (= La guerre d’Afrique), Soldaduzkako bertsoak (= Poèmes du service militaire), Kubako gerra (= La guerre de Cuba), Euskal mutillak armetan (= Les jeunes Basques aux armées) ou Tiro tartean bertsotan (= Poèmes dans la mitraille).
|
|
Ceux qui ne voulaient pas partir au Maroc (1921) : La population gardait en mémoire les guerres coloniales (Cuba, Maroc) qui éclataient avec une trop grande fréquence, les adieux sur les quais de gare, les fusillades traîtresses du front, et le retour des blessés et des morts. Ci-dessus: manifestation à Saint-Sébastien pour demander que soient jugés les responsables du désastre d’Annual (Maroc). |
De fait, un service militaire forcé pouvait s’avérer traumatisant pour beaucoup. D’ailleurs, les anecdotes qui ont toujours cours parmi nous en sont la preuve. En effet, une fois établie l’obligation du service militaire et dès lors que le conflit colonial (qui avait éclaté des années auparavant) s’aggravait, le jeune qui entrait dans les rangs, victime d’un tirage au sort aveugle, pouvait se retrouver envoyé au front, ce qui arrivait très fréquemment dans le contexte du moment. Nombre de Basques ne comprenaient absolument pas pourquoi, puisqu’une guerre sur leur propre sol leur avait valu tant de misère, d’autres guerres menées sur des terres étrangères et lointaines devaient leur apporter un quelconque bénéfice. Dans les vers de Gorostidi que nous présentons ci-joint, apparaissent quelques-uns des doutes générés par la guerre de Cuba (1895-1898).
|
|
Sur la route de Castille : Ces vers anonymes datent certainement de la fin du XIXème siècle. Grande était l’inquiétude provoquée par le fait d’être basques et de connaître à peine le castillan chez ces jeunes qui, à la veille de partir au service militaire, parcouraient les rues de Tolosa en chantant: "Erderaz itzegiten / gutxi dakigunak" (= nous qui savons si peu parler le castillan). |
Le service militaire provoquait chez les jeunes recrues, en majorité bascophones unilingues, un choc culturel brutal car le système leur apprenait très vite que l’euskara n’avait aucune valeur en regard de la prépotence du castillan et du français. Au cours des affrontements de la dernière guerre carliste (1870-1875), un membre castillan du bataillon Guernica avait déjà remarqué le rôle à la fois différenciateur et rassembleur de la langue: "Ces Biscaïens sont exclusivistes et, pour eux, rien n’est supérieur à leurs fueros, leur langue et leur terre". En effet, les carlistes bascophones en campagne ne manquaient pas de remarquer avec insistance la condition d’euskaldun ou d’erdaldun des personnes qui les entouraient, comme nous l’apprend une enquête ultérieure, observation ou estimation différenciatrice qui pouvait facilement se révéler gênante pour le spectateur étranger.
L’expérience linguistique vécue à la caserne engendra parfois des résolutions dramatiques. On cite le cas d’un homme qui, après ce qu’il avait souffert dans l’armée, décida, bien que vivant dans un lointain hameau de la Haute-Navarre (Arano), de ne jamais apprendre à ses enfants la langue qui avait toujours été la sienne. La nouvelle de ce mauvais moment à passer se répandit bientôt dans les foyers des futures recrues, et beaucoup de parents se retrouvèrent face à une décision à prendre: il devenait souhaitable que leur fils, avant de partir au service, apprît quelques rudiments de castillan en Alava, dans la Rioja ou l’une des grandes villes du Pays, c’est-à-dire dans un cadre extra-familial certes, mais plus familier que l’ingrate caserne regorgeante de soldats. C’est ainsi que, avant même l’école castillane obligatoire, la vie en commun du service national imposa aux Basques une deuxième "école" de bilinguisme que les familles financèrent pour éviter de plus grands maux.
Il semble que, dans le contingent de recrues basques, le nombre de ceux qui ignoraient complètement le castillan était important, au point qu’en 1918, la Députation de Gipuzkoa estima nécessaire, à l’encontre de l’ordre de Madrid, de s’opposer à la nomination d’un médecin castillan et de choisir un médecin basque pour la visite médicale des futurs soldats. Voici la raison qui fut donnée: "parce que la majorité des jeunes soumis à l’examen médical ne connaissent pas le castillan et qu’il est juste que [le médecin] maîtrise leur propre langue pour pouvoir les comprendre". C’est pourquoi la Députation protesta contre les mesures du gouvernement central.
A cette époque, le fait de quitter les villages bascophones pour l’étranger nous semble également lié, du moins en partie, au problème du service militaire. Traversant la frontière, les jeunes qui fuyaient la zone nord-pyrénéenne d’Euskal Herria s’embarquaient pour l’Amérique à Pasajes (Gipuzkoa), et ceux de la zone sud-pyrénéenne à Bayonne, Bordeaux ou Liverpool. Il s’agissait, en fait, de déserteurs dont la seule obsession était d’échapper à l’armée et à la guerre.
Les statistiques prouvent, en effet, que les désertions étaient nettement plus nombreuses en temps de guerre. Comme le service militaire représentait, pour les jeunes et leurs familles, un monde inconnu et hostile, et que son caractère obligatoire était perçu comme une mesure répressive après la défaite, plus d’un Basque décida de s’embarquer pour l’Amérique ou de traverser la frontière franco-espagnole. Voici quelques éléments significatifs de ce phénomène qui toucha les deux côtés des Pyrénées:
|
KUBAra!
Monarkitarren gobernu txarrak gauz onik eziñ ekarri ixtillu ederrak jarri diozka oraiñ ere erriyari: amen ondotik semea eraman, kendu senarra andreari, errukimenik ez diyo artzen aien ume tristeari.
Gobernu txarrez aspertu dira Kuba’ko gure anaiak, zergatik arki diraden illun lengo paraje alaiak; ez dituzte nai aiek sufritu emengo zitalkeriyak, ta altxa dira defenditzera bear diran lege garbiyak.
Autonomiya eskatzen dute, ta au da eskamen prestuba nork bere etxia gobernatzia ez al da gauza justuba? Urte askuan sufritu dute lepoan zepo estuba... Onian eziñ logratu dana logratzen da odoleztuba.
Elias GOROSTIDI (c. 1898) ITURRIA:ZAVALA, A. (1983): Kuba’ko Gerra. Tolosa: Auspoa. |
Il faut dire que les Etats français et espagnol avaient compris, plus ou moins clairement, le rôle d’uniformisation linguistique que pouvait jouer le service militaire: "Dans nos bataillons, on parle généralement français et, une fois qu’ils auront pris cette habitude, ils diffuseront la langue chez eux" (Abbé Grégoire, 1792). La "francisation" de l’armée s’avéra d’autant plus nécessaire, en particulier après la Grande Guerre (1914), que les régiments rassemblaient des soldats qui parlaient des langues différentes (français, breton, provençal, basque, corse, alsacien...).
Nous manquons toujours de données précises à propos de l’influence du service militaire sur l’hispanisation et l’implantation du bilinguisme au Pays Basque mais, dès à présent, nous pouvons dire que ce fut un facteur important qui doit être pris en compte parmi d’autres. IPARRALDE HEGOALDE 1850 La moitié des déserteurs, en France, était basque. 1852-55 1.311 déserteurs 1913 Le 20,76% des appelés désertèrent. 1914 Le 22,09 des appelés Basques désertèrent.
|
|
Txomin Agirre (1864-1920) : Les romans de Txomin Agirre, écrivain originaire d’Ondarroa, constituent des classiques du renouveau littéraire basque: Auñamendiko Lorea (1898), Kresala (1901-1906), Garoa (1907-1912). Ce sont surtout les deux derniers qui ont fait la célébrité d’Agirre. Voilà un auteur qui réussit à passer maître dans l’art d’écrire en utilisant deux dialectes différents: Kresala, en biscaïen; Garoa, en guipuzcoan. |
Nous voudrions évoquer ici non seulement la littérature écrite, mais aussi la littérature orale, qui toutes deux ont donné à la bascophonie des œuvres magnifiques. La Renaissance Basque permit le développement tant de la poésie que du roman, du théâtre et de l’essai, et aborda avec plus ou moins d’audace des genres nouveaux pour la tradition littéraire basque. Cet intérêt pour les belles lettres se fit sentir plus particulièrement dans les vingt années qui précédèrent la guerre, et il est permis de penser que c’est le Congrès d’Oñati (1918) qui en fut à l’origine. Nous nous pencherons sur les écrivains les plus importants et laisserons de côté les ouvrages à caractère non littéraire. Des deux côtés des Pyrénées, c’est la poésie qui fut la plus féconde. Le souffle poétique d’Elizanburu (+1891) ou d’Adema/Zaldubi (+1907)donna ses plus beaux fruits avant le début du XXème siècle, tandis que la prose journalistique d’Hiriart-Urruty fleurit à la fin du XIXème et au début du XXème siècle (+1915). La littérature nord-pyrénéenne doit également à Barbier (+1931) et Oxobi (+1958) de très belles pages de poésie, de fable et de roman. Dans ce dernier genre, signalons l’ouvrage de Barbier intitulé Piarres. Alors qu’au nord des Pyrénées, Euskal Herria renforçait sa tradition littéraire, au sud, la littérature toucha à un plus grand nombre de thèmes et put offrir un éventail plus large de publications. Bilintx (+1876) ne vécut pratiquement pas la perte des "Fueros" mais, après la défaite, Arrese-Beitia (+1906) et Iparragirre (+1881) mirent leur plume au service d’une Renaissance Basque compromise et en proie au doute, pour exprimer en son nom les désirs et frustrations de l’époque. A côté de la poésie et du roman, apparut la littérature politique dans laquelle le problème de la langue revenait comme un leitmotiv. À cet égard, l’œuvre d’Azkue fut déterminante et mérite d’être mentionnée, même si c’est en castillan que son talent littéraire s’exprima avec le plus de vigueur. En revanche, ses ouvrages en euskara offrent un meilleur exemple de synthèse entre valeurs littéraires et fidélité linguistique. Dans le genre romanesque, la palme revient indiscutablement à Txomin Agirre (1864-1920) avec les deux jalons du roman basque que sont Garoa et Kresala.
|
|
Les poètes : Les trois auteurs présentés ci-dessus, Orixe (1888-1961), Lizardi (1896-1933) et Lauaxeta (1905-1937) sont l’élite de toute une génération de poètes. Souvenons-nous de Barne-muinetan (1934) et Euskaldunak (1935, 1950) du premier d’entre eux, et de Biotz-begietan (1932) et Bide Barrijak (1931) pour les deux autres respectivement. Leurs œuvres, si intimement liées aux inquiétudes littéraires de l’époque et au mouvement euskariste, constituèrent une référence obligée pour les générations qui suivirent. |
|
|
Genio y Lengua : Ce livre fut écrit par un écrivain des Ecoles Pies, Justo Maria Mokoroa (Ibar), qui y développa certaines idées littéraires et linguistiques qui occupaient les esprits avant guerre. Il insista notamment sur l’importance que peuvent avoir les œuvres littéraires pour faire revivre une langue. Par ailleurs, cet essai de critique et d’éducation littéraires permit, au moment de sa parution et longtemps après, de retrouver la trace des valeurs les plus précieuses de notre littérature. |
Mais, c’est en poésie que la génération d’avant-guerre atteignit des sommets sur le plan esthétique. Cela ne fut pas un hasard, ni un simple parti pris esthétisant: les poètes d’avant-guerre étaient mûs, avant tout, par la conviction que les belles lettres avaient le pouvoir de redonner son éclat à la langue basque, et de la sauver. Une telle conviction était, en grande partie, le résultat de l’enseignement littéraire d’un professeur jésuite, le père J.M. Estefania (+1942), auteur d’une préface pour Orixe et guide intellectuel du poète Lauaxeta (fusillé, comme García Lorca, par les franquistes, 1937), comme du groupe formé autour de la revue Eusko-Gogoa. Citons aussi l’ouvrage de Mokoroa/Ibar, Genio y Lengua (1936), et l’œuvre critique d’Aitzol qui exerça son talent dans des journaux et la revue Yakintza (1933). Enfin, il convient de rappeler le nom illustre de Lizardi, poète et observateur des phénomènes sociolinguistiques (1896-1933). Au-delà des divergences ou des affinités, tous étaient unis dans la poursuite d’un seul et même but avoué: réunir toutes les conditions culturelles pour assurer la survie de la langue basque.
|
|
L’enseignement littéraire : Au cours des dix dernières années de la Renaissance Basque, l’intérêt pour la littérature se raviva (l’année 1927 vit la célébration de l’Euskeraren Egunak à Mondragón et la fondation de la société Euskeltzaleak). A la lumière de ce qui était arrivé à d’autres langues minoritaires, les tenants du renouveau littéraire commencèrent par adopter une attitude critique vis-à-vis de leurs propres ouvrages. Pour bien comprendre l’état d’esprit qui régnait alors, la revue Yakintza est indispensable. En outre, dans ce courant de remise en valeur de la littérature, la population participait, aux côtés des intellectuels, aux fêtes littéraires qui avaient lieu chaque année dans les villages. Et on se faisait un devoir de faciliter la publication des poèmes primés. |
En effet, pour rendre sa vitalité à l’euskara, il fallait produire une littérature de la plus grande qualité. C’était là le meilleur moyen de rehausser le prestige social du basque, de combattre l’inertie et la haine de soi, et de renforcer l’orgueil linguistique de la communauté bascophone. La littérature orale (bertsolariak) et le théâtre remplirent les mêmes fonctions. Ce dernier, grâce à Soroa (1848-1902) et à Toribio Altzaga (1861-1941), devint une tradition célébrée chaque année à Saint- Sébastien, laquelle se répandit ensuite dans les villages et les vallées où elle trouva un public non négligeable.
|
|
Une langue nationale : Arana Goiri prit conscience, dès son plus jeune âge, de la dimension nationale de la langue. Il publia cet article en 1886 dans la revue Euskal-Erria de Saint-Sébastien. |
Le "bertsolarisme" constitue un phénomène à part. Il s’agissait d’un jeu au cours duquel le poète chantait et improvisait en vers. Cette tradition populaire, qui remonte à une époque ancienne (nous connaissons des bertsoak du XIVème et du XVème siècles), était restée vivante dans les couches les plus modestes de la société où elle trouva un dernier refuge dans les cidreries et tavernes. C’est le travail des chercheurs et des universitaires qui réussit à tirer le bertsolarisme de la marginalisation et le réhabilita aux yeux des intellectuels et, en fin de compte, des masses populaires. Manuel de Lekuona, dans La métrica vasca (1918), dévoila les beautés de ce genre de littérature orale plein de ressources et de possibilités. Tandis qu’il éveillait l’intérêt des universitaires pour cette manifestation du génie basque, José de Ariztimuño "Aitzol" fit le succès des bertsolaris dans le peuple et obtint pour eux prix et récompenses. De même, se multiplièrent les fêtes populaires où la littérature était à l’honneur à travers concours et prix divers. Ainsi furent organisés les Euskararen Egunak, les jours de la poésie ou du théâtre, afin de montrer à tous les richesses d’une littérature en plein renouveau. La FAPE (Fédération d’Action Populaire Euskariste) de la Société d’Etudes Basques ou Euskeltzaleak eurent également le souci de s’ouvrir à la littérature en organisant des mouvements populaires et en aidant les écrivains (non seulement par des prix, mais en finançant parfois des commandes de création littéraire).
|
|
Les associations euskaristes : Avant la guerre, les euskaltzales (= amis de la langue) ressentirent le besoin de s’associer pour rassembler leurs forces. Parallèlement aux travaux académiques d’Euskaltzaindia, il ne fallait pas oublier de renforcer la cohésion fraternelle de la population, et en particulier des jeunes, autour de l’euskara par diverses activités pratiques. Pour cela, la Fédération d’Action Populaire Euskariste fut créée (1928) au sein de la Société d’Etudes Basques. Cette association regroupait six entités: Eskualzaleen Biltzarra, Euskal-Esnalea, Jaungoiko-zale, Euskeraren Adiskideak, Euskeltzaleak et le groupe Baraibar. Ci-contre: comité directeur de l’association: assis au premier rang, F. J. Landaburu, J. M. Barandiaran, B. Etxegarai et A. Apraiz. Debout, un inconnu, Aitzol, Arrue, Espartza et Anabitarte. |
A mesure que les revendications des nationalistes bénéficiaient de nouveaux appuis, en théorie comme en pratique, les partis politiques de tous bords se trouvèrent dans l’obligation de reconsidérer le déséquilibre social qui existait entre les langues de la communauté et, plus concrètement, la place et l’avenir réservés à l’euskara. Aux yeux des intellectuels et des hommes d’Etat, des associations culturelles et des partis politiques, il semblait de plus en plus évident que la situation linguistique d’Euskal Herria dépendait du pouvoir politique, et que celui-ci allait devoir intervenir à l’avenir pour orienter, dans un sens ou l’autre, l’évolution de cette situation.
Nous ne pouvons résumer en quelques lignes le chemin parcouru par tous les partis politiques, mais nous donnerons au moins un aperçu des projets politiques exposés par les euskaristes. Les années 1918-1937 marquèrent une nouvelle étape dans l’histoire des formulations politiques et officielles de la conscience linguistique basque. Depuis la perte des "Fueros" jusqu’à l’obtention du statut d’autonomie, les partis et les institutions consacrèrent bon nombre de textes politiques au problème de la langue.
Il y eut aussi des périodes d’extrême tension: lorsque, par exemple, les Députations envoyèrent au gouvernement leur message relatif aux travaux des Cortès (1917), ou en raison des initiatives extraparlementaires avant et après l’envoi dudit message (1918); à l’occasion du mémoire adressé par la Députation de Gipuzkoa au "Directoire Militaire" (1923-1924); et, sous la République (1931-1937), à propos des différents avant-projets de statut: celui de la Société d’Etudes Basques, celui d’Estella (1931), celui de 1932, celui voté par les provinces basques (1933) et, enfin, celui finalement adopté en 1936.
Parmi tous ces textes, le plus achevé et celui qui nous montre le plus clairement la pensée euskariste est peut-être l’avant-projet de statut rédigé par la Société d’Etudes Basques (1931): "La langue nationale des Basques est l’euskara. Celle-ci sera reconnue comme officielle dans les mêmes conditions que le castillan" (art. 16). L’avantprojet d’Estella utilisa les mêmes termes, mais le suivant fit référence à "la langue d’origine des Basco-Navarrais" (1932). Le projet adopté par les provinces basques (1933) reprend cette dernière définition (art. 11), mais celui approuvé par la République (1936) laissa de côté cette réminiscence de revendication nationale et se limita à reconnaître le caractère officiel de la langue basque (art. 1):"Le basque sera, comme le castillan, la langue officielle du Pays Basque. (...). Dans les relations avec l’Etat espagnol ou ses autorités, la langue officielle sera le castillan".
Passant des positions exprimées spontanément par les abertzales dans le statut d’autonomie aux formules de compromis finales, les hommes politiques acceptèrent donc une définition certes plus consensuelle, mais qui pouvait être considérée comme vidée de son sens par le mouvement euskariste.
Textes sur la politique linguistique|
1915
Et je déclare qu’il m’appartient d’encourager, de pousser et de forcer les cours de justice à accepter cette idée et cette décision selon laquelle il n’y a, en Espagne, d’autre langue officielle que la langue castillane.
M. de BURGOS Y MAZO Ministre de la Justice (Discours prononcé au Sénat)
1923
Tous les maîtres devront enseigner la langue castillane avec volonté et pédagogie, dès le premier jour d’école de l’enfant. (...). À partir de ce moment [cours élémentaire], les maîtres devront toujours s’adresser aux enfants en castillan.
Direction Générale de l’Education (Circulaire du 23-X-1923)
1925
Au cours des visites qu’ils effectueront dans les écoles, les inspecteurs de l’enseignement primaire examineront les livres de textes et, si ceux-ci n’étaient pas écrits en espagnol, les feront retirer immédiatement des mains des enfants, de même qu’ils ouvriront une enquête sur le maître, lequel sera suspendu, ne percevra plus que la moitié de son salaire et fera l’objet d’un rapport auprès de Son Excellence.
Ordonnance royale du 13-X-1925
1932
L’Etat espagnol, qui constitue le pouvoir suprême, n’a qu’une seule langue, l’espagnol, et cette dernière, par voie de conséquence, est celle qui doit prévaloir juridiquement.
J. ORTEGA Y GASSET 27-VI-1932 Euskara, la langue des Basques.
1923
Les médecins, notaires, maîtres d’école, secrétaires de mairie et, d’une façon générale, tous ceux qui occupent un poste de la fonction publique dans une région où se parle couramment le basque, et où cette langue a été déclarée coofficielle, sur la totalité ou une partie de son territoire, devront connaître ladite langue pour exercer leurs fonctions dans les localités où la coofficialité a été instaurée.
LA DEPUTATION DE GIPUZKOA (Mémoire au Directoire Militaire)
1931
La langue nationale des Basques est l’euskara. Celle-ci sera reconnue comme officielle dans les mêmes conditions que le castillan. Dans les écoles des trritoires bascophones du Pays Basque, les enseignants utiliseront les deux langues et respecteront à cet effet les règles fixées par la députation dont dépend le territoire en question. SOCIETE D’ETUDES BASQUES (Avant-projet de Statut Basque: art. 16 et 17)
1936
Le basque sera, comme le castillan, la langue officielle du Pays Basque et, en conséquence, les dispositions officielles à caractère général émanant des pouvoirs autonomes seront rédigées dans les deux langues. Dans les relations avec l’Etat espagnol ou ses autorités, la langue officielle sera le castillan. (...).
Statut d’Autonomie du Pays Basque (Approuvé le 6 -X-1936: Art. 1
L’histoire de l’euskara au cours de ces cinquante années peut se diviser en trois grandes périodes: • 1937-1956: ce sont les années de persécution et d’interdiction de l’après-guerre. Juste après la guerre civile, même l’usage oral de l’euskara était banni, principalement dans les grandes villes. Il était interdit aux intellectuels euskaristes de s’associer ou de tenir des réunions, conformément aux directives générales de la dictature. Dans ce sombre paysage, un événement plus encourageant apportait de temps à autre une lueur d’espoir.
|
|
Euskaristes d’avant-guerre : Cette photographie, prise à l’occasion de l’hommage posthume rendu à Lizardi (Tolosa, 1934), nous permet d’évoquer la mémoire de quelques-uns des euskaltzales d’avant-guerre. La commémoration était présidée par Antonio Garmendia. De gauche à droite: A. M. Labaien, E. Urkiaga "Lauaxeta", N. Ormaetxea "Orixe", Lupe Urkiola, A. Garmendia, Pilar Sansinenea, J. Ariztimuño "Aitzol", D. Ziaurritz et F. Leunda. Aitzol et Lauaxeta furent fusillés deux ans plus tard par les franquistes. Les autres subirent l’exil et l’ostracisme au nom d’une idéologie politique illustrée par le journal ci-dessous (Unidad, 19-III-1937). (Archives photographiques de la Kutxa. Dr. Camino) |
• 1957-1975: c’est une période marquée par l’organisation et le développement des initiatives sociales. Entre 1956 et 1965, la langue basque bénéficia d’un climat dynamique de changement dans lequel quelques actions de résistance culturelle allaient lui fournir un cadre nouveau et plus solide. Cela correspond au réveil du basquisme pionnier regroupé autour de la langue, de la culture et de la politique. • 1976-1988: ce sont les années de la réorganisation des institutions linguistiques, sociales, publiques ou privées. Le nationalisme doit alors faire des choix face à de nouvelles alternatives dont les propositions sont toujours en vigueur.
La communauté bascophone souffrit de l’exil et, au Pays, de toutes sortes d’interdictions. La société basque, culturellement désarmée et niée en tant que nation, fut attaquée de façon éhontée. C’est alors qu’arrivèrent les premiers immigrants de l’après-guerre. Euskal Herria connut ainsi une deuxième vague d’immigration après celle de la fin du XIXème et début du XXème siècle: la province de Biscaye, mais aussi celles de Gipuzkoa, de Navarre et d’Alava se transformèrent en terres d’accueil pour les immigrants. Cette fois non plus, le Pays Basque n’était pas en mesure de communiquer sa langue aux nouveaux venus, en partie à cause de l’inadaptation des canaux de transmission, puisque la seule langue officielle était le castillan.
|
|
Congrès d’Euskaltzaindia (1956) : La première réunion publique d’Euskaltzaindia de l’après-guerre eut lieu à Arantzazu presque vingt ans après la fin du conflit. Ce fut l’occasion d’une rencontre entre la génération des aînés et celle des plus jeunes désireuse de se lancer dans la tâche de redressement linguistique. On peut retrouver sur la photo quelques visages connus: l’académicien A. Irigoyen, l’écrivain M. Zarate, etc. |
Autour des années 1956-1964, la jeune génération qui n’avait pas connu la guerre apporta une nouvelle sève. On note à cette époque une véritable passion pour le fait linguistique basque (revues, groupes, organisations, investissements...), un grand intérêt pour la langue parlée et écrite, un engouement pour l’enseignement, la chanson... Des hebdomadaires et des programmes de radio firent leur apparition... On organisa des semaines ou des quinzaines culturelles, des concours de bertsolaris, des fêtes... Des projets en faveur de l’Ikastola furent lancés, de même que des campagnes d’alphabétisation ou pour la création de l’Université Basque... On reprit l’ancien plan d’unification de la langue... À quoi il faut ajouter la Nouvelle Chanson basque, les maisons d’édition, les foires du livre et du disque basques... L’édition prit un essor sans précédent, ainsi que le journalisme...
|
|
Campagne "Bai Euskarari" (1978) : Pour fêter la fin de la campagne "Bai euskarari" (= Oui à l’euskara), 40.000 personnes se retrouvèrent sur le terrain de football San Mamés de Bilbao. Cette campagne de mobilisation populaire parrainée par Euskaltzaindia eut un remarquable succès, et dépassa en ampleur toutes les manifestations du même type organisées auparavant. |
L’analyse détaillée de tout cela est impossible à faire en quelques pages, aussi nous limiterons-nous à de brèves indications. En outre, devant l’impossibilité de présenter une bibliographie exhaustive sur le sujet, nous nous contenterons de fournir deux références tout à fait accessibles: la revue Jakin, rédigée en basque, a abordé ces dernières années (1977-1991) pratiquement tous les thèmes évoqués, et le lecteur intéressé par une vision panoramique pourra également consulter Euskal Herria. Errealitate eta egitasmo (Jakin, 1985) où il trouvera une bibliographie complémentaire (pages 560-562). L’effet conjugué d’initiatives modestes, mais multiples et courageuses, entraîna -au moment où les mentalités changeaient par rapport à la langue- une évolution prometteuse de la situation culturelle. Les euskaristes s’étaient rarement montrés aussi pleins d’espoir et d’optimisme que vers 1975.
Les années qui ont suivi le franquisme ont signifié développement institutionnel, nouvelles tâches et nouveaux conflits: de plus grands moyens sont désormais à la disposition des Basques pour construire le présent et le futur du Pays. Et la relative ingénuité des premiers moments d’euphorie a laissé la place au réalisme, et parfois même aussi au découragement. Les actions culturelles en faveur de la langue et nombre de leurs animateurs ont reçu, de la part des institutions, un accueil qui ouvre enfin de nouvelles perspectives. Le militantisme linguistique traditionnel continue, mais dans un contexte modifié en profondeur. En matière de coexistence entre les langues, comme dans d’autres domaines de la société, il faudra trouver, de manière consensuelle, les meilleures formes de collaboration et d’aide réciproques. Certes, l’institutionnalisation de la langue basque est devenue une réalité, qui est entrée dans les faits plus ou moins rapidement selon les entités politiques, mais il reste trois tâches fondamentales à accomplir:
1. L’établissement de relations plus cordiales de coopération entre les "euskaltzales" et les institutions publiques, coopération qui, pour diverses raisons, est en train de devenir excessivement conflictuelle. 2. La coordination de toutes les politiques linguistiques des différentes entités administratives d’Euskal Herria pour éviter la dispersion des forces et orienter les efforts vers des activités complémentaires. 3. Enfin, une planification linguistique générale au lieu des mesures qui continueront certainement à être encore appliquées, dans les dix années qui viennent, province par province, c’est-à-dire sans prendre en compte la totalité du Pays Basque.
|
|
Euskaristes emprisonnés et exécutés : Jose de Ariztimuño "Aitzol" (1896-1936), guide spirituel des euskaltzales du temps de la République, fut capturé en mer et exécuté par les franquistes. Ci-dessus: compte rendu de l’arrestation dans El Diario Vasco (17-X-1936).
|
L’oppression linguistique ne commença pas avec le franquisme. Cependant, la dictature poussa à l’extrême la vieille hostilité antibasque, faisant fi de toute considération politique. L’usage de l’euskara, en public comme en privé, fut durement réprimé: les manifestations sociales sur lesquelles un certain contrôle pouvait s’exercer, furent impitoyablement étouffées (festivités, publications, discours, etc.). On fit taire les euskaristes et on les dispersa pour venir à bout de leur résistance en tant que groupe social. Il ne resta bientôt qu’un seul programme politique: le fascisme. Des centaines de textes historiques retracent cette période.
La répression de l’euskara commença par la suppression de tout statut officiel préexistant, dès le début de la guerre et à partir du décret qui déclarait comme rebelles les provinces de Biscaye et de Gipuzkoa (1937). Le basque fut donc privé du caractère officiel que lui conférait le statut de 1936. Les mesures suivantes dépendirent du caprice des vainqueurs et du va-et-vient politique, mais s’inscrivaient toutes dans le cadre de l’idéologie nationaliste espagnole, laquelle préconisait de marginaliser et de châtier une langue (l’euskara) pour tenter d’en imposer une autre (le castillan).
Pour mener à bien cette politique linguistique répressive, le franquisme utilisa tous les moyens qui lui parurent efficaces, y compris les plus mesquins. Les noms de baptême basques furent interdits (car "ils ont une incontestable signification séparatiste" disait-on en 1938), et les bateaux qui s’appelaient "Mendi" durent être rebaptisés "Monte" (’montagne’). À partir du moment où l’euskara n’était plus langue officielle, il allait de soi que toute démarche devait être faite en castillan. Malgré tout, il était difficile d’empêcher complètement les manifestations attentatoires à la pureté linguistique officielle, pour reprendre les termes du législateur, qui "malheureusement" éclataient en public "dépassant le cadre partiellement incoercible de la vie privée". Aussi, cette vie privée basque, qui était à l’évidence la cause de tant de maux, fut-elle prise pour cible à plusieurs reprises.
|
|
Prisonniers à Burgos : En plus des victimes des pelotons d’exécution et des exilés, nous devons nous souvenir de ceux qui furent incarcérés. Comme nous le prouve ce programme des fêtes de Noël, il restait dans les années 1942-43, assez de détenus basques dans la prison de Burgos pour pouvoir organiser ce type d’activités culturelles. |
Le mépris politique et idéologique envers l’euskara et la volonté d’imposer le castillan transparaissent dans les sanctions administratives et les journaux de l’époque. Tous publiaient des textes semblables à celui qui parut dans Unidad de Saint- Sébastien (15-IV-1939): "Dans tous les cafés, dans tous les restaurants, dans toutes les boutiques, dans tous les bureaux, on devrait accrocher des affiches avec ces mots: Si tu es Espagnol, parle espagnol". Au niveau officiel, les gouverneurs diffusèrent la même consigne et proférèrent les mêmes menaces. Celui de Gipuzkoa publia un édit intitulé "Parlez castillan" qu’il justifia succinctement et de façon draconienne en ces termes: "la préoccupation de toute autorité doit être d’éliminer les causes qui tendent à diviser les administrés" (16-IV-1937).
|
|
O.P.E. (1947) : L’Office de Presse du gouvernement basque en exil (Paris) distribuait partout ce bulletin d’information afin de diffuser les nouvelles de la communauté basque. Ce bulletin s’avéra être une source d’information très précieuse, non seulement pour la presse étrangère, mais aussi pour les lecteurs à l’intérieur du Pays. Plus tard, ces feuillets allaient passer de main en main, clandestinement, dans les collèges qui seraient le berceau des nouveaux écrivains. |
|
|
Les publications politiques : Les revues politiques qui virent le jour en Amérique paraissaient généralement en castillan, mais l’habitude fut prise d’y inclure quelques brèves rubriques en euskara. A elles toutes, elles permirent de conserver un lien entre les exilés dispersés, et se firent l’écho de diverses informations relatives à la langue basque. |
Cette politique était sous-tendue par une idéologie plus élaborée qui reposait sur le binôme dans une seule nation = une seule langue (paradoxalement, c’était un véritable écho des expressions de la Révolution Française) Et, comme l’Espagne était identifiée à la Castille, la langue autour de laquelle le projet national espagnol devait s’articuler était précisément le castillan. La vieille idée de Nebrija se retrouvait ainsi mise en pratique, en métropole même, dans la vie de tous les jours. Le but ultime de l’Empire était l’unité de l’Espagne, unité dont le ciment serait une langue unique.
De telles idées eurent des conséquences immédiates en Euskal Herria. Les institutions mises sur pied par les euskaristes après tant d’efforts virent soudain leur avenir anéanti: la plupart disparurent, certaines sombrèrent dans une longue léthargie, mais toutes furent privées de la protection légale et/ou du soutien économique indispensables à une activité normale. Naturellement, celles qui étaient liées aux partis politiques subirent un traitement encore plus dur, de même que s’éteignirent les institutions basques des organismes officiels...
|
|
Gernika (1945) : Les intellectuels qui se virent contraints à l’exil reprirent, dès qu’ils eurent les moyens de vivre, les activités culturelles dont ils s’étaient occupés auparavant. Des personnalités, comme J. M. Barandiaran, Fagoaga, Thalamas, Pikabea ou Hernandorena, lancèrent des publications du style de Gernika et, à ce titre, sont dignes d’honneurs. |
Les exemples de méfaits de cette politique ne manquent pas: la Société d’Études Basques disparut, asphyxiée par l’administration, et ses travaux en faveur de la langue restèrent inachevés; les concours et fêtes populaires allaient se voir refuser aides et autorisations; et quelque dix ou quinze années passèrent avant que l’Académie de la Langue Basque pût, peu à peu, se remettre à ses travaux, tandis que sa revue Euskera ne reprit vraiment sa parution que dans les années 1954-1956.
Dans les années 40, Euskaltzaleak, Zabalkundea, Jaungoiko-zale, entre autres, n’eurent le droit de rien publier. Très épisodiquement, un ecclésiastique, et personne d’autre, parvenait à faire paraître une doctrine ou une neuvaine.
|
|
De Kristau-Ikasbidea (1921) à Cristau-Dotriña (1941) : L’oppression linguistique d’après-guerre n’était pas dépourvue de logique lorsqu’elle allait jusqu’à entraver la normalisation orthographique de l’euskara. Qu’il s’agisse d’ignorance ou de volonté délibérée, le fait est que l’entreprise de normalisation amorcée avant guerre fut interrompue. Il se produisit la même chose en Catalogne avec les éditions de Verdaguer. Ci-contre: les différentes orthographes et terminologies employées dans les manuels de catéchisme avant et après la guerre. |
De plus, les ouvrages n’étaient pas édités en Euskal Herria sud-pyrénéenne, mais à Buenos Aires, Santiago du Chili, Bayonne ou Madrid. La première publication autorisée à bénéficier d’une large diffusion fut l’«Egutegia» d’Arantzazu (1947), et la première œuvre à traiter de l’étude ou de la pratique de la langue basque fut le dictionnaire du père Bera (1948). Vinrent ensuite, dans le domaine spécifique de la littérature, les publications de M. Lekuona (1948) et S. Mitxelena (1949). C’est en 1949, enfin, que la maison d’édition Itxaropena de Zarautz créa la collection Kuliska Sorta.
Toutefois, ces réussites ne pouvaient compenser les pertes subies, ni l’écrasement systématique de toute initiative par les autorités. La presse paraissait intégralement en castillan. Les publications bascologiques d’avant-guerre étaient mortes: la RIEB d’Urquijo, la revue Yakintza d’Aitzol, ainsi que les journaux Argia et Eguna qui comptaient de nombreux lecteurs dans le peuple. Outre la culture écrite, c’était le propre mode de vie basque qui était menacé, de façon honteuse parfois, sous prétexte d’imposer officiellement le monolinguisme. Dans ce contexte figé par la coercition, les maîtres et maîtresses d’école, et tous ceux qui jouaient un certain rôle social (curés, vétérinaires, médecins, pharmaciens) participèrent à la mise en œuvre de la politique officielle au détriment d’une communauté bascophone affaiblie et sans protection légale.
D’après les données publiées par le gouvernement basque, le nombre d’habitants d’Hegoalde qui se réfugièrent en Iparralde ou en France, quand le front nord tomba, s’élève à 150.000. Les Basques prirent le chemin de l’exil en trois grandes vagues successives: à la chute du Gipuzkoa (1936), à la chute de Bilbao (1937) et à la fin de la guerre. Hélas, le malheur de ces gens continua avec la IIème Guerre Mondiale qui devait éclater quelques mois plus tard. Beaucoup de ceux qui n’avaient pas encore quitté l’Europe prirent alors le chemin de l’Amérique et des milliers de bascophones, représentant une partie de la culture basque, s’établirent dans les grandes villes du Nouveau Monde: Santiago du Chili, Buenos Aires, Montevideo, Bogota, Caracas, Mexico, New York et d’autres centres urbains constituèrent dès lors le nouveau cadre de vie des exilés.
Nous ne disposons pas de statistiques (certains organisme spécialisés ont parlé de 125.000 bascophones pour le Continent américain, 1962) ni de travaux de recherche sur les bascophones à cette époque d’émigration, mais nous devons rappeler l’œuvre culturelle accomplie par la diaspora basque. À cet égard, les communautés les plus actives furent celles de Buenos Aires, Caracas et Mexico, ainsi que le groupe du Salvador/Guatemala.
A Buenos Aires, les euskaristes se rassemblèrent autour de la maison d’édition Ekin (1940), créée par P. Irujo et I. López-Mendizabal, dont l’abondant catalogue contient quelques titres en euskara, certes peu nombreux. En revanche, l’une des collections de cet éditeur, sous le nom Euskal Idaztiak, se composait exclusivement de livres en basque, et divers ouvrages sur la langue figuraient également dans deux autres collections (la Biblioteca de Cultura Vasca et Aberri ta Askatasuna). Les romans d’Irazusta (1946-1950) et d’Eizagirre (1948) furent donc publiés à Buenos Aires. À côté de ces publications, il faut rappeler le précieux travail du Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos (1950), revue culturelle de l’exil presque entièrement écrite en espagnol, mais où l’euskara aussi trouva néanmoins une place.
|
|
Gernika/New York (1949-1950) : La célèbre ville de Gernika, bombardée par l’aviation allemande en 1937 (massacre évoqué par P. Picasso dans son "Guernica"), fut remise en mémoire, douze ans plus tard, dans les colonnes du New York Times (1-III-1950) pour un autre motif: le maire de la ville, respectant les consignes du gouverneur, avait fait retirer toutes les insciptions en euskara sur les tombes du cimetière. Comme on peut le voir, le journal américain publia un article à ce sujet. |
Le Mexique et l’Amérique Centrale (Salvador/Guatemala) apportèrent aussi leurs contributions. Sous ces latitudes, aucune maison d’édition semblable à Ekin n’existait mais, grâce à la collaboration de leurs amis basques, Monzon (1945) comme Zaitegi (1945-46) purent y publier leurs premiers travaux. Après les Mexicains, dont l’activité fut d’assez courte durée, les Centro- Américains prirent le relais (1950-1955). Les animateurs de ce foyer d’activités culturelles furent Zaitegi, Orixe et Ibinagabeitia (sans oublier Ametzaga qui, depuis Montevideo, coopérait avec eux). Une fois Zaitegi et Orixe rentrés en Europe, Caracas allait reprendre, dans une certaine mesure, la succession du Guatemala. Une revue comme Eman (1967) ou le livre Iltzaileak (1961) de Martin de Ugalde expriment très clairement les inquiétudes des Basques vénézuéliens.
Durant l’exil des Basques d’Hegoalde, la culture basque écrite trouva principalement refuge au nord même des Pyrénées, pendant les premières années mouvementées de la IIème Guerre Mondiale d’abord, au retour des écrivains basco-américains ensuite. Les Basques d’Iparralde effectuèrent, en effet, un travail considérable de création et de solidarité (Lafitte, Iratzeder, Oxobi, Soubelet ou Xarriton), mais l’œuvre la plus connue et la plus utilisée venue du nord des Pyrénées fut Meza-Bezperak, d’Orixe (1950), qui constitue un modèle admirable de traduction et d’édition de qualité. Bien qu’écrit en Euskal Herria, le livre fut imprimé à Tours, hors du Pays Basque, comme d’autres ouvrages à la même époque. D’ailleurs, hormis les œuvres imprimées à Bayonne ou Biarritz, certaines furent celles publiées à Tours, Toulouse, Vienne ou Lille.
|
|
Les traductions : Les écrivains basques exilés s’occupèrent également de traduire en euskara, outre de courts textes, quelques-uns des chefs-d’œuvre de leur pays d’accueil. C’est ainsi que Jakakortaxarena se chargea de la traduction du poème national argentin Martín Fierro, de J. Hernández (1972). Trente ans plus tôt, Zaitegi avait déjà publié le livre de poèmes Ebangeline, du Nord-Américain Longfellow (1945). |
Pour terminer, rappelons le rôle joué par Paris et Madrid. C’est à Madrid que parurent les trois derniers tomes d’Euskalerriaren Yakintza d’Azkue (1942, 1945, 1947), dans la maison d’édition qui en avait publié le premier volume (Espasa-Calpe).
De Paris, nous parvint une œuvre d’un style complètement nouveau, tant du point de vue littéraire qu’idéologique. La publication du livre de Jon Mirande marquait, en effet, une rupture avec la tradition et les idées en vigueur. Aux côtés de Mirande, un autre jeune auteur, Tx. Peillen, commença sa carrière littéraire à Paris, dans les pages de la revue Igela (1962-1963).
|
|
Euzko-Gogoa (Guatemala, 1950-1955) : C’est l’amour de l’euskara et le travail de ces trois hommes qui donnèrent vie à cette revue créée et imprimée au Guatemala, et dont le titre peut se traduire par "esprit basque": au centre, Jokin Zaitegi (1906-1979); à sa gauche, N. Ormaetxea "Orixe" (1888-1961); et, à droite, Andima Ibinagabeitia (1906-1967). La photo fut prise au Guatemala, alors qu’Orixe était sur le point de rentrer en Europe (1954). |
|
|
La publicité : La normalisation sociale de la langue basque était l’une des préoccupations de l’époque, c’est pourquoi Euzko-Gogoa avait pris l’habitude de publier dans ses pages des réclames de ce type. Il faut surtout retenir l’aspect symbolique de cette démarche pour le moins utopique, car si le Guatemala n’était certes pas un pays uniformément hispanophone, les bascophones ne s’y bousculaient pas... |
Euzko-Gogoa, publication de grande qualité éditée entièrement en euskara, fut la revue basque la plus élaborée et la plus riche jamais parue jusqu’alors, en raison de sa créativité dans le domaine de la poésie et de la prose tant littéraire que didactique, et du grand nombre de ses collaborateurs. C’était l’œuvre de la maturité de ces jeunes jésuites qui durent quitter Euskal Herria avant et après la République. Jusqu’à la parution d’Egan et, plus tard, de Jakin, elle fut le point de rencontre de tous les passionnés de l’euskara, à l’intérieur comme à l’extérieur du Pays Basque. Jokin Zaitegi, l’enfant d’Arrasate (=Mondragón) qui créa la revue au Guatemala, investit ses fonds personnels dans l’entreprise. En plus du travail de publication et de diffusion, Zaitegi se chargea de réunir autour de lui une équipe de collaborateurs qui participaient à la rédaction (Orixe, Ibinagabeitia), tandis que lui-même traduisait de nombreux classiques grecs et écrivait maints essais. C’est donc dans un pays, le Guatemala, qui n’avait pratiquement pas accueilli d’émigrants basques, du moins à une date récente, que s’amorça une œuvre qui allait regrouper les exilés dispersés et offrir un moyen d’expression libre à ceux qui en étaient privés à l’intérieur d’Euskal Herria. Dans les dernières années (1956-1960), la revue fut publiée à Biarritz.
Au total, parurent 44 numéros, soit 3.658 pages de texte, dans deux formats différents. Euzko-Gogoa aborda des domaines encore inexplorés en euskara, essentiellement des thèmes relatifs à l’humanisme, sans oublier les sciences de la nature. La littérature occupait une grande partie de la revue (57%) qui ouvrit aussi ses pages aux exposés de philosophie (3,5%). Cette diversification des thèmes traités répondait à un objectif explicite de la publication et de Zaitegi lui-même: défricher le chemin vers une future université en euskara.
|
|
Depuis Buenos Aires (1950) : Des exilés proches de la maison d’édition Ekin et d’Euskal Etxea aux nobles préoccupations culturelles, et parmi eux des hommes aussi remarquables que J. Garate et I. Gurrutxaga, fondèrent diverses revues consacrées à la recherche bascologique, avec le souci de réunir autour d’eux les Basques dispersés par la guerre et les chercheurs étrangers intéressés par la thématique euskarienne. Ce Boletín parut pendant de longues années. |
Les collaborateurs d’Euzko-Gogoa étaient de tendances et d’origines diverses. Il y eut des prêtres comme Jautarkol, Iratzeder, Kerexeta, S. Mitxelena ou N. Etxaniz, dont certains étaient des nouveaux venus tels San Martin ou Etxaide; des écrivains féconds ou de simples oiseaux de passage. Orixe, Altube ou Leizaola se faisaient l’écho de l’avant-guerre; Mirande ou Peillen apportaient la nouveauté. Lorsque la revue regagna Biarritz, le groupe de ses collaborateurs se diversifia encore, et y participèrent des écrivains de l’intérieur comme Aresti, J. M. Lekuona ou L. Villasante. Comme nous pouvons le voir sur la page de présentation intitulée "Gure asmoak" (= nos objectifs) et publiée quand le groupe quitta le Guatemala pour Euskal Herria, ainsi que dans les éditoriaux de la revue, l’un des buts de celle-ci était précisément de tout éditer en euskara et seulement en euskara, et de rompre de la sorte avec le bilinguisme institué par les publications d’avant-guerre: "Pour la génération d’Euzko-Gogoa, le point capital c’est le Pays Basque, et la solution à son problème c’est l’euskara et uniquement l’euskara. Les générations précédentes n’ont pas posé le problème d’Euskal Herria dans les mêmes termes que nous (...). En résumé: l’euskara, et rien d’autre, doit permettre de le résoudre (...). Cette glorieuse génération est le fruit d’Euzko-Gogoa, c’est une génération nouvelle qui souhaiterait résoudre tous les conflits au moyen de l’euskara". Ainsi s’exprimait Zaitegi, lançant comme un défi et avec rudesse, la cause nationale de la langue basque, et dénonçant comme une traîtrise les positions des nationalistes basques qui, en réalité, n’étaient pas de vrais euskaristes. Le trop petit nombre de souscriptions, problème chronique à toute époque, et l’absence de réponse de la part des lecteurs irritaient Zaitegi au plus haut point. Il est vrai que les abonnés étaient rares: Zaitegi déclare qu’au Mexique et au Venezuela, il n’y avait que cinq à six personnes qui payaient régulièrement leur abonnement (1951). Pour expliquer la situation, Zaitegi avait l’habitude de rappeler les difficultés financières et commerciales qu’avait connu Bizi, l’œuvre de Tx. Irigoien. De plus, il n’était pas simple d’introduire la revue au Pays basque depuis l’étranger, à cause de la frontière et de la censure, mais également parce qu’il s’avérait difficile de sortir de leur torpeur les "euskaltzales" découragés et, pour la plupart, dispersés.
|
|
Aintzina (1942) : Reprenant le nom d’une publication de Lafitte d’avant-guerre (1934), Aintzina, qui abordait plutôt des thèmes politiques, des Basques d’Iparralde créèrent une nouvelle publication à laquelle ils donnèrent, cette fois, une orientation plus culturelle. Motivés par la tragédie qui se déroulait de l’autre côté des Pyrénées et par les réfugiés qui se rassemblaient au nord, les hommes de lettres d’Iparralde (sous la conduite de P. Xarriton et de M. Legasse surtout) eurent à cœur de diffuser cette revue qui parut pendant un an et demi. Ekin (Buenos Aires, 1940) : A Buenos Aires, Ekin a été pendant presque quarante ans la maison d’édition la plus libre et la plus active que la culture basque ait jamais eue à l’étranger. Cette maison, créée par le Navarrais Pello M. Irujo et le Guipuzcoan I. López-Mendizabal, publia après la guerre le premier livre basque d’Amérique Latine (Xabiertxo, 1943). Dans le domaine du roman, le premier ouvrage fut Joañixio, d’Irazusta (1946). |
Comme le rappela J. A. Agirre (Président du Gouvernement Basque, résident à Paris) à l’occasion du vingtième anniversaire du gouvernement basque en exil, des mesures avaient été prises, sous l’égide du Statut d’Autonomie, pour établir des bases solides en faveur du développement de l’euskara. À cet effet, furent créés, par exemple, le Collège Officiel de Professeurs d’Euskara et l’École Normale d’Instituteurs de Langue Basque, hélas disparus au moment de la guerre. Les nationalistes exilés ne manquèrent pas de reprendre, à plusieurs occasions, les revendications linguistiques qui, d’ailleurs, donnèrent lieu à des conflits politiques. Citons tout d’abord le projet de constitution rédigé par le Conseil National Basque de Londres (1941) dans une volonté d’associer le futur d’Euskadi à celui des alliés: l’euskara y était reconnu comme langue nationale d’un futur État basque officiellement bilingue.
|
|
Le Conseil National Basque (1941) : Ce conseil fut constitué à Londres sous la direction d’Irujo, quand le gouvernement basque et son président, fuyant les Allemands, durent entrer dans la clandestinité en Europe ou émigrer en Amérique. Il rédigea un projet de constitution pour une république basque (1941), dans lequel l’euskara était défini comme la langue nationale basque. Ci-contre: P. M. Bilbao, E. Larrabeitia, M. Irujo, J. A. Agirre, A. Onaindia et J. I. Lizaso dans le bureau de la délégation du gouvernement basque à Londres. Archives de la Fondation Culturelle Sabino Arana. |
|
|
Une déclaration historique (1952) : En mai 1952, le père Luis Villasante —futur président d’Euskaltzaindia— prononça au Palais de la Députation de Biscaye son discours de réception à l’Académie de la Langue Basque. Ce fut un événement officiel retentissant. En effet, il revint à l’académicien F. Krutwig de lui répondre. Or sa réponse n’avait aucun rapport direct avec le thème traité dans le discours de Villasante: Krutwig dénonça la politique linguistique injuste suivie par l’Eglise, qu’il condamna explicitement, et en second lieu, par les autorités officielles, ce qui lui valut de devoir prendre le chemin de l’exil quelques jours après son allocution. |
Dans le message de Noël qu’il avait l’habitude d’adresser à la population de l’intérieur, le Lehendakari Agirre évoquait fréquemment le problème de la langue: il demanda aux Basques de s’approprier et d’aimer l’euskara, et d’encourager son usage (1948); il dénonça les préjudices et l’oppression dont souffrait la communauté bascophone (1950); il souligna la nécessité de maintenir notre personnalité linguistique (1951); il décrivit la façon dont était conduite la répression programmée de la langue basque, rappela qu’il appartenait à chacun d’euskariser sa propre personne et son entourage, ou réclama la nomination d’évêques bascophones (1952), etc. Et, les années suivantes, des messages relatifs à l’euskara continuèrent d’être lancés.
|
|
Itxassou (1963) : En Iparralde, le parti Enbata se déclara "abertzale" et constitua pendant plusieurs années (1960-1974) le porte-parole politique le plus sérieux de l’euskarisme. Son programme fut rendu public à l’Aberri-Eguna d’Itxassou (1963), à l’occasion duquel J. Abeberry exposa ses idées principales en matière de politique linguistique, comme l’indique le texte ci-joint. Archives de la Fondation Culturelle Sabino Arana. |
|
|
Le gouvernement basque (1937-1960) : Dans son message de Noël, J. A. Agirre avait l’habitude de toujours insister sur la valeur nationale de l’euskara, et de rappeler que la situation linguistique était l’une des principales préoccupations de la politique basque. Outre qu’il dénonçait le régime de Franco, il lançait un appel à la résistance des Basques et des "euskaltzales". Archives de la Fondation Culturelle Sabino Arana. |
Les protestations officielles, qui dénonçaient les lois et décrets franquistes à l’encontre du basque, parvinrent parfois jusqu’à l’UNESCO. À l’inverse, lorsque les institutions officielles adoptaient des positions plus tolérantes vis-à-vis de l’euskara, Agirre ne se gêna pas pour les applaudir (rappelant la politique des Députations d’Alava et de Navarre) (1957).
Entre-temps, le franquisme se consolidait avec la bienveillance des alliés, tandis que l’impatience des vétérans du militantisme et de la jeune génération se faisait déjà sentir sur le plan politique. À cet égard, les déclarations de Monzon au Congrès Basque Mondial de Paris sont significatives: les hommes politiques basques en exil devaient donner une priorité plus marquée à l’euskara (1956). La culture basque avait commencé à se réveiller et à se propager partout où c’était possible, et les plus passionnés parmi les nouveaux "euskaltzales" ressentaient le besoin de dénoncer le génocide culturel dont souffrait Euskal Herria: l’un d’eux, F. Krutwig, n’hésita pas à attaquer, à l’occasion de la réception de Villasante à l’Euskaltzaindia, les critères pernicieux de l’Église officielle en matière linguistique. En conséquence de quoi, il se vit obligé de se réfugier à l’étranger (1952).
Les propositions des jeunes formations politiques revendiquaient pour Euskadi et sa liberté un avenir national unilingue, laissant de côté les options théoriques plus temporisatrices et politiquement plus négociables: "L’euskara doit être proclamé comme unique langue nationale. Elle doit redevenir la langue de tous les Basques. Sa primauté et son caractère officiel au sein d’Euskadi seront totaux, quitte à instaurer provisoirement un régime trilingue pour tenir compte des réalités linguistiques actuelles" (1962).
Dans les années 60, la revendication linguistique allait être présente dans tous les nouveaux slogans des nationalistes basques. Il ne faut pas oublier non plus les programmes politiques nés dans la partie nord-pyrénéenne d’Euskal Herria (Enbata). Tout cela a contribué à former un courant dans la presse et les programmes des partis politiques jusqu’à ce que, avec la mort du dictateur et l’adoption de la constitution par le Congrès, nous en arrivions aux projets de statut, au Statut d’Autonomie définitif (1979) et à l’"Amejoramiento Foral" de Navarre (1982). Les termes de l’officialisation de la langue basque seront étudiés plus loin.
Textes politiques
1941
Art. 3.- La langue nationale basque est l’euskara. Les langues officielles de l’État basque sont l’euskara et le castillan, dans un régime bilingue. Toutes les dispositions officielles seront publiées dans les deux langues pour être valables.
Conseil National Basque Londres
1949
Faisons croître notre estime et notre amour pour l’euskara, éclairons et éveillons l’esprit et le cœur des jeunes, aidons les patriotes qui sont en prison, suivons les ordres du gouvernement basque et de ses dirigeants [...], soyons basques par la langue et le cœur.
J. A. AGIRRE
Message de Noël
1952
Pourquoi n’utilise-t-on pas l’euskara dans les institutions de l’Église? Cette Église qui, lorsque les Polonais voulurent attaquer la langue lituanienne dans le diocèse de Vilnius, décida que tous les prêtres devaient apprendre le lituanien et le biélorusse, pourquoi envoie-telle des prêtres non bascophones en Euskal Herria? Les Basques seraient-ils les parias de l’Église?
F. KRUTWIG
Membre de l’Académie de la Langue Basque
1956
Regardez donc, il y a quelques jours à peine, 200 écrivains basques se sont réunis sur les hauteurs d’Arantzazu. Je veux donner à ce congrès une vocation: qu’il soit le congrès de l’euskara, qu’on puisse dire que ce congrès célébré à Paris a sauvé l’euskara.
T. MONZON
er Congrès Mondial Basque. Paris
1960
Comme les pierres d’un monument qu’on entretient pour préserver la beauté de leur architecture et le souvenir qu’elles conservent de l’époque à laquelle elles furent taillées, l’euskara, en tant qu’instrument d’évangélisation et de culture indispensable au peuple basque, a un droit devant l’Église et la civilisation, celui de vivre et de prospérer. L’ignorer serait le signe, pour l’Église, d’une absurde contradiction et, pour la société, d’une politique réactionnaire et inhumaine à la limite du génocide.
339 prêtres du Pays Basque
Lettre aux Évêques
1961
Celui qui se voue à l’euskara doit s’y consacrer totalement jusqu’à son dernier souffle, en pleine responsabilité et sans frivolités, avec le plus grand sens pratique, et la connaissance la plus complète et objective qu’il puisse avoir de notre langue, en recueillant le maximum d’informations sur les phénomènes linguistiques dans les autres pays.
J. L. ALVAREZ
"Txillardegi"
1963
Quand nous parlons de langue propre, nous entendons par là langue originale et non ces variantes locales communément appelées "patois" ou "dialectes" selon les endroits. Je crois que, sur ce point, l’euskara est, sans le moindre doute, une langue vivante et originale qui constitue un élément ethnique essentiel.
J. ABEBERRY
Présentation d’Enbata
|
|
Une carte géolinguistique "réticulée" : Jusqu’au siècle dernier, les cartes de l’euskara faisaient apparaître une nette séparation entre les territoires correspondant à chacune des langues (exception faite de deux ou trois grandes villes isolées, plus ou moins hispanophones). Cependant, la présence d’immigrants et d’autres changements d’ordre socio-démographique ont transformé l’aire linguistique basque en un réseau maillé, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, il est possible de trouver partout des enclaves hispanophones unilingues, outre que les euskarophones eux-mêmes sont devenus bilingues. Tout cela suppose, à l’avenir, une planification beaucoup plus soignée. |
|
|
Une chaîne ininterrompue : Vers 1960, rien ne permettait de prédire au bertsolarisme un avenir radieux. Mais, dans les années qui suivirent, le statut du bertsolari se trouva revalorisé, à mesure que les concours et leurs participants gagnaient en qualité et en virtuosité. Les médias et, en particulier, la radio ont tracé un sillon qui porte maintenant ses fruits, au point qu’aujourd’hui, l’ETB (1991) réussit à capter un public de quelque 200.000 téléspectateurs avec son programme "Hitzetik Hortzera". Par ailleurs, l’enseignement traditionnel, et les groupes plus ou moins officiels d’amateurs qui se réunissent dans les académies populaires de bertsolaris, assurent la formation technique de nos futurs poètes et virtuoses de la langue: le bertsolarisme continue à être la fête chantée de l’euskara. |
Au sortir de l’après-guerre (1937-1956), la communauté bascophone vit s’éloigner à l’horizon les sinistres images du passé et se rendit compte qu’une nouvelle génération frappait à la porte. Une jeunesse moins expérimentée, mais plus vigoureuse, faisait son arrivée avec la ferme intention de laisser derrière elle les souvenirs pénibles ou glorieux, et de passer à des actions plus concrètes. Chacun des jeunes euskaltzales -formés pour la plupart dans des centres religieux de haut niveau- s’apprêtait à entreprendre une tâche, modeste ou ambitieuse, pour la résistance linguistique.
L’euskara était devenu un champ d’investigation propice à des expériences culturelles, à la fois nobles et enrichissantes. La nouvelle conscience linguistique des bascophones était admirable et, bien souvent, les plus jeunes devançaient les euskaristes plus âgés. Certes, le choc des générations se faisait sentir, dans les sensibilités et les objectifs, mais le zèle dont chacun faisait preuve ouvrait la voie: au sein de cet effort commun, le développement de la langue basque était perceptible, dans ses propres structures comme dans ses répercussions sociales. Et on reprenait le chemin avec de nouvelles certitudes et de nouvelles audaces.
|
|
Le langage scientifique : Chaque domaine de la science possède son propre langage et, de l’un à l’autre, les différences sont parfois considérables. Lorsqu’une langue est utilisée pour la première fois dans un domaine scientifique particulier, les difficultés d’adaptation sont sérieuses. Cette évolution de la langue peut faire l’objet de propositions de la part des techniciens, mais seuls l’école et les médias sont en mesure d’assurer la diffusion des nouvelles expressions et des nouveaux termes au sein de la société. Grâce aux efforts de certains, l’euskara a fait, dans ce secteur, des progrès encourageants durant ces vingt-cinq dernières années. |
|
|
Uhin Berri (1969) : A la fin des années 60, un souci de renouveau commença à se faire sentir dans la littérature basque, et les jeunes écrivains s’essayèrent à des formes littéraires plus modernes. Cette anthologie de J. San Martin rassemble quelques-unes des preuves de cette évolution. |
Le réveil des consciences et la résurgence des désirs entraînèrent un redressement linguistique dans de nombreux secteurs de la société: sur le plan de l’enseignement, on construisit l’Ikastola; en matière de communication, les Radios Populares commencèrent à gagner du terrain sur les radios castillanes; les groupes de txistularis, sur le point de disparaître, ressurgirent avec force... Dans tous ces domaines, et dans beaucoup d’autres, les échanges sociaux en relation avec la langue s’intensifièrent. Parallèlement aux changements sociaux, l’attitude à l’égard de l’euskara commença à évoluer: à mesure que le mouvement progressait, les petits succès et les grandes réussites conféraient au basque de nouveaux attraits. Cette langue à retrouver, c’était aussi la patrie des libertés rêvées...
Chaque parcelle de terrain gagnée au profit de l’euskara servait de base pour en conquérir une autre, ou à forcer le militant découragé à poursuivre le combat. La cause se propageait de village en village, et l’on finissait toujours par trouver les moyens financiers et matériels nécessaires, même si c’était difficile et souvent risqué.
|
|
La communauté bascophone (1981-1986) : Comme l’indiquent les données sociologiques recueillies au cours des recensements effectués dans la Communauté Autonome Basque, certains changements se sont produits ces dernières années parmi les bascophones. Il suffit de prendre connaissance du second graphique pour constater une évolution. Mais, tant que toutes les informations ne seront pas étudiées en détail, il sera difficile de saisir la signification profonde de ces phénomènes. |
|
|
Elbire Zipitria (1906-1982) : Sur cette photo prise vers 1960, nous reconnaissons Elbire Zipitria (Zumaia 1906 - Saint-Sébastien 1982) qui ouvrit la première ikastola de l’après-guerre. Elle est entourée de ses élèves et de leurs parents, à l’occasion d’une journée à la montagne. |
Les divers domaines d’application du basque, sur le plan social, faisaient nettement apparaître la nécessité d’adapter la langue écrite à ses nouvelles fonctions. Les usages de plus en plus modernes de l’euskara, et le désir d’une langue commune à tous les euskarophones, rendaient indispensable l’unification générale du basque. C’est pourquoi la résistance culturelle insista sur l’urgence d’une langue standard. Les confusions idéologiques qu’une telle initiative suscite généralement ne manquèrent pas de se produire au Pays basque, comme ce fut le cas ailleurs. Mais, cela ne nous fit pas perdre de vue une unification considérée par tous comme impérative.
Cet activisme culturel permit aux revues et aux cercles bibliophiles de voir le nombre de leurs abonnés augmenter par milliers dans toute l’Euskal Herria. Les maisons d’édition basques se développaient année après année: les livres se multipliaient, les éditeurs prenaient de l’importance, les thèmes se diversifiaient. Entre 1956 et 1970, furent jetées les bases des progrès rapides à venir. Bien qu’encore modestes et fragiles, les structures sociales de la culture écrite se mirent en place peu à peu, à travers l’organisation de maisons d’édition, de groupes d’écrivains et de canaux de distribution.
Les activités artistiques en euskara, qui sont autant de célébrations de la langue, prirent à cette période un essor inattendu: la Nouvelle Chanson basque (Kanta Berria) vit le jour, et les bertsolaris chantèrent de nouveau sur les places pour le plus grand plaisir des foules. Pour la première fois, ces formes de créativité linguistique trouvèrent, dans les stations de radio, un moyen de diffusion à grande échelle. Puis furent enregistrés les premiers disques et bandes magnétiques.
|
|
L’Ikastola en Iparralde (1969) : Mettre sur pied les ikastolas en Iparralde s’avère plus difficile encore qu’au sud des Pyrénées dans la mesure où, pour utiliser des termes politiques, le nationalisme y est moins bien implanté socialement, et l’intransigeance de l’Etat français à l’égard des langues de l’Hexagone n’a pratiquement jamais fléchi. Les ikastolas d’Iparralde sont regroupées au sein de l’association Seaska. La première ouvrit ses portes en 1969 (Arcangues) et leur nombre s’élevait à 20 en 1988, avec un total de 1.000 élèves en 1991. L’aide officielle accordée aux ikastolas se résume aux chiffres suivants (1991): Seaska a reçu 60.000 FF du Ministère de l’Education (Paris) et 250.000 FF du Conseil Général du Département (Culture); les municipalités du Pays Basque Nord ont, quant à elles, débloqué 700.000 FF répartis entre les ikastolas. Pour compenser l’insuffisante prise en charge de la part des autorités, les Basques de la zone sous administration française organisent depuis 1984, à Saint-Pée-sur-Nivelle, une manifestation populaire de soutien financier, la fête d’Herri Urrats. |
La scolarisation eut pour effet, outre d’éduquer les enfants en basque, de faire entrer le problème linguistique dans les foyers: d’abord, les rédactions, la lecture et les devoirs faits en famille permirent aux adultes de se former; ensuite, la nécessité de se préoccuper de la gestion et des aspects économiques du centre scolaire stimula la participation de tous... La polémique sur l’euskara normalisé (euskara batua) entra chez les Basques par cette même porte. Dans les débats et les activités sociales, dans les classes et les réunions, le professeur basque devint un personnage populaire et digne de respect, au même titre que le curé, le pharmacien ou le médecin d’autrefois. Il symbolisait aussi l’honneur de la langue.
Dans un souci d’appréhender la trajectoire historique et culturelle du peuple basque, et de gagner la population à la cause du redressement linguistique, des euskaristes multiplièrent les conférences, semaines et quinzaines culturelles dans les villes et les villages. Les auditeurs étaient rarement nombreux, mais l’expérience porta ses fruits: parmi les promoteurs de ces initiatives, certains devinrent d’infatigables activistes et, en revanche, ceux qui se lassaient étaient vite remplacés par des troupes fraîches. Il s’agissait là d’un véritable militantisme.
Ainsi continua-t-on d’avancer, conscients ou non du changement qui était en train de se produire, tandis que la culture basque prenait très vite de plus en plus d’ampleur, relativement bien sûr, au sein de la société.
Les relations et contacts entre l’école et l’euskara, après guerre, sont passés par trois étapes distinctes: la première couvre la période qui va de la guerre jusqu’aux premières ikastolas (1937-1960); la deuxième correspond à la phase de développement de l’Ikastola (1961-1975); et la troisième marque l’entrée officielle de la langue basque dans tout le système éducatif. Chacune de ces périodes a donné lieu à des problèmes spécifiques.
|
|
La construction des ikastolas : La société basque apporta un soutien sans faille au projet d’Ikastola, comme l’atteste le nombre de centres et d’élèves en constante augmentation chaque année. La volonté des Basques fut d’autant plus grande qu’ils devaient lutter contre la méfiance des autorités, et surmonter les obstacles légaux que celles-ci mettaient continuellement sur leur route. En outre, la construction de ces établissements scolaires, qui relevait d’une initiative privée, supposa d’importants investissements financiers. |
En ce qui concerne les deux premières décennies, nous devrions plutôt parler de l’absence de l’euskara à l’école. En effet, la législation franquiste interdisait le basque de façon explicite, le système éducatif et son contrôle constituant l’un des instruments idéologiques auxquels le régime accordait le plus d’attention. Le professeur de ce qu’il était convenu d’appeler l’"Ecole Nationale" fut donc perçu, dans nos villages bascophones, comme le symbole même du système hispanisateur. Les lois, mais aussi les inspecteurs veillaient scrupuleusement à ce que l’institution exerçât pleinement sa fonction répressive.
|
|
Les textes scolaires en euskara : Quand les ikastolas ouvrirent leurs portes, élèves et professeurs se retrouvèrent sans aucun livre de classe en basque, ou alors avec les rares ouvrages édités avant guerre pour les petites classes. Ce manque n’a pas été le moindre des problèmes que l’institution dut affronter, et il fallut plusieurs années pour rattraper partiellement ce retard. Aujourd’hui encore, une grande partie du matériel nécessaire dans le secondaire fait défaut. Néanmoins, le développement relatif de la culture basque a permis de faire quelques progrès décisifs au cours des dernières années. Ce catalogue d’EIMA (1986), qui présente la liste des matériels pédagogiques actuellement disponibles en euskara, en est la preuve. L’édition de textes scolaires basques est ainsi passée de ces livres d’avant-guerre tant décriés, mais aussi sans prétention, aux volumineux ouvrages que nous connaissons de nos jours. |
De plus, il ne vint jamais à l’esprit des responsables politiques ou du ministre de l’éducation de l’époque -à l’inverse de ce qui s’était produit, dans une certaine mesure, avec les carlistes au XIXème siècle- qu’aider l’euskara aurait pu leur être utile pour diffuser l’idéologie du régime. L’euskara, considéré comme incompatible avec l’idéologie dominante, ne pouvait, par conséquent, s’intégrer dans le projet national défendu par le pouvoir. Cette conception trouvait son expression dans les lois (auxquelles quelques nuances furent apportées à partir de 1970) qui visaient essentiellement à nier la réalité sociolinguistique existante et à renforcer l’enseignement exclusif du castillan (1945, 1967 pour le primaire; 1938, 1944 pour le secondaire). Pendant exactement trente ans (1937-1967), l’euskara n’eut aucune possibilité légale d’entrer à l’école, et c’est justement pour lutter contre cette injustice que l’Ikastola fut créée, sans la moindre protection officielle.
|
|
Structure du système éducatif : Dans les cours scolaires choisis du système éducatif (Centres publics + Ecoles privées + Ikastolas: CAB et Navarre), les élèves étaient répartis selon les pourcentages indiqués. |
La première ikastola fut organisée à Saint-Sébastien sous la houlette de l’institutrice Elbire Zipitria (1954) et, trois ans plus tard, une deuxième fit son apparition à Bilbao sous la direction du professeur J. Berrojalbiz (1957). En plus de ses fonctions d’institutrice et d’éducatrice, Elbire forma également les futures andereños (= maîtresses d’école basques). Au début, ces ikastolas avaient le statut légal d’écoles privées: elles regroupaient dix à quinze élèves chez des particuliers afin de pouvoir échapper aux sanctions et aux fermetures. Mais, bientôt, le succès même de l’expérience imposa de trouver des structures moins précaires. Dans les ikastolas, on prit toujours grand soin de préserver la qualité et la renommée du travail scolaire. Ce faisant, et à l’aide de mille autres subterfuges, un écueil de taille put être évité: celui des livrets scolaires.
|
|
Les Ikastolas (1960-1986) : Les ikastolas constituent, sans doute, un phénomène socio-historique intéressant. A partir des informations fournies par les centres scolaires et les élèves, nous avons réuni dans ces deux graphiques les données les plus significatives de son évolution, en tenant compte de l’ensemble des territoires historiques d’Euskal Herria. |
|
|
Les modèles linguistiques d’enseignement : Le lecteur trouvera ci-dessus la définition des modèles linguistiques. Le premier graphique illustre l’évolution de chacun des modèles dans les établissements publics du Pays Basque, ainsi que leur importance relative (1979-1991). Sur le second graphique, figurent l’ensemble du système éducatif (public + privé + ikastola) et les chiffres correspondant à chaque secteur (1990-1991).
|
Après ces débuts modestes, l’Ikastola prit un essor spectaculaire à partir de 1960, d’abord en Gipuzkoa (Orixe, 1958), puis en Biscaye (R. M. Azkue, 1958/Lauro, 1972), et plus tard en Navarre (1964), Alava (Olabide, 1963) et Iparralde (1969). Les élèves étaient de plus en plus nombreux, ce qui posa d’autres types de problèmes dont voici les plus importants: la nécessité de transformer des locaux ou de construire de nouveaux établissements; la formation et la sélection des futurs professeurs; le manque de textes appropriés; et, à certains moments, le débat idéologique, politique et pédagogique qui fit de l’Ikastola une institution créative certes, mais agitée et conflictuelle. À cet égard, les années 70 furent particulièrement mouvementées mais, en dépit des ruptures, l’Ikastola poursuivit son chemin tant bien que mal: ces centres scolaires, qui avaient surgi du néant en 1958, comptaient en 1986 presque 80.000 élèves.
Dans le cadre du système éducatif général, c’est en Gipuzkoa que le pourcentage d’élèves scolarisés dans l’Ikastola a été le plus fort: 24,3% (1985-1986). Pour les provinces de Biscaye et d’Alava, les chiffres sont plus modestes (7,7% et 5,7% respectivement, pour la même année scolaire). En Navarre, le pourcentage a atteint 9,4% en 1988-1989 pour redescendre à 6,48% en 1990-1991.
A la lecture de ces chiffres, nous constatons que la grande majorité des élèves sont scolarisés en dehors du réseau d’ikastolas: suivent les cours du système public ou privé 87,2% des enfants de la CAB (1985-1986), ainsi que 93,52% des petits Navarrais (maternelle et primaire: 1988-1989, en tenant compte du fait que les ikastolas municipales de Pampelune et Elizondo sont considérées par la LOGSE comme des centres publics). Aussi estil absolument nécessaire de faire entrer l’euskara dans l’enseignement public et privé, si l’on veut renforcer sa présence dans l’ensemble du système éducatif. C’est précisément ce que l’officialisation du basque tente de faire dans ce domaine.
Pour pouvoir introduire l’euskara dans toutes les écoles, conformément aux dispositions légales, la Communauté Autonome Basque a défini trois modèles linguistiques en fonction du degré d’utilisation du basque: dans le modèle D, l’enseignement est dispensé en euskara, à l’exception des cours de langue espagnole; en revanche, dans le modèle B, l’enseignement est partagé entre les deux langues; enfin, dans le modèle A, l’enseignement est dispensé en castillan, avec en plus des cours de langue basque. Le modèle X, sans euskara, représente un pourcentage résiduel.
|
|
L’Université (1987) : L’euskara a fait son entrée à l’université. Cela a été rendu possible, essentiellement, par le développement de l’enseignement pré-universitaire, ainsi que par les réunions et publications extra-universitaires. L’Université du Pays Basque est l’institution qui, jusqu’à maintenant, a accordé le plus d’attention à l’euskara, même si elle reste fondamentalement hispanophone. Grâce aux "euskaltzales" parmi les professeurs et les étudiants, l’enseignement est dispensé en basque dans quelques instituts et à certains niveaux, en accord avec les décisions du conseil d’université. D’ailleurs, un plan quinquennal est en cours d’application pour aboutir à la normalisation linguistique de l’UPB/EHU (1990-1991). Ci-contre: l’enseignement universitaire d’après les totaux et pourcentages des cours par langues dans les divers Campus d’UPB/EHU. Tous les cours dispensés en euskara le sont également en castillan, à l’exception des cours spécifiques à la langue basque. En revanche, sur un total de 1.565 cours programmés à l’UPV, 1.061 ne sont donnés qu’en castillan. Il n’existe donc, actuellement, aucune possibilité pratique d’enseignement en euskara pour 67,8% du programme universitaire. |
D’après les informations fournies par les inscriptions dans la CAB, la répartition des élèves par modèle, pour l’année scolaire 1990-1991, est la suivante: les modèles B/D représentent 49,36% des élèves, et le modèle À 49,47%, le modèle X ne dépassant pas 1,17%. Les graphiques joints illustrent cette situation et son évolution d’année en année (1983-1991). Les résultats quantitatifs de ces dix ans de travail, qui témoignent d’une progression générale, peuvent être consultés dans le rapport du Service d’Euskara du Département de l’Education du Gouvernement Basque intitulé 10 Urte. 10 Años de Enseñanza bilingüe.
La Navarre a également créé différents modèles linguistiques (19-V-1988) pour la maternelle, le primaire, le secondaire et la formation professionnelle. L’enseignement de l’euskara est obligatoire dans la zone bascophone. En revanche, l’enseignement en euskara repose sur la base du volontariat et se définit en fonction de l’aire linguistique (bascophone/mixte/hispanophone). Dans la zone dite bascophone, deux modèles sont en vigueur: le modèle B, dans lequel l’enseignement est dispensé en euskara, le castillan constituant une matière parmi d’autres, dans toutes les classes du cycle d’études, et servant de langue véhiculaire pour un ou deux cours; le modèle D, dans lequel l’enseignement se fait entièrement en euskara dans toutes les classes et les matières, à l’exception du cours de castillan. Ces deux modèles peuvent aussi s’appliquer à la zone mixte si, au cas où les parents ou les élèves le demanderaient, l’administration en décide ainsi (rappelons que l’enseignement de l’euskara ne répond pas à une obligation mais à un volontariat).
Voici les chiffres portant sur les écoles publiques et ikastolas de Navarre pour l’année scolaire 1990-1991: en maternelle et dans le primaire, 10.569 élèves (14,77%) suivent les cours des modèles B/D et, dans le secondaire, 1.754 sont inscrits dans le modèle D. En ce qui concerne la zone hispanophone, la loi ne prévoit pas la possibilité de dispenser un enseignement en euskara, et la langue basque ne représente qu’une matière facultative. La structure du système éducatif navarrais repose donc sur une synthèse des modèles et des zones linguistiques.
La bilinguisation du système éducatif a commencé par les premiers niveaux de la scolarité, et il n’est pas étonnant qu’en Navarre et dans la Communauté Autonome Basque, l’euskara soit beaucoup moins présent dans les classes audessus du primaire (secondaire et supérieur), ou que le basque dispose de moins de moyens comparativement au castillan (dans le secondaire, par exemple, les livres de textes et autres matériels pédagogiques sont moins abondants). Et, avec la réforme de l’enseignement en cours dans l’Etat espagnol, la situation risque de s’aggraver. L’introduction de l’euskara à l’université présente des difficultés supplémentaires et constitue désormais un véritable défi. Les euskaltzales travaillent sur deux ou trois fronts pour parvenir, d’une part, à adapter la langue à l’enseignement supérieur et, d’autre part, à assurer la formation au plus haut niveau: c’est le rôle des groupes ou mouvements universitaires comme l’UEU, Elhuyar ou l’UZEI, des séminaires et groupes de travail de l’université privée, et des collectifs de professeurs et d’élèves de l’université publique. L’Université du Pays Basque/Euskal Herriko Unibertsitatea, fonctionne en général, en castillan mais comprend un vice-rectorat chargé des affaires concernant l’euskara, ainsi que quelques filières en basque dans le premier cycle de nombre de facultés. En 1990, ce vice-rectorat a élaboré, pour l’université publique, un "Plan de Normalisation de l’Usage de l’Euskara" sur les cinq prochaines années. En Navarre, la présence de l’euskara au niveau universitaire est conditionnée par le petit nombre d’étudiants et leur dispersion. Les chiffres et pourcentages figurant dans le tableau ci-joint permettent de tracer le profil linguistique global de l’Université du Pays Basque (EHU/UPV) en fonction de la langue d’enseignement utilisée dans les cours (graphique).
Il va sans dire que l’histoire des médias au Pays Basque n’est pas l’histoire des médias en euskara. Dans le domaine de la communication, deux mondes, l’un hispanophone ou francophone, l’autre bascophone, ont coexisté en se tournant le dos (1937-1975). Naturellement, ce qui nous intéresse, en premier lieu, est de savoir comment l’euskara est venu aux médias, mais aussi comment et pourquoi, après la guerre civile, il en a été écarté pendant des décennies: en effet, tous les médias d’Euskal Herria étaient entièrement hispanophones, et la place ridicule qui était parfois laissée à l’euskara servait précisément à souligner son peu d’importance.
|
|
La Presse en euskara : Au cours des quarante dernières années, la presse écrite au Pays Basque a été majoritairement hispanophone. Il a toutefois existé une presse hebdomadaire en basque dont deux titres méritent d’être signalés pour leur longévité et leur diffusion: Herria (1944) de Bayonne et, en Hegoalde, Zeruko Argia (1963) qui allait devenir Argia en 1988. Ces revues ont été, dans les quinze dernières années du franquisme, la voix et l’école de la culture basque. |
Comme dans le reste de l’Etat espagnol, la victoire du franquisme par les armes bouleversa complètement la situation des moyens d’information du Pays Basque: dans les quatre capitales d’Hegoalde, quatorze journaux disparurent et seulement dix continuèrent à paraître. En outre, sous l’influence du régime triomphant, de nouveaux titres firent leur apparition: deux à Saint-Sébastien et deux autres à Bilbao. Bien sûr, aucun d’eux ne fit la moindre place à l’euskara. Une censure stricte se chargeant de bâillonner la langue basque, parfois sans aucune raison, l’affaire était considérée comme réglée.
|
|
Egunkaria (1990) : C’est actuellement le seul quotidien basque rédigé intégralement en euskara (le second dans l’histoire de notre journalisme). Publié à Saint-Sébastien, il bénéficie d’une large diffusion. Eguna, le premier quotidien en basque, parut à Bilbao en pleine guerre civile (1937) sous la direction de M. Ziarsolo "Abeletxe" et d’Agustín Zubikarai, et avec la précieuse collaboration d’E. Erkiaga. J. M. Arizmendiarrieta, qui, des années plus tard, allait devenir le mentor du "Cooperativismo Mondragonés", fit également partie de ce petit comité de rédaction. |
|
|
Arrasate Press (1988) : Cet hebdomadaire, principalement consacré à la vie locale et régionale, a vu le jour à Arrasate/Mondragón dans le cadre d’un projet civique d’euskarisation et de normalisation sociolinguistique, et avec le soutien officiel de la municipalité. Ces dernières années, le journalisme local a pris un essor inattendu qui est l’expression du dynamisme de groupes de travail certes modestes, mais entreprenants. |
Les graphies basques et les noms de baptême euskariens étaient rigoureusement interdits et, si l’on voulait faire paraître un faire-part en basque dans un quelconque journal, il fallait en payer un autre en castillan. Jusqu’en 1962, aucun article en euskara ne fut autorisé, lorsque cette année-là, pour la première fois, le Diario Vasco publia en basque... les prix de la foire hebdomadaire d’Ordizia! Plus tard, le Diario de Navarra allait commencer à inclure dans ses numéros une page en euskara (1966: "Nafar izkuntzan orria"). C’est également à partir de 1966 que le "bertsolari" et journaliste Basarri va tenir sa rubrique quotidienne dans La Voz de España.
Mais ces petites oasis de liberté étaient cependant pénalisées sur le plan économique: la page en euskara qui paraissait dans le Diario Vasco de Saint-Sébastien, dès 1969, n’était pas financée par le journal, mais par les euskaltzales. À partir de cette date, quelques journaux ici et là se mirent à publier de très courtes rubriques en basque. Par ailleurs, les auteurs de ces pages spéciales n’étaient pas journalistes, ce qui n’a rien d’étonnant: en effet, une enquête réalisée en 1976 montre que, parmi tous les directeurs de journaux, pas un ne connaissait la langue basque et que, sur les 178 journalistes interrogés, sept à peine comprenaient et parlaient l’euskara.
|
|
Les interdictions administratives : Briser le monopole du castillan sur les médias, au niveau légal comme dans les faits, ne fut pas une tâche facile. L’administration s’acharnait à mettre des bâtons dans les roues des euskaltzales avec un zèle plein de méfiance (en effet, l’apparition de l’euskara sur les ondes rendait l’exercice de la censure plus difficile). Ci-contre: les accusations formulées contre Radio Popular de Loiola. Les sanctions portent sur le fait d’être sorti du cadre réservé à l’euskara et d’avoir diffusé quelques chansons basques non autorisées. |
A côté de ce désert dans le secteur des quotidiens, la presse écrite basque prenait forme dans les périodiques: Herria (1944) en Iparralde, la nouvelle formule de Zeruko Argia à Saint-Sébastien (1963), la revue bimensuelle Anaitasuna (1967) et l’hebdomadaire Agur (1972) à Bilbao, et enfin l’hebdomadaire Goiz-Argi de Saint- Sébastien (1974). Les quotidiens Egin et Deia, nés après le franquisme, allaient bientôt offrir à l’euskara un espace journalier et, presque dix ans plus tard, paraîtraient des hebdomadaires au format "quotidien", ou des suppléments spéciaux en langue basque de telle ou telle publication: Hemen (1986), Eguna (1986), Zabalik (1986). L’automne 1990 nous a apporté une nouveauté importante avec l’apparition d’un quotidien totalement en euskara: Euskaldunon Egunkaria.
A cet égard, l’hebdomadaire Argia est le seul qui, fidèle à son orientation, a poursuivi ses travaux de façon assidue tout en touchant un public accru. Dans la mesure où les lecteurs basques se fidélisent et où le journalisme écrit mûrit, nous approchons petit à petit d’une normalisation linguistique dans le domaine de la presse écrite.
Abordons maintenant la presse parlée, et plus particulièrement la radio. Pour les raisons citées plus haut, toutes les radios du Pays Basque d’après-guerre, à savoir SER, Radio Nacional et Radio Cadena Española, étaient hispanophones unilingues. Ce monopole linguistique allait se briser en 1950, avec les premières émissions destinées au monde rural, les célébrations religieuses ou les retransmissions de sports populaires basques volontairement marquées par la diglossie.
|
|
De nouveaux hebdomadaires : Récemment, l’expérience a été tentée de faire paraître des hebdomadaires, comme un ballon d’essai pour une éventuelle presse quotidienne en euskara, qui serait probablement financée par des fonds publics: Eguna, Hemen (1986). Il existe également les pages et suppléments spéciaux en langue basque des journaux en castillan, comme Zabalik (1986...) du Diario Vasco de Saint-Sébastien. Mais, nous ne devons pas oublier la persévérance et les progrès constants d’Argia, qui a toujours été conçu comme une publication hebdomadaire. |
Bientôt, dans les années 1956-1959, les "Herri Irratiak" (Radios Populaires), créées par l’Eglise sous l’égide du concordat, modifièrent le paysage radiophonique: par exemple, à Segura (1956), Tolosa, Loiola, Arrasate ou Arrate (1959) en Gipuzkoa; Barakaldo en Biscaye; Beruete ou Irurita en Navarre. Il s’agissait fondamentalement de radios religieuses, mais l’euskara s’en accommoda assez vite. La première station qui commença à émettre des programmes complets en basque fut celle de Loiola (1961). Toutefois, à une occasion au moins (1964-1966), les autorités mirent rapidement un terme à ses velléités euskariennes.
Presque à la même période, la plupart des petites stations furent contraintes au silence par l’article 2 de la loi sur la presse de 1966. Les autres durent changer de fréquence et continuer leur travail dans des conditions particulièrement pénibles. Les restrictions linguistiques imposées par l’administration étaient draconiennes. Dans un premier temps (22-X-1964), l’usage de l’euskara fut strictement interdit sur les ondes de Radio Popular de Loiola. Ce n’est qu’après de difficiles négociations que cette station fut autorisée à émettre avec une marge de manœuvre extrêmement limitée: le basque ne pouvait s’utiliser que dans un programme par semaine, et dans deux autres émissions religieuses, quant à la publicité en euskara, elle était censurée. Mais, la vie triompha de l’administration, quand la radio basque fut enfin reconnue majeure à l’occasion de la célébration des "24 Orduak Euskaraz" (= 24 heures en euskara) le 27 mars 1976.
Après l’instauration de l’autonomie dans la CAB (1979), le gouvernement basque créa l’EITB (1982) et, au sein de cette entité, Euskadi Irratia et Euskal Telebista (ETB, 1982). La place de l’euskara dans ces nouvelles structures peut se définir comme suit: en 1992, les émissions d’ETB-1, la chaîne en basque d’Euskal Telebista, représentent 4.290 heures de programmation. Sur les 6,4 milliards de pesetas du budget d’ETB en 1989, 3,9 étaient destinés à ETB-1. Pour la radio, Euskadi Irratia émet vingt-quatre heures sur vingt-quatre en basque à Saint- Sébastien, tandis que la station jumelle de Bilbao émet presque exclusivement en castillan. Euskadi Irratia (entièrement en euskara) et Radio Euskadi (majoritairement en castillan) reçoivent chacune environ la moitié du budget d’Eusko Irratia qui s’élève, en 1992, à 1.268 millions de pesetas.
En Navarre, l’audience d’Euskalerria Irratia (Pampelune, 1988), de Xorroxin Irratia (Elizondo, 1989) et de Aralar Irratia (Lekunberri, 1991) -les deux dernières stations étant plutôt des radios locales que régionales- est en progression constante et, comme le Gouvernement Foral les avait oubliées dans sa répartition des fréquences (1990), des négociations se sont ouvertes et se poursuivent toujours à l’heure actuelle (décembre 1991).
Il ne faut pas oublier que, sur d’autres stations, les émissions en euskara occupent une part importante de la programmation. C’est le cas de Egin Irratia, Gipuzkoa Herri Irratia, Segura Irratia, Arrate Irratia, Bizkaia Irratia, Iruñeko Herri Irratia, etc.
Enfin, des stations de radio basques sont nées aussi en Iparralde, comme Gure Irratia (1981) à Villefranque, Irulegiko Irratia (1982) et Xiberoko Botza (1982), qui diffusent des programmes très complets, voire presque entièrement en euskara. Rappelons, pour terminer, qu’en 1988, quelque 47 radios libres émettaient au Pays Basque et que la langue basque est présente, à des niveaux divers, sur les ondes de la plupart d’entre elles.
Année après année, la communauté bascophone conquiert de nouveaux espaces pour l’euskara. Les acquis, à ce jour, sont indéniables, mais la majeure partie des moyens de communication audiovisuelle, et même de la presse écrite, reste essentiellement castillane. Aujourd’hui, les médias qui dépendent de Paris et Madrid semblent percevoir, quoique très tardivement, l’intérêt d’un service en euskara: par exemple, RNE a émis sur Radio Cuatro (FM) un programme quotidien de six heures en euskara (jusqu’en août 1991) qui s’est poursuivi, à une échelle plus modeste, sur RNE-1 et RNE-5 (janvier 1992). Mais, d’une façon générale, les obstacles à la normalisation linguistique sont plus évidents dans ce secteur dirigé depuis l’extérieur.
D’une façon générale, l’autonomie a ouvert de nouvelles perspectives, tant dans la presse écrite que parlée. Pourtant, on n’est pas encore parvenu à définir et mettre en pratique la normalisation indispensable pour le futur. Aussi, les années à venir -celles que nous vivons déjà- seront-elles vraiment décisives pour le monde de la communication en euskara.
|
|
Egan (1948. 1954) : La revue culturelle Egan, publiée en annexe du Boletín de la Société d’Amis du Pays grâce à l’aide de la Députation de Guipuzcoa, fut, dans le genre, la publication la plus prestigieuse à l’intérieur du Pays Basque, surtout dans les années 1954-1965. Sa présentation soignée, ses thèmes d’actualité et son style équilibré entre tradition et modernisme témoignèrent du haut niveau intellectuel de ses animateurs. Les directeurs de la revue furent Antonio Arrue, Aingeru Irigarai et Koldo Mitxelena. L’œuvre journalistique et de vulgarisation de ce dernier y fut, d’ailleurs, publiée. Depuis 1960, la parution d’Egan fut hélas épisodique. |
Conditionné par la situation sociolinguistique de la communauté bascophone et de la société basque en général, ainsi que par le contexte politique, le livre basque connut un développement très lent dans les années de l’immédiate après-guerre. Depuis la période à laquelle rien ne pouvait être publié, période qui dura plus de dix ans (1938-1949), jusqu’à 1960, le nombre d’éditions annuelles ne dépassa pas trente. En outre, l’inspiration de ces rares ouvrages était essentiellement religieuse. Il fallut attendre 1950 pour que les publications et travaux littéraires basques pussent bénéficier de meilleures conditions.
C’est la maison d’édition Itxaropena de Zarautz qui, la première, entreprit un travail éditorial durable. De temps à autre, et pour des raisons différentes à chaque fois, un livre particulier trouva un public plus large. Ce fut le cas d’Euskaldunak d’Orixe, ouvrage longtemps attendu (1935-1950); de Meza-Bezperak (1950), traduction du même auteur; et d’Arantzazuko Egutegia (1947). L’anthologie poétique basque Milla Euskal Olerki Eder (1954) de S. Onaindia, qui comblait une grave lacune, ainsi que le roman particulièrement audacieux, Joanak joan (1955), de J. Etxaide eurent un grand succès auprès de la jeune génération.
|
|
Gure Izarra (1950). Jakin (1956) : Gure Izarra (1950-1974) fut une revue qui, en tant que publication interne au séminaire franciscain d’Olite, ne bénéficia jamais de diffusion publique. Parmi toutes les revues des séminaires, elle se révéla être, de loin, la plus féconde: en vingt-cinq ans d’existence, elle réunit plus de 306 signatures et produisit 6.176 pages de textes. Ces publications d’internat constituaient, pour les jeunes, les premiers espaces de liberté pour s’initier à l’écriture et à la littérature. Gure Izarra allait, par la suite, donner naissance à la revue Jakin (1956-1968, 1977-1991) lorsque les euskaltzales d’Olite entrèrent en contact avec d’autres centres religieux et des euskaristes laïques (à l’occasion de la célébration du Ier Congrès public d’Euskaltzaindia d’après-guerre: Arantzazu, 1956). Bien qu’interdite en 1968, Jakin continua sa tâche à travers des collaborations à d’autres publications, puis reparut en 1977. C’est actuellement la revue culturelle euskarienne la plus diffusée. |
|
|
P. Untzurruntzaga. S. Onaindia : FRANCISCO UNTZURRUNTZAGA (1906-1984) - SANTIAGO ONAINDIA (1909). Après la guerre, il fallut faire de grands efforts pour permettre la publication de livres basques, en raison des difficultés administratives et du faible niveau d’alphabétisation en euskara du public potentiel. Des personnalités comme Francisco Untzurruntzaga de la maison d’édition Itxaropena à Zarautz, et le père carme Santiago Onaindia à Larrea (Biscaye) vécurent nombre de péripéties et essuyèrent bien des déboires. Nous devons au premier la collection "Kuliska Sorta", et à Onaindia l’anthologie poétique Milla Euskal Olerki Eder (1954), notamment, qui apparurent comme des oasis dans le désert d’avant 1960. |
Entre 1960 et 1970, la production littéraire basque suivit une progression lente mais constante et, au bout de dix ans, le nombre de livres publiés chaque année avait presque triplé: 71 éditions en 1970. La tendance s’accentua encore au cours des quinze années suivantes, avec un record de 154 éditions en 1975.
La demande de livres en euskara, créée par l’officialisation de la langue basque, a favorisé considérablement le développement de l’activité éditoriale du Pays: 209 éditions ont paru en 1980, 606 en 1987, 774 en 1988, 732 en 1989, 850 en 1990. À cette date, les domaines les plus importants quantitativement sont la littérature (33,5% des publications) et l’enseignement (25%). D’après les chiffres disponibles (1989), les maisons d’édition Elkar et Erein sont en tête de liste pour le nombre et les pourcentages de publications.
|
Les séminaires, une formation littéraire
: Nombre de jeunes trouvèrent l’occasion de faire leurs premières
armes dans les lettres par l’intermédiaire des revues d’internats de
l’Eglise (1950-1976). La crise généralisée de ces centres
institutionnels permit à leurs anciens étudiants de prendre une part
active aux initiatives sociales en faveur de la langue basque. Plus
d’une fois, ils furent les premiers professionnels à encadrer
l’enseignement et les moyens d’information en euskara. Le tableau
ci-contre indique le nombre de collaborateurs de chaque revue et le
pourcentage qu’ils représentaient par rapport à l’ensemble des
étudiants. |
Il convient ne pas omettre ici la personnalité de l’auteur du texte, c’est-à-dire de l’écrivain, du père de l’œuvre. Que savons-nous de l’écrivain basque, qu’il soit professionnel ou amateur? Dans le cas des langues minoritaires, le travail d’apprentissage de la langue écrite et l’acquisition d’une certaine maîtrise stylistique sont, généralement, assez difficiles, dans la mesure où n’existent pas, sur le plan social, les moyens classiques de transmission de la tradition littéraire. Jusqu’à il y a peu, cela a constitué un lourd handicap pour tout écrivain basque en devenir. A partir de 1950, il fut désormais possible d’apprendre à écrire en basque au sein de cercles réduits. Les séminaires de l’Église furent à l’avant-garde de cet enseignement qui représente l’élément de base du métier d’écrivain. Cette action allait avoir des conséquences tangibles quelque temps plus tard. En effet, la jeunesse scolarisée dans ces centres entreprit une bonne partie du travail éditorial et journalistique des années 1960-1975, à côté des respectables écrivains autodidactes. Ensuite, c’est l’Ikastola qui joua ce rôle de pépinière et, de nos jours, le système éducatif, officiellement bilingue, contribue à normaliser l’emploi de la langue écrite dans la vie quotidienne.
|
|
Le développement éditorial (1937-1990) : A toute époque, la conjoncture socio-culturelle et politique a eu une influence directe sur la production littéraire, et cette influence se fait sentir plus encore dans les peuples minoritaires. Ce fut le cas au Pays Basque: après une période stérile de dix ou treize ans, l’édition de livres basques a commencé à augmenter en 1950, pour connaître, à partir de 1970, un développement assez spectaculaire. Mais, nous ignorons encore si, étant donné l’importance démographique de la communauté bascophone, ce processus va bientôt se stabiliser ou non. |
Voulant dresser le portrait-robot de l’écrivain basque de ces trente dernières années, Torrealdai l’a défini ainsi (1976): l’écrivain basque s’est vu ou reconnu comme le serviteur d’une langue et d’un peuple minoritaires, et comme un élément actif de la société; il ne s’est pas égaré dans d’élégantes réunions de café, sans devenir pour autant un bohème; il a toujours su que ses lecteurs formaient une minorité et que cette minorité n’était absolument pas élitiste, mais populaire; dans la plupart des cas, il ne s’est pas embarqué dans de longs projets littéraires, mais s’est plutôt attelé à des tâches urgentes et pratiques de moindre ampleur; ses origines sont humbles; il n’a pas de grande bibliothèque (en 1976, il possédait moins de trois cents livres en euskara, mais le double ou le triple en castillan); avec le temps, le nombre d’écrivains qui ont fait des études supérieures augmente (la source des séminaires s’est tarie avant 1970). Inutile de préciser que ce portrait-robot a rapidement évolué depuis quinze ans.
Dans les années 1960-1980, les écrivains travaillaient principalement dans les revues, les hebdomadaires d’information et les publications culturelles. Comme ils n’étaient pas professionnels, leurs textes avaient généralement peu d’envergure, et rares étaient ceux qui envisageaient d’écrire un livre. Plus tard, les écrivains ont tout de même pu se consacrer à des travaux plus importants, par choix personnel et pour répondre à la demande culturelle et sociale croissante (journalisme, enseignement, maisons d’édition, etc.).
L’écrivain basque, aujourd’hui plus qu’auparavant, écrit des livres "pratiques" et une dualité se fait jour, dont les éléments apparemment contradictoires sont en fait complémentaires: les livres de littérature sont plus nombreux que jamais (156 titres en 1990) mais ne représentent que 19% de l’ensemble des ouvrages parus au cours de l’année (contre 23,15% en 1976 et 41,5% en 1960-1975). Il faut souligner que cette diminution du nombre de textes spécifiquement littéraires est, en réalité, normale. À mesure que la culture basque s’épanouit et se diversifie, la production littéraire euskarienne se tourne, de plus en plus, vers des problèmes distincts de la littérature pure.
D’après le catalogue établi par l’UZEI, plus de 1.500 publications périodiques, totalement ou partiellement en euskara, ont vu le jour au cours du XXème siècle, et abordé le problème de la langue basque de diverses façons. Nous nous contenterons de citer ici celles qui ont le plus contribué à la normalisation linguistique, en traitant des thèmes divers, en formant des écrivains et en touchant un vaste public.
|
|
Les revues littéraires : Tant en Iparralde qu’en Hegoalde, la créativité des écrivains, dans ses diverses tendances idéologiques et formelles, a trouvé dans les revues le moyen le plus commode de s’exprimer socialement. La précarité de ces publications s’explique, en général, par la petite taille du marché basque. Mais, les changements fréquents à la tête du groupe qui les animait n’ont pas contribué à la continuité des revues. |
|
|
Olerti (1959) : Publication littéraire dirigée par le père S. Onaindia, Olerti a recueilli la tradition de la poésie d’avant-guerre, mais aussi les travaux de jeunes auteurs. Des concours de poésie furent organisés à Larrea (Biscaye) à l’initiative de cette revue qui devint, de la sorte, le lieu de rencontre d’un groupe d’euskaltzales. |
|
|
Les revues spécialisées : Des revues comme Elhuyar (1986) ou Senez (1985) ont été créées dans le souci de répondre aux nouveaux besoins qui se faisaient sentir dans la communauté bascophone. La première a pour objectif de divulguer les découvertes de la science et de la technique, tandis que la seconde présente les nouveautés et théories du monde de la traduction. Il a existé d’autres publications similaires, plus éphémères, consacrées à l’enseignement ou aux thèmes religieux. (Kimu, Eskola, etc.) |
D’entrée, l’ensemble de ces revues peut être classé selon deux critères: leur périodicité, d’une part, et le domaine auquel elles ont choisi de s’intéresser, d’autre part. Dans le contexte culturel euskarien, ce sont les hebdomadaires qui prédominent. Bénéficiant d’un vaste public, ils fournissent le volume de texte le plus abondant. Nous avons déjà mentionné ceux qui, historiquement, ont occupé la plus grande place. Viennent ensuite les mensuels qui traitent également de sujets très variés (information, analyse et critique sociale, essai littéraire...), alors que les bimensuels et trimestriels préfèrent souvent se définir expressément comme des publications de grande diffusion culturelle, ou de spécialistes.
Si nous les étudions précisément du point de vue de leur public et, partant, de leur contenu, les revues apparaissent très diverses: elles peuvent être destinées aux enfants; émaner d’institutions religieuses et s’adresser aux croyants; n’être que rédactionnelles ou bien illustrées; traiter de science ou de littérature; faire de l’information ou aborder des thèmes culturels plus choisis; ou, enfin, s’intéresser plus particulièrement aux différents aspects de la langue basque. En ce qui concerne leur couverture géographique, certaines s’adressent à tout le Pays Basque ou, au contraire, se limitent à une province ou une région précise... Le lecteur intéressé pourra trouver dans l’Urtekaria (= Annuaire) d’Argia (1991), les adresses postales de 82 revues euskariennes.
|
|
Larrun (1985) : Cette revue de débat et d’information politico-culturelle, entièrement en euskara, a voulu donner à son choix explicite et exclusif un sens politique, et se démarquer ainsi du bilinguisme en vigueur dans le monde de la culture et de la politique basques. |
|
|
Plazara (Irun, 1985) : L’officialisation de l’euskara a ouvert de nouvelles perspectives à la langue basque au sein des institutions publiques. Sous l’impulsion des euskaltzales, des revues se sont créées dans les députations et les municipalités. Celle que nous présentons ici, Plazara, est la publication entièrement en euskara du Conseil de l’Euskara de la municipalité d’Irún, et témoigne de la qualité qui a toujours caractérisé le journalisme de cette région de la Bidassoa. Avec l’hebdomadaire Arrasate Press, c’est un bon exemple de journalisme régional actif. |
|
|
Albistaria (1985) : Il s’agit du Courrier de l’UNESCO en langue basque. Cette revue internationale, publiée en de nombreuses langues, est la meilleure illustration du large éventail de sujets que la traduction basque aborde aujourd’hui: histoire, archéologie, génétique, astronautique, etc. |
Même si la longévité d’une publication n’est pas forcément l’élément le plus important pour déterminer son rôle historique et culturel, il ne fait aucun doute que la continuité d’une revue dans le temps peut être aussi un signe de son enracinement social. À l’instar des publications à caractère culturel dans d’autres pays, peu de revues euskariennes ont vécu plus de vingt ou vingt-cinq ans: Euskera, Egan, Jakin, Argia, Herria, Elhuyar, Karmel, Jaunaren Deia, Otoizlari...
Soulignons l’apparition de nouvelles revues littéraires ces dernières années. Comme leurs couvertures figurent en illustration, nous ne nous étendrons pas plus.
Dans les textes et les débats relatifs à ce problème, les expressions "euskara batua", "basque unifié" ou "langue littéraire commune" étaient, en général, synonymes et faisaient référence le plus souvent à la langue écrite. Au sens large, elles désignent les formes standard de la langue, écrites ou parlées.
|
|
Le projet d’unification (1913-1922) : La modernisation d’une langue passe par l’établissement de normes et la définition d’un modèle standard. Ce sont l’histoire, les conditions sociolinguistiques, la mentalité et la volonté des locuteurs qui déterminent le moyen concret d’atteindre ce but. Dès les premières années de son existence (1921), l’Académie de la Langue Basque chercha à définir ce qui devait être la langue écrite standard mais, à l’époque, les circonstances ne s’y prêtaient pas, et il fallut de longues années de discussions et d’avant-projets avant de trouver le moment propice. Ci-dessus: les premiers rapports d’Euskaltzaindia (Euskera, 1922) et le discours prononcé à ce sujet par Eleizalde, à Bayonne, quelques années auparavant (Euskadi, 1913). |
L’objectif à atteindre est évident: il s’agit de mettre au point une langue commune, au-dessus des dialectes, qui puisse être facilement comprise par tous les Basques, après une période d’adaptation la plus courte possible. Pour parvenir à ce but, il est aussi important de normaliser la future langue standard (tâche qui incombe à l’Académie), que de diffuser la langue normalisée dans la société par l’intermédiaire de l’école, des médias et de tous les canaux interdialectaux, afin qu’elle soit adoptée par le maximum de locuteurs.
|
|
Bayonne (1964) et Ermua (1968) : La réunion de Bayonne rassembla, les 29 et 30 août 1964, un certain nombre d’écrivains basques d’Hegoalde désireux de moderniser l’euskara en collaboration avec ceux d’Iparralde, lesquels avaient déjà travaillé avec quelques réfugiés politiques du sud des Pyrénées. Assistaient à la réunion Aresti, Txillardegi, Altuna, Monzon, le groupe de Jakin, etc. Les décisions prises à Bayonne furent immédiatement acceptées par les rédactions des jeunes revues culturelles d’Hegoalde. En 1968, les écrivains réunis à Ermua (Biscaye) franchirent une nouvelle étape, ouvrant la voie des réunions ultérieures de l’Académie. Ci-dessus: les travaux de Bayonne et d’Ermua. |
Cette langue générale est indispensable à la modernisation d’un idiome. Elle peut être le résultat d’un processus spontané de rapprochement des différents dialectes, ou le fruit d’une planification conduite par une institution linguistique, voire la conséquence de l’effet conjugué des deux facteurs. Dans le cas de l’euskara, il existe des antécédents significatifs d’une relative convergence entre les dialectes (la langue ecclésiastique, le bertsolarisme, les textes scolaires, les moyens de communication modernes, etc.). Mais, dans le débat sur la langue basque (1968-1980), c’est le rôle de l’Académie qui a été le plus souvent évoqué, tant par les défenseurs du projet que par ses détracteurs. La nécessité d’unifier l’euskara fut déjà perçue par nos premiers écrivains. Dans sa préface, Axular (1643) en parle en termes très clairs. Aussi, après l’échec d’Hendaye-Fontarabie (1901-1902) et à partir de la fondation d’Euskaltzaindia (1919), l’unification fut-elle l’un des principaux objectifs de la nouvelle Académie. Le rapport que Campión et Broussain présentèrent à Euskaltzaindia, en 1921, répondait à la même préoccupation. Le débat qui s’ouvrit alors, et les nouvelles idées qui virent le jour, permirent de réunir des projets de tous types, plus ou moins contradictoires, parmi lesquels celui qui semblait apporter la solution la plus pratique ne s’inspirait, hélas, que du dialecte Gipuzkoan. C’est Azkue en personne qui proposa son gipuzkera osotua, ou Gipuzkoan "complété", en présentant une œuvre littéraire qu’il avait écrite d’après ce modèle (Ardi galdua, 1919).
|
|
Arantzazu (1968) : Ce sanctuaire Guipuzcoan accueillit, du 3 au 5 octobre 1968, le congrès d’Euskaltzaindia pour l’unification de l’euskara. Au cours des années suivantes, les décisions et propositions de ce congrès ont servi de trame pour construire l’euskara standard, en dépit des polémiques parfois violentes qui éclatèrent, comme ce fut le cas ailleurs dans les mêmes circonstances. |
|
|
Dialectes et langue littéraire : Le modèle d’euskara unifié, ou euskara littéraire commun, a été élaboré essentiellement à partir des dialectes centraux (Guipuzcoan-navarrais-labourdin), en conséquence de quoi les dialectes biscaïen et souletin se sont retrouvés plus éloignés de la norme. C’est pourquoi il a fallu arrondir les angles, en matière de pédagogie, pour passer progressivement du biscaïen, par exemple, à la langue unifiée. Dans ce fascicule, sont recueillies toutes les règles à suivre à cet effet. |
Après la guerre, l’Académie reprit ses travaux en commençant, cette fois encore, par s’attaquer au problème de l’unification. Choisissant le meilleur de notre histoire littéraire, elle voulut prendre alors le labourdin classique comme modèle standard (Krutwig, Villasante: 1952). Quelques années après, de nouveaux volontaires, résolus à promouvoir l’unification, firent leur apparition (1956-1964): Aresti, Txillardegi, Kintana et nombre d’écrivains de la jeune génération qui, en outre, bénéficiaient de l’infrastructure et du soutien des revues les plus dynamiques. En effet, ces publications commentaient et adoptaient les règles orthographiques immédiatement applicables. Par exemple, les réunions annuelles de Jakin furent consacrées à ce travail de normalisation pré-académique (1957- 1963).
Naturellement, ces initiatives de plus ou moins grande ampleur, mais invariablement privées et limitées à quelques groupes ou secteurs, étaient insuffisantes. C’est pourquoi un groupe d’écrivains, des deux côtés des Pyrénées, décida d’organiser une réunion ouverte afin d’élaborer un avant-projet immédiatement applicable à diverses publications: ce fut le Congrès de Bayonne (1964). Ses résolutions parurent bientôt dans les jeunes revues et la réunion de Bayonne devint la référence, en matière de normes, pour beaucoup d’auteurs qui les respectèrent scrupuleusement dans tous leurs écrits. En 1968, le groupe de Bayonne, qui avait grossi entre-temps, se réunit de nouveau à Ermua et demanda à l’Académie de prendre une position officielle. C’est à ce moment qu’il fut décidé de convoquer le congrès d’Euskaltzaindia à Arantzazu (3-5 octobre 1968). À l’issue de ce congrès, une fois les rapports présentés, discutés et synthétisés, l’euskara disposa du premier ensemble structuré de normes académiques pour l’unification.
|
|
Depuis les dialectes jusqu’à la langue commune : Le défi de l’euskara batua peut se résumer à cette question: comment faire pour qu’une langue unique, divisée en dialectes, puisse être mieux comprise et utilisée par tous? En d’autres termes, que faut-il prendre des dialectes parlés et des dialectes littéraires? Dans les deux cas présentés ici, dugu et naiz (=’avons’ et ’suis’), ont été retenues les formes centrales du Guipuzcoan-labourdin-navarrais, au détriment des extrêmes que constituent, géographiquement et dialectalement, le biscaïen et le souletin. |
Le projet d’unification traitait principalement de l’orthographe, de la morphologie, des déclinaisons et des néologismes, et s’appliquait à la langue écrite. L’unification proposée prenait comme base le Gipuzkoan-navarrais et, en second lieu, les variantes optionnelles des dialectes périphériques. Durant les années qui suivirent, Euskaltzaindia continua à compléter la proposition initiale et, à cet égard, le travail de standardisation du système verbal réalisé par la commission ad hoc (1973) eut une grande importance.
Le corpus proposé par Euskaltzaindia, dans le cadre de l’unification, n’offre pas un lexique très fourni, et il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir éditer un dictionnaire normatif complet. Cependant, grâce aux propositions faites par Kintana ou Sarasola, à celles de l’UZEI à un niveau plus concret, et aux travaux de la commission lexicographique de l’Académie, un programme de normes lexicales modernes et bien acceptées est en train de prendre forme sur la base des listes de vocabulaire d’Euskaltzaindia.
|
|
La Sous-Commission d’unification du verbe (1973) : La commission d’Euskaltzaindia chargée du projet d’unification de la conjugaison effectua ses derniers travaux à Arantzazu (27-28 juillet 1973). Ci-contre: quelques-uns des membres de la commission. Celle-ci avait pour tâche de trouver une solution globale unique à partir de plusieurs propositions qui, de par leur structure, s’excluaient mutuellement. |
D’ici quelques années, le dictionnaire basque normatif sera une réalité. Les solutions aux problèmes de déclinaison, du système verbal auxiliaire et synthétique sont déjà pratiquement au point. Mais, la problématique inhérente à la normalisation exige de nous d’autres tâches.
En Euskal Herria, comme dans beaucoup d’autres pays, la mise en place d’une langue standard n’a pas été une sinécure. Les années 1969-1975, notamment, furent extrêmement difficiles. D’âpres polémiques ont éclaté et mené, parfois, à des attaques personnelles tout à fait hors de propos. À l’inverse, certaines valeurs dialectales, sans doute trop négligées au moment de la réalisation pratique de la langue standard, devraient être rattachées au plus vite à notre futur patrimoine commun: il est vrai que le dialecte souletin se retrouve excessivement isolé, mais les éventuels apports du biscaïen, par exemple, bien qu’acceptés en théorie, n’ont pourtant presque jamais été exploités par les écrivains des autres dialectes. Les efforts que les Biscaïens ont fait et continuent de faire pour l’unification devraient inciter les autres écrivains à s’abreuver à la source jaillissante et trop méconnue de ce dialecte.
Le devenir socio-culturel de la langue basque est intimement lié à deux tâches fondamentales: 1) Faire que le citoyen basque devienne bascophone, qu’il vive l’euskara en tant que locuteur afin que la langue, à son tour, soit vivante en tant que fait social. Pour cela, il est nécessaire de faciliter l’accès à l’euskara de tous les Basques hispanophones unilingues. 2) Faire que tout locuteur scolarisé soit capable de lire et d’écrire en euskara de façon à donner à la langue basque, à travers l’alphabétisation, la dimension culturelle moderne qui lui revient.
|
La déclinaison normalisée : Voici, pour cet aspect grammatical, les normes de la langue unifiée qui prennent en compte tous les dialectes parlés et écrits. |
Pour les informations dialectales: Intchauspe (1858): Le Verbe Basque, Paris. (B, G, L). — Gèze, L. (1873): Eléments de Grammaire Basque. Dialecte Souletin. Bayonne. (S). — Intxausti, J. (1961): Euskal aditza. Arantzazu. (B, G). — Euskaltzaindia (1973): "Aditz laguntzaile batua", in: Euskera, XVIII (1973), 5-74. |
La conjugaison : Le choix d’une norme commune a été plus difficile pour la conjugaison que pour la déclinaison. D’une façon générale, le biscaïen semblait s’éloigner systématiquement des formes les plus courantes dans les autres dialectes (y compris le souletin), alors qu’au moment du choix, on s’aperçut que c’était précisément ce dialecte qui, bien souvent, avait le mieux conservé les vestiges de l’ancienne tradition commune. Ce tableau illustre quelques variétés dialectales, et les difficultés qu’il a fallu surmonter pour établir une langue standard. Sources: |
Ce sont les objectifs qu’ont cherché à atteindre, au cours des vingt
dernières années, les organisations nées au sein de la société ou des
institutions publiques comme, par exemple, les structures d’alphabétisation AEK
et HABE, les euskaltegis municipaux ou privés, les classes d’été (à Derio,
notamment), outre bien d’autres initiatives tout aussi efficaces.
"Dans les années 60, diverses tentatives et campagnes d’alphabétisation, modestes et dispersées au début, commencèrent à voir le jour avec la volonté de faire naître chez les Basques des habitudes de lecture et d’écriture en euskara. Rikardo Arregi fut le principal instigateur de ce mouvement qui reçut la protection officielle d’Euskaltzaindia, par l’intermédiaire de la section de défense et de promotion de la langue basque de l’Académie.
|
|
Sous l’égide de l’Académie Basque (1968) : Afin d’obtenir une protection officielle pour le mouvement d’alphabétisation, ses responsables s’adressèrent à Euskaltzaindia. Ci-dessus: la demande envoyée à l’Académie. De fait, pendant les premières années, cette initiative culturelle bénéficia de la protection de l’institution académique. |
Plus tard, ces expériences d’alphabétisation des bascophones s’orientèrent de plus en plus vers l’enseignement de l’euskara -parlé, puis écrit- aux hispanophones. En même temps, l’euskarisation élargit son domaine d’action, sur le plan social, en passant des villages au monde industriel des grandes villes, et en déplaçant les premiers cours du soir, aux horaires contraignants, à des heures beaucoup plus pratiques. Les cours du soir (Gau- Eskolak) du début se transformèrent donc en écoles basques (Euskal Eskolak), puis en euskaltegis (=centres d’enseignement de l’euskara pour adultes), et la formation dispensée pendant l’année fut complétée par des stages d’été, des cours intensifs et des séminaires résidentiels. Grâce aux programmes et aux textes de plus en plus perfectionnés, ainsi qu’aux professeurs de plus en plus qualifiés, l’enseignement de l’euskara gagna peu à peu en professionnalisme. De là sont nés la Coordination d’Alphabétisation et d’Euskarisation (AEK), de nombreuses écoles basques et euskaltegis (Labayru, euskaltegis privés, etc.) qui ont adapté et conjugué leurs efforts pour apporter une réponse aux nouveaux besoins linguistiques du Pays Basque.
|
|
La Coordination d’Alphabétisation et d’Euskarisation (AEK) : La Coordination d’Alphabétisation et d’Euskarisation (AEK) mena à bien sa tâche avec la participation des forces sociales et des euskaltzales de toute l’aire linguistique basque, et en demandant, chaque fois que c’était possible, l’aide des institutions. Ci-contre: la plus célèbre de ses manifestations populaires, la Korrika, au cours de laquelle les participants parcourent des centaines de kilomètres à travers les sept provinces basques, et contribuent ainsi à réveiller la conscience linguistique euskarienne dans les villages traversés. |
|
|
R Arregi (1942-1969) : La jeunesse des années 60 sut retrouver les voies de la défense de l’euskara. L’une d’elles fut le mouvement d’alphabétisation qui vit le jour à cette époque sous la conduite de Rikardo Arregi, hélas disparu trop tôt. |
Afin de coordonner, réglementer, orienter et structurer toutes ces tâches et activités -et, par conséquent, de pouvoir les aider financièrement-, le Parlement basque vota, le 25 novembre 1983, la loi 29/1983 portant création de l’Institution pour l’Alphabétisation et l’Euskarisation des Adultes (HABE), qui régit également les euskaltegis (BOPV 12-XII-1983), définissant ainsi un nouveau cadre légal pour l’enseignement de l’euskara" (X. Aizpurua). Par ailleurs, le gouvernement de Navarre a pris, à ce sujet, des décisions similaires à celles adoptées dans la CAB. En revanche, l’euskarisation-alphabétisation d’Iparralde ne bénéficie d’aucune couverture légale ou sociale équivalente. Mais, d’une façon générale, le mouvement social d’alphabétisation en euskara et les institutions du Pays Basque rencontrent toujours de sérieux problèmes pour faire coïncider, de façon harmonieuse, les actions indispensables aux bascophones et hispanophones, et pour unir leurs forces afin d’offrir le meilleur service possible dans chaque domaine.
|
|
Les Euskaltegis : Au cours des dix dernières années, le Pays Basque a vu la création de nombreux centres spécialisés dans l’enseignement de l’euskara pour adultes, plus encore que de centres d’alphabétisation: appelés Euskaltegiak, ils s’inspirent du modèle israélien de l’Ulpan. Certains d’entre eux sont dûs à des initiatives privées, d’autres, au sein de la CAB, relèvent des municipalités ou de l’HABE. Ces centres, qui constituent un instrument d’apprentissage de la langue tout à fait nouveau au Pays Basque, organisent des stages intensifs et des séminaires de formation résidentielle. Ci-contre: l’Euskaltegi de Fontarabie (Guipuzcoa). |
|
|
Le matériel pédagogique imprimé : Pour accomplir sa tâche éducative, l’euskarisation et l’alphabétisation ont besoin de matériel pédagogique sur papier, non seulement de livres, mais aussi de revues et d’outils plus pratiques. Toutes ces publications périodiques ont été créées pour répondre à ce besoin: Habe (1981) et Aizu (1982) sont destinées à l’euskarisation; Kili-kili, qui paraît depuis plus longtemps (1966), est conçue pour faciliter l’alphabétisation des enfants bascophones. |
| ANNEE |
EUSKALTEGIS |
ÉLÈVES | SUBVENTIONS |
BUDGETS |
| 1981-82 1984-85 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 |
201 216 231 186 172 175 |
18.000 45.000 77.488 58.582 47.713 47.322 |
-- -- 1984: 490.000.000 1986: 1.000.000.000 1987: 1.146.000.000 1988: 1.236.000.000 1989: 1.339.000.000 |
-- -- |
L’HABE (1981) : L’HABE est
l’institution que le gouvernement de la Communauté Autonome Basque a
créée pour mener à bien sa politique d’alphabétisation et de
ré-euskarisation des adultes. Elle a sous sa responsabilité des centres
et institutions aux statuts juridiques divers: il peut s’agir
d’euskaltegis libres, municipaux, conventionnés ou homologués (en
référence dans le tableau ci-contre). Les moyens financiers accordés à
cette institution sont en constante progression d’année en année comme
il en est indiqué dans les statistiques. Les subventions de 1990 ont été
de 1.477.000.000 pts., et le budget total pour la même année de
2.519.000.000 pts. Entre 1984-1985 et 1989-1990, la progression des
centres d’enseignement (euskaltegiak) a été la suivante: Euskaltegis de
l’HABE, 4 et 4; Municipaux, 19 et 37; Homologués, 11 et 27;
Conventionnés, 7 et 15; Libres, 175 et 92. Elèves: Nombre d’élèves
inscrits. - Subventions: Il faut ajouter 107.000.000 (1989) et
500.000.000 (1990) aux quantités présentées ci-dessus. Elles sont
destinées à l’IVAP (Institut Basque d’Administration Publique) pour la
formation en langue Basque des fonctionnaires.
Après l’éclosion littéraire d’avant-guerre, la raréfaction des œuvres de littérature pure, après la guerre civile, se fit sentir de façon plus aiguë encore que le manque de livres basques en général. De fait, les éditions à caractère littéraire tardèrent à réapparaître.
|
|
La poésie basque : Avant la guerre, d’aucuns (Ibar, par exemple, en 1936) avaient déjà souligné le rôle sociolinguistique que la littérature pouvait jouer pour normaliser et renforcer l’euskara dans la société basque. C’est ce propos qui allait inspirer le poème Arantzazu (1949) de S. Mitxelena et l’œuvre Euskaldunak (1950) d’Orixe. L’activité littéraire allait se développer dans le même esprit jusqu’en 1960, pour se transformer, dans les années 1960-1975, en une œuvre de redressement socio-culturel. Les illustrations ci-dessus retracent un demi siècle d’histoire de la poésie. |
Il fallut attendre les années 50 pour voir publier des ouvrages littéraires vraiment significatifs, tant en poésie qu’en roman, et il s’agissait parfois d’originaux d’avant-guerre. Vers 1956, renouant avec la tradition littéraire du passé, on réédita des œuvres classiques comme Gero (1954), Peru Abarka (1956) et Biotz-Begietan (1956), ainsi que quelques magistrales traductions d’Orixe, comme Aitorkizunak (Les Confessions, de St. Augustin, 1956).
|
|
Euskal Elerti (1969) : Les critiques avaient décelé le courant de modernité au sein de la littérature basque. Cette édition fut préparée avec le souci d’offrir aux lecteurs une anthologie plus accessible des nouvelles créations basques. |
|
|
La recherche critique : Aujourd’hui, les œuvres d’un écrivain sont analysées sous des angles et des points de vue différents. Outre la critique de la valeur strictement littéraire des écrits, les spécialistes font l’étude de l’écrivain basque et de son œuvre dans leur environnement social. L’activité littéraire est donc appréhendée dans sa dimension historico-sociale. |
L’histoire littéraire de cette époque peut se décomposer en plusieurs périodes, en fonction des principales motivations politicoculturelles (et donc extra-littéraires) du moment (K. Otegi). Il y eut, d’abord, une phase pendant laquelle la littérature fut perçue comme une tentative de préserver l’identité nationale (1939-1957). Puis, le fait littéraire a été synonyme d’action en faveur des droits de l’homme et des revendications sociales (1957-1975). Enfin, depuis quinze ans, la tâche d’écrivain est reconnue comme un moyen d’expression artistique à part entière. Etape après étape, chaque genre littéraire s’est développé à son rythme, a remporté ses propres succès et écrit son histoire respective.
La première étape de la poésie rassemble les publications de l’exil, avec Zaitegi et Monzon, celles de l’intérieur, avec S. Mitxelena et Orixe, ainsi qu’Iratzeder en Iparralde, Mirande à Paris, sans oublier Etxaniz et Aurraitz en Hegoalde. C’est à cette époque que parut la grande anthologie d’Onaindia, Milla Euskal Olerti Eder (1954), qui fut une révélation pour la nouvelle génération et marqua les lettres basques, dans la mesure où, jusqu’à cette date, nous ne disposions d’aucune histoire accessible de notre littérature. À l’étape suivante (1957-1975), nous rappellerons les noms de Goikoetxea, Gandiaga et Aresti, qui s’engagèrent dans un processus d’innovation et de renouvellement des thèmes. Une autre anthologie (Uhin berri, 1969) allait, d’ailleurs, faire la synthèse des nouveaux courants de cette époque qui restera marquée par Zabaleta, Lete, Urretabizkaia, Lekuona, Artze et bien d’autres. Enfin, nous devons à Atxaga, Izagirre, Sarrionaindia, A. Lasa, Zarate, pour ne citer qu’eux, d’avoir fait l’histoire récente de notre poésie.
|
|
La nouvelle et le conte basques : Après les nouvelles publiées en Amérique (1946-1948), à partir de 1950, on nota les premiers signes d’un renouveau de la nouvelle basque: Joanak joan (1955), Leturiaren egunkari ezkutua (1957), Peru Leartzako (1960). Depuis 1960, la production littéraire a compté des œuvres plus innovatrices sur le plan formel: Egunero hasten delako (1969), 100 metro (1976), Abuztuaren 15eko bazkalondoa (1979), Obabakoak (1988). |
Au cours du demi siècle qui nous sépare de la guerre, le roman a également compté. L’œuvre commencée en Amérique par Irazusta (1946) et Eizagirre (1948) se poursuivit, à l’intérieur, avec Etxaide (1950, 1955) et Loidi (1955). À l’étape suivante, de nouveaux genres firent leur apparition avec Txillardegi (1957, 1960, 1969), Erkiaga - plus traditionnel sur le plan de la forme-, Saizarbitoria (1969, 1976), Urkizu, Peillen, Zarate ou Lertxundi (1971, 1973), qui constituent les principaux romanciers de cette période. Pour les auteurs actuels, citons J. A. Arrieta (1979, 1987), Irigoien (1976, 1982) et les œuvres de M. Onaindia (1977), de même que les romans d’ autres auteurs précédents comme Krutwig, Izagirre, Txillardegi (1979), Atxaga (1988), P. Aristi, entre autres, dont certains ont été écrits afin de renouveler les structures formelles du roman basque. En outre, il faut signaler les romans de Garate y Gereño, plus populaires et destinés à un large public, ainsi que la contribution de nombreux auteurs à des collections de nouvelles. Aujourd’hui, le roman est un domaine d’activité littéraire agité et vivant. À cet égard, Obabakoak, l’ouvrage de Bernardo Atxaga couronné par le Prix National en 1989, symbolise à la perfection le travail accompli.
Jusqu’à maintenant, le théâtre basque n’a pas fait preuve de la même fertilité que le roman ou la poésie. Pour autant, les auteurs et les œuvres dignes d’intérêt ne manquent pas. À ce titre, méritent d’être mentionnés, en particulier, Labaien (1955, 1965, 1967), Zubikarai (1950, 1969, 1970, 1983), Etxaide (1952, 1958, 1962), Lartzabal (1961, 1962, 1968), Monzon, Etxaniz, Mitxelena, Aresti (1971) ou Garmendia (1969). Plus récemment, Begiristain, Landart (1970, 1972, 1973, 1981), Haranburu-Altuna, Atxaga et d’autres ont produit diverses œuvres. Les mises en scène de pièces classiques grecques et occidentales doivent aussi être signalées. Il faut ajouter que l’apparition d’une production cinématographique et d’ETB, qui produit des œuvres originales, a créé une demande qui n’existait pas auparavant, ce qui peut stimuler, à plus ou moins long terme, la création théâtrale. De même, le théâtre populaire traditionnel renaît dans les pastorales de Soule (Casenave, Davant). Enfin, le théâtre basque compte désormais une revue d’information et d’édition, Antzerti (1982), publiée par l’organisme du même nom.
|
|
Le théâtre : Ces dernières années, le théâtre a voulu accroître son rôle culturel, des deux côtés des Pyrénées. Malheureusement, il n’a pas toujours trouvé l’accueil ni eu l’impact souhaités. Des troupes ont monté des versions basques des classiques (Shakespeare, classiques grecs, etc.), mais également des œuvres de création. Dans les pièces originales des écrivains d’Iparralde (Lartzabal, Landart, Casenave), on retrouve souvent des échos du théâtre populaire traditionnel. En ce qui concerne le renouvellement du genre en Hegoalde, nous devons évoquer les œuvres d’Aresti, et l’initiative théâtrale lancée par l’école Antzerti et la revue du même nom. Plus généralement, l’activité théâtrale, au niveau de la création littéraire et des troupes, a un bel avenir devant elle face à la demande croissante du public et de la production de la Télévision. |
|
|
La prose de l’essai : Bien qu’en avance sur la langue scientifique et technique, la prose littéraire n’a atteint sa maturité, encore incomplète, que tardivement. Sans faire fi des excellents travaux en prose publiés avant-guerre par Lizardi ou le docteur Etxepare, nous pouvons dire que l’essai prit son essor après la guerre, dans les pages des revues et, notamment, avec une œuvre de la meilleure facture de S. Mitxelena "Inurritza", Unamuno eta abendats (1958). Dans les vingt années qui suivirent, les maisons d’édition proposèrent aux lecteurs des collections complètes d’essais. Signalons comme d’excellents exemples du genre ceux de Txillardegi dans Huntaz eta hartaz (1965) pour leur valeur littéraire, celui de Joxe Azurmendi Hizkuntza, etnia eta marxismoa (1971) pour l’intérêt qu’il présente comme recherche historico-philosophique, ou ceux de K. Mitxelena, Idazlan hautatuak (1972) pour leur langue remarquable. |
Abordons maintenant l’essai. Après une longue période de creux, malgré les travaux parus dans des publications périodiques, à partir des années 50, l’essai basque a suivi de nouvelles voies grâce à Mirande et surtout S. Mitxelena (1958), Zaitegi et L. Mitxelena (dont les écrits épars furent rassemblés en 1972 et récemment publiés en édition complète). Dans ce domaine, sont également intervenus Txillardegi (1965), R. Arregi (1972), X. Mendiguren et, plus particulièrement, le philosophe Joxe Azurmendi (1977, 1978). Ce genre a été abondamment reproduit dans les revues et publications littéraires Euzko-Gogoa, Egan, Olerti, Igela, Ustela saila, Idatz eta Mintz, Maiatz, Xaguxarra, Susa, Pamiela, Literatur Gazeta, etc., ainsi que dans les revues culturelles Jakin, Zabal, Zehatz, Hitz, etc.
Nous n’avons cité ici que le nom des auteurs sans parler, c’est vrai, de leurs œuvres. Nous nous contenterons néanmoins de ce résumé, certains que nous sommes, que le lecteur intéressé pourra consulter des sources d’informations plus exhaustives. Ne pas mentionner l’épanouissement de la traduction (littéraire ou non) et l’existence d’EIZIE (Association basque de Traducteurs, Correcteurs et Interprètes) qui favorisent des projets de grand intérêt, serait inexcusable.
Depuis quinze ans, en raison des besoins sociaux, le travail de l’écrivain s’est étendu à l’école, aux médias et à des domaines assez éloignés de la littérature. Certes, le public potentiel et réel d’une œuvre littéraire est, aujourd’hui, plus important que jamais, si nous le mesurons en lecteur/heures. Pourtant, du fait de la normalisation progressive de l’euskara, la langue écrite fonctionnelle a mis un terme à la suprématie, en termes quantitatifs, du basque littéraire dans la société. Pour la première fois, cette nouvelle situation va peut-être servir à donner aux quelques hommes et femmes de lettres basques un moyen de vivre de leur plume. L’écrivain basque, lui aussi, commence à devenir une réalité sociale.
|
|
Poèmes à la langue : L’un des thèmes récurrents des œuvres littéraires basques, si présent chez les poètes et les bertsolaris, est la défense et l’éloge de la langue. Nous avons, d’ailleurs, déjà abordé ce sujet dans l’introduction du présent ouvrage. En effet, n’est-il pas légitime qu’un artiste de la langue se préoccupe, plus que quiconque, de l’avenir incertain de celle-ci? Ce souci est resté très vif pendant les longues années de répression officelle et, à défaut d’une normalisation satisfaisante, continuera de se manifester. Les deux poèmes reproduits ici expriment cette inquiétude, mais d’un point de vue différent suivant l’auteur: Gandiaga, par une succession de paradoxes, fait allusion aux difficultés pratiques que rencontre l’euskara à être utiliser dans la société, tandis que T. Etxebarria évoque l’angoisse presque tellurienne engendrée par l’hispanisation. |
|
|
Asociación de escritores : Comme cela s’était déjà fait avant la guerre, une Association d’Ecrivains Basques fut créée à Ermua, en 1968, qui réunit sa première assemblée en 1969. Après une longue parenthèse dans les années 70, Euskaltzaindia relança le projet d’association (1978-1979) et réussit, une fois toutes les démarches légales accomplies, à la remettre sur pied en la dotant d’une personnalité juridique propre. Par ailleurs, pour favoriser les relations internationales, les auteurs basques participent au PEN Club (club international d’écrivains). Ces associations contribuent aussi à renforcer la personnalité littéraire de la langue basque au sein de la société et le professionnalisme des auteurs, tout en jouant, si nécessaire, un rôle de porte-parole dans la communauté basque et la communauté internationale. |
|
POETAREN PROTESTA
|
EUSKERIA
Zer, ai, gure aldietako
|
|
|
Les représentations théâtrales : Depuis quelques années, le théâtre nous a permis d’assister à de nouveaux spectacles qui répondent à un souci évident de perfectionnement. Ces représentations sont dues, tantôt à l’organisme Antzerti, tantôt à des initiatives privées. Même si les troupes théâtrales du Pays Basque sont loin d’être bien intégrées sur le plan professionnel, il semble que les acteurs, qui travaillent aussi pour le cinéma, la télévision et l’audio-visuel en général, ont, quant à eux, atteint un certain niveau de maturité. Dans le domaine du théâtre, signalons la pièce Agur, Eire... agur (1987-1988) qui a fait une large place au problème de la langue. |
|
|
La discographie : La production discographique basque, même modeste, constitue pour les Basques un inestimable trésor: en effet, les disques sont le matériel de base des émissions radiophoniques en euskara et permettent de délivrer à chacun un message culturel dans sa propre langue. La foire de Durango (décembre 1988) a donné à sept maisons de disques l’occasion de présenter leurs catalogues. Le souvenir de la langue est également très présent dans la Nouvelle Chanson basque: Euskara eta Txakolina d’Oskarbi, ou Alemanian euskaraz d’Oskorri en sont la preuve. D’ailleurs, le lecteur intéressé par le parcours de ce dernier groupe, admirable de continuité et de qualité, pourra trouver dans le livre Oskorri (1991) —collection complète en quatre langues de leurs œuvres— une excellente source d’informations. |
Entre la langue écrite et la langue parlée, il y a également la langue chantée ou représentée, celle qui se transforme en mélodie dans la bouche des bertsolaris et des chanteurs, ou constitue le support verbal des spectacles audiovisuels.
Par tradition, le peuple basque a toujours aimé le chant. Aussi, n’est-il pas surprenant que l’euskara ait trouvé tout naturellement sa place dans notre musique populaire et classique. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder nos compilateurs de chansons (Sallaberry, Azkue ou A. Donostia). Par ailleurs, la langue basque a aussi fait son entrée dans la musique classique, grâce à des hommes aux talents multiples tel Azkue, linguiste et compositeur à la fois. Dans certains cas, les musiciens ont trouvé leur source d’inspiration dans la littérature, comme Escudero avec l’œuvre de Lizardi (Ileta, 1954). Ou bien c’est l’écrivain qui a écrit le livret en collaboration avec le compositeur, comme M. Lekuona pour Zigor d’Escudero. Mais, les opéras en euskara ou les représentations théâtrales chantées n’ont pas favorisé la reconnaissance sociale de la langue autant que la Nouvelle Chanson (Kanta Berria) à partir des années 60.
|
|
La profession de chanteur : Quelques chanteurs basques ont réussi à faire de leur art une activité professionnelle à part entière. Grâce à la fidélité du public, certains membres de la Nouvelle Chanson basque, toujours aussi dévoués à l’euskara, explorent ce domaine culturel depuis de nombreuses années. Ci-contre: B. Lertxundi, qui commença à chanter en 1965 et a enregistré depuis six quarante-cinq tours et onze albums, tous en basque. |
S’il fallait indiquer une date précise pour la naissance de la Nouvelle Chanson basque, nous la situerions en 1961 avec la sortie du disque de Michel Labegerie. Ce qui était en train de se produire à l’époque, dans des pays aux sentiments nationaux identiques aux nôtres, allait bientôt servir de modèle à nos auteurs interprètes. À cet égard, ce qu’on appelle la Nova Cançó Catalana eut une influence toute particulière, en raison de sa proximité. Pourtant, quelque temps auparavant, un écrivain avait déjà ressenti la nécessité de donner le jour à une chanson plus moderne, et s’était engagé sur cette voie: il s’agit de N. Etxaniz avec son livre Kanta kantari (1951). Avec dix ans d’avance, Etxaniz tenta, par ses compositions, d’offrir à la langue basque un support nouveau et différent qui, de fait, ne prit forme qu’au cours des années suivantes. D’emblée, la Nouvelle Chanson fit le choix de la loyauté vis-à-vis de l’euskara, une loyauté qui ne s’est jamais démentie depuis.
A partir de 1963, de nombreux chanteurs commencèrent à faire leur apparition: L. Iriondo, M. Laboa, M. Idirin, J. Lekuona, J. A. Irigarai, Estitxu, B. Lertxundi, A. Valverde, X. Lete, Pantxoa eta Peio, Etxamendi eta Larralde, etc. Certains d’entre eux formèrent des groupes parmi lesquels Ez Dok Amairu, Oskarbi et Oskorri prirent la relève des anciens (les frères Argoitia, "Contrapuntos", etc.). Les noms de la deuxième vague de chanteurs nous sont plus familiers: G. Knörr, Tx. Artola, I. Rekondo, G. Mendibil, Urko, Imanol, etc. À cette période, de nouveaux groupes se firent également connaître comme Errobi, Irukaitz, Haizea, etc.
|
|
Le cinéma basque : La communauté bascophone n’a pas voulu renoncer au cinéma. En réponse à la demande d’ETB, et grâce à l’énorme travail effectué par les sociétés de post-synchronisation, notre industrie cinématographique a tenté de faire une place sur les écrans à la langue basque. Dans la Communauté Autonome Basque, cela a été rendu possible par les subventions du gouvernement. Pourtant, en matière de production et de distribution, le cinéma basque souffre toujours de conditions sociolinguistiques difficiles et doit affronter un avenir incertain. |
|
|
Les dessins animés : Les dessinateurs basques se sont aussi efforcés de servir leur langue, surtout dans les années 80. D’une part, ils ont créé des bandes dessinées pour l’enseignement de l’euskara et l’alphabétisation des enfants et, d’autre part, ils ont fait une place à la langue basque dans le monde de la bande dessinée en général. Un important travail a également été accompli dans le domaine du dessin animé, pour le cinéma et ETB. Cette activité représente une tâche considérable, même lorsqu’il ne s’agit pas d’une œuvre de création et que le travail principal consiste en traduction et en doublage. Le dessin animé original, Kalabaza tripontzia, de Jaizkibel (1985), mérite d’être signalé comme une réussite dans le genre. |
|
|
La télévision basque (ETB) : Avec l’entrée d’Euskal Telebista dans les foyers euskarophones (1983), le public basque a disposé pour la première fois d’une télévision qui lui offre quotidiennement une programmation en euskara. Dès le départ, ce moyen de communication (ETB-1) s’est défini comme un média dont l’objectif était de normaliser complètement la "langue propre" à Euskal Herria. Les discussions pour savoir quels programmes et quel niveau d’euskara étaient les plus adaptés pour atteindre ce but, n’ont pas manqué. Mais, la communauté bascophone a trouvé dans la télévision un outil indispensable pour faire revivre sa langue. En revanche, en Navarre et en Iparralde, beaucoup reste à faire dans ce domaine. |
C’est dans l’œuvre Oskorri (1991), compilation tétralingue de la production
du groupe, excellent exemple musical et littéraire que l’apportation à la langue
a été le plus marquée. Musiciens et chanteurs n’étaient pas étrangers à la
littérature et recoururent souvent à l’inspiration littéraire des écrivains (par
exemple, le groupe Oskorri avec Aresti), quand ce n’était pas les écrivains
eux-mêmes qui chantaient (Lete, Artze, etc.). De plus, J. M. Lekuona, J. A.
Artze ou B. Gandiaga, entre autres, contribuèrent de façon importante à la
Nouvelle Chanson par les poèmes qu’ils composaient. Parmi les thèmes de
prédilection des chanteurs, l’euskara fut l’un des plus exploités dans les
années 1965-1980. À ce titre, la reprise d’Euskara, euskara d’Etxepare (présenté
dans l’anthologie au début du présent ouvrage) que la Nouvelle Chanson basque
fit découvrir au public dans une ambiance festive et revendicative à la fois, a
une valeur de symbole.
|
|
La publicité en euskara : Jusqu’à très récemment, le monde de la publicité est resté totalement étranger, ou presque, à l’euskara. Des campagnes bilingues ont eu lieu, financées notamment par les institutions publiques, mais l’usage publicitaire du basque demeure très réduit. En décembre 1991, s’est tenu à Saint-Sébastien la première manifestation internationale, à la fois foire et congrès, sur le thème Publicité et Langues minoritaires. D’après l’étude d’EHE (Euskal Herrian Euskaraz) présentée à ce congrès, sur les 7 milliards investis dans le secteur publicitaire en Hegoalde, seulement 0,7% sont consacrés à la publicité unilingue en euskara.
|
Dans les années 80, la Kanta Berria a été bousculée par l’explosion des jeunes groupes de "hard rock". Mais, la chaîne ne s’est pas rompue pour autant. Après la première et deuxième vagues de chanteurs, lesquels continuent de se produire, les nouveaux groupes procurent aujourd’hui à la jeunesse basque de quoi satisfaire ses goûts musicaux en euskara. Plus récemment, nous pouvons signaler le succès des trikitilariak, une forme de chanson populaire traditionnelle qui fait preuve aussi de capacités d’innovation inattendues.
La Nouvelle Chanson basque n’est pas toujours parvenue à atteindre le niveau de qualité souhaité. Néanmoins, elle a produit quelques excellentes œuvres qui pourraient trouver leur place dans notre patrimoine général, et servir de base à une nouvelle tradition. En outre, elle a merveilleusement contribué à bâtir l’avenir de l’euskara.
Abordons maintenant un autre domaine, celui dans lequel la langue basque est artistement ouvragée par la technique traditionnelle des bertsolaris, chantée et partagée par tout l’entourage d’amateurs du genre. Les Basques, grâce au talent de certains d’entre eux et à leur goût des joutes oratoires, ont depuis des siècles leurs bertsolaris, c’est-à-dire des poètes populaires qui improvisent sur n’importe quel thème. Le bertsolarisme est une fête et un jeu de la langue, en même temps qu’une forme de compétition. La vigueur du berstsolarisme est, en quelque sorte, l’indicateur de l’état de santé de l’euskara à un endroit donné car, comme l’a dit Lazkao-Txiki, "pour que les bertsolaris atteignent des sommets, il faut que la langue autour d’eux soit fluide. Sans quoi, cela revient à peindre les nuages au pinceau".
Le bertsolarisme, à savoir les bertsolaris euxmêmes ainsi que les amateurs qui les suivent, a accru son rôle social par les bertso-paperak d’abord, puis en participant à des fêtes populaires et à tous types de concours, publications, recherches et activités diverses. Cette manifestation culturelle de la langue qui, il y a trente ans, était moribonde, a fait de considérables progrès, tant sur le plan de la qualité artistique que de l’ampleur qu’elle a prise. Des Séminaires ont été organisés par les écoles de bertsolaris pour former les futurs poètes et, tant que le "métier" sera enseigné aux jeunes générations et que les dons de chacun seront mis en valeur comme il se doit, la source de ce jeu linguistique ne sera assurément pas près de se tarir. À l’époque de la normalisation de l’euskara, le bertsolarisme est comme un ruisseau d’eau fraîche et limpide.
De nos jours, on peut trouver dans les collections de livres de poésie à notre disposition (dont Auspoa est un bon exemple), et les riches phonothèques que les amateurs et les médias sont en train de constituer, une trace de l’expression la plus forte de notre conscience et de nos revendications linguistiques. En effet, les bertsolaris ont été parmi les serviteurs et les combattants les plus actifs que l’euskara ait comptés dans notre société.
Outre la langue chantée par les bertsolaris et les chanteurs, il existe la langue représentée, c’est-à-dire l’euskara du spectacle, la langue que nous entendons au théâtre, au cinéma, dans les vidéos et à la télévision, en public comme en privé. Nous abordons là un secteur de la communication qui dépasse les limites du Pays Basque et représente un monde en soi, auquel nous n’avons pu accéder que par l’intermédiaire d’autres langues. Aujourd’hui, encore, nous sommes obligés d’emprunter un matériel qui, dans le meilleur des cas, a été traduit en basque. C’est pourquoi il faut impérativement encourager la production d’œuvres originales en euskara. À une époque où l’image est si omniprésente, la communauté bascophone ne peut se permettre de négliger ce média et se doit de l’exploiter dans un double but: pour perfectionner l’apprentissage de la langue basque, et pour ne pas rester à l’écart d’un domaine culturel essentiel. L’importance capitale de ce média est assez évidente pour que nous n’entrions pas plus dans les détails.
|
|
Euskaltzaindia: l’Académie de la Langue Basque : Depuis 1956, date à laquelle elle a repris la tête du mouvement euskaltzale, l’Académie de la Langue Basque joue dans notre pays un véritable rôle de direction socio-académique. Le développement de l’Université du Pays Basque, et les compétences des gouvernements autonomes en matière de politique linguistique, ont conduit naturellement à redéfinir les fonctions de l’Académie. Cependant, elle continuera à accomplir sa tâche de normalisation dans la mesure où elle a le statut officiel d’organisme consultatif. Par ailleurs, Euskaltzaindia est la seule institution linguistique qui couvre l’intégralité du territoire géographique de l’euskara. Enfin, elle reste le point de rencontre obligé des bascologues du monde entier. |
Les diverses sciences de la langue ont coutume d’offrir des visions différentes d’un même sujet et appliquent des méthodes elles aussi différentes. Selon les cas, elles peuvent aborder le problème d’un point de vue strictement linguistique, ou bien anthropologique, historique, sociologique, géogaphique, psychologique, etc. Il en va de même en bascologie, et chaque discipline a sa façon bien à elle d’envisager la réalité de l’euskara. Néanmoins, toutes n’ont pas consacré la même énergie à notre langue et certaines sciences sont allées plus loin que d’autres. Le cadre du présent ouvrage nous oblige à concentrer notre attention sur deux disciplines particulières, la linguistique et la sociolinguistique, sans plus entrer dans les détails.
|
|
Le père L. Villasante Kortabitarte : Né à Guernica en 1920, il fut président d’Euskaltzindia de 1970 à 1989, à la période la plus importante des normes académiques et de l’acceptation sociale de l’euskara "standard" pour la normalisation de la langue basque. Sous sa présidence, l’Académie entreprit de réécrire ses statuts (1972) et de mettre en place des structures fonctionnelles plus efficaces. |
Commençons par citer les centres consacrés à la recherche sur la langue, domaine dans lequel quelques institutions du Pays Basque se sont illustrées. La première d’entre elles a été, naturellement, Euskaltzaindia, c’est-à-dire l’Académie de la Langue Basque. Y compris à l’époque du franquisme, elle réalisa, dès 1956, de nombreux travaux et réunit plusieurs congrès. Nous avons mentionné plus haut certains d’entre eux, mais il convient d’y ajouter ici la publication de la revue Euskera, ainsi que les travaux effectués à l’occasion de congrès, hommages et réunions moins importants.
|
|
Koldo Mitxelena (1915-1987) : Né à Errenteria (Guipuzcoa), il fut professeur à l’université de Salamanque et de Vitoria (ses travaux non euskariens sont signés Luis Michelena) et dirigea le département de recherche d’Euskaltzaindia. Dans l’histoire de la bascologie, il peut être considéré comme l’un des plus grands esprits auxquels Euskal Herria ait jamais donné le jour. Nous lui devons, en particulier, la Fonética Histórica Vasca (1961) et le projet général, ainsi que la publication du premier volume du Diccionario General Vasco (1987). |
|
|
L’Université : Les universités d’Etat n’ont créé les chaires de langue basque que très tardivement (Vitoria, 1977: Chaire de “Linguistique Indo-européenne et Philologie Basque”; 1990: Chaire de Philologie Basque). C’est pourquoi la bascologie a dû se construire en dehors de ces centres, dans les universités étrangères ou nos revues, dans les ouvrages des bascophiles ou des établissements d’enseignement secondaire. La seule chaire de basque, au sein de l’université publique du Pays Basque, se trouve à la Faculté de philologie, géographie et histoire de Vitoria. Ci-dessous: la bibliothèque "Koldo Mitxelena" de la Faculté des Lettres de Vitoria. |
Ces publications nous permettent de connaître de près la vie quotidienne de cette institution officielle de la langue basque. Par ailleurs, les collections scientifiques de l’Académie apportent des contributions plus spécifiques: la collection intitulée "Iker Saila" rassemble des travaux de recherche essentiels comme, par exemple, les présentations et communications du Congrès International de Bascologues (1980). L’Académie édite aussi la collection Onomasticon Vasconiae Saila, consacrée à la toponymie du Pays Basque, et a publié un ouvrage important de découvertes sur l’euskara, mEuskararen liburu zuria, qui porte le titre El libro blanco del Euskara dans sa version castillane (1977). En ce qui concerne la grammaire, elle est responsable, depuis 1985, de la publication en plusieurs tomes d’Euskal Gramatika. Aujourd’hui, Euskaltzaindia travaille en commissions, permanentes ou ad hoc, ce qui a permis de mettre en route la publication du Orotariko Euskal Hiztegia ou Dictionnaire Général Basque (Mitxelena/Sarasola,1987) et d’autres études lexicologiques et lexicographiques, de travaux grammaticaux et onomastiques, ainsi que de projets de dialectologie (atlas linguistique) et de recherches sur la littérature populaire ou savante.
Après la guerre, quand la RIEB eut disparu et que la Société d’Études Basques eut été condamnée au silence, la Députation de Gipuzkoa organisa le Séminaire Julio de Urquijo, avec l’intention de combler, dans la mesure du possible, le vide laissé par les précédentes institutions. Nous devons à cet organisme une revue importante, l’Anuario de Filología Vasca Julio de Urquijo (= ASJU), qui vit le jour dans les années 1953-1954 et qui, après une longue parenthèse, a repris sa parution en 1967. Le Séminaire Julio de Urquijo a publié, entre autres ouvrages, la Fonética histórica vasca (1961) de L. Michelena.
|
|
Fontes Linguae Vasconum (1969) : Cette revue, fondée par la Diputación Foral de Navarre, a longtemps été la plus importante publication de bascologie et l’outil de communication le plus souple pour toute la communauté scientifique intéressée par l’euskara. |
En Navarre, la Députation concentra son travail bascologique autour de l’institution "Príncipe de Viana" qui s’exprima d’abord à travers la revue du même nom et, à partir de 1969, par l’intermédiaire de la revue Fontes Linguae Vasconum. Cette dernière a été la publication de bascologie la plus importante des années 1970-1980. En Iparralde, les études basques se sont articulées autour du Musée Basque de Bayonne, et de publications comme Gure Herria (1921) et le Bulletin du Musée Basque (1924). Jusqu’à ce jour, la contribution des Députations d’Alava et de Biscaye a été plus limitée.
Dans le cadre de l’Université du Pays Basque/Euskal Herriko Unibertsitatea, signalons en premier lieu la Faculté de philologie basque qui peut jouer le rôle d’une nouvelle école de bascologie. Dépendant également de l’UPV/EHU, d’autres centres, hors du campus, se consacrent à des études plus spécifiques: Saint- Sébastien/Ibaeta pour la psycho-linguistique, la sociolinguistique, etc.; Leioa pour les recherches en matière d’alphabétisation technique. L’euskara a aussi été introduit dans les Escuelas Universitarias de Magisterio (= Ecoles normales) où les problèmes pédagogiques et didactiques inhérents au basque représentent un vaste champ d’investigation.
Outre l’UPV/EHU, il faut mentionner l’Université de Bordeaux III qui comprend une chaire de basque dirigée jusque dans les années soixante-dix par R. Lafon, puis par J. Haritschelhar, et actuellement par J.-B. Orpustan. Au sein de l’Université de Pau, la culture et la langue basques sont sous la responsabilité d’un maître de conférences (Tx. Peillen). À Bayonne, deux centres distincts -un centre d’enseignement supérieur et un centre de recherche s’intéressent à la bascologie: le "Centre Interuniversitaire d’Études Basques", géré conjointement par Bordeaux III et Pau, prépare les étudiants aux diplômes de DEUG, licence, maîtrise et doctorat; tandis que l’URA-1055 (Unité de Recherche Associée), en collaboration avec le CNRS et Bordeaux III, se consacre exclusivement à la recherche. En France, il faut citer encore les travaux de bascologues comme J. Allières (à Toulouse-Le Mirail), G. Rebuschi (à Paris III) ou B. Oyharçabal (à l’URA-1028 du CNRS/Paris VII).
|
|
Préparer le futur : En même temps qu’on étudie le passé et la situation actuelle de la langue basque, il faut la préparer pour le futur et prévoir l’adaptation de ses ressources propres (ce qu’on appelle habituellement le corpus) pour que la normalisation soit couronnée de succès. C’est dans cette optique que l’Académie Basque Euskaltzaindia organise divers congrès et séminaires de recherche. L’UZEI collabore dans le même sens, mais plus spécialement sur la lexicologie et la terminologie. Ci-contre: Maileguzko hitzak (= emprunts lexicaux), travail réalisé par M. Zabilde (1982). |
Parmi les universités privées de la Péninsule, signalons l’existence d’un département de basque à Deusto, et d’une faculté d’anthropologie et langue basque à Pampelune. Par ailleurs, le centre de l’UNED à Vergara ou les cours et publications de l’UEU (Udako Euskal Unibertsitatea/Université Basque d’Été) assurent l’important travail social que d’autres organismes ne sont pas en mesure de prendre en charge aujourd’hui. Enfin, bien que très éloigné du Pays Basque, le "Basque Studies Program" de l’Université de Reno/Nevada, aux États-Unis, a comblé un grand vide dans la bibliographie basque, tant par son imposante bibliothèque que par ses travaux de recherche.
Par les recherches qu’elles ont entreprises et l’édition de diverses publications, certaines institutions privées ont également permis de combler des lacunes évidentes: à titre d’exemples, citons Euskeraren iker atalak de Labayru Ikastegia (Bilbao), la série "Euskal Herria" (Bilbao, Université de Deusto), ou les publications Mundaiz (Saint- Sébastien, Université de Deusto, Département de langue basque). Le groupe Gaur qui, à une époque, avait été le pionnier en sociolinguistique, comme Siadeco, dont la continuité dans la recherche a été digne d’éloges, ont produit ces derniers temps toute une série d’études statistiques et d’analyses sociologiques sur l’euskara. Dans un autre domaine, un important matériel a été recueilli depuis 1977, grâce au travail de l’UZEI, pour constituer une base de données terminologique basque: "Euskalterm".
Enfin, depuis quelques années, la Société d’Études Basques, fondée par les quatre Députations, a repris avec détermination ses recherches en bascologie. À côté d’études linguistiques à orientation ethnographique, les cahiers Hizkuntza eta Literatura et la RIEB rénovée, publient les travaux de divers bascologues.
Il ne faut pas oublier les maisons d’édition pour le rôle qu’elles ont joué en commandant des travaux de recherche et en en publiant les résultats. Ces publications figurent dans les catalogues de la Foire du Livre et du Disque Basques de Durango ou, pour celles écrites en euskara, dans la liste bibliographique établie chaque année par Jakin. Cette dernière revue propose aussi les résumés de nombreuses recherches récentes. Rappelons, pour terminer, que le matériel pédagogique conçu pour l’enseignement a parfois donné lieu à un véritable travail de recherche, étant donné qu’il aborde des aspects théoriques et pratiques de la transmission de la langue basque.
Que ces quelques lignes soient un hommage à tous ceux qui ont étudié l’euskara, y compris à ceux dont le nom n’a pas été cité expressément.
Depuis la Renaissance Basque, nombreuses furent les manifestations organisées en l’honneur de l’euskara: jeux floraux, jours de l’euskara, concours de poésie, journées du bertsolari, etc. Dans la mesure où le sentiment en faveur de la langue s’exprime de façon plus claire et plus forte, comme une revendication politique, le nombre de ces manifestations populaires a augmenté à travers tout le Pays Basque. Le moment est venu de les évoquer.
|
|
En faveur des ikastolas (1977-1990) : A mesure que l’Ikastola prenait forme, les euskaltzales de la première heure, comme leurs successeurs, ont toujours estimé nécessaire d’éveiller la conscience linguistique de tous les citoyens pour assurer l’enracinement et la pérennité de l’institution dans la société. Aussi, les fédérations d’ikastolas de chaque province ont-elles pris l’habitude d’organiser des fêtes annuelles, afin d’obtenir des aides pour leurs centres respectifs: c’est le cas de Kilometroak en Guipuzcoa (1977), Ibilaldia en Biscaye (1980), Araba Euskaraz en Alava (1981), Nafarroa Oinez en Navarre (1981) et Herri Urrats en Iparralde (1984). |
 |
|
|
Herri Urrats (1984) : Les ikastolas d’Iparralde - regroupées au sein de l’association Seaska - traversent de graves difficultés socio-politiques. Ne bénéficiant que d’un mince soutien officiel, elles ont besoin de l’aide des euskaltzales pour pouvoir subsister. A cet effet, la fête annuelle Herri Urrats réunit les euskaltzales de tout le Pays Basque, et contribue à renforcer la solidarité et la fidélité linguistiques au sein de la communauté bascophone. |
Grâce à des campagnes d’information plus efficaces dans les médias et aux possibilités accrues de se déplacer facilement, la conscience linguistique populaire a donné lieu à des concentrations de foule d’une ampleur inouïe. La chronologie et l’histoire de toutes ces manifestations de masse restent encore à faire, mais le point de départ en est assurément un fait qui constitue en lui-même un symbole: il s’agit de la campagne "Bai Euskarari" organisée en 1978 par Euskaltzaindia. Après diverses réunions et manifestations tenues dans de nombreuses localités, la cérémonie de clôture de la campagne rassembla 40.000 personnes dans l’enceinte du stade San Mamés de Bilbao. Depuis, aucun événement n’a réuni autant de monde, mais l’euskara, en tant que patrimoine culturel commun, continue d’attirer les foules qui se pressent chaque année pour soutenir l’Ikastola ou l’alphabétisation.
Depuis que les institutions autonomes de la CAB assument officiellement la défense de la langue basque, ces fêtes populaires sont toujours aussi vivantes. Elles sont l’expression de la volonté des Basques à l’égard de l’euskara pour lequel ils réclament un meilleur statut que celui actuellement en vigueur dans la Communauté et ailleurs. C’est précisément pour rappeler où en est l’autonomie euskaltzale dans chaque province, et tenter de faire évoluer la situation, que sont organisés Kilometroak en Gipuzkoa (1977), Ibilaldia en Biscaye (1980), Araba Euskaraz (1981), Nafarroa Oinez (1981) et Herri Urrats en Iparralde (1984). Par ailleurs, l’AEK organise tous les ans, depuis 1980, ce qu’on appelle la Korrika, afin de promouvoir les activités en faveur de l’alphabétisation dont cet organisme a la charge. La Korrika est une course dont le parcours traverse villages et villes dans tout le Pays Basque.
|
|
Bai Euskarari (1978) : La campagne organisée par Euskaltzaindia eut un grand retentissement social dans tout le Pays Basque, tant parmi les bascophones que les hispanophones. |
|
|
Korrika (1980) : Le développement de l’alphabétisation et de l’euskarisation implique des moyens financiers accrus. Pour trouver d’autres soutiens dans la société et pouvoir faire face aux dépenses qu’entraînent les nouveaux projets, l’AEK organise chaque année sa Korrika dont le parcours traverse toutes les provinces d’Euskal Herria. |
Pour donner une idée de l’ampleur du dévouement de la société basque pour l’euskara, nous pouvons citer quelques chiffres dans lesquels il ne faut voir qu’une estimation générale. De 1977 à 1988, 43 grandes fêtes ont été célébrées sur le thème de l’ikastola et il s’en tient actuellement cinq par an: en 1988, elles ont réuni 370.000 personnes. L’organisation Kilometroak de Gipuzkoa recueille chaque année, depuis 1980, la somme de 45 millions de pesetas grâce aux participants et aux spectateurs. En Iparralde, Herri Urrats a connu un développement étonnant: lancée en 1984, à Saint-Pée-sur- Nivelle, avec la participation de 15.000 personnes pour une recette de 400.000 francs, cette manifestation réunit, en 1988, 50.000 participants et permit de réunir 1,1 millions de francs. En outre, il est un élément qui nous prouve de façon évidente l’unité de la communauté euskarophone: non seulement les provinces de Gipuzkoa et de Biscaye, mais aussi d’Alava, ont consacré un pourcentage de leurs recettes aux ikastolas d’Iparralde et de Navarre. Ce fut toujours le cas dans l’Ibilaldia de Biscaye et, depuis 1986, ce pourcentage a atteint 90%. Même dans l’Araba Euskaraz de Laudio (Alava, 1983), la Navarre et Iparralde furent les bénéficiaires de 25% des fonds collectés. La conscience linguistique de la société basque et son dévouement pour l’euskara constituent donc un capital de solidarité et d’efforts indispensable pour mettre en pratique le plan général de normalisation.
Tout ceci reflète l’intériorisation collective d’une situation sociolinguistique conflictuelle et d’un désir de bilinguisme de la communauté basque. La participation massive des "euskaltzales" est évidente dans ces manifestations pro-euskériques, mais on ressent un manque de présence -proportionnelle- de la population hispanophone et de l’émigration établie dans le pays. Souhaitons que cette attitude pro-euskérique -favorable à tant d’aspects, d’après les enquêtes connues- contribue au processus de récupération de la langue.
La formation linguistique des fonctionnaires Même si la langue basque était utilisée oralement dans les institutions des territoires bascophones, à aucun moment, en dehors d’une courte période pendant la guerre civile (1936-1937), celles-ci ne lui avaient accordé de caractère officiel. La Constitution espagnole actuelle (1978) a donc donné aux Basques la possibilité de légaliser un nouveau statut officiel de l’euskara, dans un cadre juridique certes limité et dans les termes qui lui sont propres.
|
|
La Constitution espagnole (1978) : La Constitution espagnole de 1978 est le texte de référence qui définit les critères généraux relatifs aux langues officielles de l’Etat espagnol, lesquelles sont évoquées dans l’introduction, aux articles 3, 20 et 148, et dans la dernière disposition. Ces principes ont été discutés et votés par le Congrès des Députés, la constitutionnalité de toute réglementation ultérieure étant contrôlée par le Tribunal Constitutionnel. Ci-dessus: le Congrès des Députés à Madrid. |
Le territoire de la langue basque se répartit sur deux États (la France et l’Espagne) et trois divisions administratives (la Communauté Autonome du Pays Basque, la Communauté Forale de Navarre et le département des Pyrénées-Atlantiques). Par conséquent, la communauté bascophone n’est pas considérée de la même façon dans chaque région d’Euskal Herria.
|
|
Le Parlement basque (1982) : Lorsque la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie eurent été approuvés, il appartint au Parlement, au sein de la Communauté Autonome Basque, de définir les bases d’une loi générale de politique linguistique. A cet effet, le Parlement basque adopta, en 1982, la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera. Cette loi définit les droits linguistiques des citoyens des provinces basques, droits dont les pouvoirs publics sont chargés de garantir l’exercice. Ci-contre: la Parlement basque à Vitoria. |
A partir de ces constatations, on peut aisément supposer que les lois qui concernent la langue basque ont été élaborées à des rythmes, avec des critères et selon des schémas politiques différents et contradictoires en fonction de l’administration concernée. Jusqu’à présent, c’est le Parlement et le gouvernement basques qui ont produit la législation la plus abondante, et la Navarre est également en train de mettre au point ses propres lois organiques. De fait, la diversité de traitement légal de l’euskara est très grande: tandis que la CAB dispose d’un nombre considérable de textes juridiques sur ce sujet, dans la République française, le basque n’a pratiquement aucune existence légale.
Rappelons ici ce que dit le législateur sur le caractère officiel des langues. La principale loi organique qui réglemente et conditionne l’existence officielle de la langue dans la Péninsule est la Constitution espagnole de 1978. Aux termes de ce texte (art. 3): Le castillan est la langue espagnole officielle de l’État. Tous les Espagnols ont le devoir de la connaître et le droit de l’utiliser. La Constitution établit donc l’obligation de connaître le castillan et le droit entier du citoyen de l’utiliser où et quand bon lui semble.
Le deuxième alinéa du même article définit de quelle façon doit s’appliquer le droit des autres langues de l’État: Les autres langues espagnoles seront également officielles dans les Communautés Autonomes conformément à leurs statuts respectifs. De ce fait, les droits desdites langues ne concernent qu’un cadre géographique limité et le simple citoyen n’a aucune obligation de les connaître, mais les compléments juridiques pour l’application du texte de la Constitution relèvent des statuts d’autonomie. Ainsi, les non hispanophones disposent-ils de divers moyens pour officialiser leur propre langue, moyens qui devraient leur permettre de la faire évoluer de façon intéressante, sur le plan légal et pratique -et dans le respect de la Constitution, bien sûr-, pourvu qu’ils bénéficient du soutien et de l’aide de la volonté sociale.
|
|
Le Parlement navarrais (1986) : Conformément à la Constitution et à l’"Amejoramiento del Fuero" (1982), le Parlement de Navarre a adopté, à son tour, une Loi "forale" sur le basque (1986). Le cadre légal de la normalisation est donc défini, mais ce sont les réglementations ultérieures et les pratiques administratives qui montreront l’ampleur de la réhabilitation officielle de l’euskara en Navarre. Ci-dessous: le Parlement de Navarre. |
C’est sur ces bases que le texte relatif à la langue a été élaboré dans le Statut d’Autonomie du Pays Basque (1979): L’euskara, langue propre au peuple basque, aura, comme le castillan, un caractère de langue officielle en Euskadi, et tous ses habitants ont le droit de connaître et d’utiliser ces deux langues (art. 6). Le texte est circonscrit, naturellement, au cadre défini par la Constitution et, même si l’obligation de connaître l’euskara n’est pas imposée aux citoyens, cette obligation existe pour les institutions publiques. En outre, il appartient aux autorités de protéger les droits linguistiques du citoyen. À cet égard, les droits du Basque moyen vont trouver leur expression concrète, non pas dans cette formulation statutaire très générale, mais dans les textes réglementaires ultérieurs et dans la pratique sociale qui vont en découler.
Afin de pouvoir appliquer ces dispositions statutaires générales à la société basque, le statut prévoit au deuxième alinéa du même article: Eu égard à la diversité sociolinguistique du Pays Basque, les institutions communes de la Communauté Autonome garantiront l’usage des deux langues en réglementant leur caractère officiel, prendront les mesures appropriées et fourniront les moyens nécessaires pour assurer leur connaissance. À l’évidence, en évoquant cette "diversité", le législateur souhaite tenir compte des données démolinguistiques complexes d’Euskal Herria avant de prendre une quelconque décision ou de lancer une quelconque planification. Par ailleurs, il souhaite assurer le bilinguisme basque/castillan d’Hegoalde et en fait un objectif à atteindre par des moyens politiques, en prévoyant au troisième alinéa que: Personne ne devra souffrir de discrimination pour des motifs linguistiques.
Les alinéas suivants (4 et 5) abordent des aspects importants de la politique linguistique, à savoir la reconnaissance de l’Académie comme institution officielle de la langue basque, et les relations qui doivent être entretenues avec les autres territoires de langue basque et leurs institutions culturelles ou académiques. À cet égard, il y est fait mention de la dimension interrégionale et intergouvernementale de l’euskara, ainsi que de la nécessité d’accords pour sauvegarder et développer la langue basque. En ce qui concerne les relations internationales, le Statut prévoit comme recours possibles la médiation du gouvernement espagnol, ou l’initiative du propre gouvernement basque avec l’autorisation des Cortès Générales.
Les droits linguistiques du citoyen (textes)
COMMUNAUTÉ AUTONOME BASQUE Tous les citoyens du Pays Basque ont le droit de connaître et d’utiliser les langues officielles, tant par oral que par écrit. Sont reconnus aux citoyens du Pays Basque les droits linguistiques fondamentaux suivants: a) Le droit de s’adresser en euskara ou en castillan, oralement et/ou par écrit, à l’administration et à tout organisme ou entité situé(e) dans la Communauté Autonome. b) Le droit de recevoir l’enseignement dans les deux langues officielles. c) Le droit de recevoir en euskara publications périodiques, programmes de radio et de télévision et autres moyens d’information. d) Le droit d’exercer activités professionnelles, politiques et syndicales en euskara. e) Le droit de s’exprimer en euskara dans toute réunion.
Les pouvoirs publics garantissent l’exercice de ces droits sur tout le territoire de la Communauté Autonome pour qu’ils soient effectifs et réels.
|
COMMUNAUTÉ AUTONOME BASQUE
Tous les citoyens du Pays Basque ont le droit de (LEY BASICA DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA, 1982: Titre 1, article 5) |
NAVARRE
Le castillan et le basque sont les langues propres à la (LEY FORAL DEL VASCUENCE, 1986: articles 2, 3 et 4 |
|
|
La législation : Il n’y a pas que les parlements qui légifèrent en matière linguistique. Les gouvernements et leurs différents conseils et commissions élaborent aussi nombre de décrets, ordonnances, dispositions et règles sur le caractère officiel de la langue. Comme il est souvent difficile de tous les connaître, l’ensemble des textes de loi relatifs à la langue basque est recueilli dans des collections de ce type qui sont publiées chaque année. |
|
|
Le Secrétariat Général à la Politique Linguistique : L’exécutif basque (dans la CAB) comprend un Secrétariat Général de Politique Linguistique (1983) chargé de définir la politique à suivre dans ce domaine. Cet organisme dépend du Secrétariat de la Présidence, mais siège dans les locaux du gouvernement basque de Lakua (Vitoria-Gasteiz). Il existe également une structure similaire en Navarre (une Direction Générale). Ci-contre: Ajuria Enea, résidence du président du Gouvernement Basque. |
|
|
L’officialisation dans la loi : Une fois approuvé le caractère officiel de l’euskara (en 1979 dans la CAB, et en 1982 en Navarre), les deux communautés autonomes ont entrepris de mettre au point les dispositifs légaux résultant de cette décision politique. En revanche, il n’existe rien de semblable, jusqu’à maintenant, en Iparralde, dans les Pyrénées-Atlantiques. |
La législation linguistique de la Communauté Autonome Basque repose donc sur les bases de la Constitution espagnole et du propre Statut d’Autonomie mais, sur certains points, a donné lieu à des arrêts du Tribunal Constitutionnel. Dans ce domaine, la loi statutaire la plus importante pour le développement de la langue basque est la Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Legea (= Loi organique sur la normalisation de l’usage de l’euskara) (1982). Par la suite, de nombreux décrets et ordonnances ont précisé le texte de ces lois et établi une série de normes destinées aux secteurs de l’administration appelés à traiter des problèmes directement ou indirectement liés à la langue. Il est impossible de résumer ici leur contenu, mais le lecteur intéressé pourra consulter le détail des dispositions légales applicables aux provinces basques dans le recueil annuel intitulé Euskarari buruzko Araubidea/Normativa sobre el Euskara (publié depuis 1985 par HEEE/IVAP à Vitoria).
Pour nous en tenir à l’aspect pratique, signalons ce que stipule la Loi sur la Normalisation à propos des droits linguistiques du citoyen (article 5 du titre 1): le citoyen a droit à la connaissance de l’euskara et, partant, les pouvoirs publics doivent mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour que ce droit puisse s’exercer; le citoyen a également le droit de s’adresser à l’administration en basque, tant par oral que par écrit; il bénéficie du droit de recevoir en euskara, outre l’enseignement, toutes les informations diffusées par les moyens de communication ou émanant des organismes politiques et syndicaux; d’une façon générale, il a le droit de s’exprimer en basque au cours de n’importe quelle réunion. Forts de cette reconnaissance légale, la communauté bascophone et tous les citoyens basques peuvent donc exiger des autorités les ressources et moyens qu’elles se sont engagées à leur fournir.
|
|
La langue basque et le corps enseignant (1976-1990) : Pour réussir la normalisation linguistique, l’un des atouts les plus précieux réside dans la collaboration du corps enseignant. Il faut donc commencer par la formation des professeurs eux-mêmes. Dans la Communauté Autonome Basque, le programme IRALE (Irakaslegoaren Alfabetatze-Euskalduntzea = Formation linguistique du corps enseignant) a été conçu pour prendre en charge directement l’euskarisation et l’alphabétisation des professeurs. Le graphique ci-contre illustre, en pourcentages, la formation progressive des enseignants de maternelle et du primaire. |
En Navarre également, le législateur s’est attaché à définir le statut de la "lingua navarrorum" ou "lingua vascónica", l’Amejoramiento del Fuero de Navarre (1982) et le Statut d’Autonomie de la CAB ayant la même valeur légale. Les normes navarraises sur le caractère officiel des langues figurent à l’article 9 du texte qui déclare que Le castillan est la langue officielle de la Navarre, mais ajoute que Le basque aura un caractère de langue officielle dans les zones bascophones de Navarre. Pour compléter ces deux affirmations, le texte navarrais évoque un développement légal ultérieur, ainsi que d’autres domaines d’application: Une loi forale déterminera ces zones, réglementera l’usage officiel du basque et, dans le cadre de la législation générale de l’État, aménagera l’enseignement de cette langue. Deux points de l’Amejoramiento (voire Statut d’Autonomie) navarrais méritent d’être soulignés: a) Le castillan bénéficie d’une primauté officielle. b) Le basque ne se voit accorder qu’un caractère officiel de second plan et limité à des zones précises. En considération du fait qu’il s’agit d’une langue reconnue comme propre, il apparaît que le statut officiel de l’euskara en Navarre reste très en dessous de ce que prévoient les textes des autres communautés autonomes (par exemple, les Baléares, Euskadi, la Galice, la Catalogne ou le Pays Valencien).
Conscient de ce traitement juridique peu favorable, le Parlement de Navarre a ensuite élaboré la Ley del Vascuence (1986) dont les objectifs sont: protéger le droit des citoyens à la connaissance et à l’usage de l’euskara, et définir les instruments nécessaires pour y parvenir; veiller aux moyens du redressement et du développement de la langue basque, garantir son usage ainsi que son enseignement progressif et volontaire. Cette loi, par les lacunes qu’elle présente, va nécessiter une volumineuse réglementation pour pouvoir être mise en pratique, car il est indispensable de définir avec plus de précision le cadre juridique des droits et devoirs du citoyen.
La Loi de la Normalisation de l’usage de l’Euskara (CAU, 1982) a été le fruit de consentement de tous les partis parlementaires de la Communauté y compris ceux de l’état (central) et du Pays Basque. Par contre, la Loi "Forale" de la langue basque (Navarre 1986) ne jouit pas de la même approbation parlementaire et de nombreux groupes euskaristes s’y sont opposé. D’autre part, l’application de ces deux lois a aussi donné lieu à des prises de position politiques de caractères divers; prises de position qui avec l’évaluation des résultats de celles-ci de la part des organismes institutionnels de politique linguistique (Direction et Secrétariat) doivent donner lieu sans aucun doute à de nouvelles précisions et améliorations dans l’ensemble du rôle normalisateur des gouvernements.
| CONNAISSANCE DE L’EUSKARA PAR LES FONCTIONNAIRES (CAB, 1989) | ||||
| Gouvernement | Organisation d’Utilité Publique | Députations | Capit. et Mun. | |
| Hispanophones unilingues Quasi-bascophones Bascophones non alphabétisés Bascophones alphabétisés |
29,57 50,22 10,30 9,90 |
46,27 36,86 11,35 5,50 |
44,22 36,35 10,26 9,10 |
54,13 35,73 5,89 4,24 |
La formation linguistique des fonctionnaires : Le caractère officiel de la langue basque n’est rien d’autre que le droit des citoyens de s’adresser en euskara à l’administration, et de bénéficier de facilités pour mettre ce droit en pratique. Aussi est-il impératif d’euskariser et/ou alphabétiser les fonctionnaires de toutes les classes et niveaux, pour pouvoir passer d’une administration totalement hispanophone à une administration bilingue. A cet effet, un plan de bilinguisation a été élaboré dans le respect des droits des fonctionnaires les plus anciens comme des plus jeunes. Ce plan décrit les conditions linguistiques requises à chaque poste (profils linguistiques), réglemente le processus de bilinguisation sur une durée de cinq ans, et prévoit les moyens à mettre en œuvre. Ci-dessus: la situation linguistique des fonctionnaires de la CAB (1989).
|
|
La distribution de publications : La production culturelle basque, tant écrite que chantée, a connu bien des mésaventures pour pénétrer dans les réseaux commerciaux. Aujourd’hui, grâce au travail de quelques sociétés privées, la situation est plus favorable. Rappelons que cela constitue aussi une étape vers la normalisation. Ci-contre: les entrepôts de Zabaltzen (Saint-Sébastien, Ibaeta), la plus grande entreprise basque de distribution (1988). |
Dans la société basque, il existe, de nombreuses associations euskaristes qui peuvent et doivent participer à construire le futur de notre langue. Certaines d’entre elles sont en contact, plus ou moins étroit, avec les institutions publiques; d’autres, méfiantes, préfèrent, au contraire, rester à l’écart de toutes les structures officielles. Eu égard au faible pourcentage de population que continue à représenter le noyau bascophone, il faut en appeler à toutes les forces sociales dont nous disposons, ou dont nous pouvons disposer, y compris aux hispanophones amis de l’euskara, pour œuvrer de façon organisée.
Dans les pages précédentes, nous avons fait quelques observations sur le caractère officiel de la langue basque, et il convient maintenant de faire référence, sous la forme d’un inventaire succinct, aux forces sociales sur lesquelles l’euskara peut compter. Il pourrait s’avérer utile et intéressant pour le lecteur de consulter l’Urtekaria (= Annuaire) de la revue Argia de 1991 et de jeter un œil à l’«Agenda de la Culture Basque» qui s’y trouve (page 233). Sans être exhaustif, ni peut-être tout à fait exact, cet agenda donne une bonne idée de la relative richesse culturelle de la société civile basque. Nous parlerons donc, dans ce chapitre, des forces sociales et du capital humain que les Basques consacrent à leur langue de façon à en laisser au moins un témoignage.
Nous avons déjà évoqué les principaux supports utilisés pour transmettre et diffuser la langue basque: la parole, le son ou l’image (l’école, la radio, le cinéma, etc.), et l’écrit (la presse, les livres, etc.). Ces secteurs de la communication possèdent leurs propres institutions légales non officielles, ou bien se composent de groupes de travail informels. Il s’agit quelquefois de mouvements d’activistes militants; dans d’autres cas, d’organisations professionnelles sans but lucratif; ou encore d’entreprises commerciales. Si ces entités, quelles qu’elles soient, assurent et renforcent le rôle social de l’euskara, elles peuvent contribuer à tisser et resserrer la trame linguistico-culturelle de la société basque.
Certains groupes et organisations se consacrent à des actions directes en faveur de la langue: leurs activités culturelles peuvent couvrir l’ensemble du Pays Basque (par exemple, Euskal Herrian Euskaraz ou Euskarazko Kulturaren Batzarrea), d’autres n’ont comme champ d’action et tâche qu’une région ou vallée (de fait l’Association Gerediaga, de Durango), ou ne concerner qu’un village ou un quartier bien précis (c’est le cas de l’association Arrasate Euskaldun Dezagun de la ville Gipuzkoane du même nom), ou bien se tiennent au siège même de l’association ou dans des lieux choisis pour l’occasion (Arrano Beltza de Saint-Sébastien, ou les Euskal Afariak de Bilbao pour ne citer que les plus connus).
|
|
L’information et la coordination : La revue de presse publiée chaque semaine par Euskarazko Kulturaren Batzarrea (= Bureau de Coordination de la Culture Basque) nous permet d’évoquer deux aspects importants de la culture basque: l’information et la coordination. En effet, il est souvent difficile aux cultures et langues minoritaires, en raison du manque d’information, d’être présentes dans la conscience collective de la société où elles vivent, comme d’avoir conscience d’elles-mêmes. Le Pays Basque souffre, en plus, d’être divisé administrativement. Dans ces conditions, comment peut-on rassembler ses forces pour pouvoir fournir, tous ensemble, le même effort? Les conventions et accords intercommunautaires et intergouvernementaux mentionnés dans le Statut d’Autonomie de la CAB (art. 6, alinéa 5) se révèlent donc indispensables, non seulement au niveau des institutions, mais aussi entre les divers mouvements sociaux. Les Basques n’ont pas le droit d’ignorer ces moyens d’information et de coordination. |
Il y a aussi de nombreuses associations, organisations et coordinations privées qui interviennent sur l’ensemble d’Euskal Herria, mais dans un secteur d’activité bien précis. Leurs modalités d’action et leurs responsabilités sont très diverses. Dans le domaine de l’alphabétisation, nous trouvons l’AEK; dans celui de l’écriture, Euskal Editoreen Elkartea (EEE, Association des Editeurs Basques) et Euskal Idazleen Elkartea (=Association des Écrivains Basques); dans le secteur plus technique de la terminologie, figure l’UZEI. Nous pouvons également mentionner les activités spécifiques de la Confédération des Ikastolas (EHIE) et de l’Université Basque d’Été (UEU) dans le domaine de l’enseignement; celles de la Foire du Livre et du Disque Basques de Durango, et de la société Zabaltzen, en matière de diffusion et de distribution de livres; ou le rôle de l’Association des Groupes de Théâtre pour la production dramatique. Il va sans dire que cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive.
D’autres structures associatives valent aussi d’être signalées, même si leurs activités n’ont pas de lien direct avec l’euskara. En effet, les partis politiques, les syndicats et les églises comprennent généralement, dans leur organigramme respectif, des commissions chargées de la culture et/ou de la langue basque. Dans certains cas, ces commissions ont déjà porté leurs fruits (à titre d’exemple, citons les travaux de la commission interdiocésaine de traducteurs lithurgiques, et ceux de la Coordination des Commissions d’Euskara des Caisses d’Epargne), et peuvent fournir des forces vives et dynamiques à prendre en compte dans le cadre du futur projet de planification linguistique. Ces organes secondaires spécialisés, intégrés et reconnus au sein d’institutions qui n’ont pas de rapport direct avec le problème de la langue, méritent toute notre attention pour le grand effet multiplicateur qu’elles produisent dans la société. Il incombe donc à chaque euskariste de faire naître la passion pour le basque, dans la société en général, comme dans son secteur d’activité ou son entourage personnel. Un annuaire des professions pour prestations de services en langue basque est à la disposition du public (Zerbitzu. Profesionari eta merkatari euskaldunon gida. 1991. Bilbo: Artez).
|
|
Foire du Livre et du Disque Basques (Durango, 1965) : Lors de son inauguration en 1965, la Foire du Livre et du Disque Basques de Durango s’assura de la participation de vingt-cinq maisons d’édition et des quatre Députations qui répondaient à l’appel de l’Association Gerediaga, l’organisme promoteur de la manifestation. Depuis lors, cette foire a lieu tous les ans. En 1986 et 1987, elle s’est même tenue deux fois dans l’année: en mai, pour les livres exclusivement en euskara; en décembre, pour les œuvres en toutes langues consacrées au Pays Basque, à sa langue et sa culture. A la deuxième session annuelle de 1988, la foire de Durango a réuni 62 maisons d’édition et 7 maisons de disques, et est devenue le lieu de rencontre ouvert aux lecteurs, écrivains, éditeurs, acheteurs et amateurs en tous genres. |
Ce sont les amoureux de l’euskara qui doivent développer, protéger et rénover les organisations en faveur de la langue et les entreprises consacrées à la production de matériel linguistique. Par exemple, les écoles et groupes de traducteurs sont des éléments fondamentaux pour la normalisation. De même, le doublage des images qui nous viennent du reste du monde est indispensable pour que les Basques puissent avoir accès à l’information en euskara. En outre, il faut encourager les productions originales qui s’inspirent de notre tradition tout en les modernisant sans cesse: des entreprises comme Ikusager et Jaizkibel peuvent être un moyen de nous affranchir du colonialisme culturel dont nous souffrons toujours. Paroliers, scénaristes, cinéastes, dessinateurs, producteurs de vidéo, maisons de disques... tous les usagers et les diffuseurs de la langue dont nous avons déjà parlé, seront bientôt, s’ils le souhaitent, les piliers les plus solides et les plus stables du programme de normalisation linguistique. Comme on peut le voir, l’euskara repose sur un humus socio-culturel riche et fertile.
|
|
Institutions sociales privées : Certaines institutions privées intéressées par la langue basque sont parfois à l’origine de réussites importantes. Citons l’exemple du Séminaire de Derio, avec son école normale et ses cours d’été en basque, qui fonctionne depuis de nombreuses années. |
Après des initiatives de grande valeur, mais isolées, la culture basque a connu des phénomènes de regroupement. De tels processus ont parfois conduit à faire naître des organismes permanents (comme, par exemple, Elhuyar dans l’élaboration de livres de textes et d’alphabétisation technique) mais, dans la plupart des cas, les structures qui ont vu le jour n’ont pas brillé par leur longévité. Néanmoins, l’apport du travail en équipe a été décisif, comme le prouvent les séminaires dans nos universités, des institutions comme Labayru ou les groupes de théâtre. Les associations originales et progressistes, qui défendent leurs légitimes intérêts particuliers, doivent savoir les dépasser pour ouvrir de nouvelles perspectives à l’euskara. Prenons un exemple précis: l’Association de Bertsolaris peut certes se consacrer à la défense des intérêts des ses membres mais, une fois la rémunération du bertsolari assurée, ne doit-elle pas réfléchir aux services que le bertsolarisme est capable de rendre, se consacrer à l’amélioration des techniques de création et accroître le rôle social de ce mouvement, dans le cadre d’un programme de renouveau linguistique?
La communauté euskarophone, héritière d’une longue histoire, est disposée à tout faire, au cours des cinquante prochaines années, pour que l’euskara continue à vivre. Pour atteindre cet objectif, une planification s’avère nécessaire, ainsi que des moyens. Les Basques les trouveront-ils au sein de la société civile? En tout état de cause, il appartiendra aux institutions publiques de puiser, dans ce trésor de volonté et de force, les ressources indispensables pour conserver et transmettre aux futures générations le patrimoine culturel de l’euskara.
Le graphique suivant montre, chronologiquement, les principaux moments sociohistoriques de la langue basque. Rappelons, en premier lieu, que la langue est un code, au sens de système de relations, qui se manifeste socialement par la parole. Historiquement, ce code nous est connu sous la forme de dialectes: d’aucuns pensent que la langue basque primitive ne présentait que deux variantes dialectales.
L’usage oral fut longtemps la seule réalité sociale du basque et, tandis que les idiomes voisins (latin, arabe, langues romanes) accédaient peu à peu au statut de langues écrites, tant au niveau culturel qu’officiel, l’euskara ne subit la même évolution que bien plus tard. La littérature basque naît aux XVIème-XVIIème siècles au nord des Pyrénées, produisant des œuvres considérables (Leizarraga, Axular), puis va se développer de façon remarquable de l’autre côté des Pyrénées au XVIIIème siècle.
C’est ainsi que naquirent les dialectes littéraires. Ils permirent de franchir une première étape sur la voie qui part de dialectes dispersés et uniquement parlés pour aboutir à une seule langue écrite, l’euskara standard. Pendant ce temps, la langue parlée, qui n’avait encore aucun caractère officiel, était couramment utilisée dans la vie privée et dans la vie publique même si, en général, elle était bannie des textes administratifs. Au même moment, -face au danger que représentaient les langues environnantes, et dans un contexte d’essor culturel dû à l’initiative des écrivains- la conscience linguistique basque, à partir du XVIème siècle et, en particulier, aux XIXème et XXème siècles, donne naissance à de nouveaux projets: la normalisation de l’euskara standard, la création d’institutions linguistiques comme l’Académie, l’introduction de l’euskara à l’école, le journalisme, etc.

Les informations historico-sociales réunies dans ces pages proviennent de sources et d’œuvres aussi diverses qu’éparses. Nous ne pouvons toutes les citer ici, car une telle bibliographie serait hors de propos. Par ailleurs, la plupart des ouvrages les plus récents sont naturellement rédigés en euskara. Le lecteur intéressé par les références de ces ouvrages pourra consulter l’édition en basque du présent ouvrage. Cependant, nous estimons qu’il n’est pas superflu de donner quelques informations sommaires sur les publications les plus intéressantes disponibles dans les langues occidentales les plus accessibles. En premier lieu, il convient de citer ici une œuvre trop méconnue qui fut rédigée, à la demande et avec l’aide d’Euskaltzaindia et sous la direction de SIADECO, par un collectif d’auteurs dont les noms figurent dans la préface de M. Ugalde. Il s’agit du Libro Blanco del Euskera. Bilbao, Euskaltzaindia, 1977. Le lecteur y trouvera une source abondante d’informations et d’indications bibliographiques. INTXAUSTI, J. (ed.) (1985): Euskal Herria: I. Historia y Sociedad. II. Realidad y proyecto. Donostia/Arrasate: Jakin/Lan Kide Aurrezkia, contient aussi un important matériel actualisé et une bibliographie (II, 560-562), mais la majeure partie des travaux sont rédigés en euskara. L’ouvrage suivant, en français, présente quelques résumés pratiques: HARITSCHELHAR, J. (ed.) (1983): Être Basque. Toulouse. Privat. Notamment les travaux suivants: MICHELENA, L.: "La langue basque", pp. 225-265. HARITSCHELHAR, J.: "La création littéraire orale et écrite", pp. 267-309. ALLIERES, J. (1979): Les Basques. Paris: PUF (Coll. "Que sais-je?", 1668). Pour l’aspect historique, méritent d’être signalés: CIERBIDE, R. (1990): "Plurilingüismo histórico en Euskal Herria", Fontes Linguae Vasconum, XXII, n° 56, 149-164. CIERBIDE, R. (1991): Euskal Herria: Lugar de encuentro de Lenguas y Culturas. Vitoria-Gasteiz: Euskalerriaren Adiskideen Elkartea.
Mentionnons également quelques traités généraux sur la langue, d’auteurs tout à fait sérieux: MICHELENA, L. (1977): La lengua vasca. Durango: L. Zugaza. LAFON, R. (1973): La langue basque. Bayonne: Bulletin du Musée Basque. En ce qui concerne l’histoire de la langue, la synthèse la plus à jour et qui fournit la bibliographie la plus détaillée est celle de ECHENIQUE ELIZONDO, M. T. (1987): Historia lingüística vascorománica. Madrid: Paraninfo. Pour compléter l’aspect historique, nous citerons les ouvrages récemment édités de MICHELENA, L. qui regorgent d’abondantes informations historiques: (1985): Lengua e historia. Madrid: Paraninfo; (1987): Palabras y textos. Bilbao: UPV/EHU; et (1988): Sobre historia de la lengua vasca. Saint- Sébastien: ASJU/Anejos, 2 vols. Pour l’histoire linguistique de l’euskara, en matière de textes: MICHELENA, L., SARASOLA, I. (1989): Textos arcaicos vascos. Saint-Sébastien: ASJU/Anejos. Ouvrage qui peut être complété par: SATRUSTEGI, J. M. (1987): Euskal testu zaharrak [Textes basques anciens]. Iruñea: R. Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia. Pour les aspects fondamentaux de cette histoire, il existe un ouvrage de référence: MICHELENA, L. (1961-1990): Fonética histórica vasca. Saint-Sébastien: Diputación Foral de Gipuzkoa. De même que: IRIGOYEN, A. (1985- 1990): De re philologica linguae uasconiae. Bilbao: édité par l’auteur (3 vols. à ce jour). Sur la dialectologie actuelle, quelques titres suffisent amplement: YRIZAR, P. (1973): Los dialectos y variedades de la lengua vasca. Estudio lingüístico-demográfico. Saint-Sébastien: Amigos del País. YRIZAR, P. (1984): Contribución a la dialectología de la lengua vasca. Saint-Sébastien: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Ainsi que les travaux à paraître de deux congrès de dialectologie (celui organisé par la Univ. del País Vasco/Seminario "Julio de Urquijo" [septembre 1991], et celui réuni par la R. Académie de la Langue Basque - Euskaltzaindia [octobre 1991: Coll. Iker/7]. Même s’il est difficile de faire une quelconque sélection dans les ouvrages consacrés aux idées, croyances et théories sur la langue et ses différents aspects (origines, étendue, parentés, théories grammaticales, etc.), nous nous limiterons à signaler: LAFON, R. (1947): "L’état actuel du problème des origines de la langue basque", Eusko
Jakintza, I, 1947, 35-47, 151-153, 505-524. TOVAR, A. (1980): Mitología e ideología sobre la lengua vasca. Madrid: Alianza Editorial. ZUBIAUR, J. R. (1989): Las ideas lingüísticas vascas en el siglo XVI. Saint-Sébastien: Université de Deusto, Mundaiz. Il s’impose de consulter aussi: COLLECTIF: Euskalaritzaren historia [Histoire de la Bascologie]. 2 vols. Saint-Sébastien: ASJU/Anejos (en préparation). ZUAZO, K. (1988): Euskararen batasuna/Unificación de la lengua vasca/L’unification de la langue basque. Bilbao: R. Academia de la Lengua Vasca. A propos de la préhistoire et de l’Antiquité, on peut se référer à: MICHELENA, L. (1964): Sobre el pasado de la lengua vasca. Saint-Sébastien: Auñamendi. Et à l’ouvrage de TOVAR, A. (1959): El euskera y sus parientes. Madrid: Minotauro. Un aspect plus particulier de cette histoire est traité dans GORROCHATEGUI, J. (1984): Onomástica indígena de Aquitania. Bilbao: UPV/EHU. Nous mentionnerons également deux ouvrages de CARO BAROJA, J.: (1990): Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina. Saint-Sébastien: Ed. Txertoa; (1979): Sobre la lengua vasca y el vasco-iberismo. Saint-Sébastien: Ed. Txertoa. Le lecteur désireux de connaître l’histoire de la langue basque dans un des territoires actuellement périphériques, mais autrefois bascophones, ne peut ignorer: - Pour la zone de la Rioja et de Burgos, le traité de MERINO URRUTIA, J. B. (1978): La lengua vasca en la Rioja y Burgos. Logroño: Diputación Provincial. - Pour le cas alavais: APRAIZ Y BUESA, O. (1976): El vascuence en Vitoria y Alava en la última centuria (1850-1950). Vitoria: Diputación Foral. CIERBIDE, R.; VALLEJO, P. (1983): "Historia de las lenguas en Alava", dans: Alava en sus manos. Vitoria-Gasteiz: Caja Provincial. II, 9-40. KNÖRR, E. (1979): Alava abierta. (Préface). Vitoria: Caja Provincial. KNÖRR, E. (1991): "Sobre la recogida y el estudio de la toponimia en Alava: Pasado y presente", in: Actas de las I Jornadas de Onomástica, Toponimia. (Vitoria- Gasteiz, Abril de 1986). Bilbao: Euskaltzaindia (pp. 65-92). INTXAUSTI, J. 1994: El euskera en Alava. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.
- Les documents concernant la Navarre sont: GONZALEZ OLLE, F. (1989): Introducción a la historia literaria de Navarra. Pampelune: Gobierno de Navarra. Et plus particulièrement: APAT-ECHEBARNE, A. [=IRIGARAI, A.] (1974): Una geografía diacrónica del Euskara en Navarra. Pampelune: Ediciones y Libros (Diario de Navarra). Une courte synthèse est aussi disponible dans ECHAIDE, A. M. (1990): Gran Enc. Navarra, à "Euskera" et à "Euskera, Enseñanza del". Quant à la situation actuelle, nous recommandons l’exposé sociolinguistique détaillé de SANCHEZ CARRION, J. M. (1972): El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970). Factores de regresión. Relaciones de bilingüismo. Pampelune: Diputación Foral. En matière de synthèse sur la littérature basque, nous n’indiquerons que quelques œuvres générales en espagnol, mais notre sélection ne doit rien enlever à la valeur des ouvrages non cités: MICHELENA, L. (1988): Historia de la Literatura Vasca. Saint-Sébastien: Erein (deuxième édition), la meilleure histoire critique disponible à cette échelle; VILLASANTE, L. (1979): Historia de la Literatura Vasca. Arantzazu: Ed. Franciscana, la plus érudite et détaillée; SARASOLA, I. (1976): Historia social de la literatura vasca. Madrid: Akal. JUARISTI, J. (1987): Literatura vasca. Madrid: Altea. ESTORNES LASA, B. (1969): Historia de la Literatura Vasca. Saint- Sébastien: Ed. Auñamendi (5 vols.), surtout intéressante pour les recueils de textes. En français, il existe: LAFON, R., HARITSCHELHAR, J. (1986): "La littérature basque", in: QUENEAU, R. (1986): Histoire des Littératures. III. Littératures françaises, connexes et marginales. Paris: Gallimard (pp. 1596-1616). Les ouvrages spécialisés dans la littérature orale et le bertsolarisme sont presque exclusivement publiés en euskara. Pour un premier contact, peuvent être utiles: LEKUONA, M. de (1965): Literatura oral vasca. Saint-Sébastien: Ed. Auñamendi. ZAVALA, A. (1964): Bosquejo de historia del bertsolarismo. Saint-Sébastien: Ed. Auñamendi. Une étude récente en aborde également les aspects techniques et historiques: AULESTIA, G. (1991): Bertsolarismo. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia.
Pour tout ce qui touche à la situation sociolinguistique actuelle, les informations sont très dispersées et souvent en euskara. Aussi est-il particulièrement délicat, dans ce domaine, de donner les références des sources existantes, l’indication fournie n’étant pas forcément représentative. Néanmoins, les études réalisées par le gouvernement basque, le gouvernement de Navarre et SIADECO doivent être signalées: [SIADECO] (1979): Conflicto lingüístico en Euskadi. Bilbao: Academia de la Lengua Vasca. GABINETE DE PROSPECCION SOCIOLOGICA (1983): La lucha del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca. Una encuesta básica: Conocimiento, uso, actitudes. Vitoria- Gasteiz: Gobierno Vasco. RUIZ OLABUENAGA, J. I. (1984): Atlas lingüístico vasco. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. GOBIERNO DE NAVARRA (1988): Distribución de la población navarra según el nivel de euskara. Pampelune. GOBIERNO VASCO (1989): Mapa sociolingüístico. Análisis demolingüístico de la Comunidad Autónoma Vasca, derivado del Padrón de 1986. Vitoria-Gasteiz. Le lecteur pourra trouver une analyse théorique de grand intérêt dans l’ouvrage de SANCHEZ CARRION, J.M. (1987): Un futuro para nuestro pasado. Claves de la recuperación del Euskara y la teoría social de las Lenguas. San Sebastián. Pour plus de détails sur les parutions et acquisitions, il ne faudra pas oublier dorénavant de consulter les publications du Secrétariat Général à la Politique Linguistique, du Conseil Consultatif de l’Euskara de la CAB, de la Direction de Politique Linguistique de Navarre, d’Euskaltzaindia, de l’UPV/Seminario "Julio Urquijo" (Saint- Sébastien) ou de l’Université de Deusto, des associations euskaristes et des revues basques qui traitent parfois des aspects les plus brûlants de l’actualité sociolinguistique. Les travaux théoriques et appliqués, sans cesse plus rigoureux, sont disponibles dans les bibliothèques provinciales des capitales basques, et à la bibliothèque municipale de Bayonne, ainsi qu’à la Bibliothèque K. Mitxelena du Département de philologie basque (campus universitaire de Vitoria-Gasteiz), dans les bibliothèques universitaires de Deusto (Bilbao et Saint-Sébastien) et Pampelune, dans celles des séminaires diocésains (Derio, Saint-Sébastien), ainsi qu’à la Bibliothèque "R. M. Azkue" de l’Académie de la Langue Basque - Euskaltzaindia à Bilbao, sans oublier la bibliothèque du monastère bénédictin de Lazkao (Gipuzkoa).
En outre, les capitales basques (Bayonne, Bilbao, Pampelune, Saint-Sébastien et Vitoria-Gasteiz) abritent généralement quelques librairies spécialisées dans les thèmes euskariens, et des représentations locales d’Euskaltzaindia qui pourront orienter les personnes dans leurs recherches. Pour tous renseignements bibliographiques sûrs et immédiats, nous proposons quatre adresses utiles au Pays Basque: - Biblioteca "R. M. Azkue", R. Academia de la Lengua Vasca, Directeur: M. J. A. Arana Martija (Plaza Barria, 15. 48005-Bilbao. Tél. 19-34-4--4158371. Fax. 19-34-4-4150051). - Eusko Bibliographia. Asociación Internacional de Bibliografía Vasca.M. Luis Moreno (Olagibel, 6-3º. 01004-Vitoria-Gasteiz. Tel. 945-288411. Fax. 945-233940). - Dom Juan José Agirre (OSB. Bibliotecario) (PP. Benedictinos. 20210-Lazkao. Tél. 19-34-43- 880170). - A Bayonne: la direction du Musée Basque (qui doit s’installer dans de nouveaux locaux). - Enfin, pour les Amériques, le plus important centre d’information sur la langue basque se trouve à la bibliothèque du Basque Studies Program, University of Nevada, 89557-Reno (USA).
Au terme de cet ouvrage, nous remercions tous ceux qui, de par leur aide nous ont permis de réunir et sélectionner les illustrations. De par leurs attentions spéciales prêtées, il s’avère opportun de mentionner les personnes suivantes: Agirre, Juan Jose (Pères Bénédictins, Lazkao), Arana Marija, J.A. (Euskaltzaindia-Académie de la Langue). Ariztondo, Salbador (Députation Forale de Biscaye). Bökenförde, Maite (Köln). Bilbao, Karmen (Bibliothèque Provinciale, St.-Sébastien). Domènech, Begoña (Députation Forale de Biscaye), Foronda, Enrique (Caja Laboral Popular). Handalian, Hélène (Paris). Thierry, Nicole (Paris). Zabala, Aingeru (Députation Forale de Biscaye). Zubizarreta, C. (Pères Franciscains, Arantzazu).
I1 nous aurait été impossible de réaliser cette publication sans la collaboration de certaines institutions, aussi bien du Pays Basque que de l’extérieur. Département d’Éducation, Universités et Recherche du Gouvernement Basque. Département de la Culture et du Tourisme du Gouvernement Basque. Département de la Culture et du Tourisme du Gouvernement de Navarre. Département de la Culture de la Députation Forale de Biscaye. Département d’Éducation, Culture, Sports et Tourisme de la Députation Forale de Gipuzkoa. Musée Basque de Bayonne. Bibliothèque des Pères Bénédictins (Lazkao). Bibliothèque «Azkue» d’Euskaltzaindia. Bibliothèques et Archives Franciscaines (Arantzazu, Arrasate, Zarautz). Revue «Jakin».
Copier des archives http://www.euskara.euskadi.net/r59-734/fr qui représentent 100 Mo
Ces archives sont très très longues à télécharger en PDF.
Iluna Ehulea