
Euskara, la langue des Basques
§ de euskara.euskadi.net §
Première partie
|
|
Euskara, la langue des Basques
§ de euskara.euskadi.net §
Première partie
|
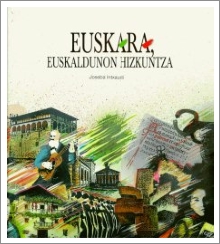 |
| Cette composition poétique (appelée "Contrapas" par l’auteur et écrite à la louange de la langue) fut publiée dans le premier livre basque imprimé, en même temps que le poème "Sautrela". Les deux compositions répondaient à une même préoccupation linguistico culturelle. L’orgueil d’écrire dans une langue vernaculaire (différente du latin culte et des langues romanes officielles ou de cour) s’apparente à celui dont font preuve nombre d’humanistes de la Renaissance. De ce point de vue, Le premier poète basque connu s’exprima en accord avec les idées de son temps. C’est précisément à l’époque où vécut Etxepare que les langues vernaculaires -majoritaires et/ou officialisées- allaient franchir les étapes décisives de leur développement (1520-1560) jusqu’à être reconnues socialement comme instruments adaptés à la vie culturelle de leur pays respectif. Avec le passage progressif du latin au second plan, le futur rôle socioculturel du français, de l’italien, du castillan et de l’anglais s’affirma. En revanche, l’allemand -en dépit des efforts de la Réforme- et le polonais, par exemple, durent encore attendre quelques siècles avant de surmonter, sous divers aspects, la suprématie culturelle du latin qui s’était imposée jusqu’alors. Par l’écriture, Etxepare voulut mettre en évidence les potentialités de l’euskara, sa chère langue maternelle, que d’autres s’évertuaient à nier. Au terme de son œuvre, l’auteur exprime la satisfaction que lui procure le résultat, qui justifie tout à fait son engagement, comme il nous le dit dans ce poème. |
Heuskara, ialgi adi kanpora. Garaziko herria benedika dadila, heuskarari eman dio behar duien thornuia. Heuskara, ialgi adi plazara Berze jendek uste zuten ezin skriba zaiteien; orai dute phorogatu enganatu zirela. Heuskara, ialgi adi mundura. Lengoajetan ohi inzan estimatze gutitan; orai aldiz hik behar duk ohoria orotan. Heuskara, habil mundu guzira Berzeak oro izan dira bere goihen gradora; orai hura iganen da berze ororen gainera. Heuskara. Baskoak orok preziatzen, heuskara ez iakin harren; orok ikhasiren dute orai zer den heuskara. Heuskara. Oraidano egon bahiz inprimatu bagerik, hi engoitik ebiliren mundu guzietarik. Heuskara. Ezein ere lengoajerik ez franzesa ez berzerik orai ezta erideiten heuskararen parerik. Heuskara, ialgi adi danzara.
B. ETXEPARE Linguae Vasconum Primitiae, 1545
|
Heuscara, sors au dehors.
Que le pays de Cize soit bénit! Il a donné à l’heuscara le rang qu’il doit avoir.
Heuscara, Sors sur la place.
Les autres peuples croyaient Quón en pouvait pas l’écrire. Maintenant l’expérience leur a prouvé Qu’ils s’étaient trompés.
Heuscara, Sors dans le monde.
Parmi les langues, tu étais jadis Tenu en piètre estime. Maintenant, au contraire, tu dois être Honoré partout.
Heuscara, Va-t’en dans le monde entier.
Toutes les autres sont arrivées A leur apogée. Maintenant, il montera, lui, Au-dessus de toutes les autres.
|
Heuscara!
Les Basques sont appréciés de tout le monde, Bien qu’on en connaisse pas l’heuscara. Tout le monde apprendara Maintenant ce qu’est l’heuscara.
Heuscara! Si tu es resté jusqu’à présent Sans être imprimé, Désormais tu iras Par l’univers.
Heuscara!
Maintenant, On en trouve aucune langue, Ni les français ni d’autres, Egale à l’heuscara.
Heuscara, Sors pour danser.
Bernat ETXEPARE Linguae Vasconum Primitiae, 1545 (Traduction: R. Lafon) |
Pendant la Renaissance, la vieille polémique entretenue depuis l’époque de Dante (1303) reprit de plus belle. En matière de culture, quelle langue devait-on utiliser, le latin ou les langues vulgaires ? Les langues populaires pouvaient-elles réellement devenir des instruments de culture convenables ? Nombreux étaient ceux qui persistaient à leur refuser le pouvoir et la dignité suffisantes. Parmi les humanistes, la Renaissance stimula pareillement l’adhésion au latin et la valorisation politique de la culture (y compris la propre valorisation nationale des cultures et des langues, même si cela peut nous sembler paradoxal de la part de ces internationalistes latinisants). Si besoin est, le texte de L. Valla (1444) ci-contre, certainement représentatif de l’époque, en fournit la preuve. Dans les années 1520-1560, le renforcement de nouvelles pratiques culturelles face aux vieilles théories académiques latinisantes et exclusives raviva l’ancienne querelle entre latinistes et vernaculistes. À titre d’exemple, citons les traductions de la Bible par la Réforme, les résolutions politico-linguistiques des grandes monarchies ou les praxis littéraires des intellectuels les plus innovateurs. Le latin moderne de la Renaissance offrait des avantages évidents à d’importantes minorités, non seulement de par son utilité technique, mais aussi en tant qu’instrument de diffusion internationale. Grâce au latin, des personnages comme Erasme de Rotterdam (1466-1536) disposèrent d’une pléiade de lecteurs dans toute l’Europe. Cependant, le pouvoir et la culture vivante prirent d’autres chemins, si bien qu’au cours des siècles suivants, la préférence pour les langues populaires finit par prévaloir. Les textes présentés ici appartiennent à trois aires géolinguistiques distinctes : castillan, portugais et français. Nebrija comme Oliveira, Du Bellay comme Villalón y expriment avec ténacité leurs prédilections idiomatiques.
Lorentzo Valla (1444)
Le siècle écoulé depuis la première grammaire castillane (1492) jusqu’à Fray Luis de León ne suffit pas à sortir définitivement du dilemme entre latin et langues vernaculaires. Aussi surprenant que cela puisse paraître, quarante ans après la publication du premier livre en basque (1545), dans le prologue à la seconde édition de Los nombres de Cristo, Fray Luis de León se vit contraint de justifier son choix linguistico-culturel du castillan (1585). Dès sa naissance donc, la littérature basque fut aussi ballottée dans les débats et les incertitudes. Etxepare en avait, d’ailleurs, pleinement conscience. Pour faire revivre cette période -et aussi parce que les doutes d’alors peuvent éclairer notre lanterne-, nous avons voulu apporter ces témoignages sur le climat intellectuel hostile qui régnait à l’époque où vécurent Etxepare et Leizarraga.
Nobles, donc, sont les attributs qui ornent le latin et grand, sans doute, est le pouvoir divin de cette langue qui s’est défendue des siècles durant, avec foi et ferveur, contre les assauts de ses ennemis, étrangers et barbares, pour que nous, Romains, ne souffrions pas, mais nous nous réjouissions et glorifiions à la face du monde. Certes, nous avons perdu Rome, nous avons perdu l’empire, nous avons perdu le pouvoir, non par notre faute mais par la fatalité de l’Histoire. Pourtant, il est un empire plus resplendissant encore grâce auquel nous régnons toujours sur de nombreuses régions du monde. Nôtre est l’Italie, nôtre est la Gaule, nôtres sont l’Espagne, l’Allemagne, la Pannonie, la Dalmatie, l’Illyrie et bien d’autres nations. Car là où la langue italienne (= le latin) s’est imposée, là vit avec elle l’Empire romain.
Lorenzo VALLA Elegantiae Linguae Latinae. 1444
Antonio E. de Nebrija (1492)
Cuando bien comigo pienso, mui esclarecida reina, y pongo delante los ojos el antiguedad de todas las cosas que para nuestra recordación i memoria quedaron escriptas, una cosa hallo i saco por conclusión mui cierta: que siempre la lengua fue compañera del imperio, i de tal manera lo siguio que junta mente començaron, crecieron i florecieron i despues junta fue la caida de entrambos.
Antonio E. de NEBRIJA Gramática Castellana, 1492
Fernão de Oliveira (1536)
Grécia e Roma só por isto ainda vivem, porque quando senhoreavam o Mundo mandaram a todas as gentes a eles sujeitas aprender suas línguas e em elas escreviam muitas boas doutrinas, e não somente o que entediam escreviam nelas, mas também trasladavam para elas todo o bom que liam em outras. E desta feição nos obrigaram a que ainda agora trabalhemos em aprender e apurar o seu, esquecendo-nos do nosso. Não façamos assim, mas tornemos sobre nós agora que é tempo e somos senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné que sejamos ensinados de Roma, ainda que ela agora tivera toda sua valia e preço. E não desconfiemos da nossa língua porque os homens fazem a língua, e não a língua os homens. E é manifesto que as línguas grega e latina primeiro foram grosseiras e os homens as puseram na perfeiçao que agora têm.
Fernao de OLIVEIRA Grammatica da Lingoagem Portuguesa, 1536
Joachim Du Bellay (1549)
Nostre Langue n’ha point eu à sa naissance les dieux & les astres si ennemis, qu’elle ne puisse un jour parvenir au point d’excellence & de perfection, aussi bien que les autres, entendu que toutes Sciences se peuvent fidelement & copieusement traicter en icelle, comme on peut voir en si grand nombre de livres Grecz & Latins, voyre bien Italiens, Espaignolz & autres, traduictz en Francoys par maintes excellentes plumes de nostre tens.
Joachim du BELLAY Deffense de la Langue Françoise, 1549
Cristóbal de Villalón (1558)
La lengua que Dios y naturaleza nos ha dado no nos deve ser menos apazible ni menos estimada que la latina, griega y hebrea, a las quales creo no fuesse nuestra lengua algo inferior, si nosotros la ensalçássemos y guardássemos y puliéssemos con aquella elegancia y ornamento que los griegos y los otros hacen en la suya. Harto enemigo es de sí quien estima más la lengua del otro que la suya propia.
Cristóbal de VILLALON Gramática Castellana, 1558
Fray Luis de León (1583)
Unos se maravillan que un teólogo, de quien, como ellos dicen, esperaban algunos grandes tratados llenos de profundas cuestiones, haya salido a la fin con un libro en romance. Otros dicen que no eran para romance las cosas que se tratan en estos libros, porque no son capaces de ellas todos los que entienden romance. Y otros hay que no los han querido leer, porque están en su lengua; y dicen que si estuvieran en latín los leyeran.[...].
Y esto mismo, de que tratamos, no se escribiera como debía por solo escribirse en latín, si se escribiera vilmente: que las palabras no son graves por ser latinas, sino por ser dichas como a la gravedad le conviene, o sean españolas o sean francesas. Que si, porque a nuestra lengua la llamamos vulgar, se imaginan que no podemos escribir en ella sino vulgar y bajamente, es grandísimo error; que Platón escribió no vulgarmente ni cosas vulgares en su lengua vulgar.[...]
Mas a los que dicen que no leen aquestos mis libros por estar en romance, y que en latín los leyeran, se les responde que les debe poco su lengua, pues por ella aborrecen lo que si estuviera en otra tuvieran por bueno. Y no sé yo de dónde les nace el estar con ella tan mal, que ni ello lo merece, ni ellos saben tanto de la latina que no sepan más de la suya, por poco que de ella sepan, como de hecho saben de ella poquísimo muchos.
Fr. Luis de LEON Los nombres de Cristo, 1585
Joan Maragall (1903): "Elogi de la paraula"
L’époque contemporaine fournit également de multiples exemples de poètes qui, dans bien des pays et des idiomes, ont exalté de toute leur âme et de tout leur cœur leur propre langue. Une anthologie considérable pourrait être constituée sur ce thème, qui recueillerait les œuvres littéraires produites par les groupes linguistiques les plus nombreux comme les plus réduits. La poésie catalane en est un bon exemple. Aribau, Omar i Barrera, Apel-les Mestres, Matheu i Fornells, Arnau i Cortina, S. Espriu, Pere Quart Foix, Andrés i Estellés, tous ont su chanter la langue opprimée. Le sujet a inspiré également de magnifiques textes en prose, parmi lesquels le célèbre Elogi de la paraula de Joan Maragall (1903). Dans le domaine de l’essai castillan, signalons le mémorable Aprecio y defensa del lenguaje de Pedro Salinas (1944), cet appel au secours en faveur de la langue castillane de Porto Rico alors en situation de grave danger. Comme introduction aux poèmes choisis, voici les considérations de Maragall et de Salinas portant sur leur langue respective et recueillies en version originale.
Heus aquí, doncs, com al predicar nosaltres l’exaltació de les llengües populars, no altra cosa prediquem que el pur imperi del verb creador, la infinita transformació de la terra en el cel, que és el més fondo anhel del veritable progrés humà. I així, quan la nostra predicació és motejada de rebel, estèril i regressiva, nosaltres podem somriure als nostres enemics amb fermesa serena, i seguir avant predicant la llei del verb, que és la llei del món. Perquè essent el món creat pel verb, ¿qui, sinó el verb, ha de regir-lo cap al cel? I si el verb que omple la creació es manifesta a través de la terra per la paraula de l’home, que és la suprema expressió de cada terra, ¿qui altre arreglament de les terres pot ésser desitjat, si no és aquell assenyalat per la vida espontània dels llenguatges?
Joan MARAGALL: Elogi de la paraula, 1903
Pedro Salinas (1944): "Aprecio y defensa del lenguaje"
Nos entendemos y sentimos en común, hoy, porque muchas generaciones de nuestros antepasados fueron entregándose una a otra ese instrumento prodigioso de vivir, en la lenta sucesión de perfecciones, de modo que el idioma ha llegado hasta nosotros más apto que nunca para expresar lo humano. ¿Tiene derecho ninguna generación a descuidar o abandonar esta santa misión trasmisora de su lengua, por flojedad o por inconsciencia? [...] Deber de todo grupo histórico, de toda generación es la transmisión enriquecida de su herencia. Consume de lo heredado, de ello vive en gran parte, pero su deber es crear, a su vez, acrecer, enriquecer, de manera que a la hora de las cuentas finales el haber común sea más alto. Tan solo así la humanidad se siente realizada en plena dignidad de su cometido. Este lenguaje que hablamos, nuestro es por unos años, recibido lo tenemos de los hombres de ayer, en él están, apreciables, todos los esfuerzos que ellos pusieron en mejorarlo. Pues bien, este es mi llamamiento: que cuando nosotros se lo pasemos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, no sintamos la vergüenza de que nuestras almas entreguen a las suyas un lenguaje empobrecido, afeado o arruinado. Este es el honor lingüístico de una generación humana y a él apelo en estas mis últimas palabras.
Pedro SALINAS: Aprecio y defensa del lenguaje. , Puerto Rico. 1944.
S’inspirant des mêmes sources et de valeurs culturelles voisines, mentionnées par les deux écrivains, la poésie a souvent chanté le profond sentiment de fidélité que les peuples nourrissent envers leur langue. Pour en apporter la preuve, nous avons choisi quatre textes poétiques procédant d’horizons culturels et de vécus linguistiques aussi éloignés que divers. L’Allemand F. Schiller (1759-1803), dans un poème plutôt médiocre, nous offre une vision de l’histoire culturelle de la langue allemande abandonnée au profit du français par les politiciens germains au XVIIIème siècle. Cette attitude critique de Schiller laisse entrevoir une réalité signifiante. Le deuxième poème est précieux par son actualité. Son auteur Olavo Bilac (1865-1918), est l’un des meilleurs poètes brésiliens. Il s’agit donc de l’enfant d’un pays, jadis colonie portugaise, qui célèbre la langue reçue de l’ancienne métropole. Le poème présenté ici est un texte que, traditionnellement, les écoliers du Portugal ont l’habitude d’apprendre et de réciter par cœur; il a donc en outre une valeur sociolinguistique.
Le poème suivant nous vient d’un peuple plus petit, mais qui nous est peut-être plus proche par son tempérament: la Géorgie caucasienne, dont les habitants, se dérobant sans cesse à l’emprise russe, forment un peuple véritablement amoureux de sa langue. Le texte choisi est d’Irakli Abachidzé, un poète du XXème siècle, et extrait de Sur les pas de Rustavéli écrit après un voyage en Palestine en 1960. Aux dires d’un critique, "Ce poème bouleversa toute la Géorgie, il la bouleversa au plus profond de son cœur". Au terme de ce chapitre, nous avons pris prétexte de l’actualité et de la récente disparition de Gabriel Celaya pour rendre hommage à celui qui chanta l’euskara, son absence et son ostracisme, en incluant ici «Sans Langue» (1960).
F. Schiller (1759-1805): "La muse allemande"
 |
LA MUSE ALLEMANDE
Aucune époque d’Auguste ne fleurissait, la magnificence d’aucun Médicis ne sourit point à l’art allemand. La gloire ne le caressa pas, il n’épanouit pas sa fleur aux rayons de la faveur des princes. Il fut sans honneur, abandonné par le plus grand fils de l’Allemagne, par le trône du grand Frédéric. L’allemand peut dire avec fiérté, son Cœur peut palpiter plus fort: Lui-même a créé sa valeur. |
Voilà pourquoi la voûte s’élève plus haut,
pourquoi l’hymne des bardes allemands
s’écoule en ondes plus courbes,
et rempli de sa propre plénitude
et jaillissant de la profondeur du cœur,
il se moque des contraintes des règles.
Friedrich SCHILLER (1759-1805) (Trad. G.Bökenförde/H.Handalian)
Olavo Bilac (1865-1918): "Langue portugaise"
LANGUE PORTUGAISE Fleur ultime du Latium, rudimentaire et belle, Tu es, en même temps, splendeur et sépulture: Pareille à l’or natif que, dans la gangue impure, Parmi les alluvions, la mine austère recèle... C’est ainsi que je t’aime, obscure et ignorée, Lyre de sincérité, trompette au son puissant, Qui gronde, souffle et siffle comme les ouragans, Mais roucoule saudade et sensibilité! J’aime ton agreste vigueur, j’aime ton arôme, Parfum de forêt vierge et de lointaines mers! Oui je t’aime, ô rude et douloureux idiome Dans lequel "Mon enfant!" ma mère murmura, Et Camoëns pleura, dans son exil amer, Le génie sans bonheur et l’amour sans éclat! OLAVO BILAC (1865-1918)
Shota Rustavéli (Siècle XIII)
 |
Irakli Abachidzé (1960): "La voix de Rustavéli” LA VOIX DE RUSTAVÉLI
Langue géorgienne, O ma langue natale, O gloire de mon peuple, Tu t’élèves et planes Comme la plus haute flamme de la foi. Toi, le baume apaisant de toutes nos blessures, O ciment qui unit les pierres dans le mur, A l’heure de la mort je n’ai plus rien que toi. J’ai tout quitté, Mes proches, des centaines D’amis et ce qui délivrait L e faux et le vrai, L’amour et la haine. Tout est fini, ... Tout s’achève, J’ai fait mes adieux aux mortels Mais toi seule demeures, Toi seule es éternelle, Toi seule Je ne puis te quitter Au moment où je meurs. |
Le soleil (1) qui portait mes rêves,
Le soleil qui me dévorait,
Les jours les plus délicieux
Et tous les instants de douceur,
O ma langue natale, tu les passes en saveur,
O mon bonheur amer,
O ma tristesse douce,
Tu peux tout dire à tous
Et tout taire.
Héros des légendes,
O grand sage,
O stèle du passé, ô présage!
Tu pénètres les secrets de la terre
Et tu scrutes les cieux,
Tu es également le burin, le pinceau,
Le chant du berceau
Et la plainte dernière,
O verbe des Ibères (2) ,
Langue de la Reine Tamar,
Mon génie et mon art,
Tu t’élèves et planes,
O langue natale, ma langue natale!
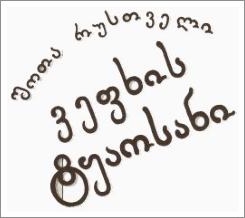 |
Tout se peut, les puissances déchoir, Au champ d’honneur les hommes trépasser, La poussière altérer la mémoire, La raison épuiser les yeux de l’évidence, L’éclair peut foudroyer toute semence, Toute grandeur peut être abaissée, Mais toi, tu restes impérissable, Image que j’adore, Le temps ne peut muer en sable Ta chair que n’atteint pas la mort. Langue géorgienne, O ma langue natale, O gloire de mon peuple, Tu t’élèves et planes Comme la plus haute flamme de la foi. Toi, le baume apaisant de toutes nos blessures, O ciment qui unit les pierres dans le mur, A l’heure de la mort je n’ai plus rien que toi. |
Irakli ABACHIDZÉ (1960) (Traduction: S. Tsouladzé)
1. Le soleil: Symbole de la reine géorgienne Tamar, muse et bien-aimée de Rustavéli.
2. Ibères: Nom que les anciens géographes grecs donnaient aux Géorgiens et utilisé de nos jours comme cultisme.
G. Celaya (1960): "Sans langue"
|
SANS LANGUE Mer d’Euzkadi, patrie sans fin, toi qui n’as pas de frontières, sur les plages étrangères, vague après vague, dis mon chagrin.
Dis qu’on nous arrache la langue! Qu’on nous vole notre chant! Même ces vers que j’écris sont traduits en castillan.
Moi, dont les lèvres ont dit "aita" avant d’apprendre à dire "papa", je ne trouve pas, à présent, la langue juste pour mon chant.
J’ai lu ceux qu’il fallait lire, bien étudié Cervantes. J’essaie d’en tirer, maintenant, profit pour aller de l’avant.
Avec mes fautes de syntaxe, moi, le Basque incorrigible, je pècherai par mes défauts comme Baroja, Unamuno.
Car force est de reconnaître qu’aucun d’eux n’a su écrire. Mon Espagne a ses docteurs qui sauront bien le leur dire.
|
 |
Si eux n’ont pas réussi, en dépit de leur passion, à adopter une nouvelle langue comment le pourrai-je, mes amis?
J’ouvre mon âme aux quatre vents. Je cherche un monde sans histoire, et un sentiment d’origine, de douce perte de mémoire.
Mais il faut parler, il faut être, et se prononcer dans la lutte, il faut extraire une langue de ce qui n’est que murmure.
C’est ma quête. Me voici, en proie à un mal que j’étouffe, comme un astre en furie, les yeux ouverts par l’amertume.
Où mes mots s’en vont-ils? Où vont mes sentiments? Qui entend ma voix? J’erre mes morts derrière moi.
Eclate en sanglots, mer d’Euzkadi, que ta langue déchirée retentisse pour clamer l’étrange sentiment qui étreint les Basques d’aujourd’hui! GABRIEL CELAYA Rapsodia Euskara, 1960 |
|
Le chant de Lelo : Depuis qu’il fut découvert par W. Humboldt à Markina (1817), ce chant, qui est censé retracer des événements de l’époque romaine, suscita des querelles acharnées parmi les érudits. En effet, le poème avait-il vraiment été écrit au moment des faits relatés? Selon l’hypothèse la plus vraisemblable, nous pensons aujourd’hui qu’il pourrait dater de 1529 environ, et non du Ier siècle avant Jésus-Christ. C’est là un bon exemple de débat aussi rude qu’inutile. A l’instar de nombreux autres peuples (rappelons, à titre d’exemple, la découverte tchèque des manuscrits de Dvur Králové et de Zelená Hora en 1817), nous autres Basques avons trouvé le chemin de la recherche jalonné de préjugés et de légendes et remontant parfois à des origines aussi nobles qu’illusoires. |
Toute langue peut être observée et décrite sous des perspectives différentes et complémentaires: - D’un point de vue externe, c’est-à-dire en présentant son histoire dans le contexte de la société qui la parle, en mettant en évidence son aire linguistique et le nombre de ses locuteurs, en précisant ses domaines d’utilisation, etc. - De même, nous pouvons l’étudier depuis l’intérieur, en montrant ses caractéristiques internes: ses structures phonologiques ou morphosyntaxiques, son lexique, etc. Le présent texte nous permettra d’appréhender avec plus de précision l’histoire de l’euskara et sa vie sociale. Nous nous y intéresserons plus particulièrement d’un point de vue externe: parcours historique et aspects sociolinguistiques actuels. Avant d’aller plus avant, une brève présentation s’impose néanmoins pour éclaircir certaines des interrogations les plus courantes qui se posent à propos d’une langue. En famille, entre amis ou avec des étrangers, nous sommes fréquemment confrontés à diverses questions sur notre "vieille langue": Quelle est l’origine de l’euskara? Quelle est sa situation actuelle? À quoi la langue basque ressemblet- elle? Où est-elle parlée et par combien de personnes? Est-elle vraiment adaptée à la vie moderne? Etc.
|
|
Rencontres Internationales de Bascologues (Leioa, 1980) : En raison du manque d’universités basques et de programmes de recherche appropriés, l’étude du basque doit, en grande partie, sa valeur scientifique aux contributions des chercheurs étrangers, des XIXème et XXème siècles principalement (W. Humboldt, L.-L. Bonaparte, H. Schuchardt, etc.). De même, à mesure que nos spécialistes ont pu disposer d’institutions et d’appuis sociaux adéquats (Académie, Université d’Etat, etc.), et qu’ils ont eu accès à des méthodologies plus élaborées, leur travail s’est considérablement amélioré jusqu’à produire, en matière de linguistique basque, des œuvres de plus grande qualité. |
Afin d’apporter un commencement de réponse à ces questions, le présent chapitre comprend quelques remarques préliminaires: · Nous aborderons d’abord la géographie de l’euskara: l’environnement linguistique européen, la répartition territoriale des locuteurs basques... · Nous ferons également quelques brefs rappels sur les origines et l’histoire de l’euskara, son extension géographique dans le passé et de nos jours... · Nous fournirons enfin des informations concernant la nature même de l’idiome: structures de la langue, typologie, classification parmi les autres langues... Au terme de cette présentation, nous retracerons le chemin suivi par l’euskara jusqu’à aujourd’hui, puis nous terminerons par une réflexion sur les points les plus importants pour l’avenir de la langue.
La carte des langues d’Europe a considérablement évolué au long des siècles. Dans l’espace européen, des peuples de langues différentes se sont progressivement mêlés les uns aux autres ou, au contraire, se sont déplacés les uns par rapport aux autres. Il y a 3.000 ans, l’euskara se trouvait entouré de langues non indo-européennes, c’est-à-dire dans une situation exactement inverse à celle qu’il connaît de nos jours. C’est au IIIème millénaire avant Jésus-Christ que les populations nomades des steppes euro-asiatiques, profitant de la récente domestication du cheval et de l’invention de la roue, commencèrent à émigrer vers l’ouest. Dès lors, et plus précisément à partir du Ier millénaire avant Jésus-Christ, la géographie linguistique du Continent allait peu à peu se transformer jusqu’au moment où les langues indo-européennes, après avoir repoussé ou étouffé les idiomes existants, dominèrent presque toute l’Europe.
D’après les classifications établies par les spécialistes, l’euskara ne fait pas partie du groupe de langues de ces peuples envahisseurs. C’est pourquoi les linguistes réservent à l’euskara une place à part parmi les langues d’Europe: on n’a connaissance d’aucune langue qui lui soit apparentée, au moins à proximité de son aire linguistique et, de ce fait, l’euskara -dont le territoire semble être le sien depuis l’origine- jouit d’une situation unique. Il existe deux familles de langues en Europe: la famille indo-européenne et la famille ouralienne. Génétiquement, l’euskara n’appartient à aucune d’elles. Sur la carte ci-dessus, les différentes couleurs font apparaître les familles de langues (germaniques, latines, slaves, etc.) qui proviennent de l’ancien indo-européen commun, ainsi que leurs variantes modernes (allemand, anglais, etc.) séparées par des lignes de partage. De cette façon, la parenté existant entre les langues indo-européennes du Continent ressort nettement. En outre, n’oublions pas qu’il existe aussi en Europe quelques langues non indo-européennes: le hongrois, l’estonien, le finnois, le lapon... Toutes se rattachent à la branche finno-ougrienne de la famille ouralienne. Si l’euskara n’a aucun lien -ni d’origine, ni de parenté- avec le reste des langues indo-européennes ou finnoougriennes, cela ne signifie pas qu’il ait vécu isolé, sans contact avec certaines d’entre elles. Et nous verrons que les échanges qui se sont produits, tant au plan lexical que grammatical, ont enrichi ou modifié la vie de l’idiome comme du groupe linguistique.
|
|
Les langues d’Europe : L’histoire nous apprend que les langues européennes actuelles sont, en fait, les dialectes d’une langue commune antérieure qui, au terme de leur évolution, ont donné lieu aux idiomes que nous connaissons aujourd’hui. En voici la classification: Langues indo-européennes Langues germaniques: allemand, anglais, danois, suédois... Grec et langues romanes (néo-latines): portugais, galicien, castillan, occitan, catalan, français, italien... Langues slaves: russe, polonais, tchèque... Langues baltiques: letton, lituanien. Langues celtiques: breton, irlandais, écossais, gallois... Langue arménienne. Langues non indo-européennes Langues finno-ougriennes: hongrois, estonien, finnois, lapon... Autres Euskara, langues caucasiennes, turc, maltais...) |
C’est à l’occasion du recensement de 1981 que, pour la première fois, des questions portant sur la situation linguistique personnelle furent posées individuellement aux habitants d’une zone du Pays Basque, en l’occurrence la Communauté Autonome Basque. Pour le recensement de 1986, les mêmes questions furent également posées en Navarre. Désormais, les experts en statistiques sont donc plus en mesure de fournir des données précises et dignes de foi sur la population bascophone des provinces d’Alava, Biscaye, Gipuzkoa et Navarre. En ce qui concerne Iparralde, nous disposons de deux sources d’informations, qui ne se regroupent pas complètement: le reensement de 1982 et une étude récente (1991) que nous évoquerons plus loin. D’après le recensement de 1986, la Communauté Autonome Basque compte 2.089.995 habitants. 28,8% sont des immigrants (personnes nées hors de la CAB et de Navarre) et 71,2% sont nés au Pays Basque. Les deux groupes linguistiques prédominants dans la société se répartissent comme suit: 57,99% de la population est hispanophone unilingue et 24,58% est bascophone, généralement bilingue. Si nous ajoutions à ce dernier pourcentage le groupe des "quasi-bascophones" (17,42%), nous obtiendrions le chiffre de 42% de bascophones à des niveaux divers de connaissance et de pratique de la langue.(Cfr. ici, au CD-ROM, La Continuité de la Langue Basque).
|
Statistiques relatives aux bascophones : D’après les statistiques en notre possession sur le nombre de bascophones, l’euskara se situe très loin des grandes langues dominantes dans le monde. Par le nombre de ses locuteurs, l’euskara peut être comparé à l’estonien, au nahuatl, à l’irlandais ou au breton. L’islandais, en dépit de son implantation, ne compte en revanche que 200.000 locuteurs (1975). |
||||||||||||||||||
1 Labourd, Basse-Navarre et Soule (Iparralde).
2 Alava, Biscaye et Guipuzcoa. Les données relatives à la CAB et la Navarre, fournies par les gouvernements respectifs, proviennent du recensement de 1986 (portant sur la population âgée de deux ans révolus).
En ce qui concerne Iparralde, le nombre d’habitants est celui de 1982 (INSEE) et le pourcentage représente la proportion de bascophones dans la population âgée d’au moins 16 ans (tranche d’âge retenue pour l’"enquête sociolinguistique" réalisée dans le cadre des accords de coopération transpyrénéenne Euskadi/Aquitaine).
|
|
L’aire linguistique basque : La carte du territoire de la langue basque, établie en 1979 par l’équipe de recherche sociolinguistique SIADECO, fait apparaître trois zones distinctes: 1) la zone où l’euskara a disparu depuis plus ou moins longtemps, 2) la zone de contact interlinguistique et 3) les zones considérées comme bascophones. Cette carte peut constituer un premier instrument de réflexion mais doit être utilisée à la lumière des dernières découvertes de la cartographie démolinguistique. |
Cette répartition en groupes linguistiques varie énormément en fonction de la région, de l’âge et de la langue maternelle. Sur ce point, précisons que l’euskara est la langue maternelle de 20,4% de la population, 73,9% ont le castillan comme seule langue maternelle et 4% sont bilingues de naissance. La proportion d’hispanophones unilingues parmi les natifs de la CAB ou de Navarre atteint 46,8% dans les Trois Provinces.
En ce qui concerne la Navarre, les statistiques les plus préoccupantes sont les suivantes: selon le recensement de 1986, la Navarre avait 515.989 habitants dont 424.558 (soit 84,58%) étaient exclusivement hispanophones, les euskarophones, au nombre de 50.953, représentant pour leur part 10,15%.
Si nous ajoutons à ces derniers les quasieuskarophones (26.478: 5,28%), le nombre de personnes ayant une connaissance de la langue basque s’élèverait, en Navarre, à 15,45% de la population. Comme il apparaît dans le tableau ci-joint, les données les plus récentes concernant le Pays Basque Nord émanent de deux sources principales: le chiffre général de population découle du recensement officiel réalisé en 1982 par l’INSEE, et le pourcentage relatif à la situation sociolinguistique provient de l’étude effectuée dans le cadre des accords transpyrénéens Euskadi/Aquitaine (1991). Il faut préciser que cette dernière étude porte uniquement sur la population âgée d’au moins 16 ans. En 1982, Iparralde compte 236.963 habitants dont 33,2% sont bascophones auxquels s’ajoutent 22,8% de quasieuskarophones, ce qui donne un total de 56% de la population ayant une connaissance de la langue basque. Des trois provinces d’Iparralde, la Basse-Navarre est celle où le pourcentage de bascophones est le plus élevé (64,5%), devant la Soule (54,7%) et enfin le Labourd (26,3%). Paradoxalement, les bascophones labourdins forment le groupe le plus important, en valeur absolue, puisque leur nombre est presque égal à la population totale (bascophone et non-bascophone) des deux autres provinces (en admettant que les chiffres du recensement de 1982 et ceux de l’étude de 1991 soient comparables). Chiffres totaux que nous avions donnés dans la première édition basque du présent ouvrage, même si ces valeurs absolues sont moins fiables. Dans l’ensemble du Pays Basque, le nombre total de bascophones pourrait s’élever à 650.000 personnes qui se répartissent, grosso modo, comme suit: 52.000 en Navarre, 70.000 en Iparralde et 528.000 dans la Communauté Autonome Basque. Les non-bascophones (hispanophones ou francophones) unilingues représenteraient 61,51% de la population (proportion à laquelle pourrait s’ajouter une part plus ou moins grande des 15,7% qui se sont déclarés quasi-euskarophones).
Avec le temps, le territoire de la langue basque ou, plus exactement, de la communauté bascophone a vu, tout naturellement, ses frontières se déplacer. Dans l’Antiquité et au Moyen-Âge, la communauté basque occupait non seulement l’Euskal Herria actuelle, mais aussi des zones bien plus vastes. La toponymie toujours en vigueur dans ces régions en fournit incontestablement la preuve historique. Les noms de lieux, dispersés ici et là, font resurgir le passé basque de ces villages dont la mémoire historique a perdu toute trace des origines linguistiques. C’est le cas, par exemple, dans le sud de la province d’Alava et de la Navarre, en Aquitaine, dans les Pyrénées ou certaines régions de La Rioja et de la province de Burgos. Les changements géographiques n’ont pas toujours été synonymes de pertes territoriales; au contraire, à certaines époques, le basque -l’homme comme la langue- a vu s’étendre son espace vital et son aire linguistique. S’il est vrai que les éléments dont nous disposons sur le recul du basque en Aquitaine et dans les Pyrénées au Moyen-Âge sont insuffisants, il ne fait aucun doute qu’à la même période, l’euskara connut une phase d’expansion vers le sud, comme nous le verrons plus loin.
|
|
Zones linguistiques de Navarre (1986) : Aux termes de la loi sur le basque, approuvée par le Parlement de Navarre (2-XII-1986), le territoire de la province a été divisé en trois zones pour permettre de mener la politique linguistique du gouvernement. De toute évidence, cette division géolinguistique de la Navarre - remise en question récemment par les mouvements basquisants - reflète les critères linguistiques et la volonté politique des partis qui la défendirent d’un commun accord. Elle traduit une véritable prise de position sur l’héritage et l’avenir linguistiques de la Navarre, tout en définissant le cadre géographique dans lequel doit s’exercer l’action politique. |
Sur les cartes historico-linguistiques, une aire linguistique peut présenter des formes diverses: il peut s’agir d’un territoire continu dans l’espace et formant un seul bloc, ou à l’inverse, de plusieurs fragments de territoires épars; dans certains cas, ses limites coïncident avec celles d’un État mais, parfois, les frontières linguistiques restent en-deçà ou vont au-delà des frontières politiques... Ce sont les hasards socio-culturels et politiques et les vicissitudes historiques des sociétés qui ont donné petit à petit son aspect définitif, quoique toujours provisoire, à la carte des langues du monde que nous connaissons aujourd’hui. D’une part, les grands mouvements de population (par exemple, les invasions indo-européennes ou barbares, en Europe; la colonisation de territoires inhabités en Sibérie, en Amérique du Nord ou en Australie) et, d’autre part, les grands empires (Rome, l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Russie...) ont continuellement modifié les espaces linguistiques de l’Humanité. L’exercice du pouvoir politique ou les influences culturelles ont eu pour effet d’accroître certaines aires linguistiques au détriment d’autres langues, de modifier lentement les usages idiomatiques des peuples, de former artificiellement de nouveaux groupes linguistiques et, en somme, de transformer complètement les relations entre les langues. Ainsi sont nés des concepts politico-linguistiques comme l’"anglophonie" ou la "francophonie" qui ne sont que le fruit d’entreprises coloniales préalables.
La question du domaine de l’euskara doit, elle aussi, être appréhendée de façon historique, la cause des modifications territoriales résidant soit dans la communauté bascophone, soit dans des conditions extérieures. De même que le déplacement des frontières politiques, ou la répartition des pouvoirs au sein d’un État, peuvent s’effectuer de diverses manières, la définition des limites géographiques et des fonctions sociales d’une langue varie d’un idiome à l’autre. La définition exacte de la territorialité d’une langue est toujours d’une grande utilité. Dans le cas de l’euskara, cette définition pourrait revêtir une importance capitale pour assurer l’avenir de la langue, ne serait-ce qu’en permettant d’élaborer la politique linguistique à mener en termes spatio-administratifs.
|
|
Régions linguistiques de la CAB (1986) : En réponse à la demande du Parlement basque, et après étude des éléments linguistiques fournis par le recensement de 1986, le Secrétariat Général à la Politique Linguistique a fait une proposition de découpage par zones de la CAB (1989). Cette carte, établie avec le concours de la Commission Consultative de l’Euskara, constituera vraisemblablement le document de base des débats parlementaires sur la planification et la normalisation de la langue basque. |
En prenant comme objectif de définir les aires dialectales ou démolinguistiques, et d’orienter la politique planifiée au niveau des institutions publiques, la cartographie contribue de façon efficace à éclaircir des situations linguistiques complexes. Les cartes sont bien souvent devenues des outils de base. De par la variété des représentations graphiques possibles, elles constituent une source précieuse d’informations et permettent de représenter aussi bien les opinions que les critères socio-politiques. L’importance des cartes et l’utilisation fréquente qui en est faite, vient sans nul doute de là. Les lois adoptées au Pays Basque pour trouver une nouvelle solution au conflit entre l’euskara et le castillan ou le français, mais plus encore les textes juridiques qui en découlent, ont parfaitement mis en évidence l’utilité d’une carte démolinguistique. Par exemple, la loi sur le basque (1986) qui fait de l’euskara la seconde langue officielle de Navarre, a divisé la province en trois zones et doté chacune d’elles d’une identité juridique spécifique du point de vue de la politique linguistique. Même s’il manque de précision, c’est ce découpage qui pourrait prévaloir, dans les prochaines années, pour définir les divers traitements réservés au basque dans l’administration.
Dans la Communauté Autonome Basque, l’Institut Basque de Statistiques (EUSTAT) entreprit en 1983 de tracer une nouvelle carte en tenant compte des données du recensement de 1981; récemment (1989), le gouvernement basque a présenté au Parlement une carte plus élaborée qui intègre les informations fournies par le recensement de 1986. Fruit du travail effectué par le Conseil Consultatif de l’Euskara, cette nouvelle carte servira de référence au cours des débats, au moment de rédiger les lois, mais aussi lorsqu’il faudra définir la politique linguistique des Institutions de la CAB. En conséquence, les cartes actuelles -à la différence des cartes de Bonaparte et autres- ne se limitent pas à fournir des données purement linguistiques, mais tentent d’être un moyen de mieux connaître la situation sociale de la langue et essaient d’orienter les politiques régionales et municipales. En d’autres termes, la nouvelle cartographie doit être un instrument pour la planification et la normalisation de la langue, rôle qui lui confère une nouvelle signification historique.
|
L’euskara à travers l’histoire : Les locuteurs d’une langue n’habitent pas toujours le même territoire, et l’histoire des langues prouve que rares sont les cas d’occupation linguistique ininterrompue dans l’espace et le temps. La langue basque a, elle aussi, connu des hauts et des bas, des reculs et des avancées notables. Les reculs ont généralement été plus importants que les avancées, mais il faut souligner ici la ténacité unique avec laquelle l’euskara a résisté, jusqu’à nos jours, à tous les assauts de l’histoire. La carte ci-dessus donne un bonne idée des vicissitudes de son aire linguistique Extrait de l’EGIPV aux Editions Auñamendi: B. Estornés Lasa. |
Dès que l’euskara entra en contact avec les langues indo-européennes (Ier millénaire avant Jésus-Christ), puis avec le latin et les langues romanes (Ier millénaire après Jésus-Christ), la langue basque subit d’importantes pertes territoriales en raison de l’implantation sociale, institutionnelle et culturelle des langues néo-latines (IIème millénaire de notre ère) qui remplirent de nouvelles fonctions ainsi que celles assignées jusque-là au basque. Cependant, l’euskara connut aussi des périodes d’expansion territoriale, comme nous le verrons en détail. Au Moyen-Âge, des émigrants originaires des régions montagneuses du nord affluèrent sur les terres récemment conquises dans certaines zones de La Rioja et de la province de Burgos. Une fois de plus, c’est bien la preuve qu’un groupe linguistique dynamique peut inverser le cours des événements. La carte ci-jointe rassemble les données les plus significatives à notre connaissance sur la géographie historique de l’euskara. Une synthèse cartographique de ce type est toujours aventureuse. Néanmoins, les indications à l’échelle du siècle, voire de l’année, sont autant de points de repère qui permettent de donner un aperçu des fluctuations à long terme. D’après les sources d’information à notre disposition, la valeur de ces cartes historico-linguistiques est relative. Plus nous remontons dans le temps, plus la représentation des situations successives des idiomes est imparfaite et il devient plus difficile encore d’illustrer le rythme auquel les changements, en général complexes et peu documentés, s’accomplirent. En premier lieu, il faut tenir compte du fait que les lignes qui figurent sur la carte sont censées retracer l’histoire géographique du basque depuis deux mille ans.
Les données dont nous disposons n’ayant pas toutes le même poids ni la même valeur, les indications géohistoriques n’offrent pas le même degré d’exactitude: celles qui font apparaître une datation précise émanent d’un document connu déterminé; les autres, qui renvoient à des siècles ou des époques, sont le résultat d’estimations réalisées à partir d’éléments divers. Dans tous les cas, une limite de groupe linguistique ne doit pas être perçue comme une ligne bien dessinée, mais comme une bande de territoire de contact. En effet, lorsque deux langues sont en contact, elles cohabitent généralement au sein d’une société bilingue sur un territoire plus ou moins vaste. D’ailleurs, chez ces locuteurs frontaliers, le choix de la langue et son utilisation varient non seulement par rapport à leur entourage géolinguistique, mais aussi selon les thèmes, niveaux et fonctions sociolinguistiques. De plus, n’oublions pas que les phénomènes illustrés par la carte, bien qu’apparaissant comme "synchronisés dans l’espace", ne se produisirent pas tous en même temps. Par exemple, le recul avait déjà eu lieu dans certaines parties des Pyrénées ou de l’Aquitaine quand l’euskara commença à s’étendre au sud de l’Ebre. Il ne s’agit donc pas de faits simultanés.
|
|
Basconcillos de Muñó (Burgos) : Il s’agit d’un petit village abandonné situé à environ 18 km au sud de Burgos, que ses habitants quittèrent il y a trente ou quarante ans. D’autres villages des provinces de Burgos et de Palencia, qui portent des noms tels que Báscones ou Vizcaíno, attestent le repeuplement basque de la région au Moyen-Age. En plus de ces noms castillans, il existe aussi divers toponymes d’origine basque qui apportent la preuve de la présence de l’euskara dans ces contrées. |
Ces observations générales étant faites, cette carte nous permet d’apprécier l’étonnante histoire de la langue et de sa continuité. L’euskara a vécu en permanence entouré de langues concurrentes: les premières disparurent toutes, mais furent remplacées par d’autres. Cependant, il a toujours existé jusqu’à présent une société basque qui a su défendre obstinément sa propre langue. C’est cette continuité qui a fait l’admiration des scientifiques et des historiens.
Pour définir les aires géographiques où se produisent les variations idiomatiques, les spécialistes ont l’habitude de réaliser des atlas linguistiques dans lesquels des lignes, appelées isoglosses, délimitent le territoire correspondant à un phénomène linguistique déterminé. Ils recherchent, par exemple, l’extension de l’usage d’un mot précis: où dit-on deus et où dit-on ezer? Où dit-on esan plutôt que erran? Quelle est l’extension de bost et de bortz, de dogu, degu ou dugu? Etc. Quand un certain nombre d’isoglosses se superposent, c’est-à-dire lorsque la ligne de partage est plus marquée, les traits épais font apparaître les aires dialectales de la langue. En réalité, sur son propre territoire, chaque idiome présente des variantes qui, sans remettre en cause l’unité de la langue, constituent des formes dialectales internes. En décrivant les phénomènes internes à une langue, la cartographie, avec ses atlas linguistiques, contribue donc à aider la géographie linguistique ou dialectologique. En revanche, la géolinguistique, ou géographie des langues, porte un autre regard sur l’idiome: sans perdre de vue la synthèse du linguiste, le géographe prend en compte les événements extérieurs à la langue en les considérant comme des phénomènes d’ordre social. De cette façon, il embrasse la langue, toute la réalité de celle-ci et s’attache à en étudier les aspects socio-spatiaux. Cette dimension sociale nous amène à aborder les réalités ethno-culturelles qui conditionnent toute langue: les ethnies culturelles, dépositaires d’un patrimoine linguistique propre, définissent en principe un espace géolinguistique. À partir de là, le géolinguiste peut réaliser une étude diachronique de l’extension et de la dynamique de la langue -ou des langues- choisie dans une société déterminée. D’une certaine façon, la géographie des langues préfigure aussi l’écologie idiomatique.
La géographie des langues, dans sa recherche sur les relations entre communauté de locuteurs et aire linguistique, utilise les postulats et méthodes que la géographie humaine applique au reste des phénomènes sociaux. Elle prend en compte les ethnies et les cultures en respectant les paramètres définis par les chercheurs en sociolinguistique (répartition des fonctions sociales, pyramides démolinguistiques, etc.). Les cartes, diagrammes (histogrammes, ethnogrammes), grilles, arbres, anamorphoses géographiques, graphiques triangulaires, etc. sont quelques-uns des instruments descriptifs auxquels recourt la géolinguistique. De nombreux moyens utilisés en géographie permettent également d’étudier et de décrire la vie et les vicissitudes d’un groupe linguistique.
Sans remonter à la préhistoire, il est généralement possible de déceler l’origine des langues connues dans un stade linguistique préalable: cette phase idiomatique antérieure est appelée langue mère. L’anglais, par exemple, vient du germanique comme le suédois ou le danois, et le castillan tire son origine du latin à l’instar du français ou du roumain. Mais que dire de l’euskara? Le problème des origines et des hypothétiques liens de parenté de la langue basque a suscité de nombreuses questions. Quelle fut sa langue mère? Quel rapport y a-t-il entre l’euskara et les langues actuelles ou des langues disparues? Quelle est, en définitive, son origine géographique et génétique? Les réponses ont été aussi diverses que contradictoires.
Par l’étude comparative des inscriptions anciennes, les linguistes ont parfois réussi à établir la parenté et la communauté d’origine de langues qui se sont scindées en dialectes il y a 6.000 ans pour donner naissance à d’autres idiomes: par exemple, il a été prouvé (1917) -ce fut un cas particulièrement ardu- que la langue des Hittites, disparue au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, était un idiome indo-européen. Hélas, cela n’a pas été aussi "facile" pour l’origine de l’euskara, bien qu’il s’agisse d’une langue beaucoup plus accessible et proche de nous. Avant l’avènement de la linguistique en tant que science, les érudits et les écrivains des XVIème et XVIIème siècles, intéressés par la langue basque (Poza, Etxabe...), firent appel aux textes bibliques pour expliquer la formation des langues, voyant dans la Tour de Babel leur origine première. Cela ne doit pas nous étonner, car ils ne faisaient que reprendre une opinion très courante à l’époque, émise même pour certaines langues romanes. Cependant, la survivance de ces idées traditionnelles a inévitablement porté préjudice au développement scientifique, aux XVIIIème et XIXème siècles.
La réaffirmation de telles prémisses extra-scientifiques non seulement empêcha, parmi les intellectuels basques, l’émergence d’une plus grande rigueur et l’adoption de nouvelles méthodologies dans l’étude du basque, mais entacha aussi les travaux de chercheurs étrangers reconnus (ceux de Hervás et Panduro, par exemple). Dès que la comparaison et la classification scientifiques des langues fut entreprise et que, dans la plupart des cas, leurs liens de parenté purent être mis en évidence (la communauté d’origine des langues indo-européennes fut la première à être établie grâce aux travaux de Bopp, 1833-1852), l’isolement linguistique de l’euskara apparut clairement. Aujourd’hui, cette affirmation se retrouve partout dans la bibliographie. Par exemple, toutes les classifications des langues, extraites des encyclopédies modernes, réservent au basque une place à part, sans généalogie définie ni parenté attestée.
Des dizaines de comparaisons ont été effectuées, en vain, pour tenter de trouver une origine commune à l’euskara et à d’autres langues (le japonais, le hongrois, le finnois, etc.). Dans cette recherche difficile, deux perspectives d’étude offrent apparemment de plus grandes chances d’être couronnées de succès: La première hypothèse, celle du basco-ibérisme, évoque la possibilité d’une parenté entre l’euskara et l’ancien ibère, disparu avec la conquête romaine. Pendant très longtemps, cette théorie jouit d’un grand crédit et trouva de nombreux partisans mais, plus récemment, elle fit l’objet de sérieuses critiques (Bähr, Caro Baroja, Mitxelena, Tovar). Une thèse voisine tente de rattacher le basque aux langues nord-africaines (berbère, langues chamitiques orientales, idiomes de Nubie, etc.). Cette opinion a été partagée par des personnalités de renom (Gabelentz, Schuchardt et dernièrement H. Mukarovski) même si ses contradicteurs ne manquent pas (E. Zyhlarz).
|
GROUPES LINGUISTIQUES LES PLUS NOMBREUX |
|
| Chinois mandarin | 500.000.000 |
| Hindi | 350.000.000 |
| Anglais | 320.000.000 |
| Espagnol |
210.000.000 |
L’hypothèse basco-caucasienne a constitué, pour les intellectuels, un second point de départ encourageant. Bien qu’aucune parenté n’ait pu être prouvée, les deux familles de langues présentent des ressemblances nombreuses et surprenantes. Beaucoup de spécialistes illustres ont cherché dans cette direction (Hervás, Fita, Uhlenbeck, Schuchardt, Trombetti, Bouda, Lafon), mais leurs méthodes de travail et la valeur de leurs conclusions ont été, elles aussi, mises en doute (H. Vogt, K. Mitxelena).
Force est de conclure en disant que l’origine génétique de l’euskara reste à déterminer. Pourtant, les similitudes mises à jour et les hypothèses avancées pourront peut-être nous aider à dessiner les tendances évolutives de notre langue, depuis le proto-basque jusqu’au basque actuel. Indépendamment de la question généalogique, la découverte d’analogies et d’affinités n’est certes pas négligeable. En effet, une relation a pu être établie entre de nombreuses structures et ressources grammaticales de la langue basque et des structures équivalentes dans d’autres idiomes. C’est la typologie linguistique qui a permis de définir, comparer et classifier diverses langues, y compris certaines très éloignées géographiquement. Dans la classification typologique de Greenberg, basée sur l’ordre obligatoire des mots dans la phrase, Tovar place l’euskara dans le modèle III, avec le géorgien, le latin, le turc et le dravidien, tandis que la majorité des langues indo-européennes se situent dans le modèle II. De toutes façons, il ne fait aucun doute que l’isolement génétique de l’euskara présente un grand intérêt pour les comparativistes qui voient dans cette langue un sujet exceptionnel pour l’étude des universels linguistiques du langage humain.
|
|
Les relations de parenté de la langue basque : Les linguistes s’accordent pour dire que l’euskara est une langue île, c’est-à-dire dépourvue de tout lien de parenté linguistique attesté. Mais cela ne signifie pas que le basque ait traversé les siècles sans entretenir diverses relations avec les langues voisines. Le graphique ci-contre indique les principales langues avec lesquelles une parenté ou des analogies ont été recherchées. |
|
|
Particularités phonologiques : Chaque langue présente des caractéristiques phonologiques propres. Par exemple, l’euskara possède un "z" spécifique qui se prononce comme indiqué sur le dessin (le castillan n’a pas cette sifflante préalvéolaire, alors que le "s" français lui ressemble). |
Instrument humain par antonomase, la langue utilise le signe verbal -écrit ou parlé- pour communiquer. C’est un moyen d’expression comme de compréhension, qui peut être appréhendé et défini de différentes façons. Mais, d’un point de vue interne, la langue, en fin de compte, n’est rien d’autre qu’un système de signes. Ces signes linguistiques peuvent être analysés à différents niveaux: par exemple, un discours ou une conversation peut se composer de plusieurs phrases; une phrase, de plusieurs mots (et morphèmes); un mot, de plusieurs syllabes; et une syllabe, de plusieurs sons. L’être humain est capable de produire des sons très variés. Cependant, parmi tous les sons disponibles en phonétique, un tout petit nombre suffit pour nous permettre de communiquer ce que nous souhaitons, c’est-à-dire pour faire la distinction nécessaire entre les messages. Dans la majorité des langues humaines, les différents sons, ou phonèmes, utilisés par les locuteurs ne dépassent pas la trentaine. Il suffit de combiner ces quelques éléments entre eux pour pouvoir émettre et recevoir divers messages et, par conséquent, configurer différentes langues.
Texte de J. A. Aduriz
Euskara, la langue des Basques. II. L’euskara aujourd’hui. De par leur petit nombre, ces sons qui ont une valeur distinctive -les phonèmes- se ressemblent beaucoup d’une langue à l’autre. Pour la même raison, certains autres caractérisent un idiome particulier: en effet, l’usage fréquent d’un son spécifique fait du phonème une marque distinctive de la langue. Il suffit de regarder le tableau ci-dessus pour identifier les similitudes et les différences existant entre les systèmes phonologiques de l’euskara, du castillan et du français. La plupart des sons, dans les trois langues, sont identiques ou peu différents, mais il apparaît aussi des dissemblances importantes.
Pour souligner une des caractéristiques de l’euskara dans ce domaine, nous pouvons nous intéresser aux sifflantes (sourdes): alors que le castillan possède une seule fricative /s/ et le français deux /s/, /I/, le basque en distingue trois /s/, / Ñ /, /I/(correspondant respectivement aux graphies "z", "s", "x"). De même, la particularité du français en matière de voyelles est évidente. Tandis que le castillan et le basque possèdent en tout cinq phonèmes vocaliques chacun, le français en distingue plus d’une douzaine: les orales (/i/,/e/, /e/, /a/, /a/, /o/, /u/, /y/, /oe/) et les nasales (/ã/, /õ/ ).
Tableau comparatif de l’euskara/castillan/français
|
|
De quand l’euskara date-t-il? : La survivance de cette langue inspira à Lluis Pericot, spécialiste de la préhistoire, une question et une image: Qui sait ce qu’est l’euskara? se demandait Pericot, et il ajoutait: dans les pays européens actuels, il n’y a rien qui puisse transporter les habitants du XXème siècle 5 ou 10.000 ans en arrière. Mais, pour cela, il nous suffit de fermer les yeux et d’écouter des paysans basques chanter des vers (il faisait allusion aux "bertsolaris"). Ce que nous entendons là, concluait-il, ce sont les bergers du néolithique, ceux qui peignirent Altamira. La langue est un fil qui court de génération en génération et de siècle en siècle. Sur les photographies, la grotte d’Ekain (Guipuzcoa): peintures remontant à 20.000/12.000 ans. Dolmen d’Aizkomendi (Egiraz, Alava): 3.000 ans avant Jésus-Christ. |
La langue basque a été la langue du peuple ou des peuples qui ont vécu sur les deux versants des Pyrénées occidentales depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Telle est la version communément admise d’après les informations dont nous disposons. De toute évidence, il ne s’agit pas d’une langue importée par d’hypothétiques immigrants.

|
|
De quand les Basques datent ils? : D’après Bosch Gimpera, la personnalité de l’homme basque était définie dès le néo-énéolithique, c’est-à-dire au troisième millénaire avant Jésus-Christ, et semble être le résultat de l’évolution subie localement par les autochtones implantés là depuis le paléolithique. Ci-contre: crâne d’Urtiaga (Guipuzcoa), l’un des maillons de la chaîne qui mène de l’homme de Crô-Magnon à l’homme de type basque: 9.000 ans avant Jésus-Christ. Jusqu’à preuve du contraire, la langue et l’histoire des habitants du Pays Basque sont indissociables depuis des milliers d’années.
|
La langue basque a été la langue du peuple ou des peuples qui ont vécu sur les deux versants des Pyrénées occidentales depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Telle est la version communément admise d’après les informations dont nous disposons. De toute évidence, il ne s’agit pas d’une langue importée par d’hypothétiques immigrants. À partir de l’an 1000 avant Jésus-Christ et jusqu’à la chute de l’Empire romain (476 après Jésus-Christ), les Basques établirent des contacts avec de nombreux peuples voisins: en premier lieu, les Ibères de la Péninsule; plus tard, les Indo-européens et les Celtes arrivés par vagues successives (les Celtibères au sud; les Gaulois dans la zone de la Garonne). Mais, de toutes les relations de voisinage, celles entretenues avec les Romains se révélèrent les plus dangereuses pour la survie de la langue. En effet, quelque 800 ans après l’arrivée des premiers Indo-Européens, les Basques virent approcher les colonisateurs de Rome: d’abord par le sud, les Romains remontant la vallée de l’Ebre (196 avant Jésus-Christ); ensuite, par le nord gallo-aquitain (56 avant Jésus-Christ). Les écrivains classiques qui nous renseignent sur ces confrontations, nous présentent une société basque fragmentée en tribus établies sur une aire linguistique beaucoup plus étendue qu’actuellement. Selon les nécessités du moment, les Romains et les Basques se comportèrent tantôt en ennemis, tantôt en alliés. À la chute de l’Empire, les Romains laissèrent derrière eux un latin affaibli, mais qui, ultérieurement, allait se prolonger dans les langues néo-latines. Et ni les Wisigoths, ni les Arabes ne parvinrent à étouffer la graine semée par Rome.
Environ mille ans après la conquête romaine, les langues romanes commencèrent à se faire entendre chez les peuples voisins des Basques (et parfois chez certains Basques) mais, généralement, les anciennes tribus restèrent fidèles à leur propre langue. Bien qu’ayant disparu au bout de quelques générations après l’arrivée du latin, les langues limitrophes de l’euskara, comme l’ibère ou le celte, ont laissé des empreintes significatives dans l’épigraphie, en général latine, de l’époque. Il en va de même pour ce premier euskara dont nous avons une trace historique, et les vestiges qu’il nous a légués, non seulement au Pays Basque actuel mais aussi dans d’anciennes régions basques (Aquitaine, Pyrénées...), sont du plus grand intérêt pour reconstituer le proto-basque.
|
|
L’euskara il y a 2.500 ans : Au milieu du Ier millénaire avant Jésus-Christ, la carte des langues de la Péninsule Ibérique, comme celle des territoires situés de l’autre côté des Pyrénées, ressemblait très peu à la carte actuelle. A cette époque, l’aire d’euskarophonie correspondait approximativement à la partie représentée en vert sur la carte. Celle-ci est censée illustrer la situation linguistique avant l’arrivée des Romains. Les Indo-Européens, qui envahirent la Péninsule par vagues successives au cours des siècles précédant l’ère chrétienne, parlaient principalement des langues celtes qui allaient entrer en compétition avec la langue ibère locale. L’extension géographique du basque, telle qu’elle apparaît sur la carte, est confirmée, à l’exception de la zone cantabro-asturienne sur laquelle tous les spécialistes ne sont pas d’accord. Nous pouvons constater également la coexistence de groupes linguistiques distincts dans les Pyrénées. Ce sont essentiellement l’épigraphie et la toponymie qui ont permis de tracer ces frontières avec le plus de précision possible. |
|
|
Le bronze de Botorrita : Ier siècle avant Jésus-Christ : Ce bronze fut trouvé à Botorrita, à vingt kilomètres de Saragosse.Les inscriptions qu’il porte sont dans une langue celtibère, c’est-à-dire indo-européenne, utilisant l’alphabet ibère. Les linguistes ont fréquemment eu recours à l’euskara pour tenter de déchiffrer ces inscriptions, mais les résultats obtenus n’ont jamais été à la mesure de leurs espérances. |
L’indo-européanisation progressive de l’Europe commença 2.000 ans avant Jésus-Christ, mais le processus s’accéléra au cours du dernier millénaire avant notre ère. En fonction de nos connaissances actuelles, nous pouvons décrire la géographie linguistique du Pays Basque et de ses alentours en remontant à environ 2.500 ans. À cette période, la Péninsule Ibérique et les terres situées au nord des Pyrénées n’étaient pas encore totalement indo-européanisées, et des langues d’origines très diverses s’y côtoyaient:
|
L’inscription de Lerga : Cette pierre trouvée dans la localité navarraise de Lerga (1960) a fourni des informations qui corroborent l’unité linguistique du proto-basque entre les zones basques sud-pyrénéenne et aquitaine. |
L’ibère s’étendait le long de la Méditerranée, depuis l’Hérault en Gaule, jusqu’en Andalousie (embrassant le haut Guadalquivir, après avoir contourné l’obstacle que représentait le celtibère). L’euskara entrait donc en contact avec l’ibère dans les Pyrénées orientales. En outre, une langue indo-européenne préceltique, appelée communément lusitanien, occupait l’ouest de la Péninsule. Il est possible également que la zone cantabrique parlât indo-européen. Plus près des Basques, dans certaines parties des provinces de Soria et de Burgos, nous trouvons le celtibère, qui remontait avec force la vallée de l’Ebre. Au nord, si nous prenons la Garonne comme frontière de l’Aquitaine, notre langue était limitrophe d’une autre langue celte, le gaulois. Le basque constituait la quatrième langue de la zone sans occuper, toutefois, une aire linguistique exclusive car, dans la Ribera navarraise notamment, il cohabitait avec le celtibère. Nous constatons donc qu’au cours des siècles précédant notre ère, l’euskara était au centre d’un environnement multilingue. Dès que les Indo-Européens les plus proches pénétrèrent jusque dans les territoires basques actuels (à cet effet, voir sur la carte la localisation des sites archéologiques celtes), des relations d’échange linguistique ne manquèrent pas de se nouer, au cœur même du Pays Basque.
|
L’ibère et le basque : Certaines similitudes lexicales, comme celles présentées ici, firent naître chez les théoriciens basco-ibéristes l’espoir d’une interprétation possible de la langue ibère à l’aide du basque; mais, lorsque l’alphabet ibère put enfin être déchiffré (1922), le recours à l’euskara se révéla pratiquement inutile. Cette inintelligibilité de l’ibère à travers le basque a peu à peu conduit à écarter l’hypothèse d’une parenté entre les deux langues. |
Nous savons très peu de choses sur l’ampleur et les effets des contacts entre l’euskara et ces langues indo-européennes, même si le bronze de Contrebia (87 avant Jésus-Christ, Saragosse) apporte quelques éléments sur cette proximité idiomatique. Il ne reste presque aucun emprunt celte dans le basque. Certains mots sont censés avoir une origine celte, comme zilar ’argent’, hogel ’vingt’, tegi ’site, dépôt’, maite ’aimé’, gori ’incandescent’, erbi ’lièvre’, mendi ’mont’, orein ’cerf’, orkatz ’daim’, etc. mais des doutes subsistent sur l’étymologie de la plupart d’entre eux. D’une manière générale, nous pouvons dire que l’euskara a conservé très peu de traces de l’héritage indo-européen prélatin, vraisemblablement pour des raisons politico-culturelles ultérieures.
Après quelque cinq ou six cents ans de cohabitation avec les Indo-Européens, le basque allait être assailli par une autre langue indo-européenne. L’apparition de celle-ci dans la région n’était pas le résultat d’une émigration massive comme auparavant, mais plutôt de la conquête du pays par les armes et de la colonisation qui s’ensuivit: il s’agissait du latin des Romains (196 avant Jésus-Christ). En effet, au cours des siècles suivants, le latin allait définitivement indo-européaniser (latiniser) tout l’Occident de façon draconienne: disparurent ainsi l’ibère, le gaulois, le celtibère et le lusitanien comme d’autres langues avaient disparu peu avant en Italie.
Résistant aux attaques du latin, sans se retrancher encore, il faut le rappeler, sur son territoire actuel, seul l’euskara a survécu au naufrage général des langues provoqué par l’indo-européanisation complète de l’Occident. De ce fait, il constitue aujourd’hui l’unique témoin de cette préhistoire linguistique perdue.
Il y a 2.200 ans, c’est-à-dire peu avant l’arrivée des Romains aux confins de la Vasconie, les Basques occupaient de vastes étendues dans la zone au nord-est de l’actuelle Euskal Herria, en Aquitaine et dans les Pyrénées. À cette époque, les Aquitains parlaient l’euskara ou une langue très proche. Par ailleurs, de nombreux noms de lieu d’origine basque ont été retrouvés dans les Pyrénées. En effet, au cours des siècles et jusqu’à récemment, la chaîne pyrénéenne n’a jamais constitué une frontière linguistique. Au contraire, le fait que les mêmes dialectes basques et catalans aient été parlés sur les deux versants, et les similitudes entre le gascon et l’aragonais, prouvent que les Pyrénées ont plutôt joué un rôle de trait d’union. L’existence d’une civilisation commune aux deux côtés des Pyrénées est bien connue depuis des siècles. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, nous constatons que la toponymie fait apparaître, d’ouest en est de la chaîne pyrénéenne, un substrat basque évident. Si les données toponymiques sont incontestables, en revanche il est plus difficile d’établir avec précision la chronologie et la continuité géographique de cette communauté bascophone, forcément changeante, car la datation des nombreux vestiges connus n’est pas une tâche facile. Néanmoins, les noms de lieu recueillis par Coromines permettent d’illustrer, sous la forme de la carte présentée ci-après, ce que furent les Pyrénées basques depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen-Âge.
|
Ethnies et langues du Pays Basque : Au dernier millénaire avant Jésus-Christ, divers peuples indo-européens approchèrent le Pays Basque et, parmi eux, les Celtes. Ces nouveaux habitants établirent des colonies dispersées à travers les plaines ouvertes du sud du Pays. Les inscriptions indiquées comme préromaines constituent les premiers vestiges écrits de l’euskara. |
En ce qui concerne l’Aquitaine ancienne, nous disposons de données plus sûres, à la contemporanéité établie, conservées par la toponymie et le substrat des langues romanes postérieures, mais surtout d’informations fournies par les écrivains classiques du début de l’ère chrétienne et par la riche épigraphie de la région.
|
|
"Andere" : Sur cette stèle latine d’il y a deux mille ans, nous pouvons voir clairement le mot basque actuel andere ’dame’ dont l’étymon, paradoxalement, pourrait être d’origine celtique. C’était le nom donné aux femmes et aux déesses dans l’épigraphie aquitaine. (La stèle se trouve au Musée Archéologique de Toulouse.) |
Il convient de signaler que le géographe grec Strabon faisait une nette différence entre Aquitains et Gaulois du nord -il mentionnait justement leur langue respective comme signe distinctif-, tandis qu’il soulignait les similitudes existant entre ces mêmes Aquitains et les habitants du versant méridional des Pyrénées. Les données les plus nombreuses sur la langue aquitaine proviennent des découvertes épigraphiques, c’est-à-dire des inscriptions sur lesquelles le latin apparaît mêlé à des éléments non latins. Les linguistes ont procédé à une étude systématique minutieuse de ces traces de langue aquitaine, et c’est précisément l’euskara, la langue actuelle des basques, qui leur a apporté l’aide la plus précieuse pour interpréter les éléments aquitains des inscriptions. Dans les travaux de Luchaire, Sacaze, Gorrochategui, entre autres, nous pouvons relever nombre de mots et de noms dont le sens ne ferait aucun doute pour un Basque d’aujourd’hui: cison (> gison), nescato, iluni (> ilun), anderexo (> andere, andre), bihox (> bihotz), sembe (> seme), baigorrixo (> ibai + gorri), etc. À propos de la situation dont témoigne l’épigraphie aquitaine et de la disparition ultérieure de cette langue, le professeur R. Lafon s’exprimait en ces termes à l’Université de Bordeaux (1947): "Nos ancêtres aquitains ont, hélas, laissé perdre leur langue, pour le plus grand regret des linguistes et des ethnographes. Nous devons donc rendre hommage et dire notre reconnaissance aux écrivains, poètes-improvisateurs (...), enfin, à l’immense foule, modeste et anonyme, de tous ceux qui, non seulement au pays de l’euskara, mais au dehors, dans de si nombreuses régions de France et d’Espagne (...) ont gardé la langue de leurs ancêtres (...) tout au long des siècles". Ce même professeur voyait dans l’aquitain un élément de preuve de la communauté d’origine de la famille basco-caucasienne qui se composerait de l’euskara, du caucasien et de l’aquitain. (Cette hypothétique famille serait restée unie jusqu’à la fin du IIIème millénaire avant Jésus-Christ.)
|
L’euskara pyrénéen dans l’Antiquité : Grâce aux recherches de Joan Coromines essentiellement, nous savons que les noms de lieu d’origine basque ont été nombreux dans la zone médiane des Pyrénées. Les villages à toponymie basque occupent une bande de territoire qui traverse l’Aragon et pénètre jusqu’en Catalogne. Des toponymes basques ont été recensés dans 48 localités du bassin de l’Aragon, 150 du haut Aragon, 30 de la haute Ribagorza et 90 du Pallars. Sur la carte, ces lieux sont représentés par des points, et certains sont signalés par leur nom afin de permettre de les situer géographiquement et de montrer ainsi par leur étymon la continuité de la langue. D’autres sources nous apprennent que l’euskara se maintint dans cette zone jusqu’à la fin du Moyen-Age. |
La pierre de Lerga (Navarre, 1960) a mis en évidence, une fois de plus, l’importance ethnolinguistique du basco-aquitain et, ces dernières années, la thèse de l’unité basco-aquitaine s’est trouvée renforcée. En d’autres termes, dans les actuels travaux de recherche, la personnalité linguistique de l’Aquitaine nous est présentée d’une façon plus précise, distincte du monde indo-européen et directement apparentée à l’euskara.
|
|
?ÛVF6T<gH. #"D*b88@4. U6L^JV<@4. : OuaskTnes. Bardulloi. Akuitanoi. : Dans son œuvre magistrale, Geographiká, l’écrivain classique grec Strabon (65 avant Jésus-Christ - 20 après Jésus-Christ) consacra les livres III et IV à la Péninsule Ibérique et à la Gaule celtique. En fait, Strabon ne visita jamais la Péninsule, mais il utilisa les excellents matériaux recueillis par d’autres voyageurs, en particulier Posidonius. Les renseignements qu’il nous donne sur les tribus basques sont, en général, succincts mais très appréciables par leur ancienneté. Ce qu’il dit sur la spécificité de la langue des Aquitains mérite, notamment, d’être souligné. A cet effet, nous avons mis en évidence, dans le texte grec, les noms de peuple et les passages qui se rapportent à la langue.
|
Au fur et à mesure que les colonisateurs et conquérants de l’Antiquité approchaient du Pays Basque et l’ouvraient à l’extérieur, les premières références à ses habitants commencèrent à apparaître dans les œuvres ethnographiques et géographiques des auteurs de l’époque. Ces références constituent les premières informations écrites sur nos ancêtres. Nous les trouvons chez certains écrivains classiques qui s’intéressèrent à la Péninsule Ibérique et à l’Aquitaine, à une époque où les entités France et Espagne, au sens actuel, n’existaient pas encore. Les premiers récits sont dûs à Strabon et à César (Ier siècle avant Jésus-Christ) auxquels s’ajouteront, plus tard, ceux de Pline l’Ancien et de Pomponius Mela (Ier siècle après Jésus-Christ). Dans le récit de ses exploits guerriers, César fait référence aux Aquitains. Ils constituaient, affirme-t-il, le peuple dominant l’une des trois régions des Gaules, les deux autres appartenant respectivement aux Belges et aux Gaulois Celtes. "Ces trois peuples étaient différents par la langue, les coutumes et les lois" aux dires de César. Strabon apporte quelques précisions à ce constat: "Certains auteurs ont divisé la Celtique en trois parties et nommé, outre les Celtes, les Aquitains et les Belges. Ils considèrent les Aquitains comme formant un peuple absolument à l’écart, en raison non seulement de sa langue, mais aussi de son apparence physique, et ressemblant plutôt aux Ibères [ce terme pourrait être compris ici au sens géographique] qu’aux Gaulois. Les autres, au contraire, sont gaulois d’aspect, et s’ils ne parlent pas tous la même langue, du moins n’y en a-t-il que quelques-uns qui en pratiquent d’autres, d’ailleurs peu différentes". L’écrivain poursuit en délimitant l’espace géographique des Aquitains: "Le nom d’Aquitains a été donné au peuple qui occupe la portion de territoire située au Nord du Mont Pyréné et du Mont Cemmène jusqu´à l’Océan, en deçà du cours de la Garonne". Ainsi, alors que les Celtes des Gaules parlaient des idiomes divers, les Aquitains avaient le sien que Strabon mettait, apparemment, en relation avec ceux de leurs voisins méridionaux. Outre l’intérêt qu’ils présentent, tous les récits de ce dernier sur les mœurs des peuples du nord de la Péninsule Ibérique sont généralement très vivants.
|
Les tribus basques : Les premiers éléments d’information sur les tribus basques nous ont été apportés par les auteurs classiques. Ceux-ci se limitèrent à mentionner Autrigones et Caristii, mais s’arrêtèrent plus longuement sur les Varduli et surtout les Vascones. En général, leurs commentaires nous sont d’une grande utilité aujourd’hui pour connaître les mœurs des tribus du nord de la Péninsule Ibérique. En ce qui concerne l’implantation géographique de ces peuples, nous pouvons seulement noter qu’elle était relativement changeante. Sous la domination romaine, par exemple, il semble que la population vasconne étendit son territoire vers les Pyrénées à l’est, et La Rioja au sud. |
Les Basques de la Péninsule, malgré leur petit nombre, ont plus inspiré les auteurs classiques postérieurs. Dans sa description de la côte atlantique, en quittant la zone galicienne et asturienne, Mela fait référence aux Varduli (c’est-à-dire les actuels Gipuzkoans et Alavais) juste après les Cantabres, sans mentionner les autres tribus basques qui vivaient entre les deux (Autrigones et Caristii). Ce furent Strabon et Pline qui complétèrent ces informations par l’énumération des tribus qui, à leur époque, habitaient le Pays Basque d’aujourd’hui et ses marches et qui, probablement, étaient toutes bascophones, à savoir les Vascones, les Varduli, les Caristii et les Autrigones.
Les auteurs classiques ne précisent pas si la langue de ces tribus était le basque. Cependant, d’après ce que nous ont appris l’épigraphie et la toponymie, ainsi que les déductions faites à partir de situations postérieures mieux connues, nous pouvons avancer que tant les Aquitains (Aquitaine), que les Vascones (Aragon-Rioja-Navarre-zone de la Bidassoa), les Varduli (Gipuzkoa: Pasajes-Deba; Alava), les Caristii (Gipuzkoa-Biscaye: Deba-Nervión; Alava) et les Autrigones (Biscaye: Encartaciones; Rioja) doivent être considérés comme Basques par leur langue. Cette thèse est moins étayée par les informations fournies par les auteurs classiques que par les situations linguistiques médiévales, difficiles à expliquer autrement.
|
|
Ama Xantalen (Irun) : Dans le contexte général de l’économie coloniale romaine, la zone montagneuse d’Euskal Herria fut plutôt marginale. Quelques endroits épars présentèrent pourtant un certain intérêt - les baies qui offraient un refuge nocturne à la flotte (Txingudi, Mundaka-Gernika, Nervión...), ou les montagnes de la chaîne côtière qui renfermaient des gisements miniers (Peñas de Aya, Somorrostro) - et l’activité commerciale devait y être plus intense. L’illustration ci-contre représente la nécropole romaine d’Irun, l’un des rares vestiges laissés par les Romains en Guipuzcoa, dans la zone à maints égards intéressante d’Oiartzun-Fontarabie. |
Au cours des dernières décennies, les historiographes qui se sont penchés sur le thème de la romanisation du Pays Basque, ont fait apparaître deux courants de pensée clairement antagonistes: d’un côté, certains considèrent le phénomène comme quelque chose de marginal, sans véritable profondeur, tandis que les autres, à la lumière des découvertes archéologiques récentes, estiment que la romanisation fut pratiquement totale. Pour notre part, nous pensons qu’il vaut mieux ici aborder ce processus d’acculturation en relativisant les positions: la Vasconie, même dans ses limites actuelles, ne fut jamais un territoire isolé, mais elle ne fut pas non plus engloutie par l’avalanche romanisatrice, comme la Bétique (Andalousie) en Hispanie ou la Narbonnaise en Gaule, loin de là. Commençons par rappeler que, dans le cadre du sujet qui nous intéresse et pour éviter le piège de l’anachronisme, nous devons parler de l’intégralité du territoire qui présentait alors une unité linguistique, donc de l’Aquitaine et également du haut Aragon (avec les précisions qui s’imposent). En outre, il faut tenir compte du fait que les Vascones et les Autrigones vivaient (ou allaient s’installer) sur les deux rives de l’Ebre. Le Pays Basque comprenait donc, à l’époque, de vastes plaines et des zones offrant pour Rome des intérêts économiques divers.
|
|
Thésée et le Minotaure (Pampelune) : Au pied des montagnes, la région appelée ager vasconum connut, outre une florissante activité agricole, une intense vie citadine. Dans cette zone, les artistes et penseurs, Romains et autochtones romanisés, s’exprimèrent de façons très diverses. Comme nous le montre cette mosaïque, les traditions culturelles romaines y atteignirent même un niveau de qualité certain. |
Evidemment, la partie centrale, montagneuse, resta beaucoup plus fermée aux relations extérieures. Malgré les routes, cette zone était non seulement plus lointaine et inaccessible, mais aussi plus étrange sur le plan socio-culturel, et les facteurs économiques n’y eurent pas assez de poids pour que la montagne se romanisât au même rythme que la plaine. La distinction traditionnelle entre le saltus vasconum de la zone montagneuse et l’ager vasconum des plaines du sud est très révélatrice des conditions géo-économiques dans lesquelles se déroula la romanisation du pays. Dans tous les pays qu’ils occupèrent par les armes, depuis la conquête proprement dite jusqu’au processus d’assimilation, les Romains recoururent toujours aux mêmes moyens pour s’implanter politiquement. Ils les utilisèrent aussi en Euskal Herria, sans toutefois y mettre le même acharnement ni en obtenir les mêmes résultats que dans d’autres parties de l’Europe. L’armée, le système de routes et de voies, le développement des relations économiques, la romanisation des villes autochtones, ainsi que les changements idiomatiques et culturels, tels furent les principaux facteurs de transformation de l’identité ethnique des natifs et d’assimilation des peuples au sein du projet culturel romain. La milice engendrait deux types d’échange: d’une part, il y avait les légionnaires étrangers qui étaient arrivés avec l’armée et, d’autre part, les Basques qui s’enrôlaient comme soldats dans les rangs romains. Sur place, les Vascons participèrent aux guerres civiles romaines, et des groupes d’origines tribales diverses se déplacèrent avec les légions à travers tout l’Empire (des cohortes de Vascons et de Varduli parcoururent les Iles Britanniques, la Germanie, l’Italie, l’Afrique, etc.). Quelques-uns d’entre eux ne manquèrent pas de figurer comme citoyens romains.
|
|
"Lapurdum" (Bayonne) : Lapurdum devait être, à l’origine, un simple village de pêcheurs mais, vers la fin du IVème siècle, elle apparaît comme place fortifiée de la région de Novempopulanie. La ville s’étendait alors sur une superficie de 10 hectares, à l’intérieur de murailles d’une longueur totale de 1.125 mètres et comptant 25 tours de 35 à 40 mètres de haut. A l’instar des villes romaines, elle avait deux rues principales: l’une, appelée cardo, allait du nord au sud (l’actuelle rue d’Espagne); l’autre, appelée decumanus, était tracée d’est en ouest. Construite par les Romains au dernier siècle de leur occupation, Lapurdum est une ville récente. Dessin original: LAUBURU: Histoire et Civilisation Basques. Dossier, I, 54. |
Il convient aussi de mentionner le réseau de voies et de routes qui parcouraient la Vasconie: les principales reliaient Burdigala (Bordeaux) à Asturica (Astorga), et Tarraco (Tarragone) à Oiarso (Oiartzun-Fontarabie). Bien que moins fréquentées que celles de la Bétique ou de la côte méditerranéenne, ces routes avaient une importance économique certaine, et les nœuds de ce réseau de communications étaient formés par les villes. Celles-ci regroupaient les gens, bien sûr, mais offraient aussi aux habitants, en même temps que les commodités de la vie romaine, divers droits politiques, en plus d’une langue culte, le latin.
Le territoire d’Euskal Herria, sans être aussi productif économiquement que d’autres régions d’Hispanie ou des Gaules, représentait aux yeux des Romains des richesses non négligeables: dans les plaines méridionales d’Alava et de Navarre, l’association traditionnelle des trois cultures blé/vin/huile et, dans la zone montagneuse, les mines de fer (comme celles d’Arditurri à Oiartzun ou de Somorrostro en Biscaye, pour ne citer que les plus connues). Parmi les facteurs qui affectèrent la relation ethno-culturelle dans la phase de colonisation qui suivit la conquête, citons le droit de citoyenneté romaine et la langue. L’histoire générale de l’Empire romain nous montre que ce furent, à coup sûr, les éléments les plus déterminants du processus d’assimilation et ceux qui produisirent les effets les plus durables. Des Basques furent donc reconnus comme citoyens romains, des villes furent fondées et leurs habitants purent jouir de droits divers: Calagurris (Calahorra) était alors la ville vasco-romaine de plus haut rang (municipium civium romanorum, vers 31-10 avant Jésus-Christ). Mais ce fut aussi la période historique où l’euskara courut le plus grand risque de disparaître, en raison de la force de la latinisation inhérente au processus de romanisation. Toutes les études concordent sur ce point. La romanisation totale, malgré une première phase de bilinguisme, entraînait à terme le remplacement linguistique. Cependant, le Pays Basque ne connut jamais le cycle complet, tel qu’il se déroula dans d’autres processus de colonisation. En effet, l’Empire romain, affaibli, s’écroula prématurément et la romanisation du Pays Basque s’avéra finalement superficielle.
|
|
Les emprunts au latin : Le contact entre l’euskara et le latin consiste essentiellement en la rencontre de deux formes de société. Du côté des nouveaux venus, au début, seuls les conquérants et les colons, c’est-à-dire les étrangers, prirent contact avec les bascophones; bientôt, l’initiative de la rencontre allait procéder des classes dirigeantes locales et des marchands basques qui affluèrent aux abords des villes. Pour eux, maîtriser le latin était absolument indispensable s’ils voulaient tirer le meilleur profit de leurs relations commerciales. C’est pourquoi, les autochtones du premier cercle colonial devinrent bilingues tandis que, loin de là, dans la zone montagneuse et les plaines retirées, les paysans et bergers basques demeuraient étrangers à ces échanges et restèrent unilingues. De ses relations avec la langue latine, le basque garda surtout du vocabulaire mais fut très peu affecté dans ses aspects grammaticaux. |
Les relations entre l’euskara et le latin ou, plus exactement, entre les locuteurs basques et les locuteurs latins, présentent deux aspects particulièrement intéressants: il convient de s’interroger, en premier lieu, sur le degré d’harmonie ou d’antagonisme sociolinguistique existant entre les deux communautés, puis sur les transformations subies par les deux langues en contact comme conséquence de ces relations (emprunts lexicaux, dans un sens ou dans l’autre, structures syntaxiques, etc.). Ce que nous savons des contacts entre le basque et le latin ne suffit pas à retracer, de génération en génération, l’histoire d’un phénomène social forcément changeant. Rappelons aussi que, entre le IIème siècle avant Jésus-Christ et le Xème siècle de notre ère, nous manquons de documents écrits consécutifs. Cette période de mille deux cents ans peut se diviser en deux étapes de durées presque égales: la première, qui va jusqu’à la chute de Rome au Vème siècle, est celle qui nous intéresse ici. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les relations sociolinguistiques de l’époque doivent être jugées dans le cadre de la situation coloniale décrite.
Rome n’imposa pas le latin par décret, mais bel et bien par l’intermédiaire des structures politiques et socio-culturelles. En effet, dans la nouvelle organisation sociopolitique mise en place, la seule langue utilisée était le latin. En outre, il était également la seule langue commune aux colonisateurs venus des quatre coins de l’Empire, même si tous ne la parlaient pas de la même façon du fait, précisément, de leurs origines diverses. Nous avons vu que la latinisation des peuples de l’Empire devint la seconde grande indo-européanisation historique de l’Occident qui eut pour conséquence, à l’ouest du Rhin au moins, de reléguer ou d’étouffer les langues indo-européennes antérieures. Certaines comme le gaulois et le celtibère, par exemple, disparurent complètement, alors que d’autres, tel le breton, réussirent à survivre aux confins de l’Empire. Parmi les facteurs décisifs pour la sauvegarde de l’euskara, la faiblesse et la pauvreté du territoire de l’actuelle Euskal Herria - le saltus de l’époque - ainsi que la relative unité culturelle et l’absence de résistance armée de ses habitants entrèrent certainement en ligne de compte, du côté basque.
Du côté romain, le système de contrôle de l’administration impériale commença à s’affaiblir très tôt dans nos régions, peut-être dès le IIIème siècle, pour ne plus exister deux siècles plus tard. L’instrument de la colonisation latine n’avait donc pas la force nécessaire pour être efficace. L’originalité idiomatique même de l’euskara, à savoir la différence existant entre ses structures grammaticales et celles du latin, peut aussi être considérée comme un facteur endogène de plus, dans la mesure où la langue du Basque l’éloignait plus de la société romaine que ne le faisait celle -indo-européenne- du Cantabre, par exemple. Mais, nonobstant ces éléments de résistance, le Pays Basque connut également une certaine latinisation. D’abord, les zones les plus ouvertes aux communications (rives de l’Ebre, Aquitaine, zones orientales des Pyrénées, régions celtisées) subirent une romanisation précoce et les villes, dès leur fondation, virent naître une société bilingue qui, peu à peu, se transforma pour laisser la place au monolinguisme latin. Par ailleurs, profitant des relations pacifiques que les autochtones entretenaient avec les colonisateurs, les Romains parvinrent à faire admettre aux classes les plus élevées de la société basque les avantages de leurs nouveaux projets culturels.
Naturellement, cela joua en faveur du latin. Il est difficile de déterminer quels éléments de langue passèrent directement du latin à l’euskara à cette époque. Les experts font parfois valoir des opinions diamétralement opposées, en raison des obstacles de taille qu’ils ne manquent pas de rencontrer au moment d’établir la chronologie des étymologies latines du basque. Étant donné l’évolution progressive du latin populaire vers les langues romanes avoisinantes, il est souvent ardu de définir et de dater les couches successives d’emprunts. Comment savoir, en fait, si un mot donné vient du latin ancien ou d’une forme romane précoce? Quoi qu’il en soit, il semble évident que des mots comme lege (loi) ou bake (paix) passèrent du latin au basque sans intermédiaire roman, et doivent par conséquent être considérés comme des emprunts anciens. D’autres cas attestés nous sont fournis par les mots suivants: bike (poix, goudron), biku (figue), ingude (enclume), iztupa (étoupe), goru (quenouille), lupu (scorpion), errege (roi), angelu (angle, coin), okela (tranche), gerezia (cerise), etc. L’influence latine se manifesta aussi dans certains suffixes de dérivation. Mais tout cela commença à se produire peu avant le début de la christianisation, c’est-à-dire au seuil d’une période qui, sur le plan culturel, allait provoquer une nouvelle vague d’emprunts au latin.
|
|
La Vasconie indépendante : Selon les chroniqueurs, le roi wisigoth Léovigild, après avoir attaqué et occupé une partie de la Vasconie, fonda en 581 la ville de Victoriacum , d’identification incertaine. La même année, le roi franc Chilpéric envoya contre les Basques le général Bladastes qui, semble-t-il, perdit dans l’aventure une grande partie de son armée. Des épisodes de ce type se reproduisirent assez souvent aux VIème et VIIème siècles. En effet, les Vascons se révélèrent être d’irréductibles guerriers face aux nouveaux royaumes germaniques apparus à leurs frontières. A cette époque (587), Grégoire de Tours les décrivait en ces termes: "Descendant des montagnes à l’assaut des plaines, les Vascons, en revanche, détruisirent les vignobles et les cultures, brûlèrent les maisons et capturèrent grand nombre d’hommes et de troupeaux. Le général Austrovald les attaqua à plusieurs reprises, mais ses assauts restèrent presque tous vains". D’après les écrits de Barbero et Vigil, dans la seconde moitié du VIème siècle, les Vascons comme les Cantabres étaient des peuples indépendants que ni les Francs, ni les Wisigoths, ni les Suèves ne purent soumettre. Selon The Times Atlas of World History, page 99. |
Nous avons vu au chapitre précédent qu’à partir du dernier millénaire de la préhistoire, quelque 1.000 ans avant Jésus-Christ, le Pays Basque entretint des relations avec différents peuples d’immigrants: tout d’abord, les Indo- Européens, puis les Romains, qui firent découvrir aux Basques la pression linguistique exercée par un Etat impérial. Ce processus prit fin dans le lent déclin de la civilisation romaine aux IVème et Vème siècles après Jésus-Christ et la chute finale de l’Empire (476). Au cours du millénaire suivant, à savoir jusqu’au XVème siècle, la communauté bascophone allait être confrontée à de nouvelles situations et alternatives historiques. En haut Moyen-Âge (du Vème au XIème siècle), la Vasconie connut une phase de consolidation territoriale: de nouvelles terres furent conquises par le repeuplement et la lutte armée, l’organisation du pays fut menée avec effort et persévérance, institutions et entités politiques diverses (duché de Vasconie en Aquitaine, et royaume de Pampelune en Navarre) furent mises en place.
|
|
Le repeuplement basque : Des noms tels que Zalduendo ou Urquiza, ou les toponymes qui subsistent aujourd’hui encore dans quelques villages au nom castillan (par exemple, à Ibeas de Juarros situé à 14 km de la ville de Burgos) sont des traces de la langue importée par les Basques, du XIème au XIIIème siècle, dans La Rioja et en Castille où elle fut parlée pendant un certain temps. Ci-dessus: villages burgalais à toponymie basque et barrage d’Urquiza (le village du même nom a disparu sous les eaux).
|
Apparemment, l’accroissement démographique du pays au cours des premiers siècles favorisa l’indépendance politique, en dépit des attaques extérieures (Goths, Francs). La période du Vème au VIIème siècle marqua un tournant dans la vie politique vasconne, dominée jusque-là par les relations pacifiques entretenues avec les Romains. N’acceptant plus aussi facilement de se soumettre, ni même de s’allier aux monarchies étrangères et, poussés par la faim qu’avait fait naître la surpopulation, les Vascons se lancèrent dans des incursions guerrières contre les peuples voisins, tant en Aquitaine que dans le sud. Comme le pouvoir politique avait pu, semble-t-il, s’ériger sur des bases sociales propres au pays, les langues vernaculaires (paradoxalement, surtout les langues romanes) gagnèrent plus ou moins de terrain, selon les cas, dans les institutions vasconnes, au détriment du latin. La conjoncture fut également favorable à l’euskara, dans la mesure où les populations qui incitèrent à l’occupation de nouveaux territoires étaient bascophones. Cela permit à la langue basque de récupérer les anciennes terres abandonnées au latin et même d’en conquérir d’autres. Et l’expansion territoriale s’accompagna vraisemblablement alors, d’un accroissement du rôle social de l’euskara.
|
|
Les itinéraires du chemin de Saint-Jacques : Comme nous le montre la carte, les différents itinéraires du chemin de saint Jacques traversaient les plaines comme les zones montagneuses du Pays Basque. A partir du XIème siècle, de nombreux pèlerins, qui parlaient des langues différentes, empruntèrent ces routes et les relations avec le reste de l’Europe commencèrent à s’intensifier. |
Dans ce contexte, il faut bien sûr ajouter au facteur politique que constitue la chute de l’Empire, le phénomène de ruralisation générale et l’affaiblissement consécutif des villes romaines que leurs habitants, latinisés, quittèrent peu à peu pour la campagne. Le latin perdit de la sorte son instrument social le plus puissant - la ville - qui, s’il n’avait pas disparu, lui aurait permis de s’imposer définitivement au reste du pays. Le développement du bilinguisme latin amorcé chez les Basques se trouva donc interrompu par une conjonction de difficultés insurmontables. En outre, la christianisation du Pays Basque se produisit lentement et progressivement. Le christianisme commença à se propager à partir des sièges épiscopaux (dans la Ribera et en Alava, à l’intérieur du pays), puis par l’intermédiaire des monastères et, enfin, via le réseau de routes principales ou secondaires du chemin de Saint-Jacques. L’influence linguistique de la christianisation apparaît concrètement dans le nouveau lexique religieux latin intégré à l’euskara. Le bas Moyen-Âge (du XIIème au XVème siècle) voit se constituer les territoires historiques, avec leurs privilèges et institutions publiques. C’est alors que naquirent les villes (surtout à partir de 1100) généralement peuplées d’autochtones, même si des étrangers y vivaient parfois, et que, dans la vaste Euskal Herria de l’époque, la langue basque noua de nouvelles relations interlinguistiques.
Malgré son expansion démographique et territoriale, la société basque ne parvint pas à imposer l’usage de l’euskara au niveau de l’administration dont la langue officielle, au moins pour la rédaction des actes, était toujours le latin. Ce rôle fut repris petit à petit par les langues romanes, tandis que la vieille "lingua vasconum", utilisée dans la vie courante, devait se résigner, dans l’administration, à n’être que parlée. Ce fut un choix historique d’une portée considérable, car le statut sociolinguistique ébauché au Moyen-Âge, au détriment de l’euskara, immobilisa la société bascophone pendant des siècles.
|
Les limites de la Vasconie : Au IVème siècle, pour contrer les attaques continuelles des Vascons, les Romains durent établir des lignes de résistance frontalière et, d’après Barbero et Vigil, un limes, défendu par des forteresses et des garnisons, fut donc élevé aux confins de l’Empire. Au cours des siècles suivants, les Wisigoths et les Francs eurent également à faire face aux Vascons, non seulement en organisant des expéditions périodiques, mais aussi en construisant, chaque fois que c’était possible, des systèmes de défense permanents. C’est justement cette tactique que les Arabes se virent contraints d’adopter plus tard, quand ils ne trouvaient parmi les autochtones aucun allié durable (comme les Banu Qasi de la Ribera navarraise, par exemple), voire simplement occasionnel (comme le royaume de Pampelune). Avec la Reconquête et le repeuplement qui s’ensuivit, la Vasconie eut l’opportunité d’étendre ses territoires vers le sud et d’y apporter sa langue. |
L’histoire de la christianisation d’Euskal Herria, et surtout sa chronologie, a déchaîné parmi nous d’âpres polémiques. À ce sujet, les thèses en présence -dans lesquelles généralisations géographiques et imprécisions conceptuelles abondent- diffèrent toutes, entre celles qui décrivent la christianisation comme plus ou moins avancée dès les IIIème et IVème siècles, et celles qui la font reculer jusqu’au XIème siècle (García Villada, 1935).
En ce qui nous concerne, nous nuancerons quelque peu le débat historiographique par les mots du professeur S. Mariner: "C’est une chose de penser qu’il n’y eut aucun chrétien au Pays Basque avant le VIIIème siècle, et c’en est une toute autre de penser qu’il y avait aussi des non-chrétiens". Disons seulement que la christianisation générale -territoriale et sociale- du Pays Basque fut un phénomène à développement lent et long qui se prolongea parfois jusqu’au Xème siècle. D’une façon générale, rappelons que le christianisme, né en Palestine, commença par se propager dans l’Empire romain qui, nous le savons, était alors divisé en deux grandes zones linguistiques: la zone latine en Occident, et la zone grecque en Orient. Le prosélytisme des Eglises chrétiennes allait donc, tout naturellement, être influencé par ces deux expériences linguistiques opposées. Dans la zone orientale de l’Empire, le grec jouissait depuis l’époque hellénistique du statut de lingua franca qui lui conférait, en dépit de l’usage généralisé du latin comme langue officielle, un grand rôle culturel et social, y compris à Rome même. À côté de cette dichotomie officieuse entre grec et latin, il y avait bien sûr les langues autochtones par rapport auxquelles les missionnaires chrétiens devaient prendre position. À cet égard, les Eglises chrétiennes d’Orient firent preuve d’une tolérance et d’une ouverture d’esprit remarquables vis-à-vis des langues des peuples qu’elles évangélisèrent, qu’il s’agisse de la prédication que des traductions de la Bible ou de la lithurgie (c’est ainsi qu’apparurent les différentes versions de la Bible en copte, syriaque, arménien, géorgien, gotique ou slavon).
|
|
De son côté, l’Eglise latine de Rome s’engagea, à partir des IIIème et IVème siècles, dans une voie radicalement opposée. Dans les territoires qu’elle dominait linguistiquement et culturellement en Occident, sa politique consista à faire de l’unité de la langue latine le symbole même de l’unité de l’Eglise. La politique de latinisation de l’Empire romain se trouva donc relayée par l’Eglise, gouvernée depuis Rome, et le patrimoine linguistique des peuples occidentaux ne put que s’en ressentir. La christianisation sonna l’heure de la seconde latinisation: "Le coup ultime et décisif assené aux anciennes langues péninsulaires, celui qui les fit disparaître à jamais, fut porté par la propagation du christianisme, car ces vaillants apôtres de la chrétienté, poussés par le désir de gagner les gens à leur foi, parvinrent à s’introduire dans les recoins que les armes, les lettres, le commerce et l’administration des Romains n’étaient jamais arrivés à atteindre" (García Bellido). Au Pays Basque, la christianisation devait également renforcer la fonction socioculturelle du latin et, au-delà, en l’absence de langue préromaine dominante, le rôle officiel et culturel des langues romanes. D’une manière générale, la langue basque ne reçut presque aucune protection officielle des puissantes institutions ecclésiastiques, même si Eutrope, au début du Vème siècle, voyait d’un bon œil une dévote utiliser la langue populaire pour enseigner le catéchisme. À la lumière de ses écrits, il semble qu’Eutrope faisait précisément référence aux efforts accomplis pour christianiser les Vascons dans leur propre langue (qualifiée de lingua barbara). Ainsi, les missionnaires qui prêchaient aux Vascons, de toute évidence, se posèrent le problème d’adopter une pratique plus réaliste et plus respectueuse vis-à-vis de l’euskara. |
Sans faire fi d’anecdotes comme celle-là, notons que le basque se trouva pris dans un tourbillon de vents contraires, mais sut nager contre les courants qui l’entraînaient vers sa disparition, un risque tout à fait réel dans le contexte d’évangélisation que nous avons indiqué. Nombreux sont ceux qui pensent que l’euskara doit sa survie à la tardiveté de la christianisation, à la non-coïncidence des deux pouvoirs latinisateurs du Pays (Empire/Eglise), et au fait que la société basque traversa alors des périodes d’essor démographique et social important. Pour des raisons opposées mais complémentaires, la tradition de latinisation générale de l’Eglise romaine et la christianisation tardive du pays empêchèrent l’émergence d’un alphabet basque ou d’une culture basque écrite, à l’instar de ce qui s’était produit sous d’autres cieux. L’évangélisation fut bientôt une nouvelle chance culturelle pour les langues romanes environnantes, chance dont l’euskara ne profita pas. L’héritage considérable reçu par l’euskara au cours de cette seconde phase de contact avec le latin est parvenu jusqu’à nous sous la forme des nombreux emprunts toujours en usage aujourd’hui. Les mots latins d’origine ecclésiastique les plus anciens remontent probablement à la période comprise entre le IIIème et le Vème siècle, comme par exemple: abendu (décembre), aingeru (ange), aldare (autel), denbora (temps), domeka (dimanche), fede (foi), gurutze (croix), gura (désir), meza (messe), zeru (ciel), etc. L’acquisition de ce patrimoine lexical représentait une forme de modernisation de la langue qui s’adaptait ainsi aux nouveaux concepts culturels adoptés avec la christianisation...
|
|
L’entourage roman (carte) : Si nous comparons cette carte, qui correspond à la période écoulée entre le XIème et le XIIIème siècle, à celle intitulée "L’euskara il y a 2.500 ans", quelques remarques s’imposent immédiatement: a) L’Aquitaine a été perdue. b) Une bonne partie des Pyrénées est toujours bascophone. c) L’implantation de l’euskara vers le sud - La Rioja - est antérieure à la période romane écrite. d) Toutes les langues environnantes sont nouvelles: aucune de celles qui figuraient sur la carte précédente, à l’exception de l’euskara, ne s’est maintenue. (Voir la légende pour la signification des numéros.) |
L’euskara et les langues romanes : Au Moyen-Âge, l’euskara se vit cerné de nouvelles langues nées du latin, et entra également en contact avec celles que parlaient les nombreux étrangers établis sur son territoire. Le gotique des Wisigoths (Vème-VIIème siècles) n’eut pas assez de vigueur, sur le plan politique ou socioculturel, pour mettre le basque en danger. En revanche, l’arabe (VIIIème -XIème siècles), bien implanté politiquement dans la Ribera et culturellement plus puissant, parvint jusqu’au royaume de Pampelune. Comme ces peuples ne formèrent pas d’Etats stables au voisinage du Pays Basque, ils ne laissèrent derrière eux aucune langue susceptible de rivaliser avec l’euskara. Au cours des siècles suivants (Xème-XVème siècles), l’euskara se retrouva entouré par les langues romanes, et ce furent elles précisément qui, du fait de cette cohabitation plus ou moins amicale, eurent une influence majeure sur la langue basque. Il s’agissait de la variante gasconne de l’occitan au nord, de l’aragonais et du roman navarrais au nord-est, et du castillan au sud-ouest.
Venus par le chemin de Saint-Jacques ou attirés par la politique des dirigeants, des étrangers vivaient aussi à l’intérieur même du Pays Basque, en conservant leur propre langue: il y eut les Francs qui vinrent développer le commerce et la vie urbaine, et qui parlaient divers dialectes occitans; il existait également des dizaines de quartiers juifs dont les habitants avaient des notions d’hébreu; enfin, au fur et à mesure que la Reconquête gagnait du terrain, surtout en Navarre, des arabophones restaient en arrière. À l’époque, le castillan s’étendait principalement au sud et n’empiétait presque pas sur le territoire de l’euskara, alors que le français, rappelons-le, était encore très loin, à des centaines de kilomètres de distance. Dans ce contexte historico-linguistique, il faut souligner, en outre, que certaines langues romanes naquirent du latin sur les lèvres mêmes des Basques, comme le prouve leur phonologie (cela est particulièrement manifeste pour le castillan). Les zones de contact, où coexistaient le basque et une langue romane, donnèrent naissance à différents types de bilinguisme. Nos connaissances sur ces situations sont hélas limitées mais, assurément, la langue basque n’était pas la langue "supérieure". En effet, les personnes instruites utilisaient le latin pour les tâches hautement qualifiées et, dans les autres cas, avaient tendance à employer n’importe quelle langue à l’exception de l’euskara. Le basque était un idiome socialement inférieur, y compris dans les régions où c’était la langue majoritaire. En même temps que cette division sociale se creusait entre les langues, deux grands phénomènes géolinguistiques, de nature contraire, se produisirent à cette période du Moyen-Âge: 1) L’euskara recula en Aquitaine et dans les Pyrénées. 2) Au sud, en revanche, la langue connut une grande expansion territoriale, comme nous allons le voir.
|
|
Les Gloses Emiliennes : Ces gloses (vers 950) figurent dans la marge d’un livre de prédication du monastère de San Millán de la Cogolla, dans La Rioja. Tous les érudits s’accordent pour dire qu’elles sont écrites en basque. Pourtant, bien qu’elles semblent être la traduction du texte latin qu’elles accompagnent, les opinions divergent quant à leur sens véritable: jzioqui dugu ’nous l’avons allumé’ ou ’nous le tenons pour tel’; guec ajutuezdugu ’il ne nous suffit pas’, comptent parmi les versions les plus vraisemblables. |
Aujourd’hui, personne ne met en doute le fait que la haute Rioja ait été bascophone, reste à savoir depuis quand. Pour Merino Urrutia, le chercheur qui a le plus étudié les origines basques de la toponymie dans cette région, les Autrigones et les Berones de La Rioja étaient bascophones dès l’Antiquité. Néanmoins, la majorité des spécialistes penchent, au contraire, pour une euskarisation de la région au Moyen-Âge, comme conséquence de l’immigration et du repeuplement qui suivirent la Reconquête: à partir du Xème siècle, les Alavais et les Basques de l’ouest seraient arrivés du nord pour occuper des terres vacantes et auraient alors euskarisé La Rioja ou, si l’on préfère, renforcé la population bascophone préexistante.
|
|
Jugement en faveur de l’euskara: Ojacastro (vers 1239) : En castillan médiéval, une fazanya était le jugement rendu par un tribunal, recudir signifiait ’répondre’, et le procureur du roi s’appelait Merino Mayor (bailli). Nous voyons donc que l’alcade d’Ojacastro défendit le privilège linguistique, ou fuero, des habitants de la vallée, droit ancestral que le bailli finit par reconnaître à la population bascophone. Ferdinand III, alors roi de Castille, accordait de la sorte aux Basques de La Rioja le droit d’utiliser l’euskara dans l’enceinte d’un tribunal. C’est là le plus ancien document historique portant reconnaissance officielle du basque. |
La formation politique de La Rioja remonte aux XI et XIIème siècles, mais la Reconquête avait commencé dès le VIIIème siècle (Cenicero, 735) et les moines qui vivaient dans les monastères de l’époque (San Miguel de Pedroso, 759) portaient déjà des noms basques. La Rioja nouvellement constituée offrait deux avantages aux immigrants du nord: la protection de l’armée, et un système de propriété foncière appelée presura. De ce fait, le repeuplement se déroula pacifiquement, au sein d’une population autochtone peu nombreuse et probablement de langue romane.
|
Les vallées de l’Oja et du Tirón : Les vallées de ces deux rivières s’étendent de la Sierra de la Demanda jusqu’à l’Ebre. Elles recèlent, indépendamment des noms basques de lieu que nous connaissons par les documents historiques anciens, des centaines de toponymes basques encore en usage aujourd’hui. A titre d’illustration, nous en avons sélectionné quelques-uns, ainsi que les photos de quelques villages. Les terminaisons en -uri, -uli, caractéristiques des termes urbains, méritent une attention particulière. |
Les colons basques s’établirent dans les vallées de l’Oja, du Tirón et de l’Arlanzón, ainsi que dans la région des Obarenes (Pancorbo). Notons que, sur la rive droite de l’Ebre, la toponymie basque s’étend plus à l’ouest. Les immigrants s’installèrent en plus grand nombre vers Burgos que dans les zones de la moyenne et basse Rioja. D’ailleurs, il ressort de l’étude des toponymes du Xème siècle, que la frontière orientale de la Rioja basque devait suivre la ligne de partage des eaux Oja/Najerilla- Cárdenas, bien que des restes de toponymie basque aient aussi été retrouvés récemment en aval de l’Ebre. À l’ouest, les toponymes basques sont plus fréquents dans les régions de l’Oja et du Tirón que dans celles de l’Oca et de l’Arlanzón.
|
Noms basques de lieu (vallée de l’Oja) : La vallée de l’Oja est celle qui, jusqu’à présent, a révélé la toponymie basque la plus dense. Voici les statistiques concernant les toponymes de quelques communes de la vallée, établies à partir des données recueillies dans les travaux de Merino Urrutia. |
Nous disposons de quelques informations sur la langue des Basques de la haute Rioja, lesquelles nous ont permis de déterminer l’origine des immigrants. Le parler, dont témoignent la toponymie et les noms de personne, semble appartenir aux dialectes occidentaux, car il utilise des modalités linguistiques que nous avons retrouvées, à l’époque moderne, en Alava et en Biscaye. Si nous nous replaçons dans le contexte des anciennes tribus basques, il est probable que l’euskara parlé dans la zone Rioja-Burgos était celui des Autrigones, des Caristii et, peut-être des Varduli. Par exemple, des mots tels que "ville" ou "noir" apparaissent sous la forme huri et baltz respectivement, au lieu des variantes orientales hiri et beltz. L’influence des Vascons navarrais sur la haute Rioja du Xème siècle apparaît donc assez réduite. En revanche, aux XIème et XIIème siècles, la politique navarraise d’expansion vers l’ouest provoqua vraisemblablement une nouvelle vague d’émigration vers ces régions. Cela pourrait expliquer, notamment, pourquoi le pèlerin français Aimery Picaud mentionnait, au XIIème siècle, les monts d’Oca comme frontière de la Navarre.
|
La toponymie basque dans la Rioja et la province de Burgos : Jusqu’à maintenant, nous nous sommes intéressés à la haute Rioja, c’est-à-dire aux vallées de l’Oja et du Tirón, mais la toponymie basque affleure aussi en aval, dans la moyenne et basse Rioja. Comme nous l’avons fait, au chapitre précédent, pour les Pyrénées (à partir des données de Coromines), nous présentons cette fois la carte des localités de La Rioja où ont été recensés des toponymes basques mineurs. (Il ne faut pas oublier que les localités en question ne portent pas forcément un nom basque, mais souvent un nom roman). Sur la carte, nous constatons que les villages à toponymie basque - Rubena, Espinosa, Ibeas de Juarros - atteignent presque la ville de Burgos. |
En marge de ces considérations démo-géographiques, il convient de jeter un œil sur la vie culturelle de la Vasconie d’alors. Entre les vallées de l’Oca et du Najerilla, se situent le monastère de San Millán de la Cogolla et le village de Berceo. Il se trouve justement que ce monastère a eu le privilège de conserver des documents qui, dans le cadre de notre étude, présentent un grand intérêt. En effet, nous avons trouvé dans les sermonnaires du monastère une série de gloses, appelées "Gloses Emiliennes", qui interprètent, en castillan ou en euskara, les textes de prédication latins. Les manuscrits, sur lesquels ces annotations étaient portées année après année, recueillirent ainsi les premières phrases écrites en euskara comme en castillan (ou, si l’on préfère, en roman navarrais).
Les Gloses constituent également un témoignage vivant de la coexistence de deux communautés linguistiques, la romane naissante et la bascophone. À côté de San Millán, le village de Berceo nous rappelle le poète castillan du même nom, né vers 1180/90 et mort en 1265. Les expressions comme Don Bildur, dont il truffe ses écrits en roman, font résonner à nos oreilles de Basques l’écho d’une autre langue, non romane: la nôtre, bien sûr! Nous avons vu que les Gloses font état du bilinguisme de la région au Xème siècle et que, trois siècles plus tard, l’euskara y était toujours présent, comme le suggèrent les mots mêmes de Berceo. Eh bien, nous disposons, à l’appui, d’arguments encore plus frappants. Le poète vivait à San Millán vers 1239 à l’époque où, non loin de là, fut rédigé un document qui fait la lumière sur la situation de l’euskara dans la vallée d’Ojacastro située de l’autre côté des montagnes. Ce texte, découvert en 1932, rapporte la dispute entre l’alcade d’Ojacastro et Don Morial, Merino Mayor de Castille, qui refusait aux habitants du village le droit d’être entendus en basque dans l’enceinte du tribunal royal. Irrités, les villageois séquestrèrent le bailli jusqu’à ce qu’il leur reconnût ce privilège (fuero). Sous le règne de Ferdinand III le Saint, l’euskara jouissait donc bel et bien, dans la haute Rioja, d’une certaine reconnaissance officielle. Sur le plan sociolinguistique, ce fait, recueilli et publié par Merino Urrutia, est sans doute l’élément documentaire le plus intéressant de toute l’histoire de la langue. Hélas, les années suivantes virent l’euskara de La Rioja déserter les rives de l’Ebre. Encerclée par le castillan, la langue basque survécut, tout de même, dans la haute vallée d’Ojacastro dès lors coupée des terres bascophones du nord. Bel exemple de résistance linguistique de la part des descendants de ceux qui, venus des montagnes du nord, avaient peuplé la vallée! Mais il est vraisemblable qu’au cours du Moyen-Âge, des cas similaires se produisirent dans certaines enclaves pyrénéennes.
|
|
"Lingua navarrorum" (1167) : C’est ainsi que le roi Sanche VI le Sage appela l’euskara, dans un document adressé au monastère de San Miguel de Aralar. Aussi, même si les nobles, les gens cultivés du royaume et le roi lui-même utilisaient d’autres langues pour écrire, la couronne admettait-elle que l’euskara fît partie du patrimoine général des Navarrais. |
Sanche le Sage de Navarre qualifia l’euskara de "lingua navarrorum" (1167), reconnaissant ainsi que le basque, appelé jusque là "basconea lingua", était la langue de la majorité de ses sujets. Mais, quelle était la place de l’euskara dans la Navarre médiévale? Par la toponymie et les listes anthroponymiques, nous savons qu’au Moyen-Âge, les noms basques se comptaient par milliers dans les bourgs, campagnes et monastères navarrais. Ces données ont contribué à établir l’état des lieux de l’euskara, lorsqu’elle était la langue des Navarrais.
|
|
Monastères de Navarre: Leire : L’étude des documents monastiques navarrais commence à faire apparaître des traces de langue basque. De plus, les archives des monastères constituent une des plus importantes sources d’informations sur l’onomastique basque de ce temps-là. Les manuscrits d’Irantzu et de Leire, par exemple, regorgent de noms basques, comme le Fuero Navarro sur certaines manifestations sociales traditionnelles. Dans un monastère, le cadastre permet de découvrir des formes toponymiques anciennes, et la liste des serviteurs témoigne des us onomastiques de l’époque: Eneco Arçaia (’le pasteur’. Ororbia), Miguel Arguina (’le tailleur de pierre’. Artaxona, 1173), etc. Cependant, la langue officielle utilisée dans les écrits monastiques n’était pas le basque, mais le latin. |
Le basque dominait alors dans la partie de la Navarre qui s’étend au nord d’une ligne Codes-Lerin-Arga-Tafalla-Caparroso-Sangüesa. Dans les bourgs et les monastères, en revanche, l’euskara cohabitait avec l’occitan, le roman navarrais ou le latin. D’une façon générale, en ville et dans les activités culturelles, ces langues faisaient courir à l’euskara le danger de perdre son hégémonie. Et c’est exactement ce qui arriva dans les documents officiels. À titre de preuve, les Archives Générales de Navarre renferment quelque 80.000 textes écrits en roman navarrais, environ 3.000 en occitan, et pratiquement aucun en basque. L’exclusion de l’euskara du monde de l’administration allait compromettre sérieusement l’avenir de la langue. L’incapacité du basque à devenir, au Moyen-Âge, la langue écrite courante s’explique, dans un premier temps, par l’hégémonie du latin, puis par le fait que les classes sociales dominantes, très tôt, préférèrent les langues romanes pour les devoirs officiels. Cette préférence apparaît clairement dans les règlements des nouvelles institutions, lesquels furent rédigés en roman. Néanmoins, le facteur social pesait de tout son poids.
|
|
Le Fuero Navarro (XIIIème siècle) : Le Fuero General (charte constitutionnelle du royaume) est rédigé en roman navarrais. En effet, dans leurs nouvelles attributions, les classes sociales supérieures de Navarre (la cour, l’Eglise) abandonnèrent l’usage du latin et optèrent pour le roman; mais, comme les règlements étaient destinés à une société bascophone, les mots basques apparaissent au détour des pages: ay una pecha que es clamada en bascuenz açaguerrico (Livre I, Titre VII, Chapitre II du Fuero General). |
C’est pourquoi le Fuero General navarrais recourt souvent, pour désigner les coutumes des habitants et les réalités quotidiennes, aux appellations basques, c’est-à-dire aux expressions courantes utilisées par la population. Comment pouvait-il en être autrement, puisque la majorité des Navarrais auxquels les lois étaient destinées parlaient basque. Heureusement, cette période ne fut pas que pertes et recul. Malgré ces faiblesses socio-culturelles, l’euskara navarrais gagna du terrain au Moyen-Âge, tant à la campagne qu’en ville. En effet, profitant des progrès de la Reconquête, les colons émigraient vers le sud, avec la langue basque dans leurs bagages. D’après les statistiques, 42,3% de ceux qui s’installèrent à Olite, entre 1244 et 1264, étaient uniquement bascophones ou tout du moins bilingues. L’émigration navarraise peut donc se comparer au repeuplement de La Rioja et de la province de Burgos par les immigrants de Biscaye et d’Alava. Comme dans le nord, les bascophones de la Navarre méridionale côtoyèrent des populations qui parlaient d’autres langues: l’hébreu, langue religieuse et culturelle des quelque 80 juiveries recensées dans les villes et localités importantes du royaume; le mozarabe et l’arabe, dans les territoires musulmans; l’occitan, pratiqué par les colons francs dans les bourgs fondés le long du chemin de Saint-Jacques; enfin, le latin, langue de culture toujours en usage. N’oublions pas qu’il existait également une langue romane locale, le roman navarrais né aux IXème et Xème siècles. Cette dernière allait d’ailleurs gagner les faveurs de la cour, tant à Nájera qu’à Pampelune, tandis que le bas peuple continuait à s’exprimer en basque.
|
Aspects ethnolinguistiques de la Navarre : Cette carte de la Navarre au bas Moyen-Age fait apparaître: 1) Les villes et villages de population navarraise (1366, 1350). 2) Les localités comprenant des quartiers juifs et musulmans (hébreu et arabe). 3) Quelques-uns des bourgs (occitan). 4) Certains monastères (latin). 5) Les aires correspondant à chacune des langues (basque, roman navarrais, arabe). 6) La zone de contact entre l’euskara et le sud romancisé. Carte originale. Sources: Atlas de Navarra. CAN, 1977. 46, 51-52. Bibliographie: Irigarai, Ciérvide, Mitxelena, etc. |
|
Les habitants de Navarre (1366) : La majorité des noyaux de population se trouvaient au nord. En revanche, les plus importants centres urbains se situaient au sud. Parmi ceux qui comptaient le plus grand nombre de feux, c’est-à-dire de foyers au sens de familles, citons Pampelune (967), Tudela (961), Estella (829), Laguardia (637), Olite (485, en 1350) et Sangüesa (443). La répartition des feux par merindad était la suivante: Nous constatons que la population des territoires bascophones était dispersée dans un grand nombre de petites villes, tandis que celle du "sud romancisé" se concentrait dans des villes plus grandes mais moins nombreuses. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer les chiffres de Tudela et d’Estella par exemple. |
Comme nous le rappelle l’historien de la langue R. de Ciérvide: "Les gens du peuple, les paysans, les Navarrais des textes de Leire, c’est-à-dire le véritable soutien économique du royaume et de la noblesse, parlaient toujours euskara quand ils travaillaient la terre, s’occupaient des troupeaux ou préparaient les radeaux (trains de bois) qu’ils remorquaient jusqu’à Tortosa".
|
|
Billets de cour (1415) : L’euskara avait aussi sa place à la cour royale de Navarre où, souvent, des bascophones occupaient des charges officielles. Le billet ci-contre, retrouvé il y a quelques années, est la preuve que des fonctionnaires correspondaient en basque. Il s’agit d’une lettre adressée par Martín de San Martín à Machín de Zalba sur laquelle on peut lire: Et jaunatiçula abarion ez naiz bildur ezten alla... |
En Navarre, le recul de la langue basque au Moyen-Âge est plus social que territorial. Il tient au fait que l’euskara ne réussit pas à s’implanter dans les nouveaux domaines d’activité engendrés par la modernisation de la société et qui allaient prendre une grande importance sociolinguistique. La preuve en est qu’en 1350, in ydiomate nauarre terre s’appliquait désormais au roman, même si la majorité du peuple restait fidèle à sa langue et, ce faisant, défendait la frontière linguistique méridionale d’Euskal Herria. 192 343 325 28 92
Le Moyen-Âge, "Age Obscur", arrivait à son terme. C’était, comme on l’a dit, l’«Automne du Moyen-Âge». À cette époque, Gutenberg avait déjà inventé l’imprimerie (1440) et les lettres classiques connurent un intense renouveau, tout à leur honneur. Les premières éditions imprimées -classiques ou religieuses- étant diffusées à travers l’Europe, toute œuvre pouvait être reproduite à des centaines voire des milliers d’exemplaires. Le latin d’abord, puis les langues vernaculaires se trouvèrent confrontées à ce nouveau défi. En ce qui concerne l’euskara, il fallut attendre un siècle entier, à notre connaissance, avant de voir le premier livre imprimé dans cette langue (1545). La Péninsule vécut un XVème siècle agité au cours duquel la société basque traversa des périodes de lutte armée entre factions rivales, le célèbre épisode des Parientes Mayores ("guerre des Bandes"). C’est dans ce contexte d’affrontement général que furent composées les premières chansons et élégies basques connues. Recueillies et imprimées bien plus tard, ces chansons d’amour et de haine sont un exemple de littérature populaire produite par une société tourmentée. Hormis celles écrites par quelque factieux en colère, notons que quelques-unes des plus marquantes sont l’œuvre de femmes. À cet égard, le Fuero Viejo de Biscaye (1452) s’attaqua violemment aux pleureuses qui chantaient traditionnellement dans les cortèges funèbres et qui, semble-t-il, mêlaient à leurs lamentations, authentiques manifestations de poésie populaire, des critiques d’ordre social. Il est permis de croire que ces pratiques prélittéraires devaient être assez répandues pour que le législateur daignât s’y intéresser. Il faut signaler qu’il arrivait également aux gens aisés des classes supérieures d’utiliser l’euskara en public, pour exprimer une revendication politique ou une peine.
|
Mots basques d’origine arabe : De même que la langue basque emprunta certains mots à d’autres langues environnantes, l’euskara prit quelques mots à l’arabe, directement ou par le canal d’une langue intermédiaire. Cependant, les arabismes sont assez rares en basque. |
|
Le lexique latino-chrétien. Au Pays Basque comme ailleurs en Occident, la christianisation s’accompagna d’un enrichissement lexical de la langue. Voici un extrait de la longue liste des emprunts basques au latin ecclésiastique: |
|
|
Juan de Zumarraga (1537) : Dans la lettre qu’il écrit de Mexico à sa famille de Durango, l’archevêque rappelle la maison de campagne de Muntsaratz (Obatuco ta ondraduco dogu munçarasco eseorj = Nous embellirons et honorerons cette maison de Muntsaratz). Gageons que la restauration entreprise dans cette demeure par la "Diputación Foral" de Biscaye en 1990 sera une façon d’exaucer le vœu de Juan de Zumárraga dont le monument mexicain s’élève sur la Plaza Ezkurdi à Durango, à quelques kilomètres de Muntsaratz. |
|
|
L’élégie de Milia Lasturko (vers 1450) : Nous ignorons la date exacte à laquelle fut composée cette élégie. Elle n’en constitue pas moins un magnifique exemple des vers qu’une poétesse du XVème siècle pouvait écrire et réciter: Cer ete da andra erdiaen zauria/Sagar errea, eta ardao gorria./Alabaya, kontrario da Milia/Azpian lur oça, gañean arria. Ces chants datent des XIVème et XVème siècles, mais furent recueillis par écrit au XVIème siècle et nous devons leur étude à J.C. Guerra. |
En effet, les "meilleures" familles de Biscaye et de Gipuzkoa ne voyaient pas d’un mauvais œil la pratique d’une forme écrite, plus culte, de l’euskara. D’ailleurs, le plus long texte basque en prose que nous connaissions, antérieur de quelques années au premier livre, a été rédigé par un personnage originaire de la région où furent écrits les chants reproduits ici: il s’agit d’une lettre que Juan de Zumárraga (1476-1548), natif de Durango et premier archevêque de Mexico, écrivit aux siens en basque, selon la coutume familiale. L’éclosion d’une nouvelle forme de culture, la littérature, était dans l’air du temps. Mais, la société basque de la Renaissance allait-elle fournir à l’euskara l’opportunité socio-culturelle que le Moyen-Âge ne lui avait pas donnée?
|
|
Les défenseurs du castillan : Au XVIème siècle, l’accession des langues vernaculaires au statut de langues officielles, principalement dans l’Europe du sud-ouest, entraîna la publication d’une abondante bibliographie sur le sujet, car il fallait bien, dès lors, établir des règles d’usage susceptibles d’être appliquées par tout un chacun. Les discussions, plus ou moins théoriques, qui s’éternisaient depuis le Moyen-Age prirent donc un tour décisif pour donner des résultats concrets (1520-1560), tous sans exception au détriment du latin. Aussi, en même temps que les hommes de plume, les idéologues des grandes monarchies de la Renaissance se préoccupèrent-ils de diffuser et d’étayer les arguments et les pratiques qui avaient prévalu. Sans omettre le travail de pionnier de Nebrija (1492), la Gramática Castellana de Villalón (1558) constitue un bon exemple de cet effort. |
L’Europe des Temps Modernes vit se produire, entre autres, certains phénomènes et événements significatifs qui allaient changer radicalement la situation des langues du continent et conditionner leur développement futur. En premier lieu, c’est la politique suivie à la Renaissance qui forgea l’appareil administratif des États modernes et conduisit directement à l’Absolutisme, au regard duquel les Monarchies de la France et de l’Espagne faisaient figure de précurseurs. Pour satisfaire l’appétit du colonialisme européen, l’économie trouva sur d’autres continents (Amérique, Afrique, Indes Orientales) des richesses inconnues jusque là, et les Basques, comme les autres, s’efforcèrent d’en tirer profit. Et au XVIIIème siècle, l’Angleterre commença sa révolution industrielle. Dans le domaine culturel, les sciences naturelles positives et la philosophie moderne ouvrirent de nouvelles voies et reléguèrent de plus en plus la Scolastique au second plan. De plus, les changements religieux -notamment, la Réforme protestante- ébranlèrent les croyances traditionnelles.
La protection accordée à certaines langues vernaculaires, dont les classes dirigeantes favorisèrent la pratique, sur le plan culturel d’abord, au sein des institutions officielles ensuite et, aussi, par une politique linguistique délibérée, commença à porter ses fruits. Au cours de la période qui nous intéresse, à savoir depuis la publication du premier livre basque (1545) jusqu’à la Révolution Française (1789), l’histoire de l’euskara fut marquée par des événements importants, parmi lesquels nous pouvons mentionner: • La naissance de la littérature basque: aux XVIème et XVIIème siècles au nord des Pyrénées; dans le courant du XVIIIème siècle au sud. • L’opportunité historique que la Réforme et la Contre-Réforme offrirent aux langues populaires, mais qui influença également l’euskara. • L’apparition de cercles de bascophiles, qui promurent et cultivèrent la langue écrite: l’entourage de Leizarraga, l’école de Saint-Jean-de-Luz/Sare, le cercle de Larramendi. • Le rôle directeur de certains dignitaires et hauts fonctionnaires -la reine Jeanne d’Albret, l’archevêque Echaux et Oihenart lui-même- et, en contrepoint, la négligence de la plupart d’entre eux. • Les options de l’Église catholique sur la langue ecclésiastique: les Constitutions Synodales de Calahorra, les choix linguistiques des Ordres religieux, etc. • La multiplication des apologies de l’euskara, pour contrer les attaques dont la langue basque faisait l’objet: Garibai (1571), Poza (1587), Etxabe (1607), etc. Hélas, pour des raisons qui restent encore à analyser, tout cela ne suffit pas à donner à la langue un statut social déterminant. Certes, sur le territoire propre à l’euskara, la majeure partie des bascophones étaient réellement unilingues, mais nous ne pouvons oublier que la langue basque, aux Temps Modernes, se vit dépossédée de régions qu’elle occupait jadis, et cantonnée à l’intérieur des limites actuelles du Pays Basque.
|
|
"Sautrela" d’Etxepare : Le premier livre en basque, publié par B. Etxepare, se composait de poèmes religieux d’inspiration mariale et de poèmes amoureux. Conscient d’être le premier écrivain basque, Etxepare dédia également deux magnifiques compositions poétiques à la langue qu’il avait choisie pour écrire ses vers, dans son livre Linguae Vasconum Primitiae (= Prémices de la Langue des Basques). De l’édition princeps de la première œuvre basque, il ne reste aujourd’hui qu’un seul exemplaire conservé à Paris, dont nous reproduisons ici une page en fac-similé. |
Lorsqu’Etxepare entreprit la tâche d’écrire le premier livre basque, l’Europe était en train de vivre des événements d’une importance capitale pour l’avenir des différentes langues des États et pays occidentaux. Certaines des langues parlées dans les grandes monarchies de la Renaissance avaient pris le chemin de leur réussite future dès le Moyen-Âge. Le statut de langue administrative officielle accordé au castillan par Ferdinand III (1217- 1252), et la marginalisation du français en Angleterre comme conséquence des changements linguistico-administratifs de la seconde moitié du XIVème siècle, par exemple, avaient marqué le début de la recomposition du paysage sociolinguistique de ces deux royaumes. La Renaissance, par l’intermédiaire d’instances politiques et culturelles appropriées, apporta sa pierre à l’édifice dont les fondations avaient été jetées auparavant. Mais, à l’époque, le débat entre latinistes et vernaculistes, loin d’être clos, redoubla. Dans les années 1520-1560, la pratique résolue des langues vulgaires comme langues de culture s’intensifia, effaçant de la sorte l’hésitation et la méfiance envers les langues vernaculaires. Les préférences de nombreuses personnalités, du monde intellectuel ou politique, ainsi que les mesures prises par les institutions socio-politiques, contribuèrent à tracer de façon de plus en plus nette la ligne de partage linguistico-culturel entre l’ancien et le moderne.
|
Les premières grammaires : Au XVIème siècle, tandis qu’elles ravissaient au latin son rôle traditionnel et qu’elles commençaient à en jouer de nouveaux, les langues vernaculaires —en particulier, celles qui bénéficiaient d’une protection officielle— éprouvèrent le besoin de mettre par écrit leurs propres règles, donnant ainsi naissance aux grammaires. Il est communément admis que le basque doit sa première grammaire à Larramendi, mais rappelons tout de même les travaux antérieurs d’Oihenart (1638) et d’Etxeberri de Sare (1712-1716), sans oublier que Leizarraga porta également beaucoup d’intérêt, en son temps (1571), à une normalisation de la langue qui aurait permis l’alphabétisation générale et, plus spécialement, des jeunes. Parmi les langues néo-latines, le castillan fut la première à avoir une grammaire (1492). En dehors des langues romanes, il fallut attendre presque un siècle pour voir apparaître la première grammaire anglaise (1586). La première grammaire imprimée de la langue catalane fut l’œuvre de J. P. Ballot: Gramàtica i Apologia de la lengua catalana (1815). |
Bien que les humanistes de la Renaissance fussent inconditionnellement latinistes, dans la mesure où ils croyaient en la supériorité culturelle du latin sur les langues vernaculaires, d’aucuns virent aussi dans les langues vulgaires, convenablement pratiquées, des instruments adaptés au développement culturel des peuples. Dans ce contexte, et sans que nous sachions s’il avait connaissance de ces courants d’idées, Etxepare nous apparaît bel et bien comme un homme de son temps. L’orgueil linguistique dont il fait preuve dans ses textes n’est pas seulement celui d’un pionnier de la langue, auteur d’une œuvre innovatrice parmi d’autres, mais également celui d’un intellectuel européen de la Renaissance, vernaculiste convaincu. Malheureusement, Etxepare fut un cas isolé et ne fit pas école.
|
|
Cize, perle de la Basse-Navarre : C’est dans cette belle région de Cize qu’Etxepare composa le premier livre basque connu: Garaziko herria/benedika dadila,/heuskarari eman dio/behar duien thornuia. (= Que le pays de Cize soit bénit! Il a donné à l’heuscara le rang qu’il doit avoir.) La photo, prise depuis le col d’Osquich, nous montre la contrée s’étendant entre la Basse-Navarre et la Soule. |
L’histoire de Leizarraga, son successeur dans les lettres basques, est assurément différente. C’est à lui qu’incomba l’honneur d’être le père de la prose basque. La publication de sa version du Nouveau Testament (1571) s’inscrit dans l’autre grand courant culturel qui caractérise le XVIème siècle, à savoir les rivalités religieuses entre Réforme et Contre-Réforme. Et les collaborateurs de Leizarraga, véritable équipe de traducteurs efficaces, travaillèrent en harmonie avec ce mouvement à l’échelle de l’Europe. L’histoire des traductions de la Bible antérieures à la Réforme est certes très riche (entre 1466 et 1520, pas moins de 22 traductions furent publiées en Allemagne; la version complète en français date de 1487), mais c’est la Réforme qui fit de la traduction systématique des Écritures un instrument de base de la vie pastorale, alors que l’Église catholique, à partir du Concile de Trente (1563), montra dans ce domaine la plus grande méfiance. Dans l’équipe de Leizarraga, les traducteurs savaient ce qu’ils faisaient et n’ignoraient pas que les raisons et motifs théoriques de leur travail étaient ceux-là mêmes qui avaient poussé Luther et Calvin, avant eux, à entreprendre leurs traductions. Quelque vingt ou trente ans avant de parvenir jusqu’à nous, la Réforme avait exposé dans sa théologie et assumé dans sa pastorale les raisons de ce choix.
D’après ce que nous savons, Leizarraga avait des vues apparemment très larges. Conscient du programme général de la Réforme, il en connaissait toutes les motivations. Mais, dans le cadre de notre tradition littéraire naissante, cela ne suffisait pas à garantir le succès de sa traduction. En effet, le savoir-faire littéraire de quelques traducteurs, aussi compétents fussent-ils, ne constituait aucunement l’assurance d’un grand retentissement social, à travers le pays, pour la version de Leizarraga. De fait, sa diffusion fut limitée à une petite zone du Pays Basque Nord et dépendit en grande partie des vicissitudes du parti huguenot français. Aussi, quand Henri le Navarrais comprit que "Paris valait bien une messe" et se convertit au catholicisme, le sort en fut-il jeté. En fin de compte, l’effort considérable de Leizarraga fut vain, car il ne permit pas l’instauration durable d’une tradition littéraire plus générale. Devant l’inconstance de ces efforts, pouvait-il y avoir un meilleur moyen de développer l’héritage linguistique du peuple basque et de rehausser son prestige? Il semblerait que ce fut l’avis de certains. Le hasard fit que l’année où Leizarraga publia sa traduction (1571), Esteban de Garibai, originaire de Mondragón et premier historien général d’Espagne, voyait imprimer son œuvre majeure, le Compendio Historial. Les chapitres relatifs à la langue basque n’y manquent pas et marquent le début d’une nouvelle tradition, celle des écrivains basquisants s’exprimant en castillan. Les apologies du basque écrites dans une autre langue allaient tenter de sauvegarder l’honneur et le renom de l’euskara par le biais de croyances et de savoirs mythiques. Malgré certains travaux de grande valeur (comme celui de Poza,1587), en ce qui concerne la capacité du basque à s’approprier de nouvelles fonctions socio-culturelles, la polémique, alimentée jusqu’au XIXème siècle, ne porta aucun fruit et contribua surtout à faire perdre la direction à suivre.
|
|
L’Ordonnance de François Ier (texte, 1539) : Les grandes monarchies de la Renaissance (en particulier la Castille, la France et l’Angleterre) réussirent à moderniser en profondeur leur système institutionnel: d’une part, elles réalisèrent l’unification de leur territoire respectif et, d’autre part, elles améliorèrent l’appareil d’Etat en renouvelant les institutions publiques, réorganisant les finances royales et accroissant le nombre des fonctionnaires de la couronne. De grands efforts furent déployés pour concentrer tout le pouvoir dans la personne du monarque. Néanmoins, les gens du peuple parlaient des langues différentes au sein de chaque royaume et, à une période où le latin se faisait supplanter dans la vie culturelle par les langues vernaculaires, les rois donnèrent leur préférence à la langue de la cour: en France, leur choix se porta sur la langue d’oïl (qui allait devenir le français) et, dans la Péninsule, sur la langue de Tolède ou castillan (connu aujourd’hui comme l’espagnol). Ce fut François Ier qui ordonna d’abandonner le latin dans l’administration et d’utiliser à la place une langue vernaculaire. Dans la pratique, une seule langue vernaculaire fut choisie à travers tout le royaume de France: le français. |
Les humanistes qui écrivirent des poèmes pour défendre leur langue au sein des grandes monarchies du XVIème siècle furent nombreux, de même que les grammaires et autres ouvrages à la gloire de la langue. Dans la préface à sa grammaire, Nebrija adresse à la reine Isabelle la Catholique une dédicace qui exprime de façon exemplaire, presque caricaturale, l’idéologie colonialiste: l’année même de la découverte de l’Amérique, le grammairien, ignorant encore l’événement et ses conséquences, invoquait la nécessité d’imposer le castillan dans tout l’Empire. Le dessein formulé par Nebrija, pris comme propos paradigmatique de domination politique, allait justifier bien des comportements colonialistes. En ce qui concerne notre littérature naissante, maints exemples montrent les liens étroits qui existent entre langue et politique. Sans trop nous étendre, rappelons seulement quelques-uns des faits survenus au cours de la décennie précédant la publication du premier livre basque. Incontestablement, Charles Quint fit siennes les priorités linguistiques de la monarchie espagnole. Outre ce que la lecture de Villalón a pu nous apprendre sur les idées qui prévalaient dans l’entourage de l’empereur (1558) en matière linguistique, un événement, qui fit couler beaucoup d’encre, nous en apporte la démonstration. Il s’agit de l’incident diplomatique provoqué par Charles Quint en 1536, à Rome, lorsqu’il dérogea aux règles du protocole en s’adressant au pape en castillan. Une telle conscience de l’hispanité était extrêmement étonnante de la part d’un monarque qui apparaissait comme le défenseur d’une chrétienté et d’un empire, concepts tout droit sortis du Moyen-Âge et, qui plus est, était de langue maternelle flamande. Il en fut pourtant ainsi et l’empereur fit preuve, sur le plan de la langue, d’un remarquable nationalisme castillan. Nonobstant cet épisode (qui peut être envisagé comme l’expression d’une catégorie sociale, ou comme une simple anecdote), il faut préciser que les Habsbourg (XVIème - XVIIème siècles) n’imposèrent jamais aux pays catalanophones de la couronne d’Aragon, par exemple, de changer de langue officielle, et respectèrent le multilinguisme dans les différents royaumes de la couronne. Ce fut la France qui prit l’initiative, dès le XVIème siècle, d’une politique plus coercitive. Soucieux de clarifier la situation dans l’administration, François Ier, le "Chevalier sans Tache" (1515-1547), considéra qu’il était nécessaire d’abandonner l’usage du latin et de recourir à une langue connue de ses sujets pour les affaires administratives: cette volonté royale fut formulée dans l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. En principe, l’ordonnance aurait pu jouer en faveur de n’importe quelle langue du royaume mais, de fait, elle servit exclusivement la langue de la cour, laquelle se développa de plus en plus au détriment des autres. Comme nous le verrons, ce changement en faveur du monolinguisme ne se produisit pas d’un seul coup, loin de là, mais les mesures prises par l’administration allaient dans ce sens. De plus, le développement de l’administration même, toujours plus puissante, contribua à accentuer la tendance: en effet, au cours du XVIème siècle, le nombre de fonctionnaires du royaume passa de 5.000 à 50.000.
|
|
Jeanne d’Albret (1555-1572) : A partir de 1560, la reine de Navarre se prononça ouvertement, y compris en public, en faveur du protestantisme. Les premiers protestants qu’elle rencontra furent des ecclésiastiques, des magistrats et des nobles (Ezponda, Gramont, Beltzuntze, Larrea, Leizarraga lui-même, etc.). En 1564, elle proclama la liberté de religion dans le royaume tout en restant, naturellement, une ardente partisane du mouvement protestant. L’interdiction des fêtes religieuses catholiques déclencha le soulèvement catholique et la guerre civile (1566-1571), et ouvrit une période d’incertitude et de cruels massacres. C’est dans ce contexte que Leizarraga se vit confier la préparation du Testamentu Berria par le synode calviniste de Pau (1564), à la demande de Jeanne d’Albret qui finança la traduction avec 50 écus, puis la publication avec 120 écus de plus. Cette édition du Nouveau Testament fut d’ailleurs dédicacée à la reine.
|
Il était permis de penser que les choses se passeraient autrement dans l’Angleterre d’Henri VIII et Elisabeth Ière où, à la différence de la France, la Réforme était mise en œuvre, sous la conduite et la responsabilité du monarque en personne. Comme il se doit, la Bible fut traduite en anglais, mais aussi en gallois. Le Nouveau Testament et le Book of Common Prayer, en gallois, datent de 1567 et la Bible, dans sa version galloise intégrale, de 1588. Sur le plan culturel, ce fut un grand pas en avant qui aurait pu conduire à la normalisation linguistique du Pays de Galles. Mais la loi y avait déjà opposé un obstacle car, dans les années 1536-1542, Henri VIII avait imposé à la Principauté la politique des actes d’Union dans le cadre desquels le rôle des langues était parfaitement défini. Dès lors, la seule langue officielle de l’administration au Pays de Galles serait l’anglais. Ce document eut des conséquences sociales et sociolinguistiques vraiment désastreuses, et finit par entraîner l’abandon du gallois par les classes dirigeantes et leur émigration.
Par ces brefs rappels historiques, nous avons replacé dans le contexte général européen le cas de l’euskara, autour duquel un danger bien réel se précise. Les résolutions politico-linguistiques que les monarchies, dans leur essor, prirent à l’époque allaient non seulement transformer la vie quotidienne des fonctionnaires, mais surtout marquer durablement les structures mentales et les références sociolinguistiques en vigueur en France, en Espagne ou en Angleterre.
|
|
La traduction de la Bible en Europe : XVIème siècle. La traduction de la Bible, dont ce tableau retrace l’histoire, constitue l’un des faits les plus significatifs du mouvement culturel du XVIème siècle. Luther —le père de la Réforme protestante— comprit très tôt la valeur et l’influence rénovatrice que ces traductions pouvaient avoir, et il mena à bien son projet avec zèle et application (1522-1534). Les mêmes considérations conduisirent à réaliser, à l’échelle de l’Europe, un programme consistant à traduire la Bible dans la langue de chacun des pays que la Réforme souhaitait atteindre. Il apparaît clairement que le Pays Basque ne resta pas en marge de ce mouvement. Allemand (Luther, 1522-34), Français (Estienne 1528), Anglais (Coverdale 1536), Suédois (Petri 1526-41), Finnois (Agricola 1543), Danois (Pedersen 1529-50), Castillan (C. de la Reina 1569), Basque (Leizarraga 1571), Islandais (Gottskaltsson 1540-84). |
Au cours des décennies qui suivirent la publication des deux premiers livres basques (1545, 1571), l’euskara devait, en théorie, tirer profit de l’accueil favorable que lui avait réservé la société basque pour donner naissance à une tradition littéraire écrite. De fait, certains indices pouvaient le suggérer A la cour de Navarre, le basque était utilisé dans les grandes occasions (la naissance d’Henri III [IV] en 1556, par exemple, fut célébrée par un poème) et nous avons déjà évoqué le mécénat de la reine Jeanne d’Albret. Ce ne fut pas un cas isolé, comme le prouvent les concours littéraires de Pampelune, placés sous le patronage de l’évêque du diocèse (1609-1610). Par ailleurs, Leizarraga, conscient du très bas niveau de scolarisation et d’alphabétisation de la population -qui rendait impossible tout projet visant à créer des habitudes de lecture-, se permit d’adjoindre à la traduction de la Bible l’ABC ou l’instruction des chrétiens destiné à alphabétiser d’hypothétiques lecteurs. Le même souci d’alphabétiser les fidèles transparaît dans le catéchisme de Betolatza (1596) qui comprend un syllabaire d’initiation à la lecture (sujet que nous aborderons plus loin).
Une préface militante (texte) : Etxepare, l’auteur du premier livre basque publié (1545), exprima ses préoccupations linguistiques de façon remarquablement vivante. Outre les deux poèmes mentionnés plus haut, il consacra à la langue basque ce passage de la préface.
|
Comme les Basques sont habiles, vaillants et généreux et que, parmi eux, il y a eu et il y a des hommes fort versés dans toutes les sciences, je suis étonné, Monsieur, que pas un n’ait essayé, dans l’intérêt de sa propre langue, de faire quelque ouvrage en basque et de le mettre par écrit, pour qu’il soit porté à la connaissance du monde entier que cette langue est aussi bonne à écrire que les autres. Et pour cette raison elle reste diminuée, et dépourvue de toute réputation, et toutes les autres nations croient qu’on en peut rien écrire dans cette langue comme toutes les autres écrivent dans la leur. Bernat ETXEPARE, 1545 |
Sans doute, de telles initiatives pouvaient laisser croire que la communauté bascophone était sur le point de franchir une nouvelle étape de son évolution culturelle. Mais, en était-il vraiment ainsi?
|
“Contrapas” : Le contrapas, dans sa forme, semble être un reflet de la contredanse (Lafon). Dans ce poème, l’auteur tente de stimuler l’orgueil des paysans de Cize pour leur propre langue. Il fait également allusion aux pseudo-lettrés étrangers: Qu’ils sachent, eux aussi, que le basque a atteint son apogée. Il jouit désormais du prestige des langues imprimées et il est digne d’aller de par le monde. |
|
|
Le Nouveau Testament (1571) : Le deuxième livre imprimé en basque fut une traduction calviniste du Nouveau Testament, effectuée à la demande et avec l’aide de la couronne navarraise. Cette œuvre, généralement attribuée à Leizarraga, représentait, en réalité, le fruit d’un travail d’équipe. La prose basque, à ses débuts, était assurément très belle, mais les circonstances l’empêchèrent de s’épanouir et de trouver un public: une époque tourmentée commençait, celle des guerres de religion, et Henri III de Navarre, le propre fils de la protectrice des lettres basques, dut se convertir au catholicisme pour pouvoir accéder au trône de France (1593) sous le nom d’Henri IV. Plus tard, la Réforme catholique allait opter pour d’autres genres littéraires (école de Saint-Jean-de-Luz/Sare). |
D’une manière générale, la société basque du XVIème siècle formait un groupe nettement unilingue, même si le bilinguisme subsistait à la périphérie du corps social et dans certaines classes bien déterminées de la population urbaine. Au sein de cette communauté bascophone, l’hispanophone unilingue -autochtone ou implanté- ne courait pas les rues. Les gens aisés de la ville conservaient généralement l’euskara comme langue maternelle, et la transmettaient fidèlement de génération en génération. En outre, la vitalité et la force d’attraction de la langue étaient si évidentes dans la communauté basque que, d’après Isasti (1625), les étrangers installés sur la côte Gipuzkoane, par exemple, finirent par parler euskara.
|
|
Contexte social de la traduction du Nouveau Testament : La première traduction en basque du Nouveau Testament (Leizarraga: La Rochelle, 1571) fut rendue possible par le mécénat et un environnement institutionnel et social exceptionnel. La dédicace que l’auteur adressa à la reine de Navarre n’était certes pas une simple obligation protocolaire. Selon d’autres sources historiques, nous savons que la reine en personne fut l’instigatrice la plus déterminée du projet. Certains nobles de son entourage, cités expressément par Leizarraga, étaient également animés des mêmes préoccupations. Néanmoins, au-delà des mécènes, ce fut l’œuvre des traducteurs et, en premier lieu, de Leizarraga lui-même qui écrivait: "L’effort s’est révélé plus grand que quiconque aurait pu le penser au commencement". En vérité, il a dû être assez difficile, à partir d’une prose basque inexistante, d’atteindre du premier coup le niveau de qualité littéraire requis. |
En ville, bien sûr, le problème était beaucoup plus complexe. Pour éviter les généralisations, il faut préciser que la situation linguistique et les relations intercommunautaires étaient différentes à Pampelune, Saint-Sébastien, Bilbao ou Vitoria. Dans le pire des cas (Vitoria, 1571), "la plèbe parle biscaïen ou basque [...], bien qu’à l’évidence les nobles parlent castillan", comme le notait le voyageur Venturino. À une époque beaucoup plus tardive (1802), la situation en Biscaye était décrite de la sorte: "la majorité, à l’exception des gens cultivés, ne parle pas d’autre langue que le basque, sauf dans les Encartaciones et les villes de Portugalete, Balmaseda et Lanestosa où seul le castillan est pratiqué."
|
|
Le licenciado A. de Poza (1587) : Le premier grand ouvrage consacré à la défense de la langue basque est celui que le licenciado Poza publia au XVIème siècle, à Bilbao, avec l’aide du célèbre imprimeur Marés. Originaire d’Urduña, l’auteur semble, à l’évidence, avoir été bien renseigné sur les langues européennes, et avoir partagé les idées de son temps. Ses propos ne se rapportent pas seulement au basque, mais aussi à bien d’autres langues. Récemment, prenant prétexte de la commémoration par l’Académie de la Langue Basque du quatre-centième anniversaire de l’œuvre d’Andrés de Poza, l’éminent linguiste roumain Coseriu a souligné sa grande valeur historique. |
|
|
Le père Mariana (1536-1624) : Le jésuite Juan de Mariana fut l’auteur d’une histoire générale de l’Espagne publiée en latin en 1592, et en castillan en 1621. L’ouvrage bénéficia d’une grande diffusion et devint très rapidement l’un des classiques de l’historiographie espagnole. A l’encontre de ce qui avait été écrit auparavant, Mariana attribuait à l’euskara un territoire considérablement réduit, mais ce fut surtout le fait de qualifier le basque de "langage grossier et barbare" qui offensa les Basques cultivés de l’époque. |
La prédominance du monolinguisme présentait tout de même quelques failles. Dans les centres urbains d’une certaine importance, marchands et fonctionnaires ne pouvaient se dispenser de connaître et de pratiquer le castillan, les uns pour leur commerce avec l’extérieur, les autres parce que c’était la langue officielle de l’administration. Comme corollaire, la scolarisation d’abord timide, puis plus intense au XVIème siècle, dont ces classes sociales seraient précisément les principales bénéficiaires, apparut très vite comme un excellent moyen de diffusion de la langue castillane qui devint, inévitablement, synonyme de réussite socio-professionnelle pour la petite noblesse et la modeste bourgeoisie naissante, sans oublier ceux qui aspiraient à devenir secrétaire et écrivain public, métiers dans lesquels les Basques avaient la réputation d’exceller.
|
|
E. de Garibai: Compendio Historial (1571) : Dans les années où naissait notre littérature, Garibai, un Basque originaire de Mondragón, écrivait sa fameuse histoire générale. Edité à Anvers et antérieur à celui de Mariana, l’ouvrage eut un grand succès en Espagne. L’auteur y donne son opinion sur l’origine de l’euskara et sur la place qui lui revient dans le passé ethnolinguistique de la Péninsule. |
Cependant, l’euskara pouvait jouer un autre rôle social à l’extérieur de ses frontières (c’était l’époque où l’on partait "faire les Amériques"), ne serait-ce qu’en tant que preuve irréfutable de la noblesse et de la pureté de sang des Basques. Les apologies de la langue, écrites en castillan avec des arguments mythiques et passionnés, outre qu’elles exaltaient l’orgueil ethnolinguistique du Pays, étaient censées fournir la justification, pour l’époque, de l’ascension sociale de l’émigrant basque, quelle que fût-ce sa qualification. Elles contribuèrent donc à briser les préjugés qui empêchaient de tirer parti des possibilités offertes par le Siècle d’Or, tant en métropole qu’aux colonies. D’Esteban de Garibai, illustre historien natif de Mondragón (1533-1599), à Baltasar de Etxabe l’"Ancien", peintre du Mexique colonial né à Zumaia (vers 1584- vers 1620), en passant par le licenciado flamand d’Urduña, Andrés de Poza (1595), le plus brillant intellectuellement, tous célébrèrent et défendirent l’euskara dans des ouvrages publiés respectivement à Anvers (1571), Bilbao (1587) et Mexico (1607). Il était certes nécessaire de défendre le basque qui, dans le meilleur des cas, était taxé de "charabia" incompréhensible. Dans son Historia de España, Juan de Mariana (1536-1624) osa employer des termes plus durs encore: "Seuls les Biscaïens ont conservé leur langage grossier et barbare qui n’a aucune élégance" (1601).
|
|
Baltasar Etxabe (1607) : Peintre et écrivain de Zumaia, il publia à Mexico Discursos de la Antigüedad de la Lengua Cántabra, ouvrage consacré à la défense de l’euskara et sous-tendu par le souci —d’ailleurs largement partagé en ce temps-là— d’affirmer la pureté de sang et la noblesse basques. Son intention semblait être de faire l’éloge, à l’étranger, du sentiment d’orgueil des émigrants basques afin de leur assurer, en recourant à une argumentation d’ordre linguistique, une plus grande reconnaissance sociale. Dans le contexte historique de l’époque, il est certain que l’euskara pouvait apparaître comme un des piliers les plus solides de la prétendue noblesse universelle des Basques, thèse que les apologistes ne manquèrent pas d’appuyer. |
Malheureusement, le dévouement des apologistes ne concourait pas à préparer le terrain d’une normalisation de la langue écrite dans les affaires culturelles et sociales. Klaberia (1636) le comprit parfaitement, en opposant la fécondité pragmatique de la plume basque d’un Etxeberri de Ciboure à l’incohérence hispanisante de Garibai et Etxabe. En effet, il était indispensable qu’un écrivain, s’adressant à ses concitoyens, le fît en euskara et non dans une autre langue. Telle était, sans doute, l’opinion des membres de l’école littéraire de Saint-Jean-de-Luz/Sare, à laquelle appartenait Klaberia et à laquelle nous devons la naissance de la première tradition littéraire de notre langue. Mais l’idéal de la culture écrite ne fut pas facile à atteindre.
En particulier, l’école -et l’univers culturel auquel elle donnait accès- ne parvint presque jamais à se mettre au service d’une langue, l’euskara, qui socialement faisait partie du patrimoine commun: habituellement, on apprenait à lire et à écrire et on étudiait en castillan pour pouvoir prospérer. Seule l’éducation religieuse prit en compte, dans une certaine mesure, la vitalité du basque au sein de la société.
La catéchèse des XVIème et XVIIème siècles aurait pu être la meilleure occasion d’alphabétiser les enfants et les jeunes bascophones: des règles furent établies, des catéchismes édités... Tout laissait présager l’émergence d’habitudes, d’écriture et de lecture jusqu’alors inexistantes. "Pourtant, d’après les éléments dont nous disposons, il ne semble pas que cette éducation chrétienne ait été un instrument d’alphabétisation, en basque, des nouvelles générations ni, par conséquent, qu’elle ait été à l’origine de l’École Basque" (M. Zalbide). La raison en est que, au moins jusqu’au XVIIIème siècle, la catéchèse fut dispensée presque exclusivement de façon orale.
|
|
Les exigences de l’euskara écrit : Quand la langue basque parlée accéda enfin au monde de l’écriture, les auteurs comprirent aussitôt que le texte imprimé exigeait de prendre de nouvelles habitudes: l’écrit, en effet, obéissait à des règles propres. Comme nous l’avons signalé plus haut, Leizarraga publia un ABC (sorte d’abécédaire) destiné à lever les premières difficultés de la lecture. L’ouvrage se présente sous la forme d’une annexe, certes assez inattendue dans une traduction de la Bible, mais pas si insolite, somme toute, dans le contexte des réformes religieuses de l’époque. La Doctrina, que l’Alavais Betolatza avait publiée en 1596 à Bilbao, comprenait aussi un syllabaire, et nous retrouvons le même souci didactique chez Mikoleta, de Bilbao, à qui l’on doit un recueil de règles grammaticales (écrit en 1653, il ne sera publié que beaucoup plus tard, en 1880, à Barcelone). Ci-dessus, sont reproduites les couvertures du syllabaire de Betolatza et du Modo breve de Mikoleta. |
|
|
Les vers de Klaberia (1636) (texte) : Les vers de Klaberia (1636) paraissent faire écho à ceux d’Etxepare (les Basques étaient appréciés dans le monde entier, mais tous se moquaient de leur langue...), mais le premier a tiré la leçon du siècle écoulé sur le plan culturel. Il dénonce la vacuité des apologies, rédigées dans une langue étrangère, de Basques oublieux de la fidélité à laquelle chacun est tenu envers sa propre communauté linguistique: Je me moque de Garibai, / et aussi d’Etxabe, / lesquels ont parlé / des Basques en castillan. / Puisqu’ils étaient / basques tous deux / ils auraient dû écrire / leurs histoires en euskara. Ce poème figurait dans Elizara erabiltzeko liburua (1636), d’Etxeberri de Ciboure. Il s’agit d’une critique socio-culturelle, et il est significatif qu’elle soit apparue précisément dans le recueil de l’un des membres de l’école de Saint-Jean-de-Luz/Sare. En effet, nos connaissances nous permettent d’affirmer que les livres, préfaces et écrits issus de cette école reflétaient la façon de penser d’un nouveau courant culturel. |
L’échec de la Réforme et de son projet culturel au Pays Basque, les liens des classes dominantes avec l’extérieur, les apologies socialement utiles mais culturellement stériles, l’insuffisance des efforts de l’Église et des écrivains basques, l’inexistence d’une collaboration des institutions publiques, tout cela fit que l’essor culturel de l’euskara, aux Temps Modernes, ne fut pas aussi puissant que celui du tchèque, du finnois ou du suédois.
|
|
Les pêcheurs, porteurs de la langue : Ce livre, publié en 1610, nous apprend que les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz avaient transmis leur langue à des peuples très lointains. Le célèbre juge en affaires de sorcellerie, Pierre de Lancre (lui-même d’origine basque, puisqu’il s’appelait Pierre Aroztegui), dans son catalogue des peuples et nations, signale que les indigènes de Terre-Neuve et du Canada s’adressaient aux Français en basque, langue qu’ils avaient apprise au cours de premiers contacts avec les Européens. Au cours des années qui suivirent, la littérature basque s’épanouit au sein de la prospère société luzienne du temps de P. de Lancre. (La première édition de ce livre date de 1607; la photo nous présente la couverture de la seconde édition, celle de 1610.) |
La première moitié du XVIIème siècle correspond à la période où une véritable tradition littéraire fait son apparition. La Renaissance et la Réforme, au XVIème siècle, avaient contribué à la naissance de la littérature basque, mais celle-ci ne connut pas le développement souhaité. Sous l’égide de la Réforme catholique, un groupe d’ecclésiastiques amoureux de leur pays et de sa langue allaient se lancer, à partir de 1616, dans un important travail de rédaction et de publication d’ouvrages religieux. La qualité classique de certains d’entre eux assura le succès de l’entreprise qui fut couronnée par l’instauration d’une tradition durable.
|
|
Les Juntes de Biscaye (1613-1633) : Au sein des institutions publiques proches de la population basque, l’usage oral de l’euskara était admis depuis toujours, dans les zones où la langue était vivante socialement. En revanche, cela devenait plus difficile dans les hautes sphères, ou lorsqu’une affaire concernait aussi des étrangers qui ne connaissaient pas la langue. A cet égard, le Pays Basque mit en œuvre des politiques diverses et contradictoires à travers les siècles. Par moments, la discrimination à l’encontre des bascophones unilingues fut manifeste et, en particulier, amena les Juntes de Biscaye, dans les années 1613-1633, à arrêter, expulser et condamner à une amende des représentants populaires qui ignoraient le castillan. |
L’apologie ne fut pas abandonnée, mais les apologistes (Oihenart, 1638; Etxeberri de Sare, 1712) s’appliquèrent également à cultiver les lettres basques. Etxeberri, en particulier, fournit un bel exemple de défense de l’euskara, dans ce que la langue a de meilleur, avec des arguments parfois discutables, mais toujours invoqués dans une magnifique prose didactique. Nous sommes bien loin désormais du simple dithyrambe. Hélas, la clairvoyance intellectuelle d’Etxeberri ne se vit pas récompensée par la publication de son œuvre, car les institutions publiques d’alors ne se faisaient pas encore l’écho des préoccupations de minorités pensantes.
|
|
Les "Fors" de Basse-Navarre (1611) : Ce recueil des Fors (Fueros) de Basse-Navarre (Fors et Costumas) se veut la reconnaissance des différentes langues locales. Les Fors furent rédigés en gascon, mais eu égard à la diversité linguistique du royaume, les autres langues pratiquées par les sujets furent considérées comme tout aussi respectables. L’usage oral de l’euskara reçut ainsi, d’une certaine manière, l’attention des autorités. |
La marginalisation institutionnelle dont avait souffert depuis des siècles la langue basque, et avec elle toute la population unilingue du Pays, fut à son comble à cette époque. À plusieurs reprises, des représentants basques unilingues furent même expulsés des Juntes de Biscaye (1613-1632). Une telle attitude, à la fois servile et intéressée vis-à-vis du corrégidor, qui tendait à écarter les classes populaires de la vie publique, illustre parfaitement la politique linguistique du pouvoir. Malgré tout, les autorités n’adoptèrent pas toujours, ni partout, une attitude aussi intransigeante: un esprit plus ouvert et conciliant a pu être décelé en Basse-Navarre ou dans les textes de l’Église. Au XVIIème siècle, l’événement linguistique le plus important, du point de vue de la production littéraire, fut la formation du groupe d’écrivains de Saint-Jean-de-Luz/Sare, et le fait que des laïcs commencèrent à écrire en euskara. La littérature basque, née au Pays Basque Nord, s’y implanta, mais ce n’est qu’un siècle plus tard que la partie sud-pyrénéenne connut la même effervescence littéraire et put reprendre le flambeau. En ce qui concerne la géographie de la langue, il semble que l’euskara n’ait pas eu à déplorer de grandes pertes territoriales, à l’exception du recul dans la Rioja alavaise.
Tout d’abord, rappelons que la politique linguistique des institutions, appliquée à l’administration, peut varier en fonction des problèmes et des situations. Dans la pratique d’une langue, une première distinction s’impose entre usage oral et usage écrit. Dans l’histoire de l’euskara, cette distinction élémentaire revêt une extrême importance. En effet, la population basque a été unilingue, à une immense majorité, pendant très longtemps. Pour communiquer avec leur propre administration, les Basques ne pouvaient donc faire autrement que d’utiliser la seule langue qu’ils connaissaient. Or, aucun des documents dont nous avons hérité n’est écrit en basque. Dans les deux cas (usage oral et usage écrit), il convient de se demander si, au sein des institutions, la langue bénéficiait d’une reconnaissance légale ou était seulement tolérée pour des considérations pratiques.
|
|
Les Constitutions Synodales (1621, 1700) : Aux Temps Modernes, les diocèses de Calahorra et de Pampelune couvraient presque complètement le Pays Basque Sud. Quand il fallut mettre en pratique le renouveau pastoral consécutif au Concile de Trente (1545-1563) au Pays Basque, où la majorité des habitants parlaient euskara, le besoin se fit sentir de publier du matériel de catéchèse pour le peuple dans la langue vernaculaire. Les Constitutions Synodales de Calahorra (c’est-à-dire les règles de base pour administrer le diocèse) traitèrent de façon assez détaillée le problème de la langue dans l’instruction pastorale. Du point de vue institutionnel, ce fut une des mesures les plus utiles prises en faveur de la langue. |
|
|
Les Ordres religieux (texte) : Aux XVIème et XVIIème siècles, les ordres religieux (franciscains, jésuites ou carmes, par exemple) jouèrent un rôle prééminent dans la prédication et, à l’instar des diocèses, s’interrogèrent sur la langue dans laquelle ils devaient prêcher. C’est pourquoi les Ordres religieux —en particulier, les Ordres Mendiants qui étaient les plus dépendants économiquement de la bienveillance des gens mais, plus généralement, tous les Ordres— durent faire un choix linguistique en accord avec les municipalités ou à la demande des autorités ecclésiastiques. Dans le testament laissé en faveur de la fondation du couvent de San Francisco de Arrasate (= Mondragón, 1579), Araoz demandait que les supérieurs du couvent parlassent basque. De même, dans le cas du couvent des Missionnaires de Zarautz, il était conseillé de donner la préférence à des novices bascophones qui, de ce fait, seraient plus aptes à répondre aux besoins pastoraux (30-X-1747). |
|
|
Le catéchisme et la prédication (normes) : La Réforme catholique, qui fit suite au Concile de Trente, reconnut l’utilité des langues vernaculaires, au moins pour la catéchisation. Une telle décision facilita l’édition de nombreuses doctrines chrétiennes aux XVIème et XVIIème siècles. Par ailleurs, les sermonnaires et la prédication populaire contribuèrent, dans une grande mesure, à améliorer la qualité de la prose basque. Axular et son œuvre Gero (1643), par exemple, s’inscrivent dans cette tradition. La liturgie et la Bible restèrent néanmoins en latin et, pour combler quelque peu le vide ainsi créé, on écrivit des missels, livres de prières et histoires saintes en basque. Bien que d’ordinaire assez ennuyeuse, cette littérature permit à l’euskara de conserver une tradition écrite. |
Au XVIIème siècle, nous trouvons à peu près tous les cas de figures. L’Église, conformément à la pastorale de la Contre-Réforme, admit officiellement l’usage oral et écrit du basque dans certains cas, sans pour autant abandonner le latin et les langues romanes. Parmi les textes ci-joints, nous pouvons remarquer les Constitutions Synodales de Calahorra, l’un des trois diocèses, avec Bayonne et Pampelune, auquel appartenaient les fidèles bascophones. Les institutions publiques du Pays Basque ne suivirent pas de politique uniforme. En Biscaye, la participation aux Juntes Générales était soumise, par règlement, à la connaissance préalable du castillan. Certes, dans la pratique, les Juntes respectèrent assez vaguement cette obligation, sauf à certains moments où le règlement fut appliqué au pied de la lettre. Les mandataires ignorants du castillan étaient alors arrêtés et expulsés: ce fut le cas des représentants de Barakaldo, Berango, Ibarrangelu, Getxo et d’autres villes, en 1624 et 1625 notamment. Mais le corps social résista à ces mesures coercitives, si bien qu’au cours de la révolte populaire de 1631, des voix s’élevèrent pour protester contre l’usage du castillan dans l’enceinte des juntes. Pourtant, le règlement en vigueur fut maintenu avec la menace que cela comportait. La politique menée en Basse-Navarre fut tout autre. La charte constitutionnelle était rédigée en occitan gascon (Los Fors et Costumas, 1611), mais prescrivait aux institutions un égal respect de toutes les langues des citoyens. Il était également demandé aux officiers royaux "sapin lo lengoadge deu Pays". Un règlement ultérieur (1666) exigeait même que les notaires fussent basques et versés dans l’euskara.
Les juntes et cortès du Pays Basque refusèrent à plusieurs reprises leur aide pour des publications en euskara (en Gipuzkoa, et en Basse-Navarre en 1675) et, d’une façon générale, les institutions basques n’assurèrent pas la protection et la défense de la langue, comme la couronne de Castille l’avait fait pour son propre idiome. Heureusement, la vie de la communauté bascophone ne s’arrêtait pas, dans ses rapports avec les institutions, aux seuls organes politiques mentionnés, et le parvis des églises comme les "universités" constituaient un espace de liberté et d’ouverture. Aussi exista-t-il des minorités actives qui elles, valorisèrent leur patrimoine linguistique.
|
«Item digo que es mi voluntad y deseo que el Rector Guardián de dicho Colegio sea en todo tiempo Religioso que sepa hablar y predicar en nuestra lengua Bascongada, porque su doctrina pueda hacer mucho fruto en la villa y su comarca en servicio de Dios y beneficio de los fieles cristianos, naturales de ella: Pido y suplico a los muy Reverendos Religiosos Padres Definidores y Capítulos Provinciales de ella, e inter capítulos, que provean siempre de Rectores Guardianes de este Colegio a Sacerdotes Religiosos de esta nuestra antiquísima lengua Bascongada, la primera de España, pues de las cinco naciones que en Europa la hablan caen cuatro en su provincia de Cantabria que son la Gipuzkoana, vizcaína, Alavesa y Navarra en España, y la quinta de Bascos de Francia, conjunta a España en los vertientes de los montes Pirineos de la parte de Francia, y si no lo pudiesen hacer cómodamente, no les obligo a ello, pero tórnoles a supricar lo mesmo, dexando por mi equidad en sus manos lo que yo tengo en las mías. Juan de Araoz. Arrasate, 1579 |
|
|
Saint-Jean-de-Luz : Cette gravure du XVIIIème siècle nous permet d’avoir une idée de ce qu’était Saint-Jean-de-Luz au siècle précédent. La vocation de port de pêche de la ville ne remontait pas à très longtemps, car il semble que Saint-Jean-de-Luz ne devint un port qu’à une date relativement récente, aux alentours de 1450. La ville n’obtint son autonomie municipale que plus tard, lorsque ses habitants acquirent les droits de propriété de la baronnie en 1570-1632. — Au XVIIème, Saint-Jean-de-Luz connut son siècle d’or. Ce fut la grande époque de la pêche à la baleine et à la morue, des expéditions de corsaires, etc. Profitant des circonstances, les familles luziennes amassèrent de grandes fortunes. De plus, l’ensablement de l’embouchure de l’Adour provoqua le déplacement d’une partie des activités portuaires de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz. Ce développement économique 74vorisa la construction de nouveaux couvents à Saint-Jean-de-Luz même, ainsi que dans la ville voisine de Ciboure, et contribua à retenir, voire à attirer, les ecclésiastiques les plus cultivés. C’est dans ce contexte social très propice que naquit la littérature. Gravure: Ozanne, 1776. |
|
|
Le docteur Etxeberri de Ciboure : Comme il n’existe aucun portrait connu d’Etxeberri de Ciboure (Ziburu), nous présentons ici la couverture de son premier ouvrage Manual Devotionezcoa, Bordeaux, 1627. Joanes d’Etxeberri était docteur en Théologie et jouissait d’une grande autorité parmi les ecclésiastiques de la région de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure/Sare. Ce livre bénéficia de l’approbation du censeur Axular et présente, en introduction, les vers de quelques bascophiles amis de l’auteur. La photo ci-contre reproduit pour la première fois la couverture de l’édition princeps du dit livre. |
Au début du XVIIème siècle, Iparralde -ou Pays Basque Nord- connut une période florissante. La région devait sa prospérité, en grande partie, à l’activité des quelque 30.000 pêcheurs et marins dont environ 5 à 6.000 étaient de Terre-Neuve (Lancre, 1610).
|
|
"Un beau jour, alors que j’étais en bonne compagnie..." : Etxeberri de Ciboure et Axular dédièrent tous deux leurs livres (en 1636 et en 1643) à la même personne, le seigneur Bertrand d’Echaux. Il semble, en effet, que les deux écrivains bénéficiaient de la protection de l’archevêque de Tours. Axular lui adressa une "Lettre de Recommandation" posthume pleine de gratitude et empreinte de la plus sincère cordialité: Mon bien-aimé seigneur, tu as quitté mon pays, mais pas ma mémoire, ni mon cœur. Les écrivains basques de la première moitié du XVIIème siècle (comme Etxepare et Leizarraga, un siècle auparavant) avaient généralement un protecteur ou un mécène, en plus de leurs camarades et collègues de toujours. Axular fut conscient de la valeur de l’entourage qui stimula son travail littéraire comme il le dit dans son avertissement "au lecteur". |
|
|
Pedro de Agerre: "Axular" : De nombreuses librairies et ikastolak (écoles basques), des enfants même, portent son nom. C’est une forme d’hommage culturel que les Basques ont rendu, ces dernières trente années, au grand écrivain navarrais. En ce qui concerne le nom d’"Axular", il provient de la maison de campagne, située à Urdazubi (= Urdax), où naquit l’auteur dont le nom de baptême était Pedro de Agerre. Axular fit comme dans le proverbe "urak nora, gizonak hara" (= où vont les eaux, là partent les hommes) et quitta la Haute-Navarre pour le Labourd où il exerça son sacerdoce. La photo nous montre la maison Axular, aujourd’hui restaurée, qui vit naître l’écrivain à Urdazubi. |
|
|
Gero (1643) : Voici la couverture de l’œuvre magistrale et unique d’Axular. Cet ouvrage, de par sa langue admirable, a été pour beaucoup un véritable manuel d’apprentissage de l’euskara. Jusqu’à maintenant, il a fait l’objet de six éditions, sans compter celle publiée sous forme de feuilleton dans la RIEB: en 1643, 1864, 1954, 1964 et 1976 (nous ignorons la date de la deuxième édition). L’Académie de la Langue Basque a aussi publié une édition fac-similé en 1988. L’œuvre a été traduite et adaptée dans d’autres dialectes: Añibarro se chargea de la version en biscaïen (vers 1820) et Ateaga récrivit certaines parties en Guipuzcoan (vers 1909). Nous devons la première édition d’après-guerre à M. Lekuona, et les deux suivantes, qui comprennent une version en castillan, au père L. Villasante (Salamanque, 1964; Arantzazu, 1976). Gero constitue, à coup sûr, l’œuvre littéraire la plus importante de toutes celles produites par le groupe de Saint-Jean-de-Luz/Sare. |
Dans ce climat de mieux-être dû à l’environnement économique favorable, il fut plus aisé aux érudits, hommes de lettres ou d’Église, de se consacrer à écrire dans leur propre langue. Cela explique l’émergence d’une littérature basque qui, contrairement à celle née sous la plume d’Etxepare et de Leizarraga, s’est perpétuée sans interruption jusqu’à nos jours, en dépit des hauts et des bas. Une véritable tradition littéraire profondément enracinée donc. Un groupe de prêtres et de religieux prit l’habitude de se réunir à Saint-Jean-de-Luz et à Sare. Au cours de ces réunions, ils échangeaient leurs écrits respectifs, chacun participait d’une façon ou d’une autre aux travaux d’un camarade, tous s’aidaient et s’encourageaient mutuellement. Il semble qu’Etxeberri de Ciboure, prêtre de formation universitaire supérieure et intellectuel de haut niveau, ait été le mentor du groupe. Pour sa part, Pedro Axular, formé sur les bancs de l’université de Salamanque, gagna la reconnaissance de tous par ses dons littéraires. Ils personnifièrent ainsi deux formes complémentaires d’un même enseignement.
|
|
Agréments ou complicités? : Les publications de la première moitié du XVIIème siècle font clairement apparaître, dans les avant-propos, autorisations, dédicaces et autres préfaces flatteuses en vers ou en prose, les liens d’amitié qui unissaient auteurs et censeurs. Deux au moins des ouvrages d’Etxeberri de Ciboure furent soumis aux censeurs Axular et Gilentena. Par ailleurs, Axular avait déjà exercé son jugement à propos d’un livre de Materre (1616). En outre, l’un des livres dont Gilentena fut censeur présente, en regard de l’autorisation, des vers élogieux pour l’auteur. Les membres du groupe de Saint-Jean-de-Luz/Sare étaient, sans conteste, des amis intimes. |
|
|
L’unification de la langue : A la rédaction de ses textes, Axular prit immédiatement conscience de la diversité dialectale du basque qui rendait difficile la création d’une prose littéraire commune et accessible à tous: On dit "behatzea" ici, "so egitea" là... L’un va dire "ichilic" et l’autre "igilic"... Par ailleurs, Axular nous rappelle qu’une langue ne peut évoluer si ses locuteurs n’ont pas la tradition et les habitudes culturelles adéquates: Si on avait écrit en basque autant de livres qu’en latin, français ou d’autres langues étrangères, l’euskara serait aussi riche et aussi adapté que ces idiomes. L’auteur en attribue la responsabilité à la société basque: S’il n’en est pas ainsi, c’est de la faute des Basques eux-mêmes, et non de l’euskara. |
Ces hommes ne formaient pas seulement un cercle de bascophiles, mais constituèrent entre eux un véritable groupe de travail littéraire. Il est intéressant de constater comment se manifestaient leurs solidarités réciproques: le premier auteur du groupe, Materre (1617), apprit le basque à Sare, c’est-à-dire aux côtés d’Axular; il est possible qu’Haranburu, collègue de Materre, ait vécu dans la même maison que lui à Ciboure; Harizmendi fut coadjuteur de Sare; par ailleurs, Argaignarats était de Ciboure; le censeur de deux des ouvrages d’Etxeberri de Ciboure n’était autre qu’Axular (1627, 1636); Argaignarats écrivit la préface de l’ouvrage d’Etxeberri (1631) et Harizmendi celle d’Haranburu (1635). Nous voyons donc qu’ils entretenaient d’étroites relations les uns avec les autres, s’épaulaient et collaboraient pour produire leurs œuvres.
|
|
Gero: un livre grand public : Il n’existe aujourd’hui, dans le monde, que dix ou douze exemplaires connus de la première édition de Gero. L’un d’eux se trouve au séminaire Julio de Urquijo de Saint-Sébastien (à la bibliothèque de la Députation de Guipuzcoa). Les exemplaires de la première et deuxième éditions passèrent entre les mains, outre des ecclésiastiques (il s’agissait fondamentalement d’un sermonnaire recomposé), du commun des lecteurs: l’exemplaire présenté ici a appartenu à Marianna Galharraga, maîtresse de maison à Ascain. |
Une fois jetées les bases de la tradition littéraire, des érudits, laïques cette fois, commencèrent également à se manifester pour dissocier l’euskara des seuls thèmes religieux et lui ouvrir des horizons culturels plus vastes. Nous citerons plus particulièrement les noms d’Oihenart et d’Etxeberri de Sare. Tous deux considérèrent le Pays Basque comme un ensemble uni: dans une perspective historique pour le premier; du point de vue de la spécificité évidente de la langue et de sa propre trajectoire transpyrénéenne pour le second.
Les exigences de l’euskara écrit
Arnaud d’Oihenart (1592-1668) et Joanes d’Etxeberri (1668-1749) n’étaient pas des ecclésiastiques. Pour la première fois dans la société basque, deux laïcs tentèrent d’adopter une nouvelle attitude en s’attelant à la tâche d’ennoblir la langue par le biais de la littérature.
|
|
Arnaud d’Oihenart (1638) : Dans son ouvrage historiographique, publié en latin, Notitia Utriusque Vasconiae, tum ibericae, tum aquitanicae (Paris, 1638), l’écrivain basque Oihenart insiste sur l’unité du Pays Basque et le rôle historique de la Navarre. Il apporte également quelques nuances aux thèses basco-ibéristes, alors très en vogue, relatives à la préhistoire de l’euskara. En tant qu’historien, Oihenart peut être classé parmi les meilleurs de son époque. A ce propos, ses travaux, qui représentent un énorme volume documentaire, attendent toujours qu’un chercheur vienne se pencher sur eux à la Bibliothèque Nationale de Paris (Section des Manuscrits, Collection Duchesne). |
La personnalité d’Oihenart mérite d’être mise en lumière en raison de l’exceptionnelle qualité de son œuvre, mais surtout en raison de la liberté et du sens critique dont il fit preuve pour aborder le passé et le présent de son pays. À son sujet, E. Goyheneche a écrit qu’"il doit être considéré comme l’un des personnages les plus remarquables de l’histoire basque". Dans le contexte de la Monarchie française et loin d’être sans intérêts de classe sociale, Oihenart participa activement à la vie politique et institutionnelle de Navarre et, malgré l’opposition du clergé et de la noblesse, parvint à se faire élire par le Silviet - assemblée populaire souletine- syndic de la Soule (1623-1627). Il s’allia, par son mariage, à la noblesse de Navarre et de Soule, prit part aux états généraux du royaume et fut avocat au Parlement sans négliger pour autant, dans les moments difficiles, de prendre la défense des institutions populaires souletines.
Il semble qu’il consacra les vingt dernières années de sa vie à des recherches historiques, ce qui ne manqua pas d’éveiller les soupçons de certaines des institutions concernées (l’accès de la cour des comptes de Pampelune, par exemple, lui fut refusé). Cependant, après un fastidieux travail de copie, Oihenart finit par constituer un immense fonds documentaire, son activité d’archiviste ayant permis, dans certains cas, de conserver des documents dont l’original a disparu. Dans son approche du passé basque, il envisagea le Pays comme une entité historique unique, sans faire la distinction entre nord et sud. Par son sens éminemment critique des idées reçues et sa vision d’ensemble, Oihenart donna à son œuvre un retentissement qui se répéta, longtemps après lui, dans toute l’historiographie. Dans les deux ouvrages qu’il nous a légués -Atsotitzak (= Proverbes) et Gaztaroa neurtitzetan (= Poème de ma jeunesse) publiés conjointement en 1657-, transparaissent son amour de l’euskara et sa volonté de l’enrichir. C’était la première fois au Pays Basque qu’un personnage politique important, noble et laïque de surcroît, prenait la plume pour écrire un ouvrage littéraire en basque. Plus tard, en 1665, Oihenart compléta cet exercice pratique par un traité de poésie basque (Art Poétique Basque) qui traduit l’intérêt qu’il portait à l’avenir littéraire de la langue. Dans le domaine de la poésie, autant que dans celui de l’historiographie, il apparaît donc comme un pionnier. Tout poète qu’il était, Oihenart n’en fut pas moins un observateur attentif de l’histoire des langues, qui saisit parfaitement la dimension socio-politique de tout idiome. Le second, Etxeberri de Sare, fait figure de symbole. Né au Pays Basque Nord, il passa la moitié de sa vie dans la Péninsule (à Vera, Fontarabie et Azkoitia: 1716-1749). Bien que médecin de profession, il se passionna pour l’euskara et la personnalité d’Axular. Mieux que quiconque jusqu’alors, il sut utiliser le basque à des fins didactiques et pour aborder des thèmes profanes. Malheureusement, les œuvres d’Etxeberri durent attendre 1907 pour être publiées. Dans la lignée des connaissances de l’époque, mais sur un ton amical, chaleureux et réaliste, il mit en évidence l’unité de l’euskara et le ferment de modernité qu’il contenait. Les clichés sur les Tyriens et Troyens mis à part, il était convaincu que la langue basque offrait des possibilités encore inexploitées, et il le démontra par sa propre praxis de l’écriture. Pour utiliser ses propres termes: "[l’euskara] atteint et dépasse les plus hauts sommets auxquels l’intellect humain puisse accéder". Oihenart comme Etxeberri eurent une vision culturelle de la langue, l’observant en profondeur sous l’angle de l’universalité de toute culture et des échanges interculturels. En effet, Euskal Herria n’était pas isolée: elle était parcourue d’idées et d’hommes qui ne cachaient pas leur étonnement en découvrant leur langue, l’euskara.
|
|
Revendication posthume (1907) : L’œuvre littéraire d’Etxeberri de Sare qui trouva un écho auprès des intellectuels du Pays ne fut publiée que deux siècles plus tard, après avoir été égarée pendant plusieurs décennies. En 1907 ses revendications rencontrèrent un climat plus favorable dans la Renaissance Basque (1876-1936.) |
Joanes d’Etxeberri, dit "de Sare" pour le distinguer de son homonyme "de Ciboure (Ziburu)", est l’un des prosateurs basques les plus intéressants des XVIIème et XVIIIème siècles. Comme son nom l’indique, il était originaire de Sare où il naquit l’année même de la mort d’Oihenart. Dans sa considérable œuvre en prose, l’écrivain accorda la plus grande attention au problème de la langue. Le docteur Etxeberri se pencha sur l’idiome basque avec une double préoccupation: d’une part, il réfléchit aux raisons qui devaient justifier la fidélité à un patrimoine linguistique spécifique, une attitude qu’il défendit ardemment, tout en analysant les ressources propres à l’euskara; d’autre part, il contribua à faire du basque une langue d’enseignement à usage pratique. Dans ce sens, et dans la lignée de ce qui se faisait couramment depuis la Renaissance pour les langues populaires, il écrivit en euskara une grammaire pour apprendre le latin, prouvant de la sorte que la langue basque était apte à remplir cette nouvelle fonction culturelle. Chez Etxeberri de Sare, notre intérêt s’est porté plus particulièrement sur la conscience qu’il avait de la langue et les théories qu’il a développées à ce sujet. Bien sûr, il emprunta nombre de concepts et d’idées à ses prédécesseurs, mais il fut le premier à les formuler en euskara et sut y apporter, lorsqu’il l’estima nécessaire, critiques, corrections et améliorations. Etxeberri est, sans conteste, un écrivain qui a ses propres critères. Sa langue et son style sont didactiques, mais dignes, élevés et vivants.
|
|
Arguments en faveur de la langue : Epris de sa propre langue, l’euskara, Etxeberri de Sare (1668-1749) se proposa en outre de systématiser, en basque, les arguments théoriques qui accréditaient un tel attachement. Au lieu de s’évertuer à démontrer aux étrangers les qualités de sa langue, il préféra s’adresser aux locuteurs basques mêmes, pour porter à leur connaissance et leur expliquer les motifs qu’ils avaient d’être fiers d’un idiome à la fois plus culte et plus adapté. Hélas, les idées d’Etxeberri de Sare, qui désirait offrir le fruit de ses réflexions à la société basque, rencontrèrent de sérieuses difficultés de diffusion puisqu’elles restèrent sous forme manuscrite pendant presque deux siècles (1712-1905). Cependant, bon nombre d’intellectuels basques connaissaient l’existence de l’œuvre et la pensée d’Etxeberri, y compris avant la publication de son ouvrage en 1907. |
Comme l’indiquent les titres de chapitres de son livre, Etxeberri mit le doigt sur toutes les questions qui soulevaient des polémiques dans les discussions de l’époque: "L’origine de l’euskara", "De l’existence de l’euskara", "Qu’est-ce que l’euskara", "Signification du nom", "Les noms donnés au basque et au Pays Basque dans d’autres langues sont tout aussi mystérieux", etc. Tandis qu’il exalte les qualités de la langue basque, il émaille son propos de commentaires de cette teneur, exemples à l’appui: L’euskara est ancien, l’euskara est subtil, l’euskara est pur, l’euskara n’a pas subi de changements, l’euskara est noble, l’euskara ne descend d’aucune autre langue, l’euskara est fondamentalement un. Tout cela semble relever d’apologies déjà anciennes mais, chez Etxeberri, ce n’est que le point de départ qui fait présager un avenir meilleur pour l’euskara. Préoccupé par les aspects grammaticaux de la langue et l’inexistence, en basque, de modèle standard, Etxeberri souhaitait ardemment l’instauration d’un modèle littéraire classique bien défini. Pour y parvenir, il apporta sa contribution dans son livre: après avoir rappelé les caractéristiques spécifiques de la grammaire basque, les différents dialectes et l’unité fondamentale de l’euskara, il fait un long éloge d’Axular, désignant ainsi celui qui, à son avis, devait être considéré comme le maître des lettres basques. Mais, il ne néglige pas pour autant les racines populaires de la langue dont la souche la plus pure est, selon lui, le dialecte de Sare, un choix qu’il estimait justifié par l’œuvre de cet auteur, curé de sa ville natale.
Etxeberri place ses espérances futures dans une jeunesse basque plus cultivée. Des jeunes, il attend qu’ils fassent preuve d’une scrupuleuse fidélité linguistique, et de leur formation humaniste qu’elle produise une langue extrêmement soignée. Toute sa conviction euskariste, il l’exprima de façon lapidaire en disant simplement: "Eskualdun Eskuararen arbuiatzaileak, berak dira arbuiagarriak" (= seuls sont méprisables les Basques qui méprisent leur langue).
A la différence des deux siècles précédents, le XVIIIème siècle allait permettre à la littérature basque de s’épanouir au sud des Pyrénées. L’événement ne se produisit pas de manière fortuite, mais doit être replacé dans le contexte d’essor socio-économique de l’époque. Ce fut le produit d’une société aux structures bien assises et avide d’entreprendre dans le domaine économique et culturel même si, rappelons-le, les signes avant-coureurs de la crise à venir étaient déjà perceptibles. A un moment où les porte-parole culturels d’Iparralde s’éteignaient l’un après l’autre, le Pays Basque Sud reprit le flambeau de la littérature en la personne de Larramendi. Dans un premier temps, il fallut effectuer un grand travail d’ordre technique consistant à mettre au point les instruments de la langue écrite, à en perfectionner l’apprentissage et à fournir aux écrivains des outils d’un usage pratique: la Gramática (1729), le Diccionario (1745) et la Retórica (1761). Reconnaissons que tout cela supposa d’étonnantes facultés de clairvoyance et de prévision. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’époque s’y prêtant, tous ces instruments allaient trouver leur utilisation sous la plume de nombreux écrivains basques. De fait, la production littéraire basque augmenta notoirement à partir de 1760: les livres, de par leur contenu et leur fréquence de réédition, prirent une importance inconnue jusqu’alors. En somme, la production écrite s’éleva à un nouveau rang.
Pourtant, les institutions publiques basques ne témoignèrent pas à l’euskara l’intérêt modéré qu’elles allaient lui porter un siècle plus tard. La catégorie sociale la plus sensible à ces valeurs culturelles fut le clergé et, plus précisément, les jésuites. Même les Basques éclairés n’y consacreront pas autant d’attention et d’énergie. Si la défense théorique de la langue s’apparente de façon plus claire à la revendication politique (Larramendi), elle ne se manifeste pas aussi nettement qu’au siècle suivant. Dans un autre registre, il faut noter qu’au sud des Pyrénées, l’aire bascophone reste globalement inchangée, à quelques exceptions près.
|
|
El Imposible vencido (1729). Diccionario Trilingüe (1745) : Larramendi eut pour préoccupation constante de s’exprimer, par écrit comme en public, en veillant à la qualité de la langue qu’il utilisait, donc en évitant tout barbarisme. Pour cela, il était nécessaire de connaître les normes qui régissaient l’euskara tel qu’il était parlé par ses locuteurs et, pour pouvoir les apprendre et les utiliser correctement, il devenait indispensable de les recueillir de façon systématique. Les discussions enflammées incitèrent certainement Larramendi à prouver aux détracteurs du basque qu’il était possible de normaliser l’euskara. Mais, en même temps, il ressentit aussi le besoin d’intégrer ce travail dans un projet culturel organique. La publication de ses deux œuvres majeures, la Grammaire et le Dictionnaire, s’inscrit assurément dans cette perspective. |
Au sud des Pyrénées, la littérature naquit sous l’égide d’un guide exceptionnel. Devant l’imminence de la crise institutionnelle qui se profilait à l’horizon et les accusations dont l’euskara faisait l’objet de la part des étrangers, Manuel de Larramendi sut faire naître chez les Basques de nouvelles lueurs d’espoir, de nouvelles passions et de nouvelles convictions intellectuelles dans l’intérêt de la langue. Encouragés par l’ardeur et l’assurance des propos de Larramendi, ses épigones allaient œuvrer avec la même fougue.
Avec sa Gramática (1729) et son Diccionario (1745), la langue disposait désormais d’une norme. Cela donna au fait d’écrire en euskara une dimension résolument nouvelle, et même idéologique, ainsi qu’un autre sens, celui de la fidélité à un peuple dont un aspect fondamental de la culture avait été négligé jusque là. Bien que les idées archaïques des apologistes ne fussent pas complètement écartées, les écrivains récemment apparus donnèrent corps à des pensées et des pratiques linguistiques d’un style nouveau, du moins au Pays Basque Sud: Kardaberaz, Mendiburu, Barrutia, Ubillos, Munibe... Bref, une nouvelle tradition écrite commençait pour l’euskara. Si la communauté bascophone, dans ses limites traditionnelles, resta unilingue, malheureusement, sur la frontière alavaise -où elle avait déjà abandonné les rives de l’Ebre dès le XVIème siècle-, un mouvement accéléré de recul territorial s’amorça. Le même phénomène, quoique de moindre ampleur, se produisit des décennies plus tard au sud de la Navarre. Rappelons également que, malgré les débuts prometteurs du mouvement lancé par Larramendi, l’euskara, dans sa vie sociale, allait rencontrer nombre d’obstacles officiels résultant d’une politique générale de la couronne. La censure institutionnelle prit corps sous la forme de mesures qui eurent une influence néfaste sur le cours des événements dans l’édition: Kardaberaz et Mogel durent affronter ces difficultés et le comte d’Aranda, en tant que ministre, ne manqua pas de donner son avis sur le sujet. Par ailleurs, une nouvelle circonstance politique, l’expulsion des jésuites (1767), mit en danger la continuité de l’école de Larramendi. Allait-il lui arriver pareil sort qu’à l’œuvre étouffée de Leizarraga? Dans ce contexte, et en dépit de toutes les insuffisances, le XVIIIème siècle marqua une nouvelle étape du développement de l’euskara écrit qui lui permit de progresser encore.
Principales œuvres de Larramendi
Manuel de Larramendi (1690-1766)
Manuel de Garagorri y Larramendi naquit à Andoain (Gipuzkoa) et entra dans la Compagnie de Jésus en 1707 à Loyola (Loiola). Professeur à l’université de Salamanque, il y publia ses deux premiers ouvrages relatifs à la langue basque. Il fut également confesseur de la Reine veuve, Marie-Anne de Neubourg, mais quitta vite la cour pour regagner le sanctuaire de saint Ignace (1733) où il demeurera jusqu’à sa mort. Les deux étoiles que son cœur ne laissa jamais s’éteindre, et qui illuminèrent et guidèrent sa vie furent l’euskara et les institutions de son cher Pays Basque. D’entrée de jeu, les ouvrages de Larramendi nous réservent une surprise: leur date de publication. En effet, ses travaux ont été édités à des époques très diverses, certains du vivant de l’auteur, d’autres longtemps après sa mort, voire très récemment. Le hasard n’y fut pour rien, car seuls ses écrits à caractère plus politique ont été frappés d’ostracisme et sont tombés dans l’oubli muet des archives.
|
|
Le père Manuel de Larramendi : Si nous devions définir en quelques mots la personnalité du père Larramendi (1690-1766), jésuite d’Andoain, nous pourrions dire qu’il fut un amoureux inconditionnel d’Euskal Herria, un bascophile infatigable, un polémiste habile, un politicien perspicace, un animateur déterminé, un travailleur consciencieux, un homme très doué intellectuellement et doté de la faculté d’anticiper sur l’avenir qu’il contribua lui-même à forger... Rares sont ceux qui ont laissé une trace aussi durable que la sienne sur la culture basque, au point qu’aujourd’hui encore, ses manuscrits si longtemps oubliés suscitent, à leur publication, de nombreuses réflexions. |
|
Principales œuvres de Larramendi 1728 De la Antigüedad y universalidad del bascuenze. Salamanque. ---------------- 1729 El imposible Vencido. Arte de la Lengua Bascongada. Salamanque. ---------------- 1736 Discurso histórico sobre la antigua famosa Cantabria. Madrid. ---------------- (1882) Corografía o descripción general de la Provincia de Guipúzcoa. Barcelone. ---------------- (1973) Autobiografía. Saint Sébastien. ---------------- (1983) Sobre los Fueros de Guipúzcoa. Saint Sébastien. |
|
|
L’euskara dans les manifestations sociales : Contrairement au théâtre populaire euskarien, le théâtre classique n’a pas de racines très anciennes au Pays Basque. Par ailleurs, même si l’euskara était présent dans les grandes manifestations, il y joua un tout petit rôle au cours des siècles qui nous intéressent. Cependant, à partir du XVIIIème siècle, nous pouvons déceler, dans les deux cas, une plus grande considération pour la langue. Les photos évoquent deux manifestations, plus ou moins anecdotiques, mais représentatives d’une forme de reconnaissance sociale: Villancicos (Bilbao, 1755) et El Acto para la Noche Buena, de Barrutia (1682-1759). |
Larramendi était certes très porté sur la polémique, mais ne pouvons pas dire qu’il ne faisait que céder aux caprices de son tempérament. Il lutta plutôt pour apporter une réponse à des questions importantes qui concernaient l’organisation politique du Pays dont les tensions étaient déjà manifestes de son vivant. En réalité, sa clairvoyance lui permit plus d’une fois d’anticiper sur des processus et des événements aux conséquences très graves pour l’avenir. Dans son œuvre, il prend personnellement la parole en tant qu’écrivain aux convictions solidement enracinées et, par le biais de fictions littéraires, il essaie de suggérer, le plus prudemment possible, de nouvelles réflexions et solutions politiques et culturelles. De tous ses écrits achevés en faveur de l’euskara, il faut dire qu’il nous a laissé des ouvrages d’inégale valeur et de styles divers. Mais, en tout cas, rien de tout ce que dit ou fit Larramendi ne laissa ses contemporains indifférents, et son influence fut grande tant sur sa génération que sur les suivantes. Pour défendre la langue basque, il utilisa nombre d’idées et d’opinions déjà dépassées pour l’époque, usant à l’occasion des artifices élémentaires du polémiste expérimenté contre des adversaires de renom, mais ignorants de l’euskara, idiome qu’ils étaient supposés attaquer ou mépriser.
Néanmoins, nous devons savoir gré à Larramendi de deux choses éminemment importantes: d’abord, d’avoir ennobli le basque en le dotant d’une norme, ensuite d’avoir fait naître chez beaucoup -contemporains ou non- la volonté d’apporter un soutien à l’euskara, langue qu’il aima par dessus tout. Dans l’histoire de l’idiome basque, le père Larramendi figure comme l’intellectuel qui insuffla à sa génération, comme personne jusqu’alors, un sentiment d’orgueil et d’estime à l’égard de la langue.
|
|
Les ecclésiastiques et la culture de l’euskara : Les pionniers de la création littéraire du XVIIIème siècle furent des jésuites (Kardaberaz, Mendiburu). Bientôt, d’autres religieux et ecclésiastiques les rejoignirent: des franciscains (Ubillos, Añibarro, P. Astarloa, Zabala...), des carmes (Fray Bartolomé) et des prêtres séculiers (Mogel, Aguirre, Gerriko, Lizarraga). Hélas, faute d’un statut officiellement reconnu à la langue basque par la société civile, le monde laïque resta en marge du mouvement, malgré quelques initiatives sporadiques qui ne firent pas long feu (La Bascongada, Vicenta Mogel, Ulibarri, etc.). Sur le photo, nous pouvons voir: La Retórica Vasca de Kardaberaz. |
Parmi toutes les langues utilisées par l’homme, y compris les langues actuelles, seules certaines ont obtenu le statut de langues écrites. Et toutes celles qui, à un moment donné, y sont parvenues, ne l’ont pas fait dans les mêmes conditions culturelles et socio-politiques. Toute langue commence par vivre, essentiellement, sur les lèvres de ses locuteurs, pour accéder ensuite à des fonctions sociales très diverses, tant dans la vie privée que dans la vie publique, comme moyen de communication orale et écrite entre les citoyens. Ainsi, le fait qu’une langue passe dans le domaine de la culture scolaire facilite le développement de l’écriture et, par conséquent, des "belles lettres", c’est-à-dire de la littérature. Mais, dans la plupart des cas, le développement littéraire d’une langue ne se produit pas de façon subite: les formes écrites s’affinent progressivement et, en outre, les différents genres littéraires ne subissent pas tous la même évolution.
|
|
Les ecclésiastiques et la culture de l’euskara : Les pionniers de la création littéraire du XVIIIème siècle furent des jésuites (Kardaberaz, Mendiburu). Bientôt, d’autres religieux et ecclésiastiques les rejoignirent: des franciscains (Ubillos, Añibarro, P. Astarloa, Zabala...), des carmes (Fray Bartolomé) et des prêtres séculiers (Mogel, Aguirre, Gerriko, Lizarraga). Hélas, faute d’un statut officiellement reconnu à la langue basque par la société civile, le monde laïque resta en marge du mouvement, malgré quelques initiatives sporadiques qui ne firent pas long feu (La Bascongada, Vicenta Mogel, Ulibarri, etc.). Sur le photo, nous pouvons voir: le monument à Mendiburu à Oiartzun. |
Il est convenu de faire naître la littérature basque au XVIème siècle. Comme nous l’avons vu, Etxepare, l’auteur du premier livre basque (1545), faisait clairement état de l’importance qu’il accordait à l’étape littéraire dans le développement culturel de la langue. Cette opera prima est, d’ailleurs, une œuvre totalement littéraire qui mérite tout à fait de figurer dans le cadre des belles lettres. Au cours des siècles suivants, il devient moins évident de déceler l’existence de valeurs littéraires dans les publications en basque. Cela dépend du thème choisi par l’auteur et de l’objectif qu’il s’est fixé ainsi que, naturellement, de ses dons et de son inspiration d’écrivain. Les fidèles de Larramendi ont toujours insisté sur la nécessité d’une langue basque écrite. Par ailleurs, la société gravitant autour de Loiola dut aussi alimenter ce désir. En effet, il ne faut pas oublier que le médecin de famille d’Azkoitia, village limitrophe du Sanctuaire où vivaient Larramendi et Kardaberaz, n’était autre qu’Etxeberri de Sare, et que les "Caballeritos de Azkoitia", créateurs du théâtre basque, devaient avoir leur siège dans la même localité de la vallée de l’Urola. Fidèles aux convictions de Larramendi et assumant les conséquences pratiques de ses idées, des écrivains (qui formaient un groupe d’une importance numérique inédite au sud des Pyrénées) produisirent un volume considérable d’écrits au cours des quatre-vingts années qui suivirent (1760-1840). Cet acharnement permit aux différents dialectes de trouver une place bien à eux, certains parvenant même à donner corps à une tradition littéraire, à caractère dialectal, relativement cohérente. Ce fut une réussite, sans doute, qui répondait de façon satisfaisante aux besoins de l’époque, mais comportait deux lacunes: en premier lieu, un oubli patent de la tradition héritée de l’école de Saint-Jean-de-Luz/Sare et, en second lieu, un refus de créer une norme littéraire commune au-dessus des dialectes, projet dont la réalisation incombera aux générations futures.

Fondamentalement, il est permis de dire que, avec la tradition instaurée par le groupe de Saint-Jean-de-Luz/Sare et l’impulsion donnée à l’écriture par les partisans de Larramendi, la voie de la création littéraire était définitivement ouverte pour l’euskara, dans la mesure où la langue, dès lors, n’était plus du tout étrangère au monde des lettres.
Parvenus à ce point, il peut être utile de se remémorer, d’une part, les textes déjà commentés de B. Etxepare dans lesquels le poète exprime ses motivations linguistiques et, d’autre part, ce que nous avons vu chez Etxeberri de Sare. Dans la lignée de l’école de Larramendi, mais avec une tournure d’esprit originale, Kardaberaz est celui qui expose de la façon la plus novatrice les raisons pour lesquelles il est impératif d’œuvrer en faveur de l’euskara. Les raisonnements sur lesquels Kardaberaz se base et sa caractérisation du défenseur responsable de la langue basque, nous amènent à nous intéresser d’un peu plus près à cet auteur. La personnalité de ce jésuite d’Hernani était diamétralement opposée à celle de Larramendi: contrairement au fougueux polémiste, il publia en basque une œuvre considérable et ses contemporains le vénéraient comme un véritable saint. De plus, il n’hésitait pas à justifier ses revendications en faveur de la communauté bascophone. S’il suivit le chemin tracé par Larramendi, reconnaissant par là le mérite de celui-ci, il prit ses distances par rapport au maître à qui il reprochait, notamment, d’avoir trop peu écrit en euskara.
|
|
L’idéologie des ecclésiastiques au sujet de la langue : Conformément à une loi sociale bien connue, la littérature d’Hegoalde —ou Pays Basque Sud— fut personnifiée, à ses débuts, par des ecclésiastiques qui, ressentant le besoin d’établir les bases théoriques sur lesquelles fonder leur étude de la langue, eurent recours aux concepts de la théologie. De par leur condition de croyants, ils envisagèrent leur production littéraire en euskara du point de vue théologique, ou sous l’angle de leur foi et de leur fidélité à l’Eglise. Cette façon d’aborder le problème, outre l’avantage qu’elle présentait sur le plan individuel, allait leur permettre de s’assurer la protection institutionnelle qu’une telle rénovation culturelle exigeait. Au même moment, Kardaberaz s’efforça de mettre en évidence les valeurs intrinsèques du basque et les méthodes pour le perfectionner. A défaut d’une philosophie laïque moderne, toutes ces idées vont avoir cours jusqu’à nos jours, même si l’Eglise a pu prendre aussi d’autres positions dans ce domaine. |
Le père Agustín Kardaberaz (1703-1773) écrivit de nombreux ouvrages en basque, parmi lesquels un petit traité de rhétorique: Euskeraren berri onak (Pampelune, 1761). En raison de l’ascendant que son auteur exerçait sur les ecclésiastiques -et, par contrecoup, du prestige dont ces derniers jouissaient aux yeux de la société-, ce petit livre, très succinct, eut un retentissement historique qui dépassa largement tout ce qu’on pouvait attendre d’un ouvrage aussi bref.
|
|
Les centres culturels : Le XVIIIème siècle apporta au monde basque deux choses de valeur et de portée comparables: d’une part, l’intérêt en faveur de l’euskara, dont étaient animés les religieux du Pays Basque Sud et, d’autre part, l’irruption dans les lettres basques de certains laïcs (Munibe, Barrutia...). Les trois photographies présentées ici —Loiola, la bibliothèque franciscaine de Zarautz et le séminaire de Bergara— doivent nous rappeler l’œuvre culturelle accomplie par ces prêtres et par les Caballeritos de Azkoitia. C’est à Loiola que naquit l’intérêt pour la langue basque et que vécurent ses défenseurs les plus vigilants (Larramendi, Kardaberaz et, à leur côté, le cénacle "éclairé" d’Azkoitia). Après l’expulsion des jésuites, le couvent des Missionnaires de Zarautz, fondé en 1746, prit la relève et gagna en importance (Añibarro, P. Astarloa, Zabala, Uriarte...). D’ailleurs, c’est dans la bibliothèque de ce couvent franciscain que furent retrouvés les manuscrits —oubliés ou considérés comme perdus jusqu’en 1905— d’Etxeberri de Sare et celui de Peru Abarka de Mogel. Sans l’existence de ces centres culturels, l’éclosion littéraire au sud des Pyrénées aurait été impossible.
Les partisans de Larramendi trouvèrent de la sorte l’exacte formulation idéologique de leurs préoccupations. En effet, cet essai se révéla être le discours théorico-religieux indispensable au nouveau courant culturel qui y puisa sa cohérence - idéologique et sociale- et dont l’influence aurait pu être décisive si, en 1767, Charles III n’avait pas expulsé la Compagnie de Jésus. |
Kardaberaz envisagea la défense de la langue d’un point de vue théologique et pastoral, appliquant les thèses basquisantes à son propre travail et aux tâches quotidiennes d’une institution culturellement aussi importante que l’Église. Au cours des deux siècles qui ont suivi et jusqu’à il y a peu de temps, ce raisonnement théologicolinguistique a constitué le fondement théorique le plus communément admis, quoique pas toujours le plus solide, de l’euskarisme des ecclésiastiques. Kardaberaz mourut en exil, en Italie, dans un petit village près de Bologne. Des quatorze ouvrages qu’il écrivit, cinq furent publiés après sa mort. La vie de saint Ignace (1766), interdite par le comte d’Aranda, ne parut au grand jour qu’en 1901.
|
|
Pour l’école basque (1761) : Kardaberaz dénonça clairement la répression linguistique imposée dans les écoles d’Euskal Herria: Il n’existe au monde aucune langue plus infortunée que le basque, écrivait le jésuite d’Hernani. Par ces mots, qui constituent un plaidoyer en faveur d’un nouveau modèle d’enseignement, Kardaberaz insiste particulièrement sur la nécessité de réformer le modèle même de l’école. Le besoin d’un enseignement en langue basque, formulé dès les XVIème et XVIIème siècles, se fait sentir de manière encore plus pressante dans le Pays Basque Sud du XVIIIème siècle, et restera inscrit comme une revendication permanente au cours des siècles suivants. Ci-dessus, quelques pages de l’œuvre de Kardaberaz Euskeraren berri onak. |
Plus haut, nous avons dit quelques mots de la langue ou des langues utilisées dans nos écoles. De fait, la scolarisation des Basques fut l’une des inquiétudes majeures de nos premiers hommes de lettres: nous avons déjà mentionné l’intérêt que Leizarraga manifesta dans son œuvre pour l’alphabétisation du peuple basque (ABC edo Christinoen Instructionea, 1571). Aussi n’est-il pas surprenant que Kardaberaz, au moment de mettre entre les mains des croyants le message de la religion chrétienne, rappelle à son tour, faisant allusion à l’instruction primaire, les mauvais traitements réservés à l’euskara dans les classes du Pays Basque.
A propos des méthodes d’enseignement qui bafouaient les droits linguistiques de l’enfant, Kardaberaz n’hésita pas à dénoncer expressément la situation en vigueur: "Il n’existe au monde aucune langue plus infortunée que le basque, cet idiome qu’on veut faire disparaître de la société, en l’interdisant dans les écoles où celui qui le parle est marqué d’un signe distinctif ou puni du fouet, comme si le basque n’était pas notre langue maternelle et originale, comme si s’exprimer en basque était le plus grand des péchés. Y a-t-il plus grande folie que celle-là?" Kardaberaz reprend à son compte la question posée par un capitaine alavais, un de ses amis, en soulignant ses propres idées: "Comment est-il possible, dans les villages basques, de bien éduquer les enfants et de leur dispenser un enseignement religieux approprié, alors que tous les efforts sont faits pour enfoncer l’euskara et qu’on interdit à nos enfants de parler basque en les menaçant du fouet?" Le jésuite d’Hernani applaudit au comportement d’"un grand maître" (certainement Etxeberri de Sare) en raison, précisément, de sa conception radicalement différente de l’école: "Il traitait aussi en basque les questions relatives au latin. Et aux Basques français, il enseignait et expliquait les règles de grammaire en euskara. C’est pourquoi l’euskara ne doit pas être négligé, ni à l’école, ni en grammaire". Cette revendication -non seulement d’un enseignement de l’euskara à l’école, mais aussi de l’utilité et de la légitimité d’une pédagogie en euskara- allait ouvrir la voie à l’école basque du futur.
Le réformisme du Siècle des Lumières européen trouva, parmi les adeptes qu’il fit dans la Péninsule, ses plus actifs défenseurs chez les dénommés "Caballeritos de Azkoitia". En outre, la "Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País" (1764) parrainée officiellement par la couronne se révéla, à maints égards, être le modèle le plus fécond d’association.
|
|
Une langue d’érudits : A l’instar de ce qui s’était produit au nord des Pyrénées au XVIIème siècle (Etxeberri de Ciboure, Axular), les universitaires contribuèrent à l’épanouissement littéraire du Pays Basque Sud au XVIIIème siècle. Parmi eux, citons Juan A. Ubillos, originaire d’Amasa (1707-1789). Il fit ses études à l’université d’Alcalá, puis dispensa à travers le Pays (Tolosa, Arantzazu) les enseignements qu’il avait reçus. Il publia à l’adresse des étudiants un manuel de philosophie en trois tomes (Saint-Sébastien, 1755 et 1758; Vitoria, 1762) et dédicaça le dernier à Munibe, comte de Peñaflorida. Après l’expulsion de la Compagnie de Jésus, Ubillos fit partie de ceux qui tentèrent de remédier à la situation en comblant, d’une manière ou d’une autre, le vide ainsi créé. Kristau dotrin berri-ekarlea, son ouvrage très sommaire à caractère populaire, fut publié à Tolosa en 1785. |
Leurs desseins s’articulèrent principalement autour de deux objectifs clairs: d’une part, se tenir au courant des derniers progrès et des techniques les plus récentes dans l’Europe des Lumières; d’autre part, développer, sur le plan institutionnel, des activités susceptibles de permettre la mise en pratique de ces techniques nouvelles dans le contexte culturel et socioéconomique du Pays Basque. À cet effet, la Sociedad Bascongada noua des relations d’amitié avec les milieux encyclopédistes français et, plus généralement, tous les cercles éclairés d’Europe. Elle accorda des bourses à quelques jeunes privilégiés qui découvrirent ainsi divers pays, depuis la
France jusqu’au Danemark et à la Suède, au cours de longs voyages et séjours d’études; et créa le séminaire royal de Bergara. Même si la Sociedad Bascongada, en tant que telle, ne consacra pas au problème linguistique autant d’attention et d’énergie que l’école de Larramendi, il ne faut pas oublier que, dans ce domaine, elle prit des initiatives originales. Jusqu’en 1776 au moins, il exista au sein de la Sociedad un secteur euskariste lucide et actif concentré à Azpeitia- Azkoitia-Bergara. Par la suite, les "Caballeritos" se chargèrent de reprendre - dans les limites imposées par le régime des Bourbons - un programme (celui de Larramendi) dont la valeur était certes reconnue, mais dans un climat intellectuel assurément nouveau.
|
|
Les "Caballeritos" et les sciences positives : Au XVIIIème siècle, la modernité ne procédait pas de la théologie ni du droit, mais des nouvelles sciences appliquées. Ce furent les Amis du Pays qui brandirent ce drapeau (officiellement à partir de 1764-65), mais ils le firent en castillan. L’euskara, qu’ils pratiquaient, n’était toutefois pas étranger à leurs projets. "Dans ce livre, Villarreal de Berriz [1736] s’exprima en castillan, et c’est cette langue qu’allaient également utiliser les Caballeritos de Azkoitia, la Bascongada et le séminaire royal de Bergara. Mais, en vérité, ils ne s’exprimaient pas toujours en castillan. Ils parlaient aussi basque lorsqu’ils le jugeaient opportun. D’ailleurs, ils connaissaient la langue basque à la perfection, du moins ceux de la région d’Azkoitia ou Bergara. Le chef de file des Caballeritos jouit d’une certaine renommée dans la littérature basque, mais pas autant qu’il le mérite à mon avis" (K. Mitxelena). En illustration: le livre en castillan de Villarreal de Berriz (1736), l’œuvre théâtrale du comte de Peñaflorida (1764) et l’accord écrit des Amis du Pays pour le financement du dictionnaire d’Aizpitarte (1774). |
Il convient d’ajouter qu’à l’époque, certains penseurs pré-nationalistes en Europe prêtaient déjà attention au basque (Bowles, 1775; Herder, 1784, etc.), et que leurs idées étaient parvenues très tôt jusqu’à nous, comme le prouve certain texte de Mogel. Faut-il y voir l’une des sources du nationalisme linguistique évoqué plus loin? Des études récentes (Basurto, Altzibar) font remarquer que l’hypothèse ne manque pas d’intérêt, aussi ne serait-il pas inutile d’apporter quelques précisions à ce sujet.
|
|
La terminologie: un besoin impérieux : Kardaberaz et J. A. Mogel prirent en compte la nécessité d’adapter le corpus de la langue basque, c’est-à-dire ses ressources propres, aux nouvelles fonctions culturelles. Kardaberaz aborda cette question dans Euskeraren berri onak (1717); pour sa part, J. A. Mogel, exprimant son opinion dans la longue préface en castillan de Peru Abarka, fit preuve d’une grande ouverture d’esprit et d’une audace peu commune pour l’époque (1802). Dans ces textes, apparaissent deux points de vue antagoniques qui continuent à faire l’objet de discussions aujourd’hui: aux partisans d’une création terminologique originale à partir des racines de la langue (argea, "éclipse") s’opposent ceux qui préconisent d’emprunter à la terminologie gréco-latine internationale (logika, fisika, etc.). |
Dans ses statuts, la Sociedad recommandait (pour la première fois, semble-t-il, dans le cas d’une entité laïque) de cultiver la langue et la poésie basques, et de recueillir les publications euskariennes. Pourtant, du fait d’hésitations et de contradictions propres aux milieux éclairés de l’époque bourbonienne, l’euskara resta en dehors des programmes d’étude, même si les enfants de certains nobles fondateurs de la Sociedad (Peñaflorida, Narros, etc.) participèrent à des examens publics au cours desquels ils déclamaient en basque.
Les principaux membres directeurs de la Bascongada avaient une grande estime pour la langue basque et Xavier de Munibe lui-même, comte de Peñaflorida et fondateur de la Sociedad, écrivit une pièce de théâtre bilingue: El Borracho burlado ainsi que des œuvres littéraires pour les réunions du cercle éclairé d’Azkoitia. Par ailleurs, la Sociedad chargea Aizpitarte de rédiger un dictionnaire qui devait être le complément castillan-basque de celui de Larramendi (1773). Un autre membre, l’Alavais Egino, fidèle aux préoccupations des générations passées, présenta une ébauche d’apologie et de grammaire de l’euskara (1775).
En outre, nous devons rappeler le débat que la politique scolaire en vigueur suscita parmi les membres de la Bascongada, et déclenché par une lettre dans laquelle des Alavais dénonçaient l’exclusion de l’euskara de l’enseignement comme une aberration pédagogique (1772, 1775). Les Basques éclairés n’étaient donc pas insensibles aux problèmes linguistiques inhérents à la modernisation du Pays. La preuve en est que l’un d’entre eux, l’écrivain J. A. Mogel (1745-1804), s’était même intéressé aux questions de modernisation du corpus de l’euskara.
Comme Etxepare l’avait fait avant lui, Axular s’était prononcé dès 1643 sur le retard que prenait l’euskara à ne pas être utilisé, comme langue écrite, dans tous les domaines à l’instar des autres langues:
"Si on avait écrit en basque autant de livres qu’en latin, français ou d’autres langues étrangères, l’euskara serait aussi riche et aussi adapté que ces idiomes".
De toute évidence, ces écrivains avaient en tête la modernisation dont toute langue fait l’objet dès lors qu’elle est couramment utilisée pour analyser et traiter les questions que l’évolution de la société suscite en permanence.
Au XVIIIème siècle, le dictionnaire de Larramendi (1745) pallia, dans une certaine mesure, le retard pris par l’euskara sur le plan lexical. C’est pourquoi, à l’opposé de ceux qui sous-estimaient les ressources du basque, Kardaberaz, au moment de composer un dictionnaire plus complet, soulignait l’importance de l’œuvre lexicologique de Larramendi. La même préoccupation se retrouvera, plus vive encore, chez Mogel.
En général, quand on évoque la personnalité de Mogel, c’est surtout à son œuvre Peru Abarka qu’il est fait allusion. Sur le plan linguistique, Mogel s’intéressait principalement à la pureté de la langue et à ses capacités expressives. Il souhaitait tirer du peuple toute sa richesse d’expression, et dénonçait le peu de cas que l’aristocratie basque faisait de l’euskara tout comme la haine de sa propre langue que le système scolaire tendait à inculquer. Pourtant, tout en se souciant de pureté linguistique recueillie de la bouche même du peuple, Mogel revendiqua également pour le basque le droit de s’approprier une terminologie étrangère, c’est-à-dire le droit à l’emprunt terminologique tel qu’il se pratiquait dans le langage scientifique. Voici comment il exprimait sa pensée (1802):
"Il est communément reproché à notre langue de ne pas avoir de mots scientifiques et, de ce fait, d’être pauvre, du moins dans ce domaine [...]. Si le Basque imitait ceux qui, en latin ou tout autre langue, acceptent volontiers les mots grecs, son discours serait tout aussi ad hoc que prolifique".
Soulignons l’actualité de ces propos à l’heure où la normalisation terminologique constitue l’un des aspects de la modernisation des langues, non seulement de l’euskara, mais aussi de quelques-unes des principales langues de culture.
S’inspirant de la politique suivie en France par Louis XIV pour imposer le français (1661-1715), la dynastie des Bourbons, récemment installée sur le trône d’Espagne (1714), lança une nouvelle politique linguistique dans la Péninsule. En effet, la monarchie souhaitait donner une image de plus grande unité, y compris dans le domaine de la langue.
|
|
La censure et l’économie (1805-1858) : Dans l’histoire de la littérature basque, il est fréquemment arrivé que la publication d’une œuvre ait été retardée à cause de la censure ou de raisons économiques. En matière de censure, le cas de cet ouvrage de Gerriko est "exemplaire". La lutte pour obtenir des autorités l’autorisation de publication commença en 1805, presque vingt ans avant la mort de l’auteur, et l’archiprêtre de Guipuzcoa en personne intercéda en faveur de Gerriko pour que le permis fût accordé. Hélas, l’écrivain mourut en 1824 sans voir son œuvre libérée de la censure, et il fallut attendre 1858 pour pouvoir publier enfin le manuscrit. Les éditeurs purent alors expliquer, dans la préface dont nous présentons des extraits ci-dessous, les vicissitudes subies par le texte original avant d’être imprimé. |
Cette nouvelle politique fut d’abord imposée aux territoires catalans de la couronne d’Aragon, par l’intermédiaire de lois très strictes (Ley de Nueva Planta, 1716) et de décisions administratives plus contraignantes encore: c’est à cette époque que l’usage écrit du catalan fut interdit dans l’administration.
|
|
L’oppression manifeste et les pressions occultes : Quand les Bourbons, au terme d’une guerre de plusieurs années (1714), parvinrent à s’emparer des royaumes péninsulaires, la nouvelle dynastie entreprit une politique linguistique d’un style nouveau. Pour mener à bien cette politique, l’administration opéra souvent sous le boisseau (des mesures...dissimulées pour obtenir l’effet voulu sans qu’on en perçoive le danger, comme on peut le lire dans une communication secrète, en date du 20-II-1717, envoyée au corrégidor de Puigcerdá) et, parfois, à découvert. Au XVIIIème siècle, la situation s’aggrava très nettement dans les pays de langue catalane où cette politique linguistique, qui prétendait régir jusqu’aux moindres détails pratiques de la vie quotidienne, laissa des traces durables (par exemple, obligation était faite aux commerçants et aux boutiquiers de tenir leurs livres en castillan). En fait, il ne s’agissait là que d’appliquer les critères communs définis pour tout le royaume dans l’intérêt exclusif du castillan. Il va sans dire qu’une telle politique affecta également l’euskara. |
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, au cours des années 1760-1780, les dirigeants, se réclamant du "despotisme éclairé", essayèrent d’appliquer la même politique au reste des territoires péninsulaires et américains. C’est alors que furent rendues, à l’encontre des langues américaines, les ordonnances royales les plus humiliantes de toute l’histoire coloniale hispano-américaine. Ce contexte précis nous aide à mieux comprendre pourquoi les autorités de l’époque mettaient autant d’entraves à la publication de livres en basque. L’exemple le plus flagrant en est certainement le brevet du ministre Aranda (1766) qui interdisait au père Kardaberaz de publier sa Vida de San Ignacio. D’après ce que nous apprend ce document, il s’agissait d’établir un critère politique général pour tous les ouvrages qui ne fussent pas écrits en castillan. Le ministre énonce son propos dans ces termes:
|
|
La censure politique d’Aranda (1766) : Il s’agit - avec les résolutions des Juntes Générales de Biscaye évoquées plus haut - du coup le plus direct jamais porté à l’euskara sous l’Ancien Régime. Et il fallut que ce fût précisément le comte d’Aranda, ministre "éclairé" de Charles III, qui interdît au jésuite Kardaberaz rien moins que d’imprimer la vie de saint Ignace. Une copie de cette interdiction fut envoyée à chaque imprimeur de Pampelune pour qu’aucun ne s’avisât de publier l’ouvrage, par inadvertance ou esprit de contradiction, sans connaître les risques qu’il encourait. Quant aux raisons de l’interdiction, elles étaient aussi claires que générales: le souci politique de ne pas agréer l’impression d’ouvrages dans une autre langue que le castillan. |
"A cela s’ajoute le souci politique de ne pas agréer l’impression d’ouvrages dans une autre langue que le castillan, seule intelligible par toute la Nation, aussi, en règle générale, [les autorisations] serontelles refusées par ce Conseil, sans notification particulière de ma part, et l’œuvre originale en basque de la Vie de Saint-Ignace [de Loiola] sera-telle archivée". Cette politique générale d’interdictions s’exercera au cours des années suivantes: l’interdiction va devenir la norme et les autorisations ne seront plus concédées qu’exceptionnellement. Dans ces conditions, J. I. Gerriko (1740-1824) dut surmonter une série d’obstacles quasi infranchissables pour parvenir à publier ses œuvres.
Œuvres originales et traductions (1545-1879)
A l’aube de l’époque contemporaine, toute une génération d’écrivains se retrouva dans une situation contradictoire et inquiétante: enthousiasmés par les innovations du Siècle des lumières européen, ils devaient néanmoins affronter les difficultés officielles créées par le despotisme éclairé espagnol. C’est à cette époque que des auteurs basques comme Astarloa ou Mogel (à la fois si proches et si différents) eurent la possibilité de dialoguer avec des observateurs ou des voyageurs étrangers tels que W. von Humboldt (1801), ou de débattre avec des interlocuteurs comme Traggia (1802) dans le cadre des projets du ministre Godoy. Ce fut sans conteste une période d’échanges passionnés.
|
|
Premiers pas pour apprendre le latin (1712) : L’œuvre de Joanes Etxeberri de Sare fait apparaître une nouveauté qui mérite d’être relevée: il écrivit en basque une méthode pour apprendre le latin. Sous sa plume, l’euskara se transforma en un instrument pédagogique adapté à l’enseignement régulier de l’époque. Le but implicite de l’ouvrage était d’affirmer qu’il était possible de faire des études en euskara et sur l’euskara. En effet, tout en apportant des précisions sur le latin, l’auteur s’efforce de fournir de nombreux éléments de grammaire relatifs à l’euskara. Cette nouveauté, tardive dans une certaine mesure, faisait écho à la tentative, pédagogiquement innovatrice, de recourir à la langue vernaculaire connue pour accéder au domaine des humanités classiques. |
Dès l’époque des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, l’originalité linguistique de l’euskara avait attiré l’attention des voyageurs qui traversaient le Pays Basque. Dans certains cas, d’illustres humanistes et d’éminents linguistes exprimèrent par écrit l’intérêt que le basque suscitait chez eux. Et leurs réactions vis-à-vis de l’euskara, qu’elles fussent d’admiration ou de mépris, ne laissèrent jamais insensibles les Basques dans leur ensemble, tant ceux du Pays que ceux de la diaspora. En effet, comment les enfants d’Euskal Herria pouvaient-ils rester indifférents au jugement porté sur cette langue qui faisait partie intégrante de leur vie, y compris dans l’émigration, et leur permettait de s’affirmer socialement?
Les communautés d’émigrés basques, notamment dans l’Amérique coloniale, subirent un processus de regroupement ethnico-social au centre duquel la langue était perçue comme une valeur spécifique et noble (tel fut le cas à Mexico et Lima, au XVIIème siècle surtout). Ce cas particulier mérite incontestablement d’être étudié. Un autre phénomène intéressant, quoique différent, est celui du pidgin bascoïde qui a dû traverser l’Atlantique Nord, depuis l’Islande jusqu’au Labrador, en tant que "langue franque" et, à l’occasion, s’implanter durablement sous la forme de toponymes. A l’extérieur du Pays Basque, l’euskara fait aussi quelques brèves apparitions, dès la Renaissance, sous la plume d’auteurs célèbres dans les pays voisins; puis, sous des formes diverses, aux confins des territoires américains que la colonisation européenne a atteints aux XIXème et XXème siècles. Avant d’aborder tout cela, nous voudrions évoquer la démarche inverse, et rappeler que les traductions en euskara ont représenté une bonne partie de la production littéraire basque de 1545 à 1879. Parfois, créer c’est aussi traduire, recevoir de l’autre.
Pour évaluer l’importance de la traduction dans la production littéraire, sur la période qui va depuis la parution du premier livre basque (1545) jusqu’à la Renaissance Basque (ici 1879), il s’impose d’analyser quelques caractéristiques générales de l’édition en euskara. Actuellement, sont publiés en un an plus de livres (de plus de 50 pages) qu’au cours de trois siècles et demi d’histoire: 828 éditions en 1990 contre 588 de 1545 à 1879.
Notons que, dans la période considérée, il y eut 588 éditions de 194 livres, ce qui peut nous sembler énorme aujourd’hui, d’autant que cette politique de réédition répondait vraisemblablement aux besoins de classes sociales bien définies (livres religieux: doctrines, sermonnaires, Imitation de Jésus-Christ, etc.).
DIALECTES EDITIONS LIVRES ORIGINAUX Biscaïen 76 26 14 Navarro-gipuzkoan 195 76 47 Navarro-labourdin 259 78 34 Souletin 58 14 6 TOTAL 588 194 101
Eu égard à la langue standard actuelle, il peut être intéressant d’évaluer la production littéraire par dialecte, de façon à avoir une idée de l’évolution dans le temps du profil géographico-dialectal des auteurs et de leurs œuvres: jusqu’en 1900, 30% des auteurs et des œuvres peuvent être classés comme Gipuzkoans, tandis que le biscaïen représente 22,5% du total et le labourdin seulement 14,5%. Dans ce contexte général, la traduction représente une proportion importante de la production éditoriale: sur la totalité des livres parus à l’époque, 101 étaient des textes originaux et 93 des traductions ou des adaptations plus ou moins libres.
Cela ne fait que mettre en évidence deux aspects d’un même phénomène: la production littéraire proprement euskarienne n’a pas bénéficié d’un élan de créativité vraiment puissante et originale; mais, à l’inverse, elle peut être considérée comme une fenêtre ouverte sur les courants d’idées extérieurs au Pays Basque et un lieu d’échanges culturels. En effet, nous pouvons constater que certains auteurs, y compris étrangers, sont venus à la littérature basque et l’ont enrichie.
|
|
Le travail des euskaldunberris : Comme l’avait fait Materre dans sa modeste production littéraire en confessant ses propos d’alphabétiseur (1617) et ainsi que d’autres qui durent apprendre la langue basque avec des moyens réduits, Sylvain Pouvreau (originaire de Bourges, fidèle serviteur du Janséniste basque Saint-Cyran), écrivain et curé de Bidart, créa du matériel didactique pour faciliter l’apprentissage de l’euskara. Sur la photo une page de son dictionnaire (manuscrit encore inédit et conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris). |
|
“Cantabrismus incipit à suburbicariis Baionæ Lapurdensium et itinere sex aut septem dierum in intima montana Hispaniæ extenditur, Galli eos qui ea lingua utuntur vocant, Bascos vel Basculos Hispani regionem, in qua illa dialectus locum habet, generali nomine Bascuença vocant, nihil barbari, aut stridoris aut anhelitus, lenissima est et suavissima atque sine dubio vetustissima, et ante tempura Romanorum in illis finibus non erat.” J. J. Scaliger |
J. J. Scaliger (1540 - 1609) : Les opinions, favorables ou hostiles, que les personnalités importantes de l’époque avaient de la langue basque ne manquèrent pas de toucher les spécialistes basques de l’euskara et d’influencer leur pensée. C’est le cas de J. J. Scaliger, par exemple, dont les propos marquèrent Oihenart (1638, 1656). J. J. Scaliger jouissait d’un grand prestige comme humaniste et philologue classique mais, dans le contexte tourmenté des luttes religieuses, il fut tantôt encensé tantôt abhorré.
|
|
L’euskara chez Rabelais (1542) : Deux ans avant la parution du premier livre basque, François Rabelais (1494-1553), dans son Pantagruel (éd. de 1542), introduisit un texte en euskara qu’il inséra parmi des passages en breton, grec, danois, arabe et diverses autres langues européennes. Ce détail n’a d’autre valeur historique que de montrer que Rabelais avait une certaine connaissance de notre langue. |
(Les opinions, favorables ou hostiles, que les personnalités importantes de l’époque avaient de la langue basque ne manquèrent pas de toucher les spécialistes basques de l’euskara et d’influencer leur pensée. C’est le cas de J. J. Scaliger, par exemple, dont les propos marquèrent Oihenart (1638, 1656). J. J. Scaliger jouissait d’un grand prestige comme humaniste et philologue classique mais, dans le contexte tourmenté des luttes religieuses, il fut tantôt encensé tantôt abhorré.)
Les voyageurs européens qui arrivaient au Pays Basque devaient affronter une réalité inattendue. À ce propos, le Français Manier écrivait en 1736: "la difficulté majeure que nous rencontrions, quand l’usage du français soudain disparaissait, était d’entendre parler non pas espagnol, mais biscaïen, une langue plus ardue encore que l’allemand". Dans le même registre, l’évêque de Porto avait dit plus succinctement: c’est une terre peuplée d’hommes féroces qui parlent une langue inconnue" (1120), tandis que pour l’humaniste italien A. Navagiero, cette langue "est la plus nouvelle et la plus étrange que j’aurais jamais vue ou entendue" (1528).
|
|
L’euskara chez Lope de Vega (1615) : Dans la littérature castillane, les écrivains ont fréquemment fait allusion à l’euskara et au parler original des Basques, lequel était souvent synonyme de langage embrouillé et incompréhensible. En revanche, les cas d’utilisation littéraire de la langue basque sont plus rares. Le texte de Lope en est un. Il fait partie d’une comédie écrite à l’occasion des fêtes au cours desquelles les cours d’Espagne et de France se présentaient leurs princesses. |
Pour surmonter l’obstacle de la langue, d’aucuns eurent l’idée de concevoir les premiers vocabulaires basques à l’usage des pèlerins et des voyageurs: ce fut le cas du prêtre français A. Picaud en 1139, du chevalier allemand A. von Harff en 1499, de l’humaniste hispano-italien L. Marineo Sículo (1530) et de l’Italien N. Landucci (1562). Parallèlement à cet intérêt pratique pour l’euskara, de nombreux savants étrangers de grand renom contribuèrent, à partir de la Renaissance, à faire connaître notre langue à l’extérieur du Pays Basque: nous pourrions citer comme les plus importants, eu égard à l’intérêt que leur œuvre a suscité, J. J. Scaliger (1599-1605), G. Mayáns i Siscar (1737), L. Hervás y Panduro (1784, 1789-1805, 1808), W. von Humboldt (1817, 1821), entre autres. Oihenart, touché par l’éloge de Scaliger, rapporte cette citation: "le basque est une langue très douce et, sans doute, très ancienne et parlée dans ces contrées avant l’époque des Romains". Aux philologues, il faut ajouter les hommes de lettres qui recueillirent dans leurs ouvrages quelques-uns des premiers exemples d’euskara imprimé. Ce fut le cas d’illustres auteurs français et espagnols. En effet, nous devons à des écrivains castillans -et, en premier lieu, au marquis de Santillana (éd. de 1508)- d’avoir fait apparaître pour la première fois des phrases basques dans un texte imprimé. Dans sa Comedia Tinelaria, Torres Naharro (1513) emploie, par exemple, la formule juratoire "Bai fedea". Et, quelques années plus tard (1536), dans l’une des éditions de La Célestine, on peut trouver un texte plus long, le "Canto de Perucho", qui commence par un "Lelo lirelo çarayleroba" pour le moins incompréhensible.
Parmi les textes archaïques basques, il en est un assez célèbre que Rabelais reproduisit dans Pantagruel (1542), lorsque Panurge, au milieu d’un discours polyglotte, donne la version basque de ses propos: Jona andie guaussa etan be harda er remedio qui, en système orthographique ancien, pourrait se lire Iaun handia, gauça gucietan behar da erremedio, etc., c’est-à-dire "Grand Seigneur, il faut un remède à toutes choses", etc. Dans un style plus châtié, citons aussi le court poème basque de Lope de Vega (1615), dont la signification est limpide: Zure vegui ederroc / Ene lastaná / Cautivaturik nave / Librea ninzaná ("Tes beaux yeux, ô mon aimée, me gardent prisonnier, moi qui étais libre").
Cependant, la contribution des philologues et littérateurs relève plutôt de l’anecdote, et plus déterminante fut celle de ces étrangers qui, installés au Pays Basque, apprirent l’euskara puis s’appliquèrent de façon exemplaire à développer la langue écrite. À cet égard, nous nous contenterons d’évoquer deux figures emblématiques: Materre et Pouvreau.
Le père Etienne Materre, d’origine française, était arrivé au Pays Basque, vraisemblablement à Ciboure, vers 1611. Très vite, il apprit le basque à Sare, aux côtés d’Axular et, en publiant son ouvrage Dotrina Kristiana en 1617, il devança de dix ans le groupe d’écrivains de Saint-Jean-de-Luz/Sare. Il faut admettre que la décision et le dévouement du nouveau venu est pour le moins surprenante. D’ailleurs, dans le prologue, Materre se montre quelque peu embarrassé d’avoir osé écrire en euskara sans être basque d’origine. Outre sa fonction de catéchisation, le livre de Materre, qui compta Axular comme censeur, visait à atteindre d’autres buts culturels: notamment, permettre d’apprendre à lire et à écrire en basque, un objectif qui est tout à l’honneur de ce précurseur des euskaldunberris (= néo-bascophones) du futur.
Sylvain Pouvreau était également étranger. Néanmoins, avant de venir au Pays Basque, il avait eu l’occasion d’en apprendre la langue chez l’abbé de Saint-Cyran, dirigeant basque du jansénisme français, au service duquel il était entré comme assistant Lorsqu’il arriva en Euskal Herria, il compléta sa formation en quelques années (1639-1644). Tout en poursuivant ses études, Pouvreau se consacra avec passion à cultiver l’euskara, les ouvrages qu’il nous a légués témoignant de sa ferveur linguistique: d’une part, de longues traductions et, d’autre part, des travaux sur la langue (Grammaire et Dictionnaire). Si les premiers furent publiés du vivant de l’auteur (1656-1665), les derniers -en dépit de publications partielles (1881-1892)-, en particulier son Dictionnaire, ne sont jamais sortis des archives. Même si Pouvreau rentra chez lui, il fit preuve d’une grande fidélité à la langue qu’il avait apprise parmi nous, se souciant de la publication de ses ouvrages basques et effectuant quelques visites au Pays.
Dans le cadre des rapports entre les langues et entre les peuples, la place de choix que la traduction a occupée dans l’histoire de la littérature basque est évidente. Pourtant, nous ne devons pas oublier un autre type de rapport interlinguistique. Nous voulons parler des ouvrages en euskara destinés à l’apprentissage de langues étrangères: Tresora hirur lenguaietakoa (Bayonne, 1642), de Voltoire, et Eskuarazko hatsapenak latin ikasteko (1712), d’Etxeberri de Sare. Dans le premier cas, il s’agit d’un ouvrage trilingue conçu pour faciliter l’étude comparée du français, du castillan et de l’euskara. D’une façon générale, pèlerins, voyageurs, immigrants ou natifs, tous s’efforçaient -dans un sens ou dans l’autre- de réduire la distance sociale interlinguistique qui séparait les erdarak de l’euskara.
|
Vocabulaires basque-islandais (XVIIème siècle) : Ces vocabulaires basque-islandais du XVIIème siècle firent l’objet de la thèse de doctorat de Denn à l’université de Leyde (Pays-Bas) en 1937, et furent publiés la même année sous le titre générique de Glossaria duo Vasco-islandica à Amsterdam. Retrouvés à la bibliothèque Arnamagnaeana de Copenhague par le professeur J. Helgason, ces documents peuvent être considérés comme une preuve tangible qu’une "langue franque" bascoïde était utilisée, à l’époque, par les gens de mer de l’Atlantique Nord. En illustration: la première page du second vocabulaire. |
Au XVIIème siècle, l’épanouissement de la littérature basque semble lié à la prospérité économique de Saint-Jean-de-Luz (Labourd) en tant que port de pêche. Comme l’historien Gipuzkoan Isasti le rappelait en 1625: "Chaque année, les Gipuzkoans quittent les ports de la province à bord de nombreux navires et mettent le cap sur Terre-Neuve, une région septentrionale extrêmement froide et presque inhabitable". Comme les milliers de marins et pêcheurs des ports d’Hegoalde et Iparralde qui empruntaient les routes maritimes étaient bascophones, ils emportaient la langue basque avec eux, vers d’autres mers et d’autres ports.
C’est par le trafic maritime et les activités commerciales qui en découlaient que le basque fut transmis à des groupes linguistiques étrangers au Pays. Nous voulons parler, d’une part, de l’implantation de l’euskara en Amérique du Nord par l’intermédiaire des pêcheries et, d’autre part, de sa diffusion dans tout l’Atlantique Nord, jusqu’au Spitzberg, parmi les gens de mer des pays riverains.
Nous connaissons des glossaires basque-islandais conçus au XVIIème siècle pour faciliter la communication entre les hommes du Nord et les marins basques (Denn 1937, Hualde 1984). En effet, du fait de leur habileté à chasser la baleine, les Basques purent en contrôler le marché européen au XVIème siècle (R. Grenier) et, au XVIIème siècle, leur réputation était encore telle que Hollandais et Anglais les engageaient pour des campagnes.
|
La toponymie basque de Terre-Neuve : Au XVIème siècle, les marins basques, forts de l’expérience acquise au cours des siècles (surtout à partir du XIIIème), se lancèrent sur les mers des Indes Occidentales et Orientales (Philippines). L’euskara s’embarqua avec eux et laissa, en de nombreux endroits, des toponymes qui sont parvenus jusqu’à nous. Voici ceux de Terre-Neuve. |
Ces pêcheurs allèrent jusqu’au Canada pour chasser la baleine au Labrador et pêcher la morue à Terre-Neuve. La présence des Basques dans ces régions a dû être assez durable, et leur nombre assez important, pour qu’une toponymie euskarienne se soit enracinée et conservée jusqu’à nos jours. À cet égard, on estime à un millier le nombre de marins pêcheurs qui, rien qu’à Red bay (au Labrador, en face de Terre- Neuve), travaillaient chaque année du printemps à décembre. Les documents conservés dans les archives basques, espagnoles et françaises ont servi récemment (1979-1985) à localiser les vestiges des installations terrestres et les épaves des navires disparus dans cette zone.
La littérature basque se fit l’écho de cette activité de pêche et, dans une moindre mesure, de négoce. Le Manual Devotionezcoa d’Etxeberri de Ciboure (1627), par exemple, comprend quelques prières pour les baleiniers, et M. de Hoyarzabal prépara une version de l’art de naviguer qu’il intitula: Liburu hau da ixasoco nabigacionekoa (1677).
|
La toponymie basque du Québec : La nomenclature officielle du Canada (1978) ne fait pas apparaître de noms basques comme à Terre-Neuve. En revanche, de la même façon que certains toponymes médiévaux de Castille, quelques noms français témoignent de la présence de Basques en ces lieux. Les siècles écoulés n’ont donc toujours pas effacé le souvenir du passage de ces hommes de la mer. |
Sur le plan commercial, le besoin de communication interlinguistique dut se faire sentir très tôt et les Basques allaient parfois jusqu’à laisser à terre l’un de leurs mousses pour qu’il pût apprendre la langue du pays de la bouche des Indiens. En sens inverse, nous savons que ces derniers réussirent à acquérir des notions de basque au point que, lors de leurs premiers contacts avec les Français, ils s’adressaient à eux dans une espèce de sabir ou pidgin bascoïde ("Les Canadiens ne traitent parmi les Français en autre langue qu’en celle des Basques", déplorait De Lancre en 1610).
Dans le réquisitoire de De Lancre contreles “mauvais anges, contre les démons et les sorcières” (de. de 1610), nous retrouvons un texte qui parle de la double présence de l’euskara des deux côtés de l’Atlantique: “Les basques vivent le long de la côte, de la mer, ou bien égarés et un peu avancés dans la montagne, et s’appelaient anciennement Cantabri. Ils ont un langage fort particulier: et bien que le pays seul parmi nous qui sommes Français, se nomme le pays de Basques, si est-ce que la langue Basque s’étend beaucoup plus avant. Car tout le pays de Labourd, la basse et haute Navarre et une partie d’Espagne parlent Basque, et pour malaisé que soit le langage, si est-ce qu’outre les Basques la plupart des Bayonnais, haut et bas Navarrais, et Espagnols circonvoisins pour le moins ceux des lisières le savent. Et m’a-t-on assuré qu’en l’an 1609, le sieur de Mons disputant au privé conseil du Roi contre quelques gens de Saint-Jean-de-Luz, certains dommages et intérêts qu’ils disaient avoir faits et soufferts pour avoir envoyé quelques navires en Canada, il lui fut maintenu que de tout temps et avant qu’il en eut connaissance les Basques y trafiquaient: si bien que les Canadiens ne traitent parmi les Français en autre langue qu’en celle des Basques.”
Ce texte unique de l’époque retrace l’attachement de la population à sa propre langue et sa force d’implantation sur les terres américaines.
Cette intégration sociale du basque explique qu’on puisse trouver aujourd’hui des toponymes d’origine véritablement euskarienne sur des terres aussi éloignées du berceau historique de la langue que Terre-Neuve, dont la carte nous fait découvrir Portuchoa, Baya Ederra, Placentia Bay, etc. C’est, sans aucun doute, une autre preuve de la vitalité de l’idiome.
|
Aire linguistique supposée du pidgin basco amérindien : Récemment, le professeur Peter Bakker de l’université d’Amsterdam a reconstitué la zone de contact supposée entre le basque et les langues amérindiennes, et délimité l’extension géographique probable du pidgin parlé vers 1600 (en hachuré sur la carte). Son aire linguistique devait s’étendre depuis le détroit de Belle-Isle au Labrador jusqu’à l’état nord-américain du Maine, et comprendre Terre-Neuve, l’estuaire du Saint-Laurent et la péninsule d’Acadie/Nouvelle-Ecosse. |
|
|
Vestiges archéologiques basco-canadiens : Des fouilles récentes (notamment à partir de 1979), entreprises à partir de documents d’archives, ont permis de mettre au jour des restes importants de bateaux engloutis et d’installations laissées à terre par les baleiniers et morutiers basques du XVIème siècle. Les découvertes de Saddle Island (à Red bay, face à la pointe nord de Terre-Neuve), avec sa batterie de fours (qui servaient à faire fondre la graisse de baleine dans de grands chaudrons de cuivre), ses restes de tuiles et même une sépulture collective (comme nous le montre la photo de X. Otero) ont beaucoup contribué à mettre en lumière la présence basque au Canada. |
En outre, parmi les noms officiels actuels qui composent le Répertoire Toponymique du Québec (Québec, 1978), certains sont des allusions évidentes, en langue française, aux activités de nos pêcheurs: Anse au Basque, Cap du Basque, Collines du Basque, etc. Voilà comment le passé de l’euskara et de ses locuteurs continue à vivre de nos jours au Canada.
Avec la découverte du Nouveau Monde (1492), le peuple basque -pêcheur, navigateur ou négociant- trouva dans la colonisation américaine un moyen d’absorber ses excédents démographiques: c’est à cette époque que commença l’émigration basque vers l’Amérique, mouvement de population qui, en dépit des fluctuations, n’a pratiquement marqué aucune pause depuis lors.
|
Les bascophones américains (1959) : Les rares études consacrées au sujet (J. Bilbao, K. Zuazo) - travaux certes courageux mais fragmentaires - ne permettent pas d’avoir une vision globale de la bascophonie américaine à travers l’histoire. En effet, les informations disponibles, quantitatives et qualitatives, sont insuffisantes et souvent peu fiables. Aussi les chiffres qui figurent sur la carte ci-jointe sont-ils reproduits sous toutes réserves encore que, dans ce cas précis, les statistiques portent sur des dates précises (Porto Rico, 1959; 1961 pour le reste) et aient été publiées dans un ouvrage dont le sérieux ne peut être mis en doute. Source: KLOSS/McCONNELL (1979): Linguistic Composition of the Nations of the World/Composition Linguistique des Nations du Monde. Québec. |
Nous ne disposons, hélas, d’aucune étude complète sur la situation linguistique des colons basques du Nouveau Monde avant l’indépendance. Cependant, certains éléments permettent de supposer que les créoles de la première ou deuxième génération continuaient à parler l’euskara de parents ou d’aïeux bascophones. Cela est encore plus évident lorsque les communautés basques se regroupèrent en confréries autonomes, généralement en opposition à des conseils civils ou ecclésiastiques, voire à des groupes ou des classes sociales. Ainsi, la colonie basque de Mexico, capitale de la Nouvelle-Espagne, constitua une puissante association autour de la "Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu" qui réunissait des Basques européens et créoles (1671). Cette association devint très vite une institution de première importance sur le plan économique et social, suscitant du coup une grande animosité. Pour y faire face et se renforcer, elle s’associa à une autre confrérie basque, celle de saint Ignace, puis créa le "Colegio de las Vizcaínas" (1734). La Cofradía s’établit aussi à Lima, la Ville des Rois où, en 1647, la consécration de l’image de la Vierge donna lieu à des fêtes solennelles.
|
|
L’euskara de Sor Juana Inés (1685) : Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), la première figure lyrique du baroque, représente à elle seule un chapitre entier des lettres ibéro-américaines. Récemment (1982), le Mexicain Octavio Paz, prix Nobel de littérature, a étudié la personnalité et l’œuvre de cette femme dont on ne sait presque rien du père, un Basque de Bergara semble-t-il. En dépit du flou qui entoure la figure de cet homme, Sor Juana Inés se montrait très fière de ses origines et recueillit, en partie, la tradition euskarienne de la communauté basque de Mexico. |
A l’occasion de cet événement socio-religieux, fut édité à Lima un livre commémoratif contenant de longs textes en euskara. Ce ne fut pas le seul cas dans le genre puisque la première histoire du sanctuaire Gipuzkoan ne fut pas imprimée en métropole, mais à Mexico (Paraninfo Celeste, 1687). Et, nous savons qu’au cours des célébrations basco-créoles, la langue basque était perçue comme un signe de noblesse et marquait l’appartenance à un groupe. Dans ce contexte, il convient d’évoquer la personnalité d’une Mexicaine incomparable, Sor Juana Inés de la Cruz.
|
|
Paranympho Celeste (1686-1690) : L’histoire de la parution de cette œuvre nous rappelle inmanquablement celle des Discursos de B. de Etxabe. Les deux ouvrages furent publiés à Mexico et traitaient du Pays Basque (comme la Relación du père Ayllón à Lima en 1647). Le Paranymphoo, que nous devons à la plume du franciscain alavais P. Luzuriaga, est la première histoire du sanctuaire d’Arantzazu (Guipuzcoa) jamais publiée, et fut immédiatement réédité à Madrid et Saint-Sébastien (1690). Il ne serait pas étonnant de découvrir que Sor Juana Inés de la Cruz, en raison d’évidentes affinités, connaissait et avait lu l’ouvrage. Celui-ci, rédigé en castillan, comporte quelques dictons en euskara et s’inspire de l’histoire alors inédite du père Gamarra. |
Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), l’immense poétesse baroque du Mexique, était fille naturelle d’un Basque et déclarait avec fierté appartenir "à notre nation basque". En outre, elle vécut à une période où la communauté basco-mexicaine était bien organisée, influente, parfois même toute-puissante. Nous devons à Sor Juana Inés des chants de Noël (1685) dans lesquels retentit la voix de l’euskara de son père et des milieux basques de Mexico: "Notre mère Andre Maria, / Pourquoi t’en vas-tu vers les cieux? / Et, dans ta demeure d’Arançazu / Ne veux-tu point rester? [...]. Galdu naiz, hélas elle nous quitte, / Nere vici gucico galdu naiz. / Guasen galanta avec toi, / Guasen, nere lastaná, / Au ciel, ô Biscaye / Tu dois monter tout entière". Ces vers sont tout empreints de la pureté d’âme de Sor Juana Inés et expriment sa nostalgie d’un pays qu’elle ne vit jamais mais dont elle connaissait la langue.
Étant donné que nous ne pourrons revenir, dans le cadre du présent ouvrage, sur l’histoire de l’euskara américain aux XIXème et XXème siècles, nous avons préféré évoquer dès maintenant quelques-unes des circonstances dans lesquelles la langue basque allait s’exprimer au sein de la diaspora basque de l’époque. Dans l’Amérique indépendante, le "Cône Sud" sera la principale terre d’accueil des émigrants basques, lesquels feront de l’Argentine, de l’Uruguay et du Chili de véritables foyers euskariens: y séjourneront le poète Iparragirre et le bertsolari Otaño qui chantera l’ombu de la pampa avec le même amour qu’il le fit du chêne de sa maison. Sous ces latitudes, les Euskal Etxeak (Maisons Basques) seront autant de lieux de rencontre où les émigrants pourront combattre l’isolement et le déracinement, puis créer des publications en euskara, et enfin monter des maisons d’édition et des cours de langue basque.
|
|
Eskual Herria (1893) : En Amérique, les publications périodiques de la diaspora basque avaient une double fonction: permettre aux colons dispersés de se connaître mutuellement, et informer les familles qui étaient restées en Europe. A cet effet, l’euskara occupait une place de choix dans leurs colonnes. Au premier - et éphémère - journal basque de l’Ouest américain (Escualdun Gazeta, publié à Los Angeles en 1885) succéda Eskual Herria, créé en 1893, qui parut jusqu’en 1898. |
En raison de la présence de Basques, au XIXème siècle, à Cuba et dans l’Ouest américain (à partir de 1850) puis, après la guerre (1937), au Venezuela, en Colombie ou au Mexique, d’aucuns ont estimé à 125.000 le nombre - sans doute exagéré - des bascophones d’Amérique (1959-1961). Depuis le milieu du siècle dernier, l’Ouest américain a été aussi le pôle d’attraction de l’émigration basque; celle-ci ayant été favorisée à partir de 1950 par une plus ample législation. Son historie a été retracée dans un nouvel ouvrage historiographique:
Amerikanuak, de W. Douglas et J. Bilbao. Grâce à eux et à R. Laxalt la naissance et le développement d’un project singulier, soutenu par l’Université de Reno (Nevada), a pu être réalisé: “Basques Studies Program” (1967). Le Programme a toujours maintenu son double aspect -scientificoacadémique et ethnosocial- avec des travaux et publications de recherche et d’activités sociales adressées à la communauté basco-nord américaine.
|
Des Basques au "Far West" : A partir de 1850 environ, l’Ouest américain commença à attirer les émigrants basques. En ce qui concerne la fidélité linguistique de leurs descendants (de 1850 à 1980 approximativement), Bilbao et Douglass font le constat suivant: en général, les Basques américains de la première génération étaient bascophones unilingues avant d’aller à l’école, puis devinrent rapidement bilingues anglais-basque. Ensuite, la fidélité à l’euskara dépend de la profession des parents, le plus grand nombre de bascophones se trouvant chez les bergers, les négociants en laine et les hôteliers. En revanche, dans la deuxième génération, rares sont ceux qui ont une connaissance, même rudimentaire, de la langue basque. C’est pourquoi, ces vingt-cinq dernières années, le Basque Studies Program a encouragé les universitaires à faire revivre l’euskara. |
La bibliothèque traitant sur des thèmes basques possède un fond de publications et de documentation inhabituellement riche ainsi qu’une série d’éditions propres parmi lesquelles il faut remarquer le dictionnaire bilingue basque-anglais (G.Aulestia, 1989) et anglais-basque (G. Aulestia et L. White, 1990). Elle est la création la plus remarquable du “Basque Studies Program”. En outre, elle édite un bulletin d’informations: le “Newsletter” depuis 1969. Signalons aussi que dans la pratique, ce programme de Reno est devenu aux États Unis et dans le monde anglo-saxon le premier centre fédéral et international d’information sur la culture basque qui inclut bien sûr ses aspects linguistiques et surtout son historie américaine au Nord comme au Sud.
Dans la plupart des cas, une aire linguistique se présente comme un territoire continu dont la limite est marquée par une ligne ou zone frontière, plus ou moins stable, qui le sépare des autres groupes linguistiques. Cette frontière linguistique est rarement fixe et peut se déplacer en faveur, ou au détriment, de l’une des deux communautés vivant de part et d’autre de la ligne de démarcation.
En ce qui concerne l’euskara, c’est sur le flanc sud de son territoire que les frontières linguistiques ont le plus fluctué. En effet, avant même la romanisation, les marches méridionales d’Euskal Herria ont toujours été plus sensibles aux pressions démographiques conjoncturelles, dans la mesure où la géographie plus ouverte de ce versant méditerranéen du Pays -Rioja alavaise et Ribera navarraise- en rendait l’accès plus facile aux populations extérieures qui pouvaient donc s’y établir. D’ailleurs, il ne fait aucun doute que l’implantation, le long de ces frontières, de communautés dont la cohésion politique, linguistique et cult
urelle était plus grande, a progressivement entamé l’intégrité séculaire du territoire bascophone. Pourtant c’est également là, dans cette zone méridionale, que s’est produite à une certaine époque (au cours des premiers siècles de la Reconquête) l’expansion territoriale la mieux connue de toute l’histoire de l’euskara. Aussi, les circonstances géohistoriques particulières qui ont conditionné la bascophonie en Alava et en Navarre méritent-elles qu’on s’y arrête, eu égard aux phénomènes frontaliers qu’elles ont entraînés.
|
Un euskara de "longue durée" : Le chercheur alavais Odón de Apraiz y Buesa est celui qui nous a légué la synthèse géohistorique la plus complète et la plus fiable de la situation de l’euskara en Alava. Indépendamment des modifications de détail et des améliorations ponctuelles que les nouvelles recherches et études ne manqueront pas d’y apporter, cette carte, dans sa globalité, illustre parfaitement un processus culturel que les historiens appellent "de longue durée", c’est-à-dire qui n’est pas affecté par les événements d’ordre conjoncturel comme un changement dynastique ou une guerre. Le lecteur attentif remarquera que le recul rapide de l’euskara est, historiquement, très récent sur le territoire alavais. |
Au Moyen-Âge, la province d’Alava était presque entièrement entourée de territoires bascophones (à l’exception de Valdegobía à l’est). C’est pourquoi il n’est pas étonnant que Thibaud Ier de Navarre (1234-1253) n’ait pas hésité à nommer Urizarra le village de Peñacerrada aux confins de la Sierra de Cantabria. Au bas Moyen-Âge, les terres gagnées par le repeuplement après la Reconquête, qui allaient jusqu’à l’Ebre et au-delà, dans la haute Rioja et la province de Burgos, formèrent un excellent rempart le long du territoire bascophone alavais. Hélas, la ligne délimitée par le fleuve n’était pas assez stable pour constituer une frontière géolinguistique durable et les premières pertes territoriales au nord de l’Ebre eurent lieu dès le XIIIème siècle.
Sur la carte ci-jointe, Odón Apraiz a illustré ce processus de recul par deux lignes correspondant respectivement aux XVIème et XVIIIème siècles: au sud de la première ligne (XVIème siècle), figure un vaste territoire déjà hispanisé qui comprend les régions s’étendant jusqu’à l’Ebre.
|
Doublets toponymiques : Le spécialiste du Moyen-Age examinant la Grille de San Millán (où les noms de lieux alavais d’origine basque figurent parfois sous une forme qui, aujourd’hui, peut surprendre (1025): Zuhazu, Harhazua, Haberasturi, Hegiraz...), ou le voyageur, habitué du Pays Basque, parcourant la province d’Alava, y découvriront facilement des toponymes qui se retrouvent dans d’autres territoires, avec quelquefois de petites variantes orthographiques. Ces doublets toponymiques sont le fruit du patrimoine linguistique commun, mais aussi de l’histoire propre au dialecte alavais (dialecte "méridional"). En voici quelques exemples. |
Les toponymes marqués d’un astérisque (*) proviennent de la Grille de San Millán (1025). B = Biscaye, G = Gipuzkoa,, L = Labourd, N = Navarre. Top.
Nous savons que l’euskara navarrais atteignait à la fin du XVIème siècle, en 1587, un territoire voisin des localités alavaises de Campezo et Orbiso. Même s’il est assez délicat de tracer avec précision, à partir des données disponibles, la frontière linguistique à cette date, nous estimons qu’elle devait passer bien au sud des Montes de Vitoria et peut-être effleurer la localité de Treviño. À cet égard, il faut souligner que nous disposons tout de même d’indications très précises, mais beaucoup plus tardives (1787), qui nous ont permis de mieux délimiter le territoire de l’euskara en Alava et, par récurrence, d’attester a fortiori la situation au cours des deux siècles précédents.
Au début du XVIIIème siècle, le basque en Navarre se situait au niveau des localités alavaises de Larraona et Contrasta, et dépassait largement la Sierra de Urbasa, ce qui pourrait nous conduire à tracer une ligne de démarcation basque/castillan qui s’approcherait de la vallée d’Arana et d’Arraya.
Comme en Navarre (1587), c’est un document ecclésiastique de 1787 - intitulé Pueblos de Alava por Vicarías - qui nous a fourni les données les plus précises sur la géographie linguistique de cette province qui n’était encore, à l’époque, qu’une partie du diocèse de Calahorra. La raison pour laquelle cette liste des villages bascophones fut dressée résidait dans la nécessité de définir une norme pour procéder à la sélection des curés admis à participer aux concours du diocèse, sélection qui devait tenir compte de la situation sociolinguistique de chaque paroisse ou lieu de culte. Voici ce que dit le document en question à ce propos:
Parlent le basque de nombreux villages du vicariat de Vitoria, tous ceux du vicariat de Gamboa, la plupart de celui de Salvatierra, ceux des vicariats de Mondragón, Cigoitia, Zuya, Orduña, Ayala, Orozco et Tudela dans lesquels il serait pour le moins inutile d’admettre par voie de concours des curés ignorants de cette langue.
Ce récit se poursuit par la description de la situation socio-économique des Alavais qui sont présentés, à l’exception des habitants de Vitoria et des quelques artisans de la province, comme des "cultivateurs d’une terre ingrate". Le document insiste également sur les conditions très particulières de la mission pastorale en Alava, contrée à laquelle "cette petite rente (...), ce climat rude, froid et désagréable, cette langue basque" ôtaient tout attrait aux yeux des éventuels postulants qui auraient pu venir d’ailleurs. Sur la carte ci-jointe, figure la liste complète des villages bascophones d’Alava à la date indiquée.
|
L’Alava bascophone, en 1787 : Elaborée d’après le document Pueblos de Alava por Vicarías (1787), cette carte réserva une surprise à son auteur. Celui-ci, après avoir reporté un à un les noms de villages dont le document fournit la liste sur la carte d’Alava de l’époque, découvrit avec stupeur une situation qu’il ne soupçonnait pas: en effet, à la fin du XVIIIème siècle, Vitoria-Gasteiz était encore largement entourée de villages euskarophones. C’était là une information inédite qui révélait un pan d’histoire passé sous silence. Le lecteur contemporain n’ignore pas que ces données détaillées de 1787 doivent, évidemment, être replacées dans une perspective historique plus large qui suscite toujours de multiples interprétations. |
Sur le recul de l’euskara au XVIIIème siècle, l’historien alavais Landázuri nous a laissé un témoignage précieux: "depuis quelques années, cette langue y est [en Alava] manifestement sur son déclin. Et il est établi que la disparition du basque dans les confréries de la plaine alavaise, où l’usage de cette langue s’est aujourd’hui perdu alors qu’elle y a toujours été parlée, a eu lieu dans le courant de ce siècle, il n’y a que quelques années de cela. [...]. En dépit des grandes pertes subies par le basque en Alava, il s’y est maintenu dans vingt-deux confréries". En effet, c’est bel et bien au XVIIIème siècle que l’hispanisation de la province s’est accélérée, préfigurant ce qui allait se passer un siècle plus tard en Navarre. Landázuri y voit deux causes: la présence de plus en plus nombreuse de curés qui ignoraient la langue de leurs paroissiens, et la proximité de la Castille.
Depuis deux cents ans, le territoire hispanophone unilingue a progressé de la plaine vers la montagne, grâce aux effets conjugués de la scolarisation, de l’administration et du service militaire. Cependant, au cours des dernières décennies, les changements démographiques (1950-1990) et institutionnels (1975-1991) ont été plus favorables à la langue basque dont l’importance relative s’est accrue. Il est à espérer que le nouveau climat social, plus propice à la mise en valeur du patrimoine culturel alavais, permette de faire renaître la présence ancestrale de l’euskara dans les villages d’Alava.
Le Moyen-Âge navarrais a laissé une abondante documentation sur l’enracinement géographique et social de l’euskara dans l’ensemble du royaume. Nous en avons d’ailleurs déjà parlé plus haut.
|
Un euskara millénaire : Tous les historiens s’accordent pour admettre que l’euskara était la langue propre à la gens vasconica de l’Antiquité, qui occupa grosso modo le territoire de l’actuelle Navarre (sans écarter la possibilité que d’autres langues aient pu exister à certains moments dans des zones précises). La continuité de ce basque originel s’est reflétée fidèlement dans les Vascons du Moyen-Age, les "Navarrais" du royaume indépendant et les habitants de la Navarre des Temps Modernes. Ce n’est qu’à l’époque contemporaine que le basque navarrais a cédé du terrain à une vitesse vertigineuse. La carte ci-jointe illustre graphiquement cette évolution géolinguistique (carte originale établie à partir de sources diverses). |
|
|
Tafalla, un front de résistance : Aux confins de la Navarre montagneuse et aux portes de la Ribera, Tafalla est une ville qui, historiquement, symbolise la résistance séculaire de l’euskara à la progression du castillan vers le nord. Aux abords de Tafalla, les bascophones ont défendu énergiquement la frontière linguistique pendant des siècles, aidés en cela par ceux de Valdorba sur leur flanc nord. |
Au bas Moyen-Âge, l’euskara a dû commencer à voir son rôle social diminuer dans les régions de la Ribera qui avaient été en partie repeuplées par des bascophones aux siècles précédents. Néanmoins, la ligne de faîte de la moyenne Navarre, promontoire qui surplombe la plaine de la Ribera (Sangüesa, Ujué, Tafalla, Mendigorria, Estella) montra des siècles durant une telle résistance qu’il était possible, en 1820, de trouver des bascophones unilingues à Puente la Reina.
|
Conscience sociolinguistique (texte, 1662) : Ce court texte est à la fois un constat (celui de l’affaiblissement de la langue basque sur le plan social) et une revendication (en faveur de son utilisation dans les organismes officiels). Il faut noter que la demande porte aussi bien sur l’usage écrit qu’oral du basque. |
François Xavier, illustre personnage religieux de Navarre représente par sa propre histoire la situation géolinguistique du Royaume dans la première moitié du XVIème siècle. Pour concrétiser son histoire avec des données même tardives, son biographe nous rappelle que "dans la Merindad de Tafalla, la frontière linguistique basque, s’étendaient encore en 1708 au moins jusqu’à Barasoain, et dans la Merindad d’Estella en 1677 au moins jusqu’à Artazu, Arzoz et Viguria, et en 1643 jusqu’à Lezaun". François Xavier naquit au sud de cette démarcation à la limite de l’Aragon (1506) et vécut dans son château natal de Xavier jusqu’à l’âge de 19 ans. C’est là qu’il apprit ses deux premières langues: d’une part le basque dans sa famille bascophone (de la région du Baztan et de la Basse-Navarre) et avec ceux qui arrivaient des provinces voisines encore bascophones au château et d’autre part la langue romane de son entourage géographique immédiat. Ce qui explique pourquoi le missionraire navarrais désignera l’euskara comme "sa langue naturelle bizcayenne" (1544), terme très étendu à cette époque.
Dans la Navarre du XVIème siècle la géographie linguistique et la coexistence de langues sont bien exprimées dans la vie de celui qui naquît dans une zone de contact de langues et dans une famille provenant de régions diverses. Les auteurs contemporains ressentirent cette complicité sociolinguistique et le besoin d’une réponse pastorale adéquate comme il en est fait état dans le Chapitre de la Cathédrale de Pampelune.
|
La Pampelune bascophone (1604) : Au début du XVIIème siècle, les autorités de Pampelune prirent prétexte de l’inadaptation des services religieux à la situation linguistico-pastorale de la ville pour exiger plus d’égards vis-à-vis des bascophones qui y vivaient. Les arguments avancés pour faire entendre leur cause sont particulièrement intéressants. |
Même si les éléments qu’il fournit doivent être corrigés à la lumière de données plus récentes, le document qui illustre le mieux la géographie linguistique du royaume de Navarre au XVIIème siècle est un rapport sur les villages du diocèse, classés en fonction de leur situation linguistico-pastorale, établi par l’évêché en 1587. Sur la carte ci-jointe, figurent les deux frontières méridionales de l’euskara navarrais à cette époque: celle du territoire bascophone unilingue, qui passe au sud de Cáseda et Ujué, et celle de la zone bilingue, plus au sud, qui pourrait englober des localités comme Carcastillo, Olite ou Los Arcos.
Les historiens navarrais avaient pleinement conscience du fait que la Navarre était un territoire globalement bascophone dont la géographie et la société avaient aussi permis le développement de foyers de population non bascophones, et même l’apparition d’une langue romane spécifique au Moyen-Âge. À cet égard, les historiographes les plus représentatifs sont les pères Moret et Alesón.
Dans ses Annales del Reyno de Navarra, José de Moret (1615-1687), natif de Pampelune, retraça l’histoire immémoriale du basque "sur lequel - écrivait-il - sont passés tant de siècles", rappelant qu’il avait des racines vasconavarraises. En outre, il mettait l’accent sur le droit des citoyens navarrais à exiger qu’on respectât leur volonté de défendre la langue "primitive et originelle de ces régions":
Si c’est la langue primitive, commune à toute l’Espagne, qui a subsisté comme un témoignage de sa liberté [telles étaient les théories de l’époque], pourquoi blâmer le fait de la parler? [...]. S’il n’est pas reproché aux autres peuples d’avoir, par un coup du sort, complètement perdu leur langue, pourquoi jeter au visage des Basques d’avoir conservé la leur, pourtant affaiblie et moins riche?
Moret décrivit la situation générale de la langue basque, dans la Navarre du XVIIème siècle, en ces termes: "dans certains villages, le commerce traditionnel avec les frontaliers l’a fait disparaître; dans d’autres, les villageaois parlent indifféremment le basque et la langue commune d’Espagne; toutes les régions montagneuses l’ont gardée comme langue unique". Ce constat devait correspondre à une division tripartie du royaume en deux zones unilingues et une zone bilingue. Il faut y relever l’affirmation selon laquelle toutes les régions de montagne ne parlaient qu’une seule langue, l’euskara, car nous savons, par d’autres sources, que le terme "montagne" employé ici recouvre également les régions montagneuses de la moyenne Navarre.
Aussi, ne faut-il pas nous étonner que la première œuvre d’une certaine importance consacrée au sujet et imprimée dans la Péninsule (1621) ait été écrite par le licenciado Juan de Beriain, abbé d’Uterga à Valdizarbe, au sud de la Sierra del Perdón. La préface de cet ouvrage laisse transparaître l’inquiétude d’un homme qui se soucie de la valeur symbolique et identitaire de l’euskara, et des objectifs éducatifs à poursuivre pour le valoriser culturellement:
J’écris en basque parce qu’il n’existe aucune nation au monde qui n’ait été fière de la langue propre à sa patrie et d’enseigner dans les écoles à la lire et à l’écrire. C’est pourquoi il est juste que nous aussi aimions notre langue basque.
Par cette réflexion sur le système scolaire, Beriain anticipait sur le débat de la Sociedad Bascongada qui, plus de 150 ans plus tard, allait s’interroger sur le bien-fondé d’enseigner l’euskara à l’école. Beriain fut donc un précurseur clairvoyant à l’instar d’un autre Navarrais, Fermín de Ulzurrun, lequel réclama un usage officiel - écrit et oral - du basque dans l’enceinte des tribunaux du royaume afin d’empêcher sa disparition dans la société.
Bien qu’un document de 1695 nous ait appris qu’à cette date, un euskara subsistait encore assez "loin", à Tafalla et dans ses environs, les auteurs du XVIIème siècle remarquèrent très tôt des évolutions dangereuses dans les habitudes linguistiques des populations en contact avec le castillan. Pourtant, malgré ces craintes naissantes, la bascophonie était toujours une réalité bien vivante en Navarre. La preuve en est qu’entre 1771 et 1821, Joaquín de Lizarraga, curé d’Elkano, se vit obligé de rédiger en euskara l’énorme production littéraire qu’il destinait à ses paroissiens de la vallée d’Egüés, à l’est de Pampelune.
Une liste complète des localités considérées comme bascophones a pu être établie à partir des comptes rendus d’un procès particulièrement long - le jugement n’était toujours pas rendu en 1778 - et nous a permis de tracer et dater la frontière linguistique qui figure sur la carte. Par ailleurs, nous savons que, des dizaines d’années plus tard, le général Espoz y Mina, guérillero originaire d’Idocin (au sud-est de Pampelune, à Ibargoiti), était bascophone.
|
|
Lizarraga de Elkano (1748-1835) : Son travail littéraire et pastoral concerne la vallée d’Egüés et constitue le meilleur témoignage d’un dialecte disparu, le haut-navarrais méridional. Lizarraga nous a laissé une œuvre de presque 5.000 feuillets manuscrits (encore inédits pour la plupart) qui reflète la réalité linguistique de la société et de la région dans lesquelles il vivait. |
|
|
Solidarité de la Diputación Foral (texte-document, 1896) : Au XIXème siècle, les pertes géolinguistiques subies par l’euskara en Navarre sensibilisèrent vivement la société navarraise en crise (à la suite de deux guerres carlistes). Aussi, la Diputación Foral appuya-t-elle, en termes bien pesés, celle de Guipuzcoa qui avait proposé d’imposer aux candidats la connaissance de l’euskara comme condition préalable à l’obtention d’un poste d’enseignant. |
C’est au XIXème siècle que le recul de l’euskara en Navarre allait prendre des proportions alarmantes, phénomène qui fera réagir les membres de l’"Asociación Euskara de Navarra" et les pousser à poser la question de la valeur ethnolinguistique du basque en des termes nouveaux. Mais cela appartient à une autre période historique que nous aborderons plus loin.
Copier des archives http://www.euskara.euskadi.net/r59-734/fr qui représentent 100 Mo
Ces archives sont très très longues à télécharger en PDF.
Iluna Ehulea