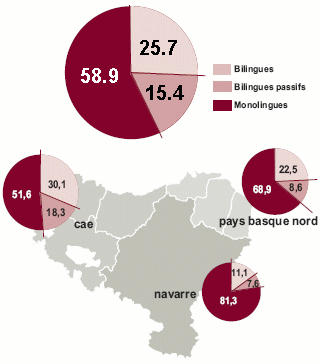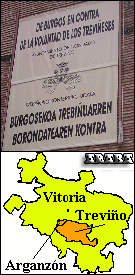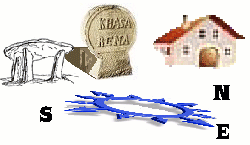Tout sur les Basques
et pour autant, si peu....
ce texte est comme toute chose vivante, une ébauche. Il évolue au fil du temps.
§ de Mutur Zikin §
Itzalaren pareko, Suntsi dire bethiko Populu handiak, Denborako nausiak, Ez ezagun tokiak : Bera Eskalduna Bizi egon dena!
Les grands peuples, les maîtres de leur temps, ont disparu à jamais, pareils à des ombres, mais non les lieux qui les connurent : le peuple basque, lui, est le seul qui ait survécu !
Jean Martin Hiribarren dans Hirugarren kanta (1853)
|
Euskaldunak
(Les Basques)
IPA: /eus.k̻a̻l̻.dunak/ (É-ouch-qwal-dounak)
|
|
|
|
|
|
Population totale : |
Environ 3 millions - Au Pays Basque
2 106 000 (70%) se considèrent Basques parmi
3 007 660 habitants (2007)
|
|
Populations significatives en : |
Provinces historiques |
|
Langue : |
Dans les 7 provinces (2006) Soit environ 41.1% des 16 ans et plus (25.7% sont des bilingues actifs et 15.4% des bilingues passifs) 52.1% : Unilingue
espagnol
|
|
Religion : |
Majoritairement catholique |
|
Gentilé : |
Basque, Basquaise, Euscarien(ne), Euskarien(ne). (fr) Euskaldun, euskal herritar, euskotar (eu) |
|
|
|
|
Groupes ethniques reliés : |
Aucun autre peuple. Plusieurs hypothèses non avérées |
|
Euskal Herria en Europe
|
|
Les Basques constituent une population autochtone implantée principalement au Pays Basque (Euskal Herria), située dans le sud-ouest de la France et au nord de l'Espagne. Une forte émigration historique a engendré une diaspora, principalement établie sur le continent américain.
Ils conservent comme patrimoine linguistique l'unique isolat européen et la seule langue non indo-européenne d'Europe de l'Ouest in situ, la « Lingua Navarrorum »[Réf] (langue des Navarrais ou « euskara »).
Leurs ancêtres proviennent d'une évolution autochtone pyrénéenne de Cro-Magnon, de culture pré-indoeuropéenne et pré-patriarcale[Réf] (néolithiques, matriarcale), puis pastorale durant la Protohistoire. Après les invasions des peuples indo-européens, non isolément et tout en constituant un organe central articulé avec les vicissitudes d'autres peuples, les Basques vont former un peuple intrinsèquement distinct[Réf]. Dès lors, leur enracinement dans cette partie de l'Europe depuis la préhistoire tend à les classifier au rang d'ancêtre.
Les Basques ou Euskariens s'auto-désignent Euskaldunak quand ils parlent le basque ou Euskotarrak, un néologisme souvent mentionné mais rarement utilisé quand ils se définissent comme ethniquement basques, s'exprimant tous en erdara (français ou espagnol) avec ou sans le basque. Le mot Euskaldunak signifie littéralement « ceux qui possèdent la langue basque », bref « les bascophones ».
Les critères anthropologiques[Réf] qui les déterminent comme groupe ethnique, peuple, population ou minorité nationale sont une combinaison de plusieurs caractéristiques dont la langue est la composante incontournable et indissociable. Une assez forte endogamie[Réf], le partage de traditions, de religion et du folklore, une identité commune maintenue face à un fort processus d'assimilation, un champ de communication et d'interaction, l'auto-identification ainsi qu'une concentration territoriale[Réf] sont aussi à l'origine de sa singularité.
Cependant les fondements d'une histoire commune sont à géométrie variable. Ayant couvert linguistiquement l'ensemble de l'Aquitaine et les 2/3 des Pyrénées vers l'an I et subit une forte romanisation, les Basques se dressent contre les invasions franque et wisigothique dans le principat de Vasconie ou de Gascogne. Au haut Moyen-Âge (du Ve au XIe siècle), la Vasconie connut une phase de consolidation territoriale : de nouvelles terres furent conquises par le repeuplement et la lutte armée, l'organisation du pays fut menée avec effort et persévérance, institutions et entités politiques diverses (duché de Vasconie en Aquitaine, et Royaume de Pampelune en Navarre en 824) furent mises en place. Les rois basques réussissent à maintenir jusqu'au XIIIe siècle certaines influences politiques et culturelles dans ce grand ensemble géographique. Après la mort du roi Sanche VII le Fort, le Royaume de Pampelune va s'effriter pendant cinq siècles au bénéfice d'États en cours de formation, tant au nord qu'au sud des Pyrénées. La chute de ce dernier au XVIIe siècle, centre de l'histoire des Basques, ne leurs permet plus d'imposer une situation juridique commune dans un état de droit[Réf]. La société basque, qui vient de traverser des périodes de lutte armée internes entre factions rivales, n'a plus assez de puissance pour s'opposer partout et assez longtemps à leurs derniers envahisseurs que sont les puissants Royaumes de France et de Castille. La suppression en 1789 du Biltzar en France[Réf], la perte des fors, éléments concrets de leur culture et de leur organisation sociale, supprimés en Navarre en 1841 et, dans les autres provinces en 1876 après l'échec des guerres carlistes ainsi que le Franquisme vont faire perdre aux Basques toute reconnaissance légitime et toute autonomie. Ce n'est qu'en 1978 que les régimes foraux furent rétablis avec les statuts d'autonomie d'Euskadi et de Navarre.
En revanche, l'anthropologie biologique a démontré récemment par l'interprétation des gènes, certaines variabilités très marquées entre une population hétérogène basque et ses voisins que sont les populations française et espagnole. Ils relèvent plutôt d'un type somatique particulier que d'un vrai groupe racial[Réf]. Mais fait exceptionnel, les Basques d'aujourd'hui sont les plus fidèles descendants de l'un des premiers groupes humains ayant colonisé l'Europe pendant le Paléolithique et qui a survécu à la dernière glaciation[Réf].
Quant au mode de vie socio-économique actuel, il est très similaire à celui qui existe en Europe, avec comme spécificités: un secteur industriel des plus développés d'Europe, un fort PIB par habitant et de nombreuses coopératives dont le plus grand groupe coopératif du monde[Réf].
Ils vivent dans la plus forte région identitaire d'Europe[Réf] devant la Flandre, les Highlands & Islands et la Catalogne. Cependant, politiquement les Basques sont divisés entre les modérés, défenseurs de la culture basque, favorables au projet européen et les radicaux qui prônent une hypothétique indépendance de l'Euskal Herria[Réf].
Le Pays Basque
Le Pays basque ou Euskal Herria en basque est un territoire qui s'étend de part et d'autre des Pyrénées occidentales sur plusieurs régions administratives dont le statut politique et juridique de chacune des provinces historiques varie en France et en Espagne, et couvre un peu plus de 20 500 km² où habitent environ 3 millions de personnes.
Si par convention, on peut faire correspondre les 7 provinces traditionnelles (Zazpiak Bat), il est difficile d'en préciser avec exactitude les contours car les frontières administratives ne coïncident pas toujours avec les frontières ethniques et culturelles. Toutefois tous ces territoires attestent une présence de la langue basque, et ce depuis plus de deux milles ans.
Le Pays basque se divise en trois entités administratives: deux communautés autonomes d'Espagne, la Communauté autonome basque, composée des trois territoires historiques d'Alava, du Guipuscoa et de Biscaye, qui constitue plus de 70 % de la population totale, et la Navarre qui représente plus de 50 % du territoire, et le Pays basque français (Labourd, Basse-Navarre et Soule), pour moins de 10 % de la population et 15 % du territoire.
Selon l'Académie de la langue basque, l'Euskal Herria désigne l'ensemble des territoires basques tels qu'ils furent nommés en 1643 par l'écrivain Axular dans l'avant-propos de son livre « Gero ». Quant aux néologismes inventés par Sabino Arana, Euzkadi désigne la nation basque et Euskadi désigne le Pays basque dans son acception politique. Ces néologismes s'additionnent à Euskal Herria, qui est une représentativité avant tout géographique du Pays Basque, et par extension socioculturelle.
Le basque ou Euskara
Le basque ou euskara est une langue non indo-européenne et est considéré comme le seul isolat d'Europe. Le basque est la plus ancienne langue d'Europe de l'Ouest in situ et dont l'origine demeure inconnue à ce jour. Parlé au Pays basque, le nombre de locuteurs en Espagne est de 734 100. En France, il y a plus de 63 700 locuteurs dans la partie ouest du département des Pyrénées-Atlantiques. Environ 20 000 personnes sont unilingues bascophones. Le basque est aussi parlé dans la diaspora basque. Le nombre total de locuteurs est de 1 234 000, bilingues passifs inclus.
La langue basque comporte une grande diversité dialectale[Réf]. Pour pallier le manque d'intercompréhension entre locuteurs de dialectes éloignés, l'Académie de la langue basque a mis en place vers la fin des années 1960 une koinè, un basque unifié (euskara batua)[Réf]. Engagé dans un processus de standardisation, d'unification et d'un développement du corpus, ce dialecte commun et nouvelle variété de basque est basé sur les dialectes du centre tels que le guipuscoan essentiellement, et le navarro-labourdin[Réf], et ce, parmi cinq ou sept dialectes[Réf] constituant un continuum dialectal[Réf]. Ne se substituant nullement aux dialectes locaux, le basque unifié investit tous les secteurs formels tels que les émissions de radio-télévision, presse écrite, Internet, recherche, enseignement, littérature, administration, etc. Dans les domaines informels, en revanche, le basque unifié cohabite avec chacun des dialectes dans un espace où se côtoient les bascophones natifs (euskaldun zahar)[Réf] et les néo-locuteurs[Réf] (euskaldun berri)[Réf]. Si au plan linguistique, le basque unifié est une forme de basque au même titre que chacun des autres dialectes, d'un certain point de vue, et de par son statut officiel, on peut le comparer à une langue comme le français[Réf].
Pour finir, et comme l'écrivit le linguiste Koldo Mitxelena, « le véritable mystère du basque est sa survivance, pas son origine ».
Autres sujets sur « Les Basques »
Sommaire
-
-
2.1 Première hypothèse : arrivée des Basques en Europe dès Cro-Magnon
-
-
3.1.1 Deuxième hypothèse : parenté entre Basques et Ibères ou Berbères
-
3.2.1 Troisième hypothèse : arrivée des Basques avec les Indo-européens
-
3.4.1 Cinquième hypothèse : relation entre les Basques et les Atlantes
-
3.5.1 Hypothèses les plus récemment discutées (déné-caucasien, albanais, proto-sarde)
-
-
-
Linguistique
-
Génétique
-
Autres indices très anciens
-
La Communauté autonome basque rassemble plus de 7 Basques sur 10 avec 2 133 300 habitants dont 303 100 hab. en Alava ou Araba (3 037 km²), 1 139 100 hab. en Biscaye ou Bizkaia (2 217 km²) et 691 100 hab. au Guipuscoa ou Gipuzkoa (1 980 km²). Officiellement : « Comunidad Autónoma Vasca » ou « Comunidad Autónoma de Euskadi » et en euskara : Euskal Autonomia Erkidegoa, Arabako Lurralde Historikoa-Provincia de Álava, Gipuzkoako Lurralde Historikoa-Provincia de Guipúzcoa, Bizkaiko Lurralde Historikoa-Provincia de Vizcaya. La capitale est Vitoria-Gasteiz. (Statistiques de 2007)
-
La Communauté forale de Navarre (« Comunidad Foral de Navarra » en castillan, Nafarroako Foru Erkidegoa / Komunitatea en basque) avec 600 200 hab en 2007. Elle se compose de 232 communes, réparties en 5 Merindades, 19 Comarques, 5 Circonscriptions judiciaires (partidos judiciales) et 3 zones linguistiques. La capitale est Pampelune (Plamplona-Iruñea). Iruñea signifie « la ville » en basque.
-
Le Labourd ou Lapurdi compte 227 800 hab., la Basse-Navarre ou Nafarroa Beherea 28 800 hab. et la Soule ou Zuberoa en basque unifié ou Xiberoa en souletin 15 500 hab. Ces 3 provinces forment la partie ouest du département des Pyrénées-Atlantiques ou Pirinio Atlantikoak avec une superficie totale de 3 182 km². La capitale est Bayonne. L'Iparralde ne représente que 9% de la population totale des 7 provinces. (Statistiques de 2007) [Réf]
-
Enclave de Valle de Villaverde ou Villaverde Turtzioz en basque.
-
Enclave du Comté de Treviño ou Trebiñu
-
Petilla de Aragón est une commune de Navarre, appelée « îles », et composée de deux enclaves dans la province de Zaragoza en Aragon, avec l'enclave principale de Petilla au nord et las Bastanes au sud. Située à 71km de la capital, Pampelune, elle appartient à la merindad de Sangüesa, d'un point de vue ecclésiastique au diocèse de Jaca et archidiocèse de Pampelune. Sa situation géographique particulière comme enclave navarraise dans des terres aragonaises est à l'origine de la polémique à savoir si l'histologiste Santiago Ramón y Cajal est aragonais ou navarrais. Ce territoire fut aussi le dernier lieu à maintenir vivante la langue aragonaise dans des terres navarraises.
-
Urduña-Orduña est une ville biscayenne située entre la province d'Alava et de Burgos. Au XIIIe siècle, Urduña est un important centre commercial mais en 1536, la ville est détruite par un incendie et cet incident va diminuer son importance économique. Au XXe siècle, l'essor de la station thermale la revitalise.
-
Esquiule ou Eskiula est une commune souletine, fondée au milieu du XVe siècle sur des terres béarnaises. L'attachement d'Esquiule à la Soule remonte au temps de Sanche IV. Faisant partie de sa propriété, le seigneur de Tardets y avait envoyé les cadets de Soule. Les premiers affièvements (terres données à des pionniers) sont datés de 1444, selon Léo Lucuix. Les vicomtes de Béarn ayant accordé une charte de franchise à Esquiule, la nouvelle « ville » fut peuplée de souletins et la paroisse n'en est pas moins demeurée sous juridiction béarnaise (dépendant tant de la subdélégation que de la sénéchaussée d'Oloron), et a été rattachée au canton d'Aramits à la départementalisation en 1790. On peut d'ailleurs préciser que le 23 janvier 1796, la population a réclamé par référendum son rattachement au canton basque de Barcus, ce qui ne lui a pas été concédé. Ces habitants ont bénéficié des mêmes droits de pacage que Barcus, mais la terre a “toujours été béarnaise, même si pendant la Révolution on avait tenté de la rattacher à la Soule. Elle fait partie de la communauté de communes du Piémont Oloronais et du canton d'Oloron-Sainte-Marie-Ouest. Depuis, les Eskiulatar ont conservé la langue et la culture basques, comme en témoigne la pastorale de 2000 sur Madelena de Jaureguiberry.
-
Sames ou Samatze est une commune bas-navarraise enclavée entre le Labourd et les Landes, dans le canton de Bidache.
-
Gestas ou Jeztaze est une enclave béarnaise qui appartient à la Soule et qui est rattaché au canton de Saint-Palais.
-
Dans les Encartaciones
-
En Alava
-
Populations urbaines espagnoles et françaises
-
En Navarre
-
Minorités gasconnes et béarnaises
-
Les Cagots ou vieille minorité historique disparue
-
Erromintxelak (Buhameak / Bukamiak) et Kaskarotak ou Bohémiens
![]() En Basque, toutes les lettres se prononcent. Le E se prononce « é
», le U « ou »,
le J « i », le Z « ç », le S « sh » et le X « ch »
En Basque, toutes les lettres se prononcent. Le E se prononce « é
», le U « ou »,
le J « i », le Z « ç », le S « sh » et le X « ch »
![]()
Origines des Basques
Les Basques sont l'objet d'études innombrables de la part de chercheurs en anthropologie, en biologie ou linguistes depuis plus d'un siècle. Un grand nombre d'hypothèses des plus sérieuses aux plus farfelues ont donné des résultats qui confirment désormais l'enracinement des Basques dans cette partie de l'Europe depuis la préhistoire et tendent à classifier le peuple au rang d'ancêtre.

Harrespil d'Okabe à Lecumberry
Les Origines des Basques sont diverses. En Europe, les Basques se distinguent de tous les autres peuples européens par la différence de leur provenance selon des caractéristiques linguistiques, historiques et des variabilités génétiques.
Recherches actuelles
Les outils actuels
d'analyse sont surtout ciblés vers la linguistique et la génétique. Ils
peuvent apporter un éclairage nouveau sur le mystère des origines des Basques.
Le projet HIPVAL
entre autres, essaye de donner des réponses sur les origines des Basques par
l'étude de l'ADN
mitochondrial ou dans le domaine linguistique.
Bien que les mots « vascon », « gascon » et « basque
» soient liés
étymologiquement, il n'y a véritablement
pas de preuves scientifiques selon lesquelles les Vascons, dont on ne connaît pas
exactement la langue (sûrement du proto-euskara)
soient les seuls ancêtres des Basques actuels. Les Vardules ou Bardyetes au Gipuzkoa et dans l'est de l'Alava,
les Caristes ou Conisci en Biscaye et dans l'ouest de l'Alava, les
Autrigons ou Allotriges à l'extrême ouest de la Biscaye et de l'Alava et les Aquitains en sont
aussi très probablement les ancêtres directs.
Voir l'article L'époque romaine.
La langue basque a été la langue du peuple ou
des peuples qui ont vécu sur les deux versants des Pyrénées occidentales depuis la préhistoire jusqu'à nos jours.
Telle est la version communément admise d'après les informations dont nous disposons. De toute évidence,
il ne s'agit pas d'une langue importée par d'hypothétiques immigrants. À partir de l'an 1000 avant Jésus-Christ
et jusqu'à la chute de l'Empire romain (476 après Jésus-Christ), les Basques établirent des contacts avec de nombreux
peuples voisins : en premier lieu, les Ibères de la Péninsule ; plus tard, les Indo-européens et les Celtes arrivés par
vagues successives (les Celtibères au sud ; les Gaulois dans la zone de la Garonne). Mais, de toutes les relations de
voisinage, celles entretenues avec les Romains se révélèrent les plus dangereuses pour la survie de la langue.
En effet, quelques 800 ans après l'arrivée des premiers Indo-Européens, les Basques virent approcher les colonisateurs
de Rome : d'abord par le sud, les Romains remontant la vallée de l'Èbre (196 avant Jésus-Christ)
; ensuite, par le nord
gallo-aquitain (56 avant Jésus-Christ). Les écrivains classiques qui nous renseignent sur ces confrontations, nous
présentent une société basque fragmentée en tribus établies sur une aire linguistique beaucoup plus étendue qu'actuellement.
Selon les nécessités du moment, les Romains et les Basques se comportèrent tantôt en ennemis, tantôt en alliés.
À la chute de l'Empire, les Romains laissèrent derrière eux un latin affaibli, mais qui, ultérieurement, allait se prolonger
dans les langues néo-latines. Et ni les Wisigoths, ni les Arabes ne parvinrent à étouffer la graine semée par Rome.
Environ mille ans après la conquête romaine, les langues romanes commencèrent à se faire entendre chez les peuples voisins
des Basques (et parfois chez certains Basques) mais, généralement, les anciennes tribus restèrent fidèles à leur propre langue.
Bien qu'ayant disparu au bout de quelques générations après l'arrivée du latin, les langues limitrophes de l'euskara, comme
l'ibère ou le celte, ont laissé des empreintes significatives dans l'épigraphie, en général latine, de l'époque. Il en va
de même pour ce premier euskara dont nous avons une trace historique, et les vestiges qu'il nous a légués, non seulement au
Pays Basque actuel mais aussi dans d'anciennes régions basques (Aquitaine, Pyrénées...), sont du plus grand intérêt pour
reconstituer le proto-basque. En ce qui concerne la langue basque ou euskara, il y existe
en Gascogne, dans le sud-ouest de la France, des indices qui démontrent que la langue parlée
avant l'arrivée des Romains, c'est-à-dire l'aquitain,
était apparentée au basque.
On a récemment découvert des inscriptions du IIIe siècle en basque dans les grottes de
l'oppidum d'Iruña-Veleia
(Alava).[Réf]
Bien que la datation ne puisse être confirmée, les inscriptions se trouvent
entre les restes d'une habitation du Ve siècle et semblent être de facture chrétienne.[Réf]
Ce sont les textes basques les plus anciens d'Espagne.
Quelques auteurs croient également que la langue basque fournit l'évidence
pour une origine de l'âge de pierre : les mots « couteau » et « hache » viennent de la racine du
mot « pierre », suggérant que la langue s'est développée quand des couteaux
et les haches ont été crée, c'est-à-dire à partir de pierres plutôt que du bronze ou du
fer.
En Europe, il
n'existe deux peuples, les Basques et les Lapons, dont on suppose qu'ils sont des survivances
du paléolithique supérieur. D'après récentes recherches génétiques, les Basques ont la
phylogénie la plus ancestrale
d'Europe avec la présence de l'haplogroupe mitochondrial U8a, un sous-groupe rare de U8,
plaçant l'ascendance des Basques dans le
Paléolithique
supérieur (entre 35 000 et 10 000 ans avant notre ère)[Réf]. L'absence de lignées U8a en Afrique donne à penser
que leurs ancêtres pourraient provenir de l'Asie occidentale il y a plusieurs dizaines de
milliers d'années. De plus, les Basques
possèdent l'haplogroupe H typique des peuples Caucasoïdes ainsi que
l'haplogroupe V. Presque toutes études génétiques classent les Basques dans une catégorie à
part vis-à-vis de ses voisins limitrophes.
Voir la
classification
des Basques.
D'autres pistes
très concrètes font l'objet d'études et de réflexions.
- Le
calendrier traditionnel basque
contient des repères solaires utilisés pour
les changements de saisons, les changements lunaires et pour le
pastoralisme.
Il était composé de 3 jours seulement.
- Certains mots ne viennent-ils pas de temps archaïques tel que
urra
(la noisette) qui précède au mot intxaurra (la noix). (des noix ont été retrouvées il y a
plus de 16 000 ans dans des sites préhistoriques.)
- Tout le cheptel
animal excepté la volaille est composé de noms d'origine basque et non latine, différent des langues
indo-européennes, en conséquence on peut penser que les Basques auraient domestiqué les
animaux
avant l'arrivée des autres peuplades venues d'Asie.
- Dans le Guipuscoa, sur
le site d'Herriko Barra, Zarautz, on
a trouvé la présence de céréales datées de 6 000 ans.
En conséquence, cela démontre que l'élevage et l'agriculture se sont développés en même temps que l'avancée des forêts de chênes,
conséquence du réchauffement climatique
durant cette période.
Première hypothèse : des Proto-Basques en Europe dès Cro-Magnon
Cette première
hypothèse semble être de loin la plus crédible et la plus étudiée. Elle stipule
qu'au début de l'ère glaciaire, les
Hommes
de Cro-Magnon situés sur le continent européen actuel auraient trouvé refuge dans les zones aux
climats plus doux : on parle de l'Ukraine et du sud-ouest européen (dans la zone pyrénéenne et dans le sud-ouest de l'actuelle France).
On peut supposer qu'un groupe humain proto-Basque ait vécu sur ces lieux.
Dès 16 000 ans avant notre ère, le climat commença à se réchauffer, et
selon cette hypothèse, cette période aurait également correspondu au début
de l'expansion de ces proto-Basques, comme l'indiquerait aussi l'expansion de la
culture magdalénienne
à travers une Europe dépeuplée. Cette culture s'exprime avec l'art
pariétal (peintures rupestres) qui orne les grottes européennes de
l'arc atlantique, autour de l'actuel Golfe
de Gascogne.
Puis vers 8 000 ans avant notre ère, les glaciers scandinaves commencèrent à fondre,
favorisant l'expansion des proto-Basques et/ou des proto-Européens dans cette même
zone ainsi que vers le nord de l'Afrique. Cette hypothèse s'appuie sur trois différents ensembles de travaux, l'un
sur la génétique (Forster et al.) et les deux autres sur des hypothèses linguistiques
(Vennemann et al.).
Enquêtes paléo-génétiques
Beaucoup plus tôt, il y a environ 30 000 ans, quelques membres de l'haplogroupe HV (mtDNA) se sont déplacés
vers le
nord à travers les montagnes du Caucase et vers l'ouest, à travers l'Anatolie, leurs lignées
sont transportées vers l'Europe pour la
première fois avec l'homme de Cro-Magnon. Leur arrivée en Europe a annoncé la fin de l'ère du
Neandertal, espèce d'hominidés
qui a habité l'Europe et des régions d'Asie occidentale il y a environ 230 000 à
29 000 ans.
La disparition des Néandertaliens semble coïncider avec l'arrivée de groupes d'Hommes anatomiquement modernes
ayant quitté le Proche-Orient pour l'Europe, il y a environ 40 000 ans, et sans doute à la faveur d'un épisode
climatique tempéré durant dernière glaciation. Ces hommes modernes, parfois appelés
« Hommes de Cro-Magnon »,
sont porteurs d'une nouvelle culture matérielle, appelée Aurignacien et caractérisée par la généralisation
du débitage laminaire et lamellaire, l'utilisation du percuteur tendre pour ces débitages, la fabrication d'outils
en matières dures animales (notamment des pointes de sagaies en os). Les hommes de l'Aurignacien sont également
les auteurs des plus anciennes œuvres de l'art pariétal et mobilier d'Europe.
Mais, quelques descendants de l'haplogroupe HV vont se scinder et constituer
leur propre groupe, d'haplogroupe H, qui par la suite va continuer sa
poussée vers l'Europe occidentale. Des
investigations paléo-génétiques (études basées sur l'ADN
mitochondrial) réalisées par l'UCM
[Réf]
indiquent que la population basque possède un profil génétique qui coïncide
avec la majorité des habitants européens et qui remonte aux temps préhistoriques.
Les études de Peter Forster[Réf]
laissent ainsi supposer qu'il y a 20 000 ans, les hommes se sont réfugiés
en Béringie
et Ibérie. Ceux qui restèrent en Ibérie présentent les
haplogroupes
H et V. De plus, ces peuples d'Ibérie ou du sud de la France colonisèrent il y
a 15 000 ans une partie de la Scandinavie ainsi que le nord de l'Afrique.[Réf]
Peter Forster, qui a étudié les gènes de 10 000 Européens, conclue que « les habitants du Vieux Continent seraient les descendants d'un groupe relativement localisé d'hommes et de femmes qui auraient habité dans la région entourant l'actuel Pays Basque, il y environ 20 000 ans
».
Ce qui revient à dire que les Basques seraient les pères fondateurs de l'Europe.
Cette hypothèse ébranlera le milieu scientifique.
Les études menées par A. Alzualde, N. Izagirre, S. Alonso, A. Alonso et C. de
la Rua[Réf]
sur l'ADN mitochondrial des êtres humains ensevelis dans le cimetière préhistorique
de Aldaieta (Alava), indiquent l'absence de différences entre ces derniers et le
reste des européens « atlantiques ».
Toutefois, d'autres études génétiques
révèlent quant à elles des singularités parmi les habitants qui peuplent
actuellement l'Europe. Certaines études, comme celles de René Herrera de l'Université de Floride et
celles de Mikel Iriondo, María del Carmen Barbero et Carmen Manzano de l'Université du
Pays Basque[Réf], distinguent différents types
de singularités parmi les Basques eux-mêmes alors que d'autres, basées sur l'étude du chromosome Y, apparentent génétiquement les Basques aux Celtes
gallois et irlandais.[Réf]
René Herrera, généticien, nous dit :
« On croit qu'ils (« les
Basques ») descendent directement de Cro-Magnon, qu'ils représentent un refuge
de la dernière glaciation et que leur ADN est très particulier »,
alors que « leur étude nous indique que chaque province
et chaque région possède un profil génétique qui se différencie de celui
des autres provinces et régions. Nous parlons des régions traditionnellement
basques et d'autres qui furent touchées par d'autres migrations péninsulaires.
Beaucoup de ces singularités peuvent être attribuées à ces migrations
provenant d'autres parties de l'Europe ou d'Ibérie,
et d'autres non. D'autant plus qu'entre les régions qui possèdent un profil génétique
majoritairement basque - dû à l'isolement - il existe des différences ».
Dans une autre étude
sur les microsatellites basques, le profil génétique des différents groupes de Basques a
démontré une division régionale distinctive (STR) et qu'ils constituent un
groupe humain clairement isolés des autres populations de l'Europe (Espagne y compris),
de
l'Afrique du Nord, et du Moyen-Orient. La ligne principale de discontinuité génétique
avec l'étude de la variabilité spatiale de la diversité de microsatellite
parmi les Basques permet d'affirmer de manière significative qu'elle correspond
à la répartition géographique de la langue basque.
L'hétérogénéité génétique parmi les groupes de Basques indigènes se corrèle
avec la géographie particulière du peuplement et sa structure matrimoniale des zones rurales
ainsi qu'avec les frontières linguistiques.
Autres hypothèses
La majorité des
hypothèses ci-dessous sont désormais fortement discutables et certaines caduques.
Mais durant des années, elles ont fait l'objet d'études très sérieuses
que la technologie et les nouvelles connaissances historiques ont remis en
question. Toutes ces études ne sont néanmoins pas vaines.
Deuxième hypothèse : parenté entre Basques et Ibères ou Berbères
La théorie du basco-ibérisme affirme que, d'une façon ou d'une autre, il existe une relation entre les langues basque et ibère, de telle sorte que le basque est une évolution de l'ibère ou d'une langue de la même famille que l'ibère. Le premier à présenter cette possibilité fut Strabon, qui affirma au Ier siècle av. J.-C. (c'est-à-dire quand la langue ibère était encore parlée dans la péninsule) que les Ibères et les Aquitains étaient semblables physiquement et qu'ils parlaient des langues similaires. Au début du XIXe siècle, l'Allemand Wilhelm von Humboldt avança subséquemment une série d'études que les Basques étaient un peuple ibère. Sur plus d'un millier de mot ibères, seulement 51 ont pu être rapprochés au basque dont 5 coïncident, 12 sont probables et 34 sont douteux. Le basque et l'ibère sont donc deux langues distinctes très éloignées linguistiquement l'une de l'autre et ce alors qu'elles furent contiguës géographiquement parlant, et le bronze de Botorrita le prouve.
Les critères de Greenberg, parmi lesquels l'agglutination et l'ordre des mots, appliqués honnêtement au basque par Antonio Tovar ont mis en lumière une ressemblance entre berbère et basque, les deux langues appartenant par exemple au dit groupe III caractérisé par l'ordre des mots SOV soit Sujet-Objet-Verbe. Mais selon Charles Videgain la méthode ne semble pas montrer un assez grand nombre de traits communs pour aller plus loin. De plus, la preuve, que le basque et l'ibère ne sont pas des langues parentes a donné un coup sérieux à cette théorie qui tendait à présenter comme bloc plutôt homogène basque et ibère dans leurs relations avec les langues hammito-sémitiques. S'il est prouvé que l'ibère est venu d'Afrique, on ne peut en déduire que le basque ait connu la même origine.
Troisième hypothèse : arrivée des Basques avec les Indo-européens
Une théorie
alternative concernant l'origine des Basques consiste à postuler leur arrivée
avec les peuples indo-européens il y 4 000 ans. Il existe des exemples
d'événements similaires. Ainsi, durant les migrations
germaniques qui déferleront sur l'Europe après la chute de Rome, la très
grande majorité des tribus était indo-européenne, excepté les tribus Huns
et Avars. Cependant, il n'y a
pas de preuves qu'un idiome indo-européen eu été parlé dans la péninsule
et, par conséquent, on ignore si des peuples indo-européens s'y sont
vraiment établis il y a 4 000 ans - soit 2 000 ans av. J.-C. Certains
chercheurs ont proposé des similitudes entre le basque et les langues
caucasiennes, particulièrement le géorgien,
en argumentant qu'un groupe de Caucasiens pourrait s'être joint à
l'invasion de l'Europe par les peuples indo-européens. D'un point de vue
grammatical et typologique, ils comparent les objets en langues agglutinantes et
ergatives, et avec le même
système déclinatif. L'autre point évoqué par les tenants de l'hypothèse
caucasienne est que le verbe basque conjugué, comme dans bien des langues du
Caucase, porte en lui des marques qui ne correspondent pas seulement au sujet
mais aussi à l'objet et au bénéficiaire. Cependant, la possible relation de proximité linguistique
entre le basque et les langues caucasiennes est niée par des auteurs de la
stature de Larry Trask, qui affirment ne rencontrer aucune occurrence permettant
de soutenir cette thèse. Hors du champ linguistique, il n'a pas encore été
trouvé de donnée historique qui atteste d'un contact entre les deux
populations. Cette contestation est d'ailleurs appuyée par la
proximité génétique découverte entre les Basques et Celtes d'Irlande et de
Galles.
Quatrième hypothèse : Euskarisation tardive
En linguistique et
ethnographie, Euskarisation
tardive (de l'espagnol vasconización tardía) est l'hypothèse, défendue
par beaucoup d'experts, qui place au Ve
ou VIe siècle EC
l'arrivée des premiers bascophones en Ibérie
jusqu'au nord-est de l'Aquitaine. Aucune de ses théories n'est complètement
acceptée nonobstant quelques résultats archéologiques
semblent confirmer la présence de la langue basque en Alava
entre le IIIe et le IVe siècle
EC. Vers la fin de la république romaine et pendant les premiers siècles de
l'empire, une migration de Bascophones venus d'Aquitaine va supplanter des
populations autochtones dont le substrat
antique serait indo-européen. Cette migration augmenterait avec un pic au VIe
et VIIe siècle. En vertu de
cette hypothèse, les premiers « bascophones » seraient des
Aquitains qui se seraient « superposés » aux habitants « vascons »
romanisés dès le Ier siècle,
dans une migration continue jusqu'au Ve siècle.
Dans son livre de 2008, Historia de las Lenguas de Europa, le philologue
et helléniste espagnol
Francisco Rodríguez Adrados a repris la discussion en arguant du fait que la
langue basque est plus ancienne en Aquitaine que dans le Pays Basque espagnol,
et qu'elle est parlée maintenant sur son territoire en raison de la pression
des invasions celtiques. Cette théorie est la « vasconisation tardive de
la dépression basque ».
Le prestigieux linguiste Koldo
Mitxelena opposa de nombreux contre-arguments, toutefois les études de sépultures,
et plus particulièrement de corps de morphologie aquitaine s'y trouvant,
renvoient à une migration importante datée des Ve
et VIe siècles, ce qui
donne de nouvelles perspectives à cette hypothèse, d'autant qu'on ne
trouve la trace écrite d'aucune invasion autre que celle des Huns,
des Alains et des Germains (Vandales)
durant ces deux siècles. Les prospections faites indiquent que des vestiges
d'installations celtiques apparaissent au-dessus d'une première « coupe »
indigène. Ces différentes cultures ont cohabité, avec cependant une suprématie
sociale des Celtes. Ces Indo-européens se superposeront de façon étendue et
profonde au substrat prénéolithique antérieur, mais seront ensuite débordés
par la présence aquitaine. Au printemps 2006, des inscriptions en euskara datées
entre les IIIe et VIe siècles
furent découvertes dans l'oppidum romain de Iruña-Veleia (Alava). La
datation est à confirmer, toutefois ces inscriptions, qui pour certains
renforcent cette théorie et pour d'autres la remettent en question, se
trouvent dans les restes d'une habitation du Ve siècle[Réf],
découverte avec d'autres vestiges dans la vallée du Cidacos,
dans la Communauté autonome de la
Rioja. Dans tous les cas, une migration aquitaine n'indique pas s'il y a
eu ou non des Basques dans le lieu d'arrivée, ni n'explique leurs origines
si l'on ne résout pas en même temps la précédence des Aquitains. Beaucoup
considèrent ceux-ci comme Basques, qui, dans le cadre de la première hypothèse
évoquée, procèdent de la sédentarisation de groupes humains sur l'arc
atlantique au temps de la dernière glaciation.
Cinquième hypothèse : relation entre les Basques et les Atlantes
D'après ses écrits, Edgar Cayce relate de la migration des Atlantes fuyant la destruction finale de la dernière île 10 000 ans avant J-C, issue de trois immenses masses terrestres au milieu de l'océan Atlantique. Atlantis ou l'Atlantide possédait la maîtrise parfaite de l'énergie nucléaire, la télépathie, le courant électrique, la propulsion mécanique de vaisseaux maritimes et aériens, une médecine très sophistiquée…etc.[Réf] Elle entraîna sa propre destruction et l'immersion du continent. Cayce relate que plusieurs des survivants allèrent en Amérique du Nord, en Égypte, dans les montagnes pyrénéennes alors que peu allèrent vers le désert du Gobi. Les archéologues ont constamment avancé que les Basques sont arrivés dans cette région entre 13 000 et 8 000 ans avant J-C. Si cette théorie est validée, alors il faut s'attendre à ce que l'ADN basque soit en lien avec l'ADN originaire du Sud-ouest de l'Europe, l'haplogroupe V.[Réf] Dans la génétique humaine, l'haplogroupe V est un haplogroupe d'ADN mitochondrial humain (mtDNA). L'haplogroupe V est censé être apparut approximativement il y a 12 000 ans, probablement en Ibérie. On le trouve avec des concentrations particulièrement élevées dans la population de Sami en Scandinavie nordique, aussi bien que chez les Basques (12%). haplogroupe V dérive de l'haplogroupe HV, qui a également donné la lignée de l'haplogroupe H (dont possède la moitié des Européens, Nord Africains et Moyen Orient). Les faits décrits sont les suivants, les échantillons dentaires et os prélevés sur 121 individus situés sur les sites préhistoriques basques, datant de 3000 à 1400 avant EC, ont démontré une présence élevée de l'haplogroupe H (37.2%) et plus surprenant l'haplogroupe X (9..1%). Cela conclue qu'entre 9000 et 3000 avant EC, des groupes humains avec l'haplogroupe X vivaient dans cette région. Cet haplogroupe X est présent chez, les Algonquins (25%), Sioux (15%), Nuu-Chah-Nulth (11%–13%), Navajo (7%), Yakima (5%), et parmi les Yanomami (12%) et récemment, certains archéologues anglo-saxons ont trouvé des similitudes entre l'industrie solutréenne et les outils tardifs du site de Clovis (Nouveau-Mexique, États-Unis). Avec toutes ces analyses scientifiques, certains ont alors suggéré que les solutréens avaient traversé l'Océan Atlantique durant l'époque glaciaire en longeant ses rivages glacés par cabotage, à l'aide de techniques de survie similaires à celles du peuple inuit actuel. Des recherches sur l'ADN mitochondrial de type "haplogroupe X" présent en Europe et chez certains peuples d'amérindiens indiqueraient la présence d'une lignée européenne ; de plus, les ressemblances trouvées par certains linguistes entre les langues pré-indoeuropéennes que sont le basque et les langues algonquiennes iraient dans le sens de cette thèse. Toutefois, cette hypothèse reste très controversée et il semble plus probable que les similitudes entre pièces bifaciales solutréennes et amérindiennes résultent de convergences morphologiques. Pour Cayce, l'haplogroupe X est le lien génétique qui lie les Basques aux survivants de l'Atlantide.
Hypothèses les plus récemment discutées (déné-caucasien, albanais, proto-sarde)
Plusieurs hypothèses font encore l'objet de recherche et concerne la paléolinguistique. La recherche d'une langue originelle, également appelée langue-mère ou protolangue originelle, a amené depuis un siècle plusieurs linguistes à émettre différentes approches scientifiques pour expliquer les origines du proto-basque.
Déné-caucasien
D'après les derniers travaux sur l'origine des langues de Merrit Ruhlen, ce dernier réaffirme que le basque est bien issu d'un groupe de langues non indo-européennes, et que l'on nomme déné-caucasien. Le déné-caucasien constituerait une famille formée de langues éloignées les unes des autres et sans continuité territoriale actuellement ; le basque dans les Pyrénées, les langues du Caucase, l'iénisséien en Sibérie sur les bords du fleuve Iénisseï, le bourouchaski au nord du Pakistan, le sino-tibétain en Chine et Tibet, le na-déné en Amérique du Nord sur la côte méridionale de l'Alaska mais aussi au sud-ouest des États-Unis – apache et navajo. En effet, Ruhlen avait déjà été remarqué des points communs entre le basque et des langues parlées dans les montagnes du Caucase, comme l'ancien géorgien par exemple. Selon Ruhlen, c'est par conséquent bien vers la région du Caucase qu'il faut chercher l'origine de la langue basque ou du moins de son groupe de naissance. C'est ensuite que les Basques ont développé sur leur terroir des caractéristiques propres. Depuis sa parution en avril 2007, cet ouvrage est au centre des débats entre linguistes, généticiens et archéologues. Ces derniers lui reprochent principalement d'avoir extrapolé dans l'inconnu. Cette thèse prolonge les vues de Heward Sapir, persuadé que le groupe na-déné constitue un ensemble tout à fait à part parmi les langues amérindiennes et qu'il est à rapprocher du sino-tibétain. Puis, dans les années 1980, Sergueï Starostine élargit le cercle de famille en proposant une connexion entre le sino-tibétain et le proto-caucasien et le proto-iénisseien, confirmé en cela par Sergueï Nikolaïev. Vers la même époque, John Bengston est convaincu que le basque et le bourouchaski sont liés au groupe jusqu'alors simplement déné-caucasien. Les six groupes sont là rassemblés.
Proto-sarde
D'autres paléolinguiste, tel que Michel Morvan considère qu'il existe des éléments ouralo-altaïques en basque et plus généralement une couche linguistique qui appartiendrait à un substrat nord-caucasien, le basque serait supposément constitué de plusieurs substrats. Il postule l'existence d'une famille ouralo-altaïque qui s'étendrait sur la quasi-totalité de l'Eurasie avant l'arrivée des Indo-Européens, de la Hongrie jusqu'au Japon. Selon le linguiste et bascologue, il faut comprendre qu'il y a des parentés proches (ibère, paléosarde, paléocorse par exemple) et des parentés éloignées (caucasien, dravidien, sibérien, etc.) Avec les travaux de E. Blasco Ferrer sur la toponymie de la Sardaigne, notamment dans la région reculée de la Barbagia et de Nuoro qui a résisté plus longtemps à la romanisation et en l'absence de données sûres concernant l'ibère, ce dernier constate que la langue la plus proche du basque (hormis l'aquitain) est la langue proto-sarde pré-romane.
Albanais
Autre piste, celle de l'albanais. Les langues thraco-illyriennes ou paléo-balkaniques sont le regroupement de langues indo-européennes de l'antiquité parlées dans les Balkans et ses régions limitrophes, et dont est issu l'albanais moderne, seule langue du regroupement qui n'est pas éteinte. Selon Alfredo Trombetti, les Pélasges, qui sont à la source de la civilisation grecque, et les Thraco-Illyriens avaient des civilisations hautement évoluées et occupaient les régions du Danube à l'Égée et de l'Italie à la mer Noire. Parlant une langue commune, il semblerait que le basque et le caucasique soit le résidu de tribus pélasgiques ayant migrées. Par contre Édouard Philipon qui reconnaissait une parenté entre les Ibères, les Ligures et les Illuriens, ne liait pas les Basques et les Ibères. Quant aux similitudes linguistiques basco-albanaises, tel que le système vigesimal, les suffixes du participe passé ou déterminatifs et autres vocables usuels, elles démontrent quelques parentés linguistiques.
Selon
d'autres linguistes tels que
Robert D'Angély et
Mathieu Aref, il
existerait une proto-langue indo-européenne dont sont issues toutes les autres,
et d'abord le grec et le latin. Cette langue est l'ancienne langue des Pélasges,
nom donné par les Grecs anciens aux premiers habitants de la Grèce, avant les
grandes invasions achéennes, éoliennes et ioniennes. Cette dernière aurait donné
ensuite l'illyrien, le thrace, l'étrusque, etc, et serait l'ancêtre de toutes
les autres langues, telles que le celtique ou le basque. Son monosyllabisme en
serait un symbole. Pour Robert d'Angély, la langue des Pélasges n'aurait pas
disparu, mais se serait conservée dans l'albanais actuel. Il considère d
'ailleurs cette langue comme précurseur du grec ancien en Grèce et de l'étrusque
et du latin en Italie.
Répartition géographique
EuropeLa plupart des Basques vivent dans les sept
provinces historiques du Pays Basque (20 747 km²) et se répartissent
sur un territoire situé sur le 43ème parallèle entre la France et l'Espagne, à proximité du golfe de Gascogne (Mer Cantabrique)
et à lʼextrémité occidentale de la chaîne des Pyrénées à la cordillère Cantabrique,
en résumé de Mauléon-Licharre
à Bilbao. Le Pays Basque peut être présenté de trois façons
selon si l'on se base sur :
Trois provinces historiques au nord des Pyrénées en Iparralde ou Pays Basque français : Ils ne représentent que 9% de la population totale du Pays Basque. |
|
||||||||||||||||||||||||
Enclaves et fragments administratifs
Le Pays Basque compte 685 communes et 76 passeries (facerías ou parzonerías), incluant Eskiula (en Soule), Villaverde Turtzioz (en Bizkaia) et Trebiñu (en Araba). La distribution par territoires est la suivante : Araba 53 municipalités, Bizkaia 113, Gipuzkoa 88, Labourd 41, Basse-Navarre 75, Navarre 272 et 43 communes en Soule. 70 des 76 facerías se trouvent en Navarre.[Réf] Il existe 3 enclaves administratives dont le Comté de Treviño, Valle de Villaverde et l'exclave administrative de Petilla de Aragón, 1 fragment administratif tel que Urduña et 3 communes françaises Sames, Gestas et Esquiule.
- 1 : Enclaves administratives
 |
Tout comme el contado de Treviño, ce territoire est toujours réclamé par quelques partis politiques basques, bien que le président de la Communauté autonome de Cantabrie, Miguel Angel Revilla, ait déjà montré sa totale opposition à le céder. La commune est régie actuellement par une majorité absolue de conseillés issus du Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Aux élections municipales de mai 2007, le PRC a obtenu 71.90% avec 6 conseillés et un pour l'IU (Izquierda Unida) avec 17.82%. Au début des années 1990, l'actuelle formation du PRC, lors d'un groupement indépendant, a publiquement demandé son rattachement au Pays Basque. La région cantabrique a dès lors décidé d'investir un million d'euros dans la municipalité et jusqu'à présent, elle est parvenue à régler le sujet sur la propriété. Malgré tout, les revendications basques, comme dans le comté de Treviñu, sont présentes partout sur les murs, les panneaux d'affichage et de signalisation. |
|
Cette enclave, composée du comté de Treviño (209 km²) et du village d'Arganzón (19 km²), appartient à la Députation de Burgos, qui avec l'assemblée de Castille-et-Léon, pour leurs parts, s'opposent à ce que le comté se sépare de la province de Burgos. Il existe une véritable revendication territoriale depuis de nombreuses années, et les forces politiques présentes en Alava réclament et considèrent ce territoire comme une partie intégrante de la province. Sa superficie de 228 km² est grande pour une population de seulement 1800 habitants. Une consultation a montré que la vaste majorité des résidants veulent être sollicités sur ce sujet avec la tenue d'un referendum. Le statut d'Autonomie de Castille-et-Léon exige, que si Treviño s'incorpore à l'Alava, il lui faut un rapport favorable de la province de Burgos et de la Communauté autonome de Castille-et-Léon, ainsi que une approbation par les Cortes Générales. Le gouvernement et le Parlement basque ont posé un recours d'inconstitutionnalité durant les années 1980 contre ce statut, qui a été rejeté par le Tribunal Constitutionnel. Une partie du nationalisme castillan revendique la propriété de Treviño alors qu'une autre partie comme la Gauche Castillane et le Mouvement Populaire Castillan, renonce à l'enclave. Pendant ce temps, le traitement des déchets et le recyclage sont gérés par la C.A. d'Euskadi et la présence de panneaux et d'affiches bilingues est plus qu'omniprésente dans tous les lieux. L'affichage en euskara est un appel du pied à l'Alava de cette petite communauté hispanophone. Les élections municipales de 2007 ont donné, 4 conseillers municipaux au Groupement Électoral Indépendant du Comté de Treviño, 5 au Parti Populaire, un pour le PSOE et un autre pour l'ANV. Le Groupement Électoral Indépendant est favorable à ce que le comté dépende administrativement du Pays Basque. Dans la commune d'Arganzón ou Argantzun, le GEI a obtenu cinq conseillers municipaux, un pour l'ANV et un pour le PP. |
En Castillan et en Basque, la mairie de Triviño affiche en grand sur ses murs « Burgos contre la volonté des Treviniens ». |
- 2 : Fragments administratifs
- 3 : Communes enclavées et détachées
Climat
 |
Le climat dans cette partie de l'Europe a joué un rôle historique, sa
diversité et la douceur durant la période glacière sont à l'origine de la survie des peuplades
proto-Basques. Grace à une grande variation du relief et à une proximité de
l'Océan Atlantique, les Basques ont le privilège de vivre sur 4 zones climatiques différentes
malgré la petite taille du territoire : |
Minorités Non-basques
Plus de 70% de la population de l'Euskal Herria se considère basque, basque français ou basque espagnol. Mais 30% de la population affirme ne pas faire partie de ce groupe ethnique. Ce sont pour la très vaste majorité des citadins venus de France ou d'Espagne.
Voir la carte des influences culturelles au Pays Basque
|
Les Enkarterriak (« Encartaciones » en castillan) est le nom d'une vallée à l'ouest de Bilbao, en Biscaye. Contrairement à l'Alava, la langue basque s'y était retirée depuis plus de 15 siècles. Durant la période préromaine, cette région était majoritairement peuplée de tribus indo-européennes telles que les Cantabres. On suppose que des 10 tribus ou clans cantabres (Salaenos, Orgenomescos, Avariginios, Blendios, Coniscos, Cadinienses, Concanos, Plentusios, Tamáricos et Vadinienses), seuls les Cantabris Conisci ou Coniscos étaient apparemment de langue proto-basque et peuplaient cette vallée ainsi que les environs. Lentement latinisés après la conquête, la langue traditionnelle et la culture de ces lieux sera pour des siècles le « montañés », un dialecte de la langue asturienne qui sera à son tour graduellement remplacé par le castillan, et, présentement langue de toute la population. Il faut souligner que quelques mots en asturien demeurent toujours dans les discours de la vie quotidienne. Chose nouvelle, depuis 25 ans, l'eukarisation dans les écoles a changé profondément le visage culturel de cette région et à ce jour environ 17% de la population, exclusivement les jeunes, est capable de comprendre le basque.
|
Grande peinture à la place de la Mairie de Karrantza, dans les Enkarterriak. |
|
Dès l'époque romaine, l'Alava est une des
voies de pénétration du latin vers les montagnes de la
Cantabrie. Puis s'en suit
au Xe siècle une euskarisation de la Rioja
qui
est due à l'immigration et au repeuplement qui suivirent la
Reconquête. En effet les Alavais et les Basques de l'ouest seraient
arrivés du nord pour occuper des terres vacantes et auraient alors
euskarisé La Rioja ou, si l'on préfère, renforcé la population
bascophone préexistante. Mais entre le XVIIe et le XIXe siècle,
dans la partie méridionale de l'Alava, et plus particulièrement dans la
vallée de l'Èbre, la langue
latine remplacera progressivement le basque.
De part sa faible population au début du XXe siècle et une forte
immigration espagnole à Vitoria-Gasteiz dans les années 1960-1970, la population alavaise
augmentera rapidement.
Présentement, la capitale de la Communauté
autonome basque représente
76% de la population totale de la province. Cette concentration est
d'ailleurs unique en Espagne. Mais paradoxalement, même si la population est
unilingue espagnole à plus de 73%, c'est la seconde des 7 provinces après le Gipuzkoa,
où les gens se considèrent le plus Basque avec un taux de 79%. |
Toponymie basque très importante dans la Rioja
Vitoria-Gasteiz perd l'usage du basque entre 1787 et 1850 (Première Guerre carliste 1833-1840) |
30% de la population de la Communauté autonome basque est née hors du territoire, ils viennent d'autres régions d'Espagne pour la vaste majorité et 40% des personnes vivant sur ce territoire n'ont aucun des deux parents qui y sont nés. L'augmentation de la population au Pays Basque français s'est faite progressivement passant de 205 000 habitants en 1960 à 219 000 en 1970, à 236 000 en 1980 et à 250 000 en 1990. Comme on peut le constater, il n'y a jamais eu de grands flux migratoires comme en Hegoalde. Cependant au Labourd, 44% de la population est née à l'extérieur de la province et cela est dû principalement aux retraités français qui aiment venir s'installer à proximité de la côte et au développement urbain du BAB qui ne compte aujourd'hui que 17% de bascophones.
Même si la grande majorité des Navarrais étaient d'un point de vue ethnologique des Basques qui se sont hispanisés tout au long du XIXe siècle, aujourd'hui, 53% de ses habitants rejettent l'identité basque et se déclarent navarrais et/ou espagnols. Cette singularité pose un défit pour la Navarre, car le tiers de sa population reste farouchement attachée à la culture basque et à sa langue. (Voir le concept de nation en Navarre)
Les Gascons et les Béarnais ont pour ancêtres les Aquitains ou
Proto-basques. Encore très basquisés aux VIe-VIIe siècles,
ils se sont progressivement latinisés mais il faudra attendre le XIe siècle et
les témoignages en langue « vulgaire » pour arriver à distinguer clairement les Gascons des Basques.
Plusieurs zones délimitent la frontière linguistique entre le basque et l'Occitan.
- Zone basco-gasconne : Bayonne est
une ville où le basque et le gascon se côtoient depuis des siècles, toutefois la
culture urbaine et française se sont imposées fortement au dépend principalement
du gascon. Quant à Bidache, de la fin du XVIe siècle à la Révolution française, elle
constitua une
petite
principauté qui concrètement pouvait rendre justice en dernier ressort, sans
recourt possible pour les royaumes de France ou de Navarre. C'est pour cette
raison que Bidache fut un havre pour les Juifs qui fuyaient l'inquisition
espagnole et autres malfaiteurs. D'autres villages où le gascon est plus (Samatze,
Bokale,
Lekuine,
Gixune,
Erango) ou moins (Batisda,
Akamarre,
Burgue-Erreiti)
présent.
- Zone basco-béarnaise : de part son enclavement en Béarn,
Jeztaze est souvent considéré
comme faisant partie du Béarn. Montori-Berorize est la commune de Soule la moins
bascophone, ayant été le théâtre de nombreux affrontements seigneuriaux au cours
des XVe et le XVIIe siècle et située
à la limite du Béarn, elle s'harmonise présentement dans une double culture.
Des deux côtés des Pyrénées, los « Agotes » ou Cagots (Crestias) en français furent une minorité dédaignée. Ils n'étaient pas un peuple à part, mais vécurent comme des personnes intouchables dans les villages basques. Toutefois, la société basque de l'époque ne les laissait se marier seulement qu'entre eux. Leur origine est remplie de légendes et de superstitions or le terme de « Chrestians » désignait les chrétiens ariens, de religion arianiste, religion adoptée par les Lombards, les Wisigoths et les Ostrogoths. Ces minorités ont difficilement été assimilées par la société. Selon Rochas, au XVIIe siècle, ils représentaient environ 400 habitants dans 60 maisons dans le hameau de Bozate » (Baztan), dernier village des Cagots, et « Ils parlaient la langue basque la plus pure ». Voir : Musée ethnographique des Cagots.
|
Comme dans le reste de l'Espagne et de la France,
les routes du Pays Basque ont été parcourues par des
Gitans
nomades et Mercheros (parlant le Quinqui), qui se sont liés à la société rurale
basque en tant que négociants, artisans, ou par exemple pour effectuer les déplacements de bétail. Le Guipuscoa et le Pays Basques français ont été également visités par
d'autres branches de Rroms
d'origine balkanique
(connue dans le Pays Basque comme Erromintxelak, Errementxelak, buhameak ou bohémiens).
En effet, des Romanichels ou Bohémiens vont arriver au XVe siècle
mais
contrairement aux autres Rroms situés dans le reste de l'Europe, ils vont fortement
s'intégrer
à la société basque. Ils acquièrent des dialectes
locaux, adoptant aussi des coutumes telles que le bertsolaritza et la pelote basque.
Il s'avérerait que beaucoup d'entre eux ont choisi de rester au Pays Basque pour échapper
aux persécutions perpétrées ailleurs en Europe. Néanmoins, loin d'être en
sécurité, le Conseil royal de Navarre en 1602 passa par exemple un édit
stipulant que tous « vagabonds » devaient être condamnés à 6 ans de travaux
forcés. Au XVIIIe siècle, l'emphase avait changé et on était de
plus en plus vers un processus d'intégration. En 1997, on estimait entre 500 et
1 000 le nombre de gens capables de parler l'erromintxela. Cette langue mixte
est basée sur une grammaire et une syntaxe basque et un lexique romani. |
- Kaskarotak qui vendent le poisson sur le port de St-Jean-de-Luz au début du XXe siècle. - Jeunes filles dansant le kaskarotak portent aussi des paniers (otarak) |
Diaspora
La diaspora basque est un nom donné pour décrire la dispersion des Basques dans le monde entier. Un grand nombre de Basques a quitté le Pays Basque pour émigrer principalement en Argentine et aux États-Unis et ailleurs dans le monde. On la nomme parfois la « huitième province ».
La diaspora
|
Une famille (Etxekoak) type du début du XXe siècle (Etxe = maison, Jaun = maître, Zahar = vieux, Andre = femme) 1 : Seconde fille entrera dans les ordres au couvent de Berriz. 2 : Troisième fils ira à Mar del Plata en Argentine. 3 : Fille aînée nouvelle maîtresse de maison ou etxeko andrea. 4 : Mari de la maîtresse de maison, fils cadet d'une autre famille et changera son nom famille pour celui de sa femme. 5 : le vieux maître de maison ou Jaun zahar, Aitatxi. Un veuf, l'Amatxi ou la grand-mère étant décédée. 6 : Fille aînée de l'etxeko jaunak, future maîtresse de maison. 7 : Troisième enfant de l'etxeko jaunak, immigrera à Monterrey, Mexique. 8 : deuxième enfant de l'etxeko jaunak, ira travailler à Bilbao. 9 : Quatrième fils qui deviendra berger à Ontario, Oregon (U.S.A). 10 : Cinquième fille qui se placera comme servante dans une autre ferme à Goizueta. 11 : le cadet restera à la baserri (ferme familiale) et sera l'ouvrier. |
Le sujet de la
diaspora
basque est rarement un sujet de conversation alors que l'émigration fut une
vraie saignée en Euskal Herria. Par exemple, durant tout le XIXe siècle, sur une population de 120 000 habitants en Iparralde, 90 000
émigrèrent sans que la population diminue. Entre 1776 et 1860, c'est plus
de 200 000 Basques qui partiront sur une population de 600 000 en
Hegoalde. Après cinq siècles d'émigration, on estime présentement à 4 500 000 de personnes à l'étranger
ayant des ancêtres directs basques et à 15 millions de personnes ayant une
ascendance directe (Peut être 40 millions
de patronymes à travers le monde). Les deux exemples de personnes d'origine
basque les plus connus
sont Simon Bolivar
et le Che Guevara.
La diaspora est actuellement dispersée à travers le
monde, et les personnes du groupe ethnique basque, forment une identité
collective distinctive à la culture dominante de leurs sociétés respectives. La majorité
d'entre eux s'est assimilée aux sociétés qui les ont
accueillis et a coupé les liens avec le Pays Basque. Nonobstant parmi cette diaspora,
quelques milliers de gens veulent retrouver leurs racines et ainsi se définissent
d'origine ethnique basque tout en restant attachés à la nation dans
laquelle ils
sont nés. La diaspora est une réalité culturelle plurielle, et non une
communauté monolithique
et homogène. Les personnes qui la représentent actuellement vivent
principalement en Argentine (15 000 dont 3.9 millions de descendants
(10%)) et au nord-ouest des États-Unis (58 000). Il y a en a aussi en
Allemagne (31 000), au Mexique (21 000), en Uruguay (11 000), en
Australie (10 000) et au Chili (9 000). |
Suite au vieillissement et à un renouvellement extrêmement faible des populations immigrantes, une loi fut votée par le parlement basque en 1994 avec pour objectif de définir les relations entre la Communauté autonome basque, présidé par le Lehendakari ou Président Juan José Ibarretxe, et les Euskal Etxeak. Le but est de développer des programmes pour la promotion de l'euskara avec parfois des aides financières. La diaspora promeut activement son identité au travers la danse, la gastronomie et les jeux.
Les gens ayant une ascendance basque vivent principalement dans vingt trois pays à travers le monde situé presque exclusivement sur le continent américain. Ils sont organisés et forment plus de 212 Euskal Etxeak, organisant des milliers d'activités socioculturelles chaque année en vue de maintenir la culture vivante. La première organisation moderne d'émigrants a été établie à Montevideo, Uruguay, en 1876, suivi d'une à Buenos Aires, en Argentine et d'une autre à Manille, aux Philippines l'année suivante. La diaspora reste nombreuse, dispersée toutefois elle est âgée, l'émigration s'étant pratiquement arrêtée dans les années 1960. La constitution d'établissements et de réseaux sociaux spécifiques à travers des associations, recoupe plus de 18 000 membres. Ces établissements ou Euskal Etxeak favorisent les interactions transnationales (C'est-à-dire entre Euskal Etxeak) ou transfrontalières (c'est-à-dire avec le Pays Basque). La dispersion à travers le continent américain, montre aussi une diversité linguistique ou des réalités quotidiennes au Canada par exemple qui peuvent différer grandement de celle de l'Uruguay. Depuis des générations, la diaspora s'intègre et s'adapte aux diverses populations et remodèle sa basquitude ou « basquité » (néologisme comme la « francité » au Québec).
L'Argentine détient le record de 98 Euskal Etxeak regroupées au sein de la FEVA fondée en 1955 à Mar del Plata. Aux États-Unis, lors du recensement ethnique en 2 000, 57 793 personnes se reconnaissent comme basques et plus de 41 organismes Basco-Américains (dont 4 ont nouvellement été crées) travaillent quotidiennement pour maintenir et favoriser l'identité basque, chapeauté par NABO ou North American Basque Organization. 20% des Uruguayens ont des origines surtout basco-françaises, tout comme le Chili.
Histoire de la diaspora
Deux grandes périodes d'émigration sont à dissocier dans la diaspora américaine. La première phase concerne la diaspora vers l'Amérique durant la conquête espagnole et l'émigration qui s'en suivra. La seconde phase est l'émigration vers les États-Unis et précisément vers les États du Nord-Ouest américain.
Voir l'article Corsaires et pirates basques.
En Amérique Latine :
|
En 1412, les Islandais notèrent la présence d'une vingtaine de baleinières basques situées à 500 miles à l'ouest de Grundarfjörður toutefois on suppose que les Basques viennent en Amérique depuis longtemps. En effet, depuis plus d'un siècle avant cette découverte, les Basques vont régulièrement vers les côtes du Labrador (Red Bay) et du Groenland pour y pêcher la morue, seul poisson, qui salé, se conserve pendant deux années et y chasser la baleine. Leur aide sur la connaissance de ces nouveaux territoires sera une aide précieuse à la Couronne d'Espagne. Au XVIe siècle, neuf avant-postes de pêche sont établis au Labrador et à Terre-Neuve dont le plus grand établissement est à Red Bay appelé Butus, avec environ 900 à 1500 personnes qui viennent à chaque été. En environ 80 ans, les Basques vont tuer 25 000 baleines jusqu'à presque toutes les exterminer. La surpêche et la guerre anglo-espagnole mettra fin à ces expéditions. Les réquisitions de baleinières enlèveront l'outil de pêche aux Basques et elles seront détruites pour la plupart par la flotte anglaise lors de combats. En 1492, Christophe Colomb découvre officiellement la soi-disant Amérique, mais cela modifiera à jamais et profondément le mode de vie des Basques ainsi que de tous les Européens. Malgré sa faible population, d'illustres découvreurs se feront connaître dans la conquête espagnole de l'Amérique. Le marin qui effectua la plus grande expédition maritime à cette époque est Juan Sebastian Elkano. Il fut en effet le capitaine des 18 marins et premiers hommes à faire le tour du monde, Magellan étant décédé aux Philippines durant ce périple. D'autres comme le conquérant Lope d'Agirre, connu pour sa tyrannie et sa cruauté, a parcouru les Andes péruviennes, les rivières Marañón et Amazone jusqu'à l'île Margarita, au Venezuela. |
Juan Sebastian Elkano, premier homme à faire le tour du monde.
Dans un livre de baptêmes de Zumarraga de 1526 figure le dessin d'une chaloupe et une baleine capturée. |
Le droit
d'aînesse en vigueur en Euskal Herria, qui octroyait tout l'héritage
aux fils aînés ou aux filles aînée, poussera des milliers de jeunes à prendre le
chemin de l'Amérique hispanique. Il y aura parmi eux des opportunistes - le
Paraguay ayant été colonisé par Domingo Martínez de Irala, le Mexique occidental par Francisco
de Ibarra, les Philippines par
Miguel López
de Legazpi et Andrés de Urdaneta - des religieux comme
Juan
de Zumarraga qui fut le premier évêque du Mexique, défenseur des droits
indiens, et qui rédigea un des premiers documents clef dans l'histoire de la
défense des droits humains ou
François Xavier. Même des compagnies
s'impliquent, comme la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, dans la formation du Venezuela
au XVIIIe siècle. Le plus féroce caudillo royaliste de la guerre d'émancipation américaine,
Pedro Olañeta. Esteban Etxeberria, est considéré comme étant le fondateur
de la littérature argentine. Mais le plus connu, symbole de l'émancipation
des peuples hispaniques en Amérique est
Simón
Bolívar. Nombreux sont ceux qui ont une statue, le nom d'une rue ou un
monument en
Euskal Herria.
L'histoire du Chili, ou celle du Venezuela, ne pourrait être écrite si elle
excluait la contribution des familles basques, et il en est de même pour
l'Argentine, où Juan de Garai fonda la ville de Buenos Aires ainsi que celle de
Santa
Fe au Nord. Les noms de famille basques sont communs dans la toponymie de
la
Pampa.
L'Argentine est le pays dans lequel les Euskaldunak (personnes possédant
l'euskara) ont été les plus nombreux à immigrer durant les XVIe,
XVIIe,
XVIIIe siècles. Elle en a accueilli un très grand nombre et accepta une partie du peuple basque étant donné les événements
postrévolutionnaires français, les campagnes napoléoniennes, les guerres
carlistes
et la guerre franco-prussienne qui favorisaient les départs. Ces événements
s'ajoutant aux années de mauvaises récoltes ou à l'obligation des jeunes
à effectuer le service militaire en Espagne, l'émigration devenait donc une échappatoire.
Le processus migratoire du peuple basque en Argentine s'est développé
en plusieurs étapes. La première vague d'immigration (1835-1853) est
constituée de bergers d'Iparralde. Elle a été suivie par une vague
d'immigration post-constitutionnelle vers 1853-1877 et la plupart d'entre
eux vont surtout au sud de Buenos Aires, dans la Pampa et seront plus de 200 000
à s'y installer entre 1857 et 1864. Par la suite, eut lieu une autre vague
suite à l'approbation de la Loi d'Immigration (1877-1914). La dernière
vague, de 1936 à 1945, a été principalement politique suite à la
guerre
civile espagnole et à la
seconde
guerre mondiale. Dans cette dernière, la contribution basque dans le
milieu culturel argentin a été très importante : création d'éditoriaux,
de revues, de nombreux centres culturels et folkloriques, etc. Finalement,
c'est vers 1950 que commence à diminuer la vague migratoire.
De 1853 à 1943, les Basques ont donné 10 présidents sur 22 à l'Argentine
dont le dictateur
Général
Lanusse et on estime à 16% l'apport basque à l'élite argentine. En
1958, 12 des 50 plus grands propriétaires sont d'origine basque et ces
derniers vont fonder la Bourse du commerce, des banques, se lancer dans la
finance et l'industrie. Cependant, d'autres vont s'illustrer autrement
comme le Che
Guevara, révolutionnaire communiste argentin, dont le père avait des
origines basques et la mère d'origine basco-irlandaise. Guevara vient de la
forme basque Gebara.
En Amérique du Nord :
|
Des colons basques pêchaient les baleines sur les côtes de Terre-Neuve depuis des siècles. Jacques Cartier sera le premier à découvrir le Canada au nom d'un roi. L'explorateur français savait par les récits basques qu'une terre existait à cet endroit du monde. Les Micmacs et les Montagnais sont deux peuples amérindiens qui ont développé un pidgin basque afin de communiquer de façon rudimentaire avec les pêcheurs basques. Quand John Cabot arrive sur cette terre, il y trouve une excellente côte pour la pêche à la morue et malgré la présence en outre de 1 000 bateaux de pêche basques, Cabot réclame la terre pour l'Angleterre. Avec l'interdiction de manger de la viande certains jours avec la réforme catholique du XVIe siècle, la consommation du poisson augmente, et le poisson le mieux conservé dans les longs trajets est la morue. |
Dans l'Est de l'Amérique du Nord, il y a eu
peu d'immigration sinon de façon sporadique sauf sur l'île de
Saint-Pierre
et Miquelon (30% des familles présentement sont d'origine basque). L'Ikurriña
fait partie du drapeau officiel.
Le gros de l'immigration, fut durant la ruée vers l'or en Californie vers
1849, des Basques déjà établis comme bergers dans la Pampa d'Amérique du
Sud, se joignent aux rangs des chercheurs d'or. C'est alors, que la plupart
ne trouvant pas d'or, ils retournent leur attention vers le bétail, vers leur
métier d'origine et recommencent à être bergers. Vers 1870, les premiers
bergers qui prospéraient dans l'élevage du mouton, ont ainsi ouvert
apparemment vastes territoires pour nourrir leurs bêtes, de la Californie méridionale,
près des montagnes Rocheuses, en passant par la
Sierra
Nevada jusqu'au plateau de Columbia. Être berger était un métier dénigré
dans l'Ouest américain et la plupart ont considéré leur vie d'isolement
dans un paysage dur et souvent hostile seulement comme un séjour provisoire à
la différence des autres immigrants. Dans un tel contexte, il y avait des barrières
à la création d'une vie de famille et à l'assimilation. Par conséquent,
les Basques, probablement plus que n'importe quel autre groupe immigré dans
l'histoire américaine, ont maintenu une sensibilité importante à leur
patrie. Ils ont regardé leur séjour comme un genre de purgatoire en vue de d'acquérir
un magot avant de s'en retourner au Pays.
Les Basques étaient les avant-gardistes pour développer le modèle de la
transhumance
et qui caractérise toujours l'élevage des moutons dans les grandes parties
de l'Ouest américain. Tandis que plusieurs des bergers continuaient de s'en
retourner, certains ont commencé à considérer la région pour y vivre de façon
permanente et commencé à acheter des ranchs dans l'intention de continuer à les opérer.
Un nombre de plus en plus important obtint la citoyenneté des États-Unis, et
les voyages vers la mère patrie ont commencé à prendre la forme de visites
provisoires, souvent par le but primaire de trouver une épouse pour retourner
avec elle en Amérique. On les appelait péjorativement les americanoak
au Pays, d'autant plus qu'ils avaient de l'argent et étaient souvent jalousés. 430 000
Basques français et espagnols vont venir s'installer aux États-Unis entre
1900 et 1920. Avec le temps, les Basques se sont établis dans des communautés
liées entre elles telles que celles située à Jordan Valley, ville du
Comté
de Malheur construite par ces derniers en 1915, dans l'Oregon,
l'Idaho, et
l'Elko ou le Winnemucca au Nevada. Durant les premières années du XXe, des entrepreneurs basques réussissent à augmenter leurs intérêts
dans des entreprises marchandes, le succès des Basques dans une grande variété
de secteurs ont eu comme conséquence que leur présence dans la région en tant
que capital culturel et économiques fut unique et soulignée. En même temps,
la communauté basque a commencé à favoriser des événements et des festivals
spéciaux célébrant leur culture.
Dans les années 1940, en partie due au manque de main d'œuvre occasionné par la deuxième guerre mondiale, l'industrie du mouton vivait une crise grave. Pour aider à remédier à cette situation, le congrès américain passa une série « de lois pour les bergers » qui vivaient en tant qu'étrangers illégaux. De 1950 jusqu'au milieu des années 1970, le système a raisonnablement bien fonctionné, permettant à plusieurs milliers de Basques de venir séjourner aux États-Unis. Cependant, un problème entre les propriétaires de ranch et les écologistes, limite le bétail dans les pâturages ce qui rend le salaire sans attrait. Le gouvernement américain va en conséquence réduire sa demande de bergers en les redirigeant vers l'Amérique latine (Mexique, Pérou et Chili). Vers le milieu des années 1970, ils étaient moins d'une centaine dans tout l'Ouest américain. Après un siècle et demi, les Basques ont laissé leurs marques dans l'économie rurale de l'Ouest américain. Certains sont même revenus au Pays Basque, comme Jon Andueza, réalisateur de cinéma et présentateur d'Euskal Telebista (la télévision basque) et né en Oregon. D'autres sont devenus connu, comme John Garamendi, nommé par Bill Clinton pour être à la tête du secrétariat du Département de l'Intérieur des États-Unis et gouverneur de Californie, ou Paul Laxalt, gouverneur du Nevada et conseiller de Ronald Reagan.
Inscriptions identitaires
|
On parle souvent d'appartenance « ethnoculturelle » au Pays Basque toutefois il n'existe pas de corrélation entre cultures et races, entre traits transmis par hérédité ou culturellement. D'où le caractère problématique du qualificatif « ethnoculturel ». S'il est difficile, pas impossible*, de savoir si une personne est de race basque ou pas, tout comme être de race française ou espagnole, il est par contre donné aux gens de décider d'appartenir à une communauté culturelle. C'est à chaque personne à se définir Basque ou pas. La réalité est complexe car s'il y a des bascophones et de lignée basque qui se considèrent Espagnols ou Français, il y a des Andalous qui vivent en Euskadi et se sentent Basque. Un frère peut se prétendre « Français » et sa sœur « Basque » et le troisième « Basque Français ». Le développement identitaire, les rapports sociaux ainsi que des repères historiques et actuels peuvent décider de l'orientation personnelle et l'acceptation d'un concept communautaire transnational ou national.[Réf] [Réf] Le rapport identitaire est différent en Iparralde où la langue basque, pour 62%, est partie prenante dans l'appartenance identitaire alors qu'en Navarre et dans la CAB seulement un tiers considère que pour être Basque, il faut connaître l'Euskara. |
|
Cette différence est le fruit de l'amalgame qui lie la langue et le peuple, et qui est très souvent encrée dans la mentalité française, où territorialité rime avec une interrelation linguistique, voire une interdépendance. Une identité, d'où qu'elle soit, peut naître aujourd'hui alors qu'elle n'existait pas hier et ne le sera peut-être plus demain. [Réf] C'est pour cette raison que l'identité basque est en constante évolution, et si elle a reculé durant des siècles, elle semble progresser surtout en Euskadi depuis qu'une nouvelle définition, surgit avec l'Article 7 de 1979 du statut d'autonomie, stipulant que « toute personne ayant établi sa résidence administrative dans la région jouira de la qualité de Basque. ». Ceci favorise l'intégration de minorités à une nouvelle identité basque et à un sentiment d'appartenance à une communauté de plus en plus multiethniques. * Concernant les études génétiques qui ont été faites sur les Basques, les donneurs devaient attester d'avoir au moins quatre générations d'ascendance en Euskal Herria ou dans certaines régions limitrophes, enregistrés sous des noms basques. Les personnes, âgées pour une majorité, devant être nées dans la même province étudiée[Réf]. HIPVAL a recueillit un grand nombre de caractéristiques physiologiques (Grandeur et taille du corps), prélèvements sanguins et relevés historiques familiaux. |
 |
Patronymes basques
|
En France, 800 000 personnes ont un patronyme basque (1.3% de la population totale) et 4 400 000 en Espagne (13% de la population totale). En France, la plus forte concentration de noms de familles basques se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En outre le gouvernement basque (CAB) a recensé plus de 10 100 patronymes basques ou noms de famille en les croisant avec le recensement électoral national, en Euskadi et dans d'autres communautés autonomes. Par conséquent la vaste majorité des personnes ayant un patronyme basque présentement sont des personnes unilingues espagnoles ou françaises et qui vivent hors du Pays Basque. Toutefois, la forte majorité des 1 120 000 personnes vivant en Hegoalde et ayant un nom basque peuvent exprimer avec plus de facilité leur « basquitude » et sont le plus souvent bascophones. Les études de José Aranda Aznar ont trouvé des chiffres surprenants puisque 55% des Navarrais avaient un nom basque alors que le pourcentage est plus bas en Biscaye (40%) et en Alava (37%). Cela prouve qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait de se considérer basque et le patronyme basque étant donné que c'est en Navarre que le taux d'appartenance à se considérer basque est le plus faible des 7 provinces. Dans cette province, on se considère avant tout Navarrais.. |
|
Voir l'article Les noms basques et gascons et Toponymie basque.
Déterminer avec certitude le nombre de patronymes est presque impossible. Si
la Chine avec 9 500 000 km² a 21 000 noms de famille, le
Pays Basque
avec ses 20 747 km² aurait plus de 40 000 noms. Le Pays Basque est par conséquent un des
endroits au monde à avoir la plus grande concentration de patronymes. Les noms de famille
pour la plupart correspondent
aux noms de maisons que les Basques se sont donnés au fil des siècles. On attribue toujours un nom de maison aux nouveaux venus. Mais ce nom peut faire référence à l'occupant, à son prénom, son origine ou son métier :Cela a
donné une nomenclature exhaustive, entendu qu'il faut aussi prendre en compte
qu'un même nom a aussi évolué en se
francisant ou se castillanisant. Par exemple, en basque, le nom de famille Nazabal s'écrit
soit Naçabal en français ou soit Nazábal - Nasabal - Nazaval en
castillan. Euskaltzaindia (Académie de la langue basque) a édité une nomenclature des 10 000 noms de famille les plus communs.
Cette dernière a été envoyée à chaque bureau de registre civil et à chaque court de la
Communauté autonome en vue de faciliter le processus de changement officiel
de patronymes, offert sur une base volontaire. La nomenclature établie respecte l'épellation originale, corrigeant les modifications de
l'influence
espagnole et française. En 1996, 3 682 familles ont demandé un certificat
à Euskaltzaindia, qui leurs indiquait l'épellation correcte de leur futur
nom, afin de procéder par la suite au changement de patronyme. Ces certificats ne sont pas nécessaires, si le nom de famille apparaît dans la nomenclature éditée.
Cependant, la première difficulté fut de déterminer quels
sont les noms de famille qui sont basques et ceux qui ne le sont pas, étant donné
les nombreux échanges linguistiques entre
euskara,
espagnol et gascon au cours des siècles.
[Réf]
La grande majorité des changements consiste à remplacer un
« v » par un
« b », un
« ch » par
« tx » ou un « c » par
« k » avec pour particularité que l'alphabet basque est composé de
seulement 22 lettres dont le « c », « q », « v », « w » et « y »
n'y figurent pas mais « ñ » y est à ajouter.
Le dilemme «
García
» : Un des noms de famille qui apparaît dans cette nomenclature est « García »,
Gartzia en basque. Gartzia était d'après les experts un nom de Navarre, synonyme de
gaztea qui signifie « le jeune » en basque. Il y eut un roi de Navarre
avec ce nom là, qu'il garda par la suite, étant lui-même le plus jeune
membre de sa famille. Rendu
célèbre, le nom fut vite populaire et aimé dans toute la Castille,
d'ailleurs il existe même un énoncé comme suit : « ceux qui n'ont eu aucun nom se sont appelés García
». Actuellement « García »
est le 18ième nom de famille le plus commun
au monde, le 1ier en Espagne et dans le monde hispanique et 14ième en France. Cela ne signifie pas que les
« Garcia » aient des ancêtres Basques, nonobstant,
tous ceux qui souhaitent le faire modifier, peuvent le changer en Gartzia. Les noms de famille les plus communs en Euskadi sont
Agirre et Etxeberria-Etxebarria dont la traduction est
respectivement
« haut lieu qui surplombe un terrain » et
« maison neuve ». En Iparralde, cela a donné Aguirre et Etcheverry.
Le basquisme et navarrisme
Le basquisme ou vasquismo en castillan est un sentiment d'attachement à un « environnement » basque et à sa culture de la part de personnes ou de groupes sociaux. Cette expression est utilisée dans toutes les zones du Pays Basque (Provincias Vascongadas). Selon le DRAE (Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española), le basquisme se caractérise par « l'amour ou l'attachement de choses caractéristiques ou typiques au Pays Basque ». Cette définition se différencie du terme « abertzale » (patriote) qui, selon la RAE (Real Academia Española), représenterait une position plus radicale. Souvent, le basquisme a été associé au nationalisme basque. D'ailleurs, on peut lire dans les journaux par exemple, le terme de « basquisants » (vasquistas) pour parler des militants nationalistes basques. Malgré tout, plusieurs organisations politiques basques et navarraises sont appelées « basquisantes », sans pour autant adhérer aux thèses du nationalisme basque. Entre autres, on peut nommer Batzarre, Nafarroa Bai, le PSE-EE, le Parti Socialiste de Navarre (PSN), Ezker Batua - Berdeak et Gauche Unie de Navarra-Nafarroako Ezker Batua.
Basquisme selon le nationalisme basque : À partir d'éléments « modérés » du nationalisme basque, le basquisme a été défini comme « un élément qui unit, qui rassemble, qui réduit des différences. C'est le ciment qui soutient un projet commun pour l'Euskal Herria. Un projet dans lequel toutes les différentes façons de voir le Pays Basque sont parfaitement compatibles, que l'on soit nationalistes ou pas ». Arturo Goldarazena souligne aussi que « nous avons souvent confondu le concept de basquité ou de basquisme avec celui du nationalisme, en faisant de manière préméditée une auto identification des deux concepts, en provoquant une érosion de ce qui devrait être l'axe central de la société basque : un véritable axe basquisant comprendrait les nationalistes et les non-nationalistes et sur lequel pivoterait un projet commun de pays, comme celui qui existe en Catalogne avec les principales forces politiques (CIU, PSC-PSOE, IC-V, ERC) ».[Citation]
|
Basquisme selon le socialisme basque : le PSE-EE affirme à ce sujet : « le basquisme que le socialisme basque défend se rattache profondément avec les signes identitaire du Pays. Il est libre de toute détermination essentialiste et/ou ethnique à consonance nationaliste. Notre basquisme a une vocation de dépasser la dialectique traditionnelle entre des nationalistes et des non-nationalistes pour construire, depuis le post-nationalisme, un pays à identités plurielles et divers sentiments d'appartenance, et qui sont exprimés à travers la richesse linguistique de l'euskara (d'abord) et du castillan (ensuite). »[Citation] Le socialisme basque espagnol dans les dernières décennies, est passé de l'autonomisme basque, qui reconnaissait la diversité sociale et culturelle du Pays Basque (avec des chefs comme Ricardo García Damborenea ou José María Benegas « Txiki Benegas »), au pari sur le basquisme comme seul élément intégrateur de la société basque, fruit de l'incorporation d'éléments nettement basquisants comme les affiliés d'Euskadiko Ezkerra ou le socialisme du Guipuscoa (Jesus Eguiguren ou Odón Elorza, comme figures importantes). Pour autant, Ramón Jáuregui, ainsi que l'actuel Lehendakari Patxi López, ont plutôt parié sur un PSE-EE nettement basquisant en même temps que le fédéralisme espagnol. Mais dans les faits, il existe de fortes réticences (probablement majoritaires, bien qu'omises par divers médias) chez le PSE-EE lui-même et dans le PSOE central à soutenir le basquisme comme axe intégrateur de la société basque (Maite Pagaza, sectores guerristas, Bono, etc..). L'élite est vouée corps et âmes au constitutionalisme espagnol alors que le discours basquisant chez les socialistes à surtout une saveur électoraliste. Ça à la couleur du basquisme, ça ressemble à du basquisme, mais ce n'est pas du basquisme.
Basquisme et groupements contraires au nationalisme : Il existe également un basquisme associé à des éléments ouvertement hostiles au nationalisme basque comme le Forum d'Ermua qui affirme soutenir, protéger et promouvoir la reconnaissance des victimes du terrorisme. En effet, certains membres du Foro Ermua ont déjà été attaqués par l'ETA. Leurs objectif est d'aider l'unité des forces constitutionnalistes au Pays Basque, dénoncer les actes de terrorisme avec force et détermination et éviter toute négociation politique avec ETA.
Le Navarrisme ou
Navarrismo, quant à lui, est une doctrine politique qui cherche
à interpréter ce qui pourrait être le sentiment de l'identité navarraise. Sa
définition dépend souvent de l'idéologie politique de ceux qui s'expriment. Il
existe deux navarrismes, le navarrisme espagnol et le navarrisme basque. Aussi appelé
regionalismo navarro, et tout comme le nationalisme
basque, il a ses origines dans le régime forale. Les partis politiques qui préconisent
et défendent cette tendance sont l'Union du Peuple Navarrais (UPN), allié
politique du Parti Populaire dans la communauté forale, et sa scission
centriste, présentement minoritaire, soit la Convergence des Démocrates de Navarre (CDN).
L'ensemble des votes UPN et CDN représentaient 46.6% aux
élections autonomes de 2007 et une coalition forme actuellement le Gouvernement de Navarre.
Le vasquismo et le navarrismo sont deux doctrines différentes. La première se base sur
une culture et une langue commune avec l'ensemble du Pays Basque, alors que la
seconde se base sur deux antagonismes, c'est-à-dire, un constitutionalisme
espagnol fort avec un saupoudrage de basquisme modéré. Ce terme pose tellement de
problèmes, que certains auteurs et politiciens ont la subtilité d'utiliser les termes suivants : un
vasquismo navarrista ou un navarrismo vasquista. Cela permet aux
locuteurs avisés de choisir la prédominance d'une des deux doctrines. |
Armoiries d'Espagne établies en 1981. L'armoirie de Navarre a été adoptée par Sanche VII le Fort en 1212, après la victoire des rois chrétiens de Navarre, Castille, Aragon et Léon sur les musulmans
Manifestation en mars 2007 pour dire à Zapatero que la « Navarre n'est pas négociable (avec E.T.A) »
« Notre maison, nos gens, notre nation, nous sommes l'Espagne » est une publicité sans ambigüité de l'UPN |
Étymologies
Étymologie de basque
L'étymologie du mot basque vient de « Basco » en gascon et de « Vasco » en castillan. Ceux-ci dérivent de « Vasco » en latin, ou « Vascones » au pluriel pour nommer les Vascons (les Vascons ont également donné leur nom aux gascons - adaptation gallo-romaine d'une prononciation germanique « Waskon »).
L'approche latine du /w/ soutient que la
consonne labio-vélaire
s'est typiquement transformée en une
consonne occlusive bilabiale voisée
c'est-à-dire le /b/ exprimé en gascon et en castillan, probablement sous
l'influence du basque et de l'aquitain (une langue liée au vieux basque et
parlée dans la Gascogne
antique). Ceci explique le calembour
romain aux dépens des Aquitains (ancêtres des Gascons) : « Beati Hispani
quibus vivere bibere est », qui se traduit par « Que les
Ibères
romains soient bénis de considérer l'Aquitain apparenté à l'Ibérien,
pour qui la vie (vivere) c'est boire (bibere) ».
Une autre théorie fréquente au sujet de l'origine de « Vasco
» en latin, est
qu'elle dérive de la signification latine de « boscus », « buscus » (« bosque »,
forêt en castillan) ou « lieu boisé » (bosquet). Ainsi les « Vascones »
signifierait « ceux qui vivent dans une terre boisée ». Cependant, cette étymologie
est fausse car il est prouvé que « boscus/buscus » en latin est seulement
apparu au Moyen Âge, et elle est probablement la déformation en latin classique d'« arbustus
»
(signification « plantée avec l'arbre », de « arbor », de l'arbre),
probablement sous l'influence de « busk » ou « bosk » en langue germanique,
dont l'origine est elle-même inconnue. Une autre étymologie discutée est
que le mot basque est l'altération de baste (1351), empruntée
probablement au provençal
basto, « couture à longs points » et « plis faits à une robe pour la relever ».
Une autre théorie veut que Vasco signifie toujours « de la terre boisée
»,
mais cette fois-ci à partir du mot basque moderne basoko. Baso-
signifiant « la forêt », et – ko, qui est ajouté à la fin des mots, qui
signifie « de ». Par exemple Basoko piztiak se traduit par les animaux de la forêt.
Même si basoko est un mot basque moderne, il est fort probable que cela
aurait pu être bien différent il y a 2 000 ans. Cette étymologie, populaire
parmi certains basques, est maintenant totalement critiquée par des linguistes.
|
Pièces de monnaie du Ier et IIe siècle avant J.-C. |
Pour compliquer le mystère, plusieurs pièces de
monnaie des Ier
et IIe siècle avant J-C ont été trouvées dans le nord de l'Espagne, avec
l'inscription suivante écrite utilisant un alphabet ibérien : « Barscunes ».
Les lieux dans lesquels elles auraient été monnayées ne sont pas identifiés
avec certitude toutefois les historiens avancent l'hypothèse de la région de
Pampelune ou de Roquefort,
étant donné que ceux sont des secteurs où se situaient les Vascons durant cette période.
Actuellement, on pense que « Vasco » en latin vient de la racine basque et
aquitaine employée par les Basques pour se nommer eux-mêmes. Cette racine est eusk -, qui est en effet étroitement liée au latin. Il y avait également des
peuples d'Aquitains que les Romains ont appelés les Ausci, et qui semblent
également venir de la même racine. |
Étymologie d'Euskal (Euskara, Euskaldun, Euskadi)
En basque moderne, les Basques utilisent comme
endonyme
Euskaldunak,
Euskaldun au singulier, formé de l'euskal- (c.-à-d. « basque
(langue) ») et - dun (c.-à-d. « qui possède »), ainsi l'euskaldun
signifie littéralement « locuteur basque ». Il est important de noter que tous
les Basques ne sont pas bascophones (euskaldunak), nombreux se disent
basques sans pour autant parler la langue de leurs ancêtres, En outre les
étrangers qui ont appris le basque deviennent également des euskaldunak.
Pour remédier à cet
imbroglio, un néologisme a
été inventé au XIXe siècle, avec
le mot euskotar ou
euskotarrak
au pluriel, qui signifie qu'une personne est ethniquement basque, qu'elle le
parle ou pas. Tous ces mots proviennent du mot basque qu'ils utilisent pour
nommer leur langue : Euskara. Des chercheurs ont reconstitué la
prononciation et le vocabulaire du basque antique, et Alfonso Irigoyen propose
que le mot euskara vienne du verbe « pour indiquer » en basque antique, qui était
enautsi
prononcé (esan en basque moderne), et du suffixe -(k)ara (« manière de
faire quelque chose »). Euskara signifierait ainsi littéralement la « manière de
dire » ou la « manière de parler ». Une preuve de ceci est trouvée dans le livre
espagnol « Compendio Historial » écrit en 1571 par l'auteur Esteban de Garibay de
Vasco, qui a enregistré le mot originel de la langue Basque en tant qu'Enusquera.
Au XIXe siècle, l'activiste
nationaliste basque
Sabino Arana
a pensé qu'il y avait un euzko originel à partir de la racine eguzkiko
(« du soleil » issue d'une religion solaire). Il créa par la suite le néologisme
Euzkadi pour parler d'un Pays Basque indépendant. Cette théorie sur la
racine eguzkiko est totalement critiquée présentement, la seule étymologie
sérieuse étant de l'enautsi et -(k)ara, mais nonobstant le
néologisme
Euzkadi, Euskadi dans l'orthographe régulier, est encore largement
populaire chez les Basques et les Espagnols.
Linguistique
Il existe deux genres de recherches basées sur l'étymologie. L'une concerne les toponymes ou noms de lieux, tandis que l'autre concerne les mots en basque.
Étymologie des toponymes
|
Noms de villes ou villages d'origine basque (Carte linguistique de Rohlf) |
La première recherche se penche sur le principe dit de « l'Européen ancien ». Elle suppose que les premiers Européens parlaient une langue commune, ou des langues de la même famille linguistique. Cette hypothèse est réfutée par de nombreux linguistes, qui estiment que dans un territoire aussi vaste que l'Europe, il devait se parler probablement plusieurs langues. Untermann et Tovar estiment d'après leurs constatations que les noms ont autant de racines indo-européennes que non indo-européennes.[Réf] Au début du XIXe siècle, Juan Antonio Moguel émis l'idée dans son livre « L'histoire et la géographie de l'Espagne illustrées par la langue basque » que beaucoup de toponymes de la péninsule ibérique et du reste de l'Europe pouvaient être étudiés et élucidés grâce au basque. Le fruit de ses études est une très longue liste de toponymes variés avec leurs explications, ce qui lui fait dire qu'il y avait dans la péninsule plusieurs langues apparentées entre elles et aussi au basque actuel. Cette thèse fut également soutenue par son contemporain, le scientifique allemand Wilhelm von Humboldt, qui pensait lui aussi que les Basques étaient un peuple ibère. En janvier 2003, dans « Investigación y Ciencia », l'édition espagnole du magazine « Scientific American », une étude conduite par Theo Vennemann [Réf] (professeur de linguistique théorique à l'Université Ludwig-Maximilian de Munich) et sa collègue Elisabeth Hamell (journaliste scientifique) est publiée avec la conclusion suivante ; « de nombreux noms de sites, de cours d'eau, de montagnes, de vallées et de paysages d'Europe trouveraient leur origine dans des langues pré-indo-européennes, et en particulier le basque ». Vennemann ajoute : « Il n'est pas exagéré de dire que nous, les Européens, sommes tous basques [Réf] ». Cette déclaration fut très critiquée par les bascologues et réfutée par beaucoup de linguistes.[Réf] Larry Trask en particulier, après de nombreuses critiques ponctuelles quant aux méthodes employées, conclut que Vennemann a probablement identifié une langue agglutinante, mais sans rapport avec le basque, auquel cas il peut simplement s'agir de l'Indo-européen, comme le pensent aussi Krahe, Tovar, De Hoz, Kitson, Villar et d'autres chercheurs. |
Joseba A. Lakarra critique également les thèses de Vennemann, jugeant comme Trask qu'il a utilisé des racines basques modernes qui ne correspondent pas au basque archaïque. Il pense aussi que, bien que le basque actuel soit une langue agglutinante, il y a des raisons de croire que ce n'était pas le cas auparavant.
Origine étymologique des mots
Le chercheur
José
Miguel Barandiarán, considéré comme le « patriarche
de la culture basque », présenta l'hypothèse selon laquelle l'euskara serait d'origine néolithique après analyse étymologique de divers mots basques qui décrivent
clairement des instruments et des concepts propres à la Préhistoire. Un
des exemples est le mot
aizkora (hache) qui comporte la racine aiz signifiant « pierre »,
ce qui signifie que l'instrument était alors fait de pierre, alors qu'on sait
très bien qu'à
partir du néolithique, cet outil était fabriqué en métal (fer, cuivre ou bronze).
Par contre, certains auteurs indiquent que ce mot serait plutôt voisin du latin
asciola qui
veut dire « hachette ». De même le mot arto
(maïs et millet
avant son arrivée) aurait pour racine artu qui signifie « cueillir ». Il
s'agirait donc littéralement de « ce qui se cueille », indiquant une époque où on
ne procédait pas encore à la semence, ou ni à la récolte. Mais là encore, un lien est possible
aussi avec le grec « artos » qui désigne le pain.
Les noms des arbres fruitiers typiques du Pays sont désignés par le nom du
fruit et l'indication ondo (« à côté »). Ainsi le pommier s'appelle
sagarondo,
littéralement « à côté de la pomme », et le poirier madariondo. En
fait ondo signifie ici
« tronc » (d'arbre), du latin fundum
« fond,
base ».
Une autre possibilité évoquée est qu'un précurseur de la langue basque se
soit développé en même temps que l'agriculture, il y a 6 000 ans.
Définition d'Euskal Herria
|
Euskal Herria,
Euskal Herría, Euskalerria, Euskalerría ou Eskualerria
sont différentes orthographies basques qui signifient littéralement : «
Pays de celui qui possède la langue basque »[Réf]
ou plus simplement « Pays Basque ». À l'origine, ces dénominations ont une connotation linguistique,
mais par la suite, son utilisation va évolué sur le plan anthropologique pour
finalement désigner un territoire avec
des caractéristiques culturelles et historiques bien définies (entre autres la
présence de l'euskara dans chacune des provinces historiques). Euskal Herria
fait désormais référence à l'union de la Communauté autonome basque, la
Communauté forale de Navarre et le Pays basque français. Ce concept,
comme on peut le constater, n'est pas lié à des frontières
administratives communes, dont le nationalisme basque et une part du
basquisme en tracent le projet politique. Que l'on accepte ou pas, sa
définition déborde du cadre culturel et politique, ce qui en facilite la
contestation. Cependant, même si ce projet est hautement contesté et
contestable, il est nécessaire de rappeler que l'Espagne et la France se
sont créés avec des conquêtes et des revendications territoriales aux
dépends de peuples et de
cultures très différentes dont les époques et l'objectif d'assimilation ont façonné. |
Couverture de l'œuvre magistrale d'Axular : « Gero » |
Le cadre est désormais tracé et servira par exemple de modèle pour la carte des dialectes basques de Louis Lucien Bonaparte (1869) qui joua un rôle éminent dans le développement de la bascologie. Aujourd'hui, ce modèle de carte se retrouve dans des nombreux ouvrages, magazines ou entre autres pour les prédictions météo à la télévision basque. Dans Communauté autonome basque, les Socialistes au pouvoir, toujours enclins à diviser la société basque, on redéfini l'utilisation du terme Euskal Herria en novembre 2009. Il ne sera pas utilisé pour désigner l'ensemble des sept provinces basques dans un sens politique, mais seulement dans un sens culturel et linguistique. Pour le sens politique du terme, on utilisera le mot Euskadi ou Communauté autonome basque, pour éviter ainsi que le terme Euskal Herria ne désigne l'ensemble des sept territoires du Pays Basque comme une entité ou réalité politique.
Terminologies régionales
Dénominations historiques des territoires basques :
Euskal Herria : (Voir Étymologie d'Euskal Herria ci- dessus)
Euskadi est l'évolution du terme Euzkadi, de la racine "euskal". Pour les nationalistes basques, ce terme faisait référence aux sept territoires historiques. Il est mentionné pour la première fois de manière officielle au début de la Guerre civile, le 1 octobre 1936, avec la formation du premier Gouvernement basque de l'histoire. Depuis 1979, selon le Statut d'Autonomie, il est un des noms officiel de la Communauté autonome du Pays Basque et, depuis lors, de manière généralisée correspond aux trois territoires de cette communauté. Le terme Euskadi est assumé par les "non nationalistes" basques, et dans la pratique du langage administratif commun en Espagne. Pour la plupart des nationalistes basques, ces derniers considèrent Euskadi comme équivalent à Euskal Herria, et suivant ce critère, ils la divisent en Euskadi Nord et Euskadi Sud.
Euzkadi a été inventé par Sabino Arana, fondateur du nationalisme basque. Enregistré pour la première fois dans 1896, après l'utilisation précédemment les termes "Euzkaria" et "Euzkadia" dans la seconde moitié du XIXe siècle. Avec cette graphie, il se référait aux sept territoires. Ces termes ne sont plus utilisé actuellement, excepté à de rares occasions, dans des emblèmes du Parti Nationaliste Basque ou par la diaspora. Quand certains nationalistes basques l'épèlent comme suit : Euzkadi. c'est pour lui donner la définition suivante : « la patrie de ce qui est basque ».
Hegoalde est un terme qui signifie "région Sud" et employé pour se référer aux quatre territoires situés en Espagne. Autres termes utilisés : País Vasco peninsular, País Vasconavarro, País Vasco-Navarro. En basque, la dénomination la plus formelle ou correcte est Hego Euskal Herria.
Hirurak bat (ou Irurac bat, avant que l'Académie de la langue basque régularise l'orthographe) est une formule qui signifie "l'union des trois", en référence au Guipuscoa, à la Biscaye et l'Alava. Cette formule a été aussi utilisée par la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País ou Euskalerriaren Adiskideen Elkartea créée par le comte de Peñaflorida en l'année 1765, avec pour intention le développement culturel basque. Hirurak bat peut parfois faire référence à l'union des trois provinces basques du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule.
Iparralde est un terme qui signifie "région Nord", et employé pour se référer aux trois territoires du nord, en France. Équivalent à Pays Basque français, il est très utilisé par les nationalistes basques et peut ou jamais utilisé par les unilingues francophones. Son utilisation est minoritaire au Pays Basque français et paradoxalement beaucoup plus utilisé au Pays basque espagnol.
Laurak Bat (ou Laurac Bat, avant que l'Académie de la langue basque normalise l'orthographe en euskara) est une formule qui peut être traduite par "Union des quatre" ou par "Quatre dans un" et se réfère à l'union des quatre provinces basques espagnoles. Il fut employé dès la seconde moitié du XIXe siècle, après les deux guerres carlistes. Ce fut la Députation forale de Navarre qui en 1864, invita les trois autres Députations (Alava, Guipuzcoa et de Biscaye) à prendre part à un projet solidaire commun appelé Laurac bat.[Réf]. En 1893 survint la Gamazada, du nom du ministre des Finances Germán Gamazo qui tenta de rogner l'autonomie fiscale de la Navarre. S'ensuivit une réaction populaire et institutionnelle, tant de la part des Carlistes que des libéraux pro-fueros, significativement appuyés par les trois autres provinces basques, favorables à l'autonomie forale des quatre territoires basco-navarrais. L'expression "Laurak bat" fut employée par les partisans des fors pour se référer aux quatre provinces dotées de régimes foraux. Il n'était pratiquement plus employé, jusqu'à ce que récemment, durant l'année 2007, il fut utilisé à nouveau par une branche du nationalisme basque, comme union politique préalable à l'union des sept provinces.
Navarre ou Nabarra ou aussi Nafarroa Osoa. Ce terme est employé en référence au Royaume de Navarre, comme symbole d'un État européen médiéval. Ce terme est employé par une partie du nationalisme basque (un certain auteur parle de « vasco-navarrismo ») avec une vision centrée en Navarre comme l'antécédent historique d'un État basque indépendant. Le territoire compris inclurait les sept territoires, bien que sa relation antérieure avec les autres provinces était féodale ou bien que ces dernières n'appartenaient pas simultanément à ce royaume. Cette vision n'exclut pas non plus d'autres territoires, comme par exemple la Rioja, où se trouve plusieurs sépultures de rois navarrais, situées dans la ville de Nájera. Par conséquent, à Euskal Herria, le fait culturel et à la Navarre le fait politique. Cette position a été défendue par l'association composée d'historiens Nabarralde. Ce terme n'est reconnu, dans aucun cas, ni par le nationalisme espagnol et les non nationalistes basques, ni par la majorité du nationalisme basque.
País Vasco est la traduction en castillan du terme Euskal Herria, toutefois depuis la création de la Communauté autonome basque, il est utilisé comme dénomination officielle. Il est actuellement le plus employé pour se référer à cette Communauté autonome dans les médias étrangers au niveau politique, pas au niveau culturel. Les nationalistes basques, politiquement, continuent à l'employer comme équivalent à Euskal Herria. La Société d'Études Basques, fondée 1918, est une institution qui considère ouvertement depuis sa fondation que la Navarre fait partie intégrante du terme País Vasco. Dans différents milieux, comme par exemple celui des académiciens, il est subdivisé entre País Vasco continental (synonyme du Pays Basque français) et País Vasco peninsular (synonyme d'Hegoalde).
Pays Basque français (País Vasco francés en castillan) dont ses territoires historiques ne sont pas actuellement reconnus par la France comme entité politique particulière, est compris dans le département des Pyrénées Atlantiques, bien que constituant une région historique, et culturelle reconnue avec la loi Pasqua. Ses trois territoires, qui étaient des provinces politiques existantes avant la division départementale de la France pendant la Révolution dans 1789, se retrouvent présentement dans un cadre administratif (Pays Basque (aménagement du territoire)) qui fait du pays un véritable territoire de projet, fondé sur une volonté locale. Il comprend 158 communes pour une superficie de 2 967 km². Il existe actuellement en France presque 300 pays.
Pays Basque a diverses significations. Voir Pays Basque (homonymie).
País Vasconavarro o Zona Vasconavarra fut un terme utilisé déjà au XIXe siècle, comme en témoigne Julian Gayarre, quand il chantait « Je suis un
Basco-navarrais, de la vallée de Roncal." Ce terme a été largement utilisé au cours de
la négociation du statut d'autonomie du Pays Basque en 1936.
Il est largement utilisé par les clubs sportifs, médicaux, les entreprises et
ainsi de suite. Pour exprimer un territoire ayant des intérêts communs, sans
indiquer une politique d'intégration claire.
Vascongadas ou Provincias Vascongadas est un terme créé au moins depuis le
XVIIIe siècle pour désigner les provinces d'Alava,
de Biscaye et du Guipuscoa. Dans le projet de loi de Segismundo Moret du 6 janvier 1884, on appelle Vascongadas la région administrative et politique formée par les provinces d'Alava, Guipuscoa, Navarre et de Biscaye et son utilisation va persisté pendant une bonne
partie du XXe siècle.
Le terme Vascongado s'utilise pour désigner la langue basque,
ou les expressions tierra vascongada, lengua vascongada ou lengua bascongada
qui se réfèrent aux terres
bascophones de Navarre.
Il est parfois utilisé par certains
nationalistes quand ils se réfèrent uniquement à ces
provinces, ou par les nationalistes espagnols qui n'acceptent pas les termes
Euskadi ou País Vasco, et qui, sans intention politique,
font référence à l'Alava, au Guipuscoa et la Biscaye.
Vasconia,
Basconie ou Wasconia (ce dernier apparaît sur la carte du monde de
Saint-Sever réalisée par le moine Estéfano Garcia au XIe siècle) est un nom
d'origine romane qui fait référence à la présence des Vascons sur un territoire mal définie.
Il a été
trouvée dans des écrits en latin vers l'an 394. Ce nom fait également référence
au duché de Vasconie, qui s'étendait
dans l'actuel Gascogne ainsi que l'Iparralde.
Le terme est réapparu à la fin du XIXe siècle, tombé en désuétude par
l'apparition de néologismes d'Arana. Autour de 1978, avec l'initiative principalement des historiens tels que José Miguel de Azaola
et Xabier Zabaltza, "Vasconia" est utilisé à la place de l'idiomatique Euskal Herria, pour désigner les sept territoires. Beaucoup d'autres travaux ont repris ce nom
comme par exemple : « De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia » (2006).
Ce terme est aujourd'hui principalement utilisé dans les milieux universitaires, afin d'éviter la connotation politique du terme
Euskal Herria.
Zazpiak Bat est une formule qui signifie « les Sept [provinces] [font] Une », de zazpi (« sept »), ak (« les ») et bat (« un ») et fait référence aux sept provinces historiques du Pays Basque. C'est en 1876, à Pampelune, que le linguiste navarrais Arturo Campión Jaimebon lança l'idée pour la première fois d'un grand Pays Basque et la formule Zazpiak Bat lors de la publication de son livre « Consideraciones acerca de la cuestión foral y los carlistas en Nabarra ». Elle C'est aussi le nom héraldique des armoiries du Pays basque.
Classification
Comme la langue basque, les Basques sont généralement considérés comme un groupe ethnique isolé et unique. Ils sont d'une part culturellement, plus spécifiquement, linguistiquement distincts des populations environnantes, et, d'autre part, génétiquement distincts aussi. Les recherches génétiques faites sur des populations basques se basent sur des corrélations entre des événements historiques, archéologiques et des techniques de description des gènes.
|
Photo du mariage de mes grands-parents maternels en 1942 à Saint-Jean-de-Luz (au quartier Acotz) |
Elle est souvent interprétée avec des intentions politiques. Par exemple, du côté espagnol, les autorités ont minimisé parfois les études existantes sur la génétique basque. En Europe, il existe une homogénéité des peuples d'après l'arbre génétique, toutefois seuls 4 peuples se distinguent du reste des populations européennes : les Sardes, les Lapons, les Islandais et les Basques. Il existe des explications historiques et linguistiques pour ces peuples qui diffèrent des Basques. De nombreuses études sont actuellement faites en Euskal Herria afin d'étudier ce phénomène génétique étant donné que de grands brassages génétiques se font avec les Français et les Espagnols depuis 50 ans et rendent la sélection des sujets plus restreinte [Réf]. Les domaines de recherche se concentrent sur la recherche génétique, l'hématologie et la myopathie. Outre l'hématologie, des 4 outils qui sont utilisés pour déterminer les différences génétiques, deux sont à l'origine de différenciation des Basques avec leurs voisins. C'est la sélection naturelle qui permet à des caractères génétiques d'augmenter d'après le milieu, et la dérive génétique qui permet à des gènes d'augmenter ou de diminuer de fréquence. Les deux autres outils, qui sont les mélanges de population qui augmentent la diversité génétique, et les mutations où les séquences d'ADN qui engendrent des changements de l'hérédité, sont peu utilisés dans cette différenciation. |
Morphologie ou type basque
Bien que les populations autochtones se mélangent de plus en plus avec les Français et les Espagnols et plus spécifiquement dans le tissu urbain, force est de constater de légères différences morphologiques à tout œil averti ou intéressé. Bien évidement, ce sont des constatations générales et non particulières. La stature est haute. Les moyennes obtenues sur de longues séries oscillent pour les hommes autour de 1,70 m. Ceci signifie qu'elle dépasse les moyennes des populations espagnoles et françaises [Réf]. Pour la femme basque la moyenne est de 1,57 m contre 1,53 m pour les autres. Les jambes sont longues et la constitution robuste. Le teint est généralement clair. En aucun point du Pays Basque n'existe de type brun qui puisse être comparé au type moyen de la race espagnole. La pilosité corporelle sur la poitrine, les épaules et les membres est très peu accusée chez les hommes. Pour 80% d'entre eux elle est nulle. Les cheveux sont en majorité (80%) de couleur châtain foncé. Les yeux peuvent avoir des colorations variées. Les plus fréquentes (60%) sont marrons clairs, verts ou gris. Le nez est dans la plupart des cas (80%) droit tant chez les hommes que chez les femmes. Depuis longtemps, on savait que les Basques occupaient une situation particulière parmi les races d'Europe, eu égard à leurs caractéristiques sérologiques [Réf].
Génétique
Tous les êtres humains sont semblables à 99.99%
au niveau génétique, on parlera par conséquent de « variabilité génétique » des
Basques sur 0.01%. En 1996, Hazout et Lucotte ont étudié l'ADN du
chromosome Y,
que possèdent uniquement les mâles, pour conclure que la fréquence de
certains segments diffère de leurs voisins. Par exemple, un
polymorphisme
(gradient de la fréquence de l'allèle
8 kb), présent dans les populations d'Europe occidentale est pratiquement
absent dans les populations basques. Cependant, l'haplotype
Ht 15, considéré comme un haplotype proto-européen, a sa fréquence la plus
élevée en Europe occidentale et 60% de la population basque le possède.
D'autres études ont démontré que les Basques possèdent le plus haut taux
de fréquences génétiques du marqueur M173, qui correspondent à la jonction
des peuplades européennes et asiatiques il y a 30 000 ans, et du marqueur
M170 originaires du Moyen-Orient. La première trace laissée par ces
populations est la « Dame de Brassempouy
»,
du nom du village des
Landes
(statuette en ivoire d'une femme) qui prouve l'existence humaine il y a
environ 25 000 ans dans cette partie de l'Europe. Quand une nouvelle
glaciation a envahi l'Europe il y a 18 000 ans, la région de la Cantabrie
et pyrénéenne fut propice à la survie des peuplades par la douceur du
climat. Elles se disperseront plus tard dans toute l'Europe quand le climat
deviendra plus favorable à une migration, c'est-à-dire il y a 10 000
ans. À cette même période, une vague de
néolithisation
qui correspond à la venue de l'agriculture du Moyen-Orient se répandit dans
toute l'Europe mais elle n'arriva au Pays Basque que 5 000 ans plus
tard (preuve fournie par la datation de germes de blé). La carence en fer des
Européens, excepté des Basques, qui indique la faible consommation de viande
des populations sédentarisées, démontre aussi que ces derniers ont continué
à vivre de cueillette et de chasse sur 250 générations et pourquoi les sites
paléolithiques
sont si nombreux. La question est maintenant de savoir pourquoi les Basques ont
mis 5 000 ans de plus que leurs voisins avant de se sédentariser.
Autres indices : les Basques ont le plus grand nombre de marqueurs H et V,
transmis par l'ADN mitochondrial,
et qui correspond à la repopulation de l'Europe à partir du Pays Basque
actuel. Les Basques sont par conséquent sans aucun doute les descendants des premières
peuplades venues du Moyen-Orient durant la période paléolithique. Leurs caractères
génétiques prouvent leur présence avant l'arrivée des peuples indo-européens
qui forment 850 millions d'habitants, soit 99.5% des Européens
présentement, les Indo-européens ayant au fil des siècles conquis ou assimilé
les populations autochtones.
|
Comparaison linguistique versus génétique |
Si l'on regarde le tableau[Réf] du généticien
L. Cavalli-Sforza
sur sa classification génétique des peuples vis à vis des langues, on
constate que si le tableau génétique remonte à un départ unique, il en est
tout autrement pour les langues. L'origine des langues est multiple alors que
l'origine des gènes est unique. Mais, encore une fois les Basques se
distinguent sur la carte comparant la langue basque versus la génétique européenne,
par de grandes similitudes. Les corrélations trouvées entre la linguistique
et la génétique rassemblent des données et forment un schéma idéal pour
l'étude des Basques. |
Hématologie géographique
Actuellement, des relations étroites sont établies
entre l'hématologie, la géographie et l'histoire. Des investigations hématologiques
sur les types basques de sang ont constaté qu'il y a bien plus de Basques
avec le type de sang de O que dans la population européenne générale, et la
plus faible fréquence au groupe B (3%), ce qui démontre le faible mélange
avec les peuples venus d'Asie. Ils auraient donc conservé les caractères
d'une population européenne primitive mélangée ultérieurement aux
immigrants venus d'Asie. Les Basques ont également une chance inférieure
d'être du type AB que le reste des Européens. Les Basques ont aussi une
proportion élevée de rhésus du type négatif dans le sang. 27% des Basques
ont un sang de type O et à Rh négatif. Le rhésus négatif peut empoisonner un
fœtus qui a un rhésus positif. Il est prouvé que durant des centaines d'années,
le taux de fausses couches et d'enfants mort-nés était extrêmement élevé
chez les Basques, en comparaison avec d'autres populations. Toutefois le taux
élevé de sang du groupe O dénote aussi l'isolement ou la dérive génétique
ou encore l'effet du fondateur. On trouve un fort taux de sang O en Irlande,
en Géorgie ou en Islande par exemple (environ 56%) ou
chez les Amérindiens non-métissés où il est quasiment le seul groupe représenté
(97% des Utes au Montana, 91% des Sioux au Dakota ou 98% des Tobas en
Argentine).
Concernant le groupe sanguin antigène Duffy, le gène FY*A y est largement plus
faible que pour les autres peuples européens. Le
facteur V
Leiden ainsi que le facteur XI,
qui sont deux anomalies génétiques de la
coagulation
du sang, sont inexistants chez les Basques (jusqu'à 7% chez les autres
peuples européens pour le premier facteur). Le facteur XI, qui favorise les
thromboses
veineuses, est chez les Basques le plus faible au monde après les populations
endogames
que sont les Juifs ashkénazes
et les Palestiniens.
L'hémochromatose
génétique, maladie génétique due à une hyper absorption du fer par
l'intestin entraînant son accumulation dans l'organisme, suggèrent une
plus faible prédominance d'hémochromatose génétique chez les Basques que
chez les personnes d'autres régions françaises (P=0.001). Cela souligne
encore une fois spécificité biologique de cette population. Sur un groupe de
37 patients issus de 34 familles, seulement quatre d'entre eux étaient
d'origine Basque : deux homozygotes pour le C282Y, un homozygote pour le H63D
et un hétérozygote pour le C282Y.
Myopathie
La myopathie est une maladie génétique qui se
retrouve en forte concentration dans la région de
Deba
et sur les deux côtés de la Bidassoa.
Cet épiphénomène
est extrêmement rare toutefois on le trouve aussi chez les
Amish
ou à l'île de la Réunion.
La consanguinité
favorise la survenue de maladies récessives dans des communautés isolées. La
recherche de solutions et les thérapies sur la myopathie se concentrent
beaucoup au Pays Basque.
- Malgré tout, il reste à préciser la relation
entre les populations Homo sapiens
neandertalensis et sapiens
et l'origine du peuple basque. De plus, de nombreux scientifiques, généticiens,
anthropologues et linguistes mettent leurs travaux en commun avec le projet
HIPVAL
(Histoire des populations et variation linguistique dans les Pyrénées de
l'Ouest) afin d'amener des réponses à la « question basque » depuis le néolithique.
Langue basque
Voir l'article Euskara, la langue des Basques. (Histoire complète de la langue basque)
-
En Iparralde ou Pays Basque français :
-
En Communauté Forale de Navarre :
-
Modèle A : Tout l'enseignement en castillan et l'euskara comme matière.
-
Modèle B : Une partie des matières en euskara et l'autre partie en castillan.
-
Modèle D : Toutes les matières en euskara sauf celle de la langue castillane.
-
Modèle G : Tout en castillan et sans euskara.
-
Dans la Communauté autonome Basque :
-
Autres :
-
Les langues transfrontalières sont internationales « limitées », avec ou sans statut officiel, quand elles sont réparties dans une petite aire géographique par rapport à la taille du pays.
-
Elles sont « internationales » quand elles sont situées sur une ou plusieurs aires géographiques (de régional à continental) avec au moins un statut officiel dans un pays.
-
1 - Symétrique et limitée comme le gagaouze parlé par 250 000 personnes dont 170 000 en Moldavie n'a pas de reconnaissance internationale, il est parlé par plusieurs communautés en Ukraine et en Roumanie, et aussi en Bulgarie. L'Ojibwé est parlé autour des Grands lacs situés sur ou près de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ces types de langues sont les plus nombreuses, les plus diversifiées et les plus menacées d'extinction. Elles ont peu ou pas de reconnaissance des deux côtés de la frontière et représentent la plupart des langues transfrontalières dans le monde.
-
2 - Symétrique et internationale, l'allemand qui est une langue officialisée depuis longtemps en Autriche, a le même statut linguistique officiel en Allemagne. C'est aussi une langue parlée dans 8 pays. C'est au profit de ce type de langues que beaucoup disparaissent. Ces langues, peu nombreuses, sont pour la plupart des « entreprises de linguicide » [Réf] et le rapport de UNESCO sur les langues en danger démontre par exemple que le français, qui se classe dans cette catégorie, menace sérieusement 26 langues ou dialectes en France[Réf] ou 13 langues au Québec[Réf].
-
3 - Asymétrique et limitée, le basque est reconnu comme langue officielle avec l'espagnol dans 4 des 7 provinces du Pays Basque (reconnaissance régionale partielle en Navarre). Dans les trois autres provinces, au Pays Basques français, il n'a aucune reconnaissance. Le wolof, lingua franca de facto et majoritaire au Sénégal puisque 80% de la population peuvent le parler, est aussi une langue très minoritaire en Mauritanie où il n'a aucun statut officiel.
-
4 - Asymétrique et internationale, le Hongrois est une langue minoritaire en Roumanie (Transylvanie), en Slovaquie, en Serbie (Voïvodine) avec ou sans droits mineurs dans tous les pays limitrophes de la Hongrie, où il est seule langue officielle. Le russe au Kazakhstan a été fortement marginalisé comparé à sa prédominance passée suite à la mise en place d'une politique linguistique qui vise à réduire au maximum la présence russophone, qui représente encore 30% de la population totale. Le Russe reste une langue internationale malgré la chute de l'URSS mais perd du terrain dans toutes les ex-républiques.
-
Familiale
-
Organisations politiques
-
L'eurorégion ou euroeskualdea
-
Système universitaire
-
Journaux
-
Organismes indépendants et communautaires
-
Coorporatisme et syndicalisme
-
Instituts de la statistique
-
Union européenne : la politique linguistique de l'Union européenne a décidé que le gaélique irlandais devient la 21ème langue officielle de l'Union avec ses 200 000 locuteurs, toutefois pour l'Union européenne, la langue basque est seulement reconnue « langue d'usage » dans les institutions européennes dès lors que, à l'occasion de son adhésion à l'Union, l'Espagne, n'a pas officialisé les langues régionales. Ces langues ne sont pas des langues officielles de travail et le basque a seulement un statut de langue régionale et minoritaire. En novembre 2007, la ministre basque de Culture Miren Azkarate s'est adressée pour la première fois en langue basque à un Conseil de ministres de l'Union européenne. La législation adoptée par le Parlement européen et le Conseil est également publiée en basque et les interventions orales lors des réunions du Comité des Régions et du Conseil de l'Europe sont possibles.
-
Communauté autonome basque : dès 1978, la Constitution espagnole autorise les régions historiques d'Espagne à se doter d'assemblées pourvues de larges compétences. Les Basques vont se doter en 1979 d'un statut linguistique avec la formation de la Communauté autonome basque composé seulement de 3 provinces (Guipuscoa, Biscaye et Alava). La province de Navarre, territoire moins « basquisé », décida de ne pas s'y joindre et de prendre un autre chemin. Le basque a un statut de langue co-officielle avec le castillan.
-
France : l'article 2 de la Constitution précise que « La langue de la République est le français », et outre l'article 11 de la déclaration 1789 qui stipule que les Basques ont le droit de « parler et d'écrire librement » dans leur langue, il n'existe aucun statut spécifique des langues régionales ou minoritaires. Cela n'empêche pas l'État lui-même, notamment via la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et l'enseignement public et les collectivités locales d'entreprendre diverses actions culturelles ou éducatives au profit de la langue basque mais seulement avec des aménagements symboliques ou peu importants, ainsi que des tolérances ou des dérogations envisageables. Avec sa notion d'État nation, où l'État préexiste à la nation, les pluralités ethniques dans tous les territoires de France sont ignorées. Nonobstant, la France étant majoritaire francophone (94% possède comme langue maternelle le français), c'est au détriment du basque qui n'a aucun droit légal d'être cité sur la place publique, que le français s'est imposé. D'ailleurs l'État traîne systématiquement des pieds lorsqu'il s'agit de dialoguer avec des associations telles que la formation Batera qui signifie « tous ensemble ». Reconnaître la langue basque, c'est faire plus de place aux langues régionales comme le breton, corse, francique, arpetan …etc. Seul le français a juridiquement accès à l'usage public. La France est un des derniers pays de l'UE à avoir signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires mais elle ne l'a pas ratifiée étant donné que la Charte III avait une liste d'obligations et comportait des clauses contraires à la Constitution française. Pour accepter qu'une autre langue tel que le basque soit érigée en principe républicain, cela revient à lui donner forcement des usages formels et juridiques dans un cadre démocratique.[Réf] C'est en réaction et par l'intermédiaire de la formation Batera, qui regroupe 52% des 159 maires du Pays Basque, qu'est demandé entre autres la co-officialisation du basque avec le français. Les maires du BAB (Biarritz-Anglet-Bayonne) n'en font pas partis où vivent 40% des habitants d'Iparralde. Cependant la représentation politique et démocratique est injuste au sein du département. Les élus des cantons basques ne sont représentés que par 21 conseillers généraux pour 43% de la population totale des Pyrénées-Atlantiques contre 31 dans les cantons béarnais.
-
Espagne : l'article 3 de la Constitution stipule que le castillan est la langue officielle de l'État. Tous les Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser. Les autres langues de l'Espagne seront également officielles dans les différentes Communautés autonomes en accord avec leurs Statuts.

Zones linguistiques : Bascophone - Mixte - Hispanophone
5. Communauté Forale de Navarre : suite au statut d'autonomie de 1982 de la Navarre, (Article 9) le castillan fut décrété la langue officielle de la Navarre et le basque aurait aussi caractère de langue officielle dans les zones bascophones de la Navarre. Mais depuis une nouvelle loi, « Ley foral 18/86, du 15 décembre 1986 », stipule que la Navarre est linguistiquement divisée en 3 zones (272 communes). Au nord, 61 communes dans la zone dite « Bascophone », qui représente 11% de la population totale de la Navarre, où le castillan et le basque ont un statut de co-officialité. - Au centre-nord, 50 communes dans la zone dite « Mixte » (basco-navarraise) qui représente 54% de la population totale de la Navarre (dont la ville de Pampelune), où des services bilingues sont prévus à l'intention des bascophones. La langue basque y progresse depuis son introduction dans le système scolaire. - Au sud, dans la zone hispanophone qui représente 35% de la population totale de la Navarre où seul le castillan est langue officielle.
-
Une société civile basque qui s'éloigne de plus en plus des 2 extrêmes que sont les Pro-Madrid et les Pro-E.T.A.
-
Un certain nationalisme basque qui ne se cache pas de vouloir intégrer ses immigrants. La preuve est que les immigrants pro-basques ont parfois tendance à être plus radicaux que les basques de souche comme Juan Paredes Manot, membre d'E.T.A, fusillé en 1975, qui était au Pays Basque que depuis 10 ans.
-
Une bonne santé économique en Hegoalde comparé à ses voisins est sûrement un gage de futur et de sécurité pour toute la société civile basque qui vote pour le même parti depuis 30 ans et qui se « basquise » tranquillement tant que la prospérité est au rendez-vous.
-
Les églises
-
L'art funéraire
-
Michel Duvert : « Des origines du Peuple Basque », Elkarlanean S.L., 2005, ISBN 291315669X
-
Peio Etcheverry et Alexandre Hurel : « Dictionnaire thématique de culture et civilisation basque », Pimientos, 2004, ISBN 2912789346
-
Luis Núñez Astrain : « El Euskera Arcaico », Txalaparta, Tafalla. 2003, ISBN 8481363006
-
Pierre Bidart : « La singularité basque - Généalogie et usages », Presses Universitaires de France, mai 2001, ISBN 213051538
-
Jean-Marie Izquierdo : « La Question basque », © Édition complexe 2000, ISBN 2870278551
-
Kurlansky Mark : « The Basque History of the World », 1999, ISBN 0802713491
-
Guy Gaunègre : « Pays Basque, une nation sous le feu de E.T.A », Édition Golias, Novembre 2000, ISBN 2911453964
-
Barbara Loyer : « Géopolitique du Pays Basque », © L'Harmattan 1997, ISBN 273845089X
-
Louis Charpentier : « Le mystère basque », 30 décembre 1999, ISBN 849338495X
-
Mikel Sorauren : « Historia de Navarra, el estado vasco », 1999, Pamiela, Pamplona. ISBN 847681299X
-
Sharryn Kasmir : « The Myth of Mondragón : Cooperatives, Politics and Working-class Life in a Basque Town », 1996, University of New-York Press, ISBN-10 0791430030
-
Francisco Letamendia Belzunce : « Historia de Euskadi : El nacionalismo vasco y ETA », R&B, D.L. 1994, ISBN 84-7728-248-X
-
Sébastien Ségas : « La Grammaire du Territoire : Action Publique et Développement et Lutte Politique dans les “Pays” », 2004, thèse en science politique, Université Montesquieu, Bordeaux 4.
-
Jean Daniel Chaussier : « Quel territoire pour le Pays Basque ? » Les cartes de l'identité, Éditions L'Harmattan, 1996, ISBN 2738441173
-
Jean-Baptiste Orpustan : « Nouvelle toponymie basque », Bordeaux, 2006, ISBN 2-86781-396-4
-
Amagoia Unanue, Nahia Intxausti, Jon Sarasua : « Kooperatibak eta Euskara : Historia Eta Aro Erri Baten Oinarriak, 2002, Emun Kooperatiba Elkartea, ISBN 84-607-5743-9
-
Xamar « Orhipean, Gure Herria ezagutzen » (Orhipean, le pays de la langue basque), Éditorial Pamiela, ISBN 8476813473
-
Merrit Ruhlen : « L'origine des langues ». Éditions Gallimar, 2007, ISBN-10 2-07-034103-8
-
Joseba Zulaika : « Basque Violence : Metaphor and Sacrament », 1998, Édition New Ed, University of NevadaPress, ISBN-10 0874173639
-
Eguzki Arteaga : « La politique linguistique au Pays Basque », 2004, © L'Harmattan, ISBN-10 274756990X
-
Javier Corcuera : « Le Pays Basque entre droit et politique » dans « Les Temps Modernes », numéro 614, 2001 Éditeur Gallimar, ISBN 2070762866
-
Philippe Veyrin : « Les Basques », Arthaud, 1975, ISBN 2-7003-0038-6
-
Andrés Ortiz Osés : « La identidad matriarcal vasca ». Revista de etnopsicología y etnopsiquiatría, ISSN 0301-6587
-
Josetxo Beriain : « La identidad colectiva : vascos y navarros », 1998, Ediciones Oria/Haranburu, ISBN 84-89923-15-9
-
Jon Etcheverry-Ainchart, Michel Duvert, Marcel Etchehandy, Claude Labat (Lauburu) - Editions Elkar. 2004 ISBN 2-913156-55-X
-
Michel Morvan : « Les origines linguistiques du basque », 1996, Presses Universitaires de Bordeaux, ISBN 2-86781-182-1
-
Francisco Javier Corcuera Atienza : « La patria de los vascos : orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1903) », 2001, ISBN 84-306-0445-6
-
David Levinson « Ethnic Groups Worldwide », a ready reference Handbook, ORYX Press, ISBN 1-57356-019-7
-
A Henri Holt Reference Book « The Encyclopedia of the Peoples of the World », Ethnic Groups - Encyclopaedias. Edited by Amiram Gonen, 703 pages, 1993, New York, ISBN 978-0-8050-2256-8
-
Eugène. Goyheneche : « Notre terre basque » aux éditions S.N.E.R.D, 1979. Laborde Pierre : « Le Pays Basque d'hier et d'aujourd'hui », 1983, éditions ELKAR, ISBN 84-7529-066-3
-
{{fr}} Lapurdum est une revue annuelle à caractère scientifique, consacrée aux études basques et notamment à la langue et aux textes.
-
{{fr}} BERTAN est une collection de publications monographiques qui traite d'aspects en rapport avec le patrimoine culturel et paysager guipuzcoan, sous une forme à la fois attractive et plaisante pour le lecteur.
-
{{es}} Revista Internacional de los Estudios Vascos. Fondée en 1907 par Julio Urquijo. En 1922 devint un organe d'Eusko Ikaskuntza-Société d'Etudes Basques
-
{{fr}} Institut culturel basque (EKE) est basé depuis sa création dans la commune d'Ustaritz, il a pour vocation de contribuer sur son territoire d'action, le Pays Basque nord, au développement de la langue et de la culture basques.
-
{{fr}} Archive ARTXIKER Artxiboa est une bibliothèque numérique recevant et diffusant les productions intellectuelles de la recherche internationale dans le domaine de la langue basque et des langues typologiquement proches.
-
(eu) Études socio-linguistiques dans les 7 provinces.
-
(fr) Institut culturel basque.
-
(eu) (es) Histoire du Pays Basque.
-
(eu) (fr) Banque de données du Pays Basque.
-
(fr) Question nationale et mouvements sociaux en Pays Basque sud, thèse de F. Jauréguberry.
-
(fr) Manifestations culturelles et spécificités basques.
-
(eu) (es) Un regard global sur la réalité d'Euskal Herria.
-
(fr) Centre de recherche sur la langue basque et particularités génétiques.
-
(fr) La frontière franco-espagnole au Pays Basque. Étude des fonctions de la frontière sur le territoire de l'Eurocité Bayonne-San-Sebastián thèse de Olivier Beaupré-Gateau.
-
(fr) Langues nationales et régionales une relation géopolitique par Barbara Loyer
-
(es) Gobernanza y territorio en Iparralde de Igor Ahedo et Eguzki Urteaga.
|
La langue basque ou
Euskara se distingue
des autres langues qui l'entourent. C'est une langue isolée et entourée
de langues et de peuples
indo-européens. C'est la plus ancienne langue d'Europe encore vivante. Tous les experts et linguistes sont d'accord sur le fait que le basque, une des rares langues non indo-européennes encore vivantes sur le continent européen, est un « trésor de l'humanité ». Mais aussi un chef-d'œuvre en péril, brimé, opprimé, réprimé depuis des siècles par soit un État jacobin ou Castillan. Le basque faisait sûrement partie d'une famille linguistique depuis la préhistoire, soit 8 000 ans, et elle est la seule à avoir survécu. |
Langues non indo-européennes en Europe
La "langue des Navarrais" au Moyen-Âge, la "Lingua navarrorum" (1167) pour parler du basque. |
L'obligation pour tous d'apprendre le basque dans les écoles de la CAB
depuis 25 ans est l'origine le la progression des personnes bilingues. Les écoles
enseignent en basque 16 h par semaine au primaire et 25 h par semaine au
secondaire. Plus de 82% des personnes de moins de 20 ans sont bilingues, dont
20% de bilingues passifs.
En 2005, sur une population totale des provinces basques qui atteint 3 millions
d'habitants, seul 20 000 sont unilingues bascophones, 802 000 sont
bilingues basques/erdara
(castillan 91.6% / français 8.4%), 455 000 sont bilingues passifs
basque/erdara (castillan 93% / français 7%) c'est-à-dire comprennent le
basque toutefois ne le parlent pas. 1 720 000, soit la majorité est
unilingue erdara (castillan 91% / français 9%). En France, on compte 80 000
bascophones dont 63 000 en Iparralde, 11 000 en Aquitaine et 6 000 dans le reste
du pays.
Euskaltzaindia
ou Académie royale de la langue basque est une institution académique
officielle qui veille depuis 1968 à fixer officiellement les critères pour
l'unification de la langue basque : c'est ainsi qu'est né l'euskara batua,
étant donné que de nombreux dialectes basques s'expriment toujours dans les diverses régions.

Des millénaires de survivance linguistique
Indépendamment de l'exactitude de telle ou telle théorie, on peut affirmer - sans trop prendre de risques - que l'euskara est la langue la plus ancienne d'Europe encore vivante. Certains croient qu'un groupe relativement petit, ayant vécu pendant des millénaires dans ou à proximité des territoires actuels, a survécu aux vagues de migrations successives de peuples ayant des structures militaires et technologiques supérieures (Celtes, Romains, Germains, Arabes, Francs). Une partie des premiers auteurs basques tentent d'expliquer cela en conservant les formes académiques de leur époque et avec des spéculations sur la supériorité raciale des Basques, toutefois la survivance de la communauté linguistique basque peut également être due à son isolement ou refuge dans les profondes vallées pyrénéennes. Pas de grands gisements aurifères comme dans les Cantabres et Asturies, sauf aux mines de Larla à Itxassou. La forêt dense était une solide défense naturelle et mettait la population à l'abri de toute convoitise au vu de la rudesse et de la pauvreté des gens qui y survivaient. Selon Jacques Brunhes, il démontre que la carte forestière de l'époque est presque une carte frontière : « Les cloisons frontalières sont délimitées, des provinces, des pays, des langues, des civilisations ». [Réf] Il cite la limite qui sépare le Pays Basque du Béarn jalonné par une série de bois, tels que la forêt d'Iraty, les bois de Mixe ou de Labastide. De tout temps, les euskalduns ont vécu dans des collectivités agricoles, de petites bourgades où les mariages mixtes avec d'autres populations étaient rares.
Statuts des locuteurs
Il existe différents niveaux de compréhension d'une langue transfrontalière selon le locuteur. La langue basque est un exemple de compréhension et cela s'applique à beaucoup de langues transfrontalières. Cette langue, nommée euskara, est parlée en Espagne et en France et se divise en 4 catégories linguistiques pour les habitants de cette région.
Enseignement du basque
|
|
Des 75 langues sur tout le territoire français, DOM-TOM compris, seulement 13 langues sont enseignées. La loi 51-46 du 11 janvier 1951 « relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux », dite loi Deixonne, fut la première loi française autorisant l'enseignement de 4 langues régionales en France, dont le Basque. Mais outre cette ouverture, l'acharnement de l'État ou des institutions à s'opposer aux actions que les populations et leurs élus tentent de mettre en œuvre pour défendre leur langue et leur culture et assurer leur survie et leur développement continue. Plusieurs exemples sont souvent cités comme le fait que l'État ne prend en charge une nouvelle école qu'après 5 années d'existence financée sur ses propres fonds, la construction, les taxes et l'entretien des locaux étant à la charge des parents. La loi Falloux de 1850, encore en vigueur, interdit toujours les établissements privés à pouvoir être subventionnées par les collectivités locales au-delà de 10% de l'investissement total engagé. L'État tente d'affaiblir cet enseignement par des coupures budgétaire, un enfant apprenant en basque compte pour un demi dans les statistiques officielles de l'Inspection académique des Pyrénées-Atlantiques et les moins de trois ans n'y sont pas comptabilisés. Cependant, en vue de maintenir l'enseignement bilingue basque-français, il existe trois modèles pédagogiques : |
1 : les Euskal Haziak sont des écoles privées confessionnelles où certaines matières sont enseignées en langue basque.
2 : les Ikastola sont des établissements scolaires au statut associatif inspirés du modèle déjà existant en Hegoalde. Seaska, « berceau » en euskara, est l'association qui régit tout le système en Iparralde. Fondée en 1969 à Arcangues, les ikastolak pratiquent l'enseignement exclusif du basque en immersion totale. L'enfant apprend naturellement et à une rapidité incroyable la langue basque. En 2005, il y avait 24 Ikastolak dont 2129 élèves. Chaque année les collectivités, les entreprises locales et des gens de partout en Euskal Herria sont sollicitées lors de la manifestation d'Herri Urrats dans l'intention d'apporter un soutien financier pour le développement des Ikastola. Elles font partie du réseau EHIK (Euskal Herriko Ikastolen konfederazioa) qui regroupe toutes les écoles des 7 provinces.
3 : Puis les Ikas Bi, ikas signifie « apprendre » et bi signifie « deux », sont des écoles publiques où l'enseignement est paritaire en langue basque et française toutefois cette parité est à relativiser. En 1993, seulement 2 907 élèves étaient scolarisés dans les modèles bilingue et immersif et en 2005, plus de 10 000 élèves sont scolarisés dans un de ces 3 modèles. Ils représentent1 élève sur 3 en maternelle, 1 sur 4 en primaire, 1 sur 5 en collège et 1 sur 10 en lycée.
Année scolaire 2004 / 2005
| Effectifs par modèle d'enseignement | Nombre d'élèves | Euskal Haziak | Ikas Bi | Seaska | Total | Pas d'enseignement en basque |
| Maternelle | 9 056 | 5.1% | 24.1% | 6.3% | 35.5% | 64.5% |
| Primaire | 15 170 | 4.6% | 15.8% | 5.4% | 26.8% | 73.2% |
| Collège | 12 836 | 8.4% | 6.2% | 3.7% | 18.3% | 81.7% |
| Lycée Général et Technique | 7 243 | 4.4% | 2.3% | 2.4% | 9.1% | 90.9% |
| Lycée professionnel | 3 274 | 0.4% | 0.3% | 0% | 0.7% | 99.3% |
| Total en % | 100% | 5.7% | 11.7% | 4.3% | 21.7% | 78.3% |
| Nombre total d'élèves | 47 579 | 2 721 | 5 552 | 2 038 | 10 312 | 37 267 |
Ces écoles dans le passé, ont trouvé toutes sortes d'embûches administratives et de difficultés diverses dans l'élaboration de leurs projets. Suite à des subventions retirées par le ministère de l'Éducation Nationale dans les années 1990, l'association Ikas Bi a du demandé à la Communauté autonome basque de financer en partie les manuels scolaires en euskara, visés par le ministère. Présentement, les acteurs gouvernementaux se sont ravisés et le CRDP (Centre régional de documentation pédagogique) donne sa validation afin que l'association Ikas Bi puisse obtenir des subventions pour les manuels scolaires. Autre exemple, 70% du financement du centre de vacances en immersion linguistique d'Ascarat est aussi payé par la Communauté autonome basque dans le cadre de l'Union européenne et du développement des programmes transfrontaliers. La région Aquitaine n'apparaît pas non plus favorable à de tels projets, et montre une indifférence totale. Soulignons que l'Euskadi jouit d'un vaste éventail de pouvoirs sur son territoire ce qui peut créer des discordances dans le cas de coopération avec la région Aquitaine où l`éducation n'est pas ou peu de sa compétence. Le budget 2003 de la Communauté autonome basque était de 6 184 millions d'euros dont 1 710 millions à l'éducation. Le budget pour l'Aquitaine 2006 était de 867 millions dont 192 millions dans la formation et 63 millions dans l'éducation. La disproportion financière est énorme quant à l'autonomie budgétaire et les choix régionaux. Le Gouvernement Basque a donné à l'Office public de la langue basque dans un accord-cadre de coopération pour le soutien à la langue basque 450 000 euros en 2006 et 1 340 000 en 2008 dont Euskal Irratiak, AEK, Seaska et Uda Leku perçoivent les 2/3 de la somme.
|
|
Ce système éducatif prévoit que l'Académie de la langue basque ou Euskaltzaindia est l'institution qui établit les normes linguistiques et joue un rôle important dans le développement du « basque unifié » ou euskara batua.[Réf] Le Décret Foral de 1989 développa la loi précédente et établira quatre modèles linguistiques (voir schéma). Les modèles A, B et D sont disponibles dans la zone bascophone, les modèles A, B, D et G dans la zone mixte et les modèles A et G dans la zone non-bascophone. En Navarre, l'euskara (modèles B et D) représente 22.2% de l'effectif scolaire. Le reste se fait entre les modèles A (19.2%) et G (58.6%) d'après les données officielles en 2004-2005.
|
|
Modèle A : Tout l'enseignement en castillan et l'euskara comme matière.
Depuis quelques années le Parlement Basque essaye de le faire disparaître Les données officielles de 2006-2007 donnent un total de 22.4% pour le modèle A, de 23.3% pour le modèle B et un 54.2% pour le modèle D en constante augmentation. Suivant des données officielles pour les années 2006-2007, dans le cadre éducatif pour la petite enfance, 68% des inscrits le font en euskara, 25% en enseignement bilingue tandis que 5.2% l'ont suivit en castillan. Quant à tous les cours d'éducation obligatoire, 52.3% des inscrits l'ont été dans le modèle D, c'est-à-dire, en euskara, 23.4% en enseignement bilingue tandis que dans le modèle A, seulement 24.4% des élèves s'y sont inscrits et ce pourcentage diminue constamment. Quant au modèle X, l'offre est réduite à seulement des zones de la Biscaye et il n'atteint pas 1% de l'effectif scolaire total du territoire. Ces données montrent le peu d'offre de places dans le modèle A et celle du X est presque nul (non accessible pour ceux qui sont nés dans la Communauté autonome basque ou qui y résident depuis au moins 4 ans). Le modèle B n'est pas accessible dans toutes les écoles publiques. L'enseignement en castillan n'est pas subventionné. Le Gouvernement Basque précédent était accusé d'endoctrinement nationaliste étant donné la suppression de l'État espagnol dans une grande partie des livres et des textes utilisés dans l'enseignement Primaire (suppression à 100% des livres analysés en langue basque). |
 |
Aux âges plus précoces, dans des garderies 90% des enfants sont dans le modèle
D (tout en euskara), par contre au baccalauréat, 53.7% le font dans le modèle
A en reléguant le modèle D à 44.1% du total. Quant à la formation
professionnelle, les dernières données révèlent que seulement 13.3% de
l'effectif scolaire suit sa formation en euskara. Le domaine universitaire
public a seulement 21% de l'effectif scolaire qui participent à certaines matières
en euskara. En 2005, divers débats sur modèle
d'enseignement D se sont engagés. En effet, 30% des élèves de ce modèle, en 4º d'ESO
(Educación Secundaria Obligatoria), ne parvenaient pas à avoir le niveau
suffisant en euskara pour obtenir un certificat de qualité en langue.
En novembre 2009, les Socialistes au pouvoir,
ont fixé en éducation l'"égalité normative" entre la langue basque et le castillan, la langue basque ne
jouira plus du statut de langue véhiculaire principale. Dans la situation linguistique où le basque jouissait d'un privilège pour sa survie,
le mettre à un pied d'égalité avec le castillan revient à l'affaiblir. Selon
Jean-Baptiste Coyos «l'usage d'une langue minoritaire, dans les conditions
actuelles de vie moderne, dépend certes de son enseignement, mais de bien
d'autres conditions que les politiques linguistiques ne peuvent ignorer.
L'augmentation du nombre de locuteurs potentiels ne suffit pas à garantir l'usage
de cette langue, même si l'objectif est d'arriver à un usage équilibré de la
langue dominante et de la langue dominée.»
[Réf]
Il semble que même si le nombre de
«basco-sripteurs» augmente considérablement chez les jeunes, ils ne se
transforment pas en «basco-parlantes» effectifs.
Par des territoires : Si l'on compare le type de collèges avec les territoires historiques, la distribution des inscrits se distingue de la manière suivante ; en Alava les modèles A et D ont des niveaux d'inscription équivalents aux collèges publics, toutefois, dans le système privé le modèle A est du triple comparé au modèle D. En Biscaye les modèles A et D ont aussi des inscriptions semblables en étant légèrement plus grand pour le modèle D dans le cadre public (il faut mentionner qu'à Bilbao, il ne reste seulement qu'un institut public du modèle A). Cependant, au Guipuscoa, tant dans les collèges publics que privés, le modèle D (toute la matière en euskara) est le modèle le plus en demande avec 82%.
On peut suivre des cours dans les Euskaltegiak ou ikastaldiak comme AEK (L'association AEK propose des stages intensifs d'apprentissage, en internat ou en demi-pension. Ces formations offrent au stagiaire un environnement bascophone qu'il n'a pas forcément dans son entourage), Udal Euskaltegiak, IKA, HABE, ou lors de séjours dans des familles bascophones. Il existe les écoles officielles de langues comme les Barnetegiak, Zornotzako barnetegia ou Maizpide barnetegia. Il est également possible d'étudier l'euskara sur Internet.
Politique linguistique
1 : En France
En vertu de l'Article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français et la langue basque a pour seul droit d'être parler et écrit librement (basé sur l'article 11 de la déclaration 1789). L'absence de tout statut juridique du basque durant des siècles a provoqué son exclusion de la vie publique et le basque s'en est trouvé relégué à des fonctions de plus en plus restreintes dans ses territoires historiques. Et c'est au quotidien que le français s'est imposé depuis un siècle, avec le nouveau mode de vie, par nécessité ou obligation, que les gens se sont tournés vers la langue de la modernité. La langue basque vit depuis plusieurs siècles une situation diglossique, état dans lequel se trouvent deux systèmes linguistiques qui coexistent, et une situation dévalorisante, puisqu'elle est exclue des domaines d'utilisation qui apportent aux langues leur légitimité, force et prestige. La violation des droits linguistiques en France se fait par conséquent de manière systématique et légale. Selon les propos de Joseba Arregi, « On avancerait également beaucoup si l'on reconnaissait que la défense des droits et des libertés individuelles, héritage de la Révolution française, a entraîné la négation d'identités, de langues et de cultures particulières, pas seulement au nom de la raison, mais au nom d'autres identités, langues et cultures elles aussi particulières, toutefois plus grandes »[Réf].
Le français ne s'est pas imposé sans heurt, les systèmes administratifs et scolaires ont joué un grand rôle d'assimilation. Un exemple parmi tant d'autres qui a permis au français de s'imposé : Pendant des décennies, au Pays Basque comme ailleurs en France, le système éducatif et son administration dévalorisaient le basque et de manière perverse, favorisant la délation. À l'école, le premier élève qui échappait un mot en basque, devait prendre une baguette appelée l'« anti » pour « anti-basque », et ce dernier cherchait par la suite un autre élève qui se ferai surprendre à parler lui aussi le basque. Le dernier à la sortie des cours avec l'anti dans les mains écopait d'une punition.
Présentement uniquement 25.8% des habitants du Pays Basque français sont bilingues, 9.3% sont bilingues passifs et 64.2% sont non bascophones. Il faut spécifier que 69% des bascophones ont entre 50 et 65 ans et que seul 17% d'entre eux ont entre 3 à 24 ans. Cette réalité a de fait conduit l'UNESCO à citer le basque de France parmi les 3 000 langues en péril sur les 6500 parlées à travers le monde. Une langue est considérée comme en danger de disparition lorsque moins de 30% des enfants d'une population donnée l'apprennent ou la parlent, un abandon qui est favorisé par l'uniformisation linguistique du monde actuel. D'après Claude Hagège, « les langues régionales sont dans un tel état de précarité que, pour leur permettre d'échapper à l'extinction totale qui les menace, il faudrait un investissement énorme et accepter de prendre des risques, comme l'ont fait les Espagnols en donnant une grande autonomie aux Basques et aux Catalans ». [Réf]
L'État n'a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et il est actuellement un des trois derniers États sur 47 du Conseil de l'Europe avec la Turquie et la Principauté d'Andorre (dont le chef de l'État français est co-prince) à n'avoir pas signé la Convention cadre européenne sur les minorités nationales. La France, sur un plan international défend la francophonie face à l'hégémonie de l'anglais et la diversité culturelle, toutefois elle est loin d'être crédible puisqu'elle ne respecte pas d'abord chez elle sa propre diversité linguistique. Selon Pierre Bidart : « ...en France, les relations entre la culture officielle (implicitement « bourgeoise ») et les expressions populaires ont été largement défavorables à ces dernières. Les langues et cultures régionales sont la représentation inavouée ou inavouable des ressources culturelles de la société paysanne. L'expression « langues et cultures régionales » désigne en effet les langues et cultures n'ayant jamais été l'objet d'une exaltation particulière (sauf peut-être pour les aspects festifs) ». [Réf]
2 : En Euskadi ou Communauté Autonome Basque :
La loi 10/1982 du 24 novembre ou loi fondamentale sur la normalisation de l'usage de l'euskara stipule dans l'Article 2 que « La langue propre au Pays Basque est l'euskara » et l'Article 3 que « Les langues officielles dans la Communauté autonome basque sont l'euskara et le castillan ». La loi de normalisation de l'usage de l'euskara, approuvée par le parlement basque en 1983, établit que les élèves qui terminent l'école obligatoire à seize ans, doivent avoir la même compétence dans chacune des langues officielles, et que tout citoyen basque a le droit d'être reçu par les administrations publiques dans la langue qu'il choisit. La loi ne s'applique que pour les médias, l'administration et l'enseignement.[Réf] « En Espagne, et surtout dans la Communauté autonome, le basque connaît depuis quelques années une croissance considérable. Cet engouement s'explique parce que, ayant déjà un statut, la région s'est construit une conscience collective grâce aux médias locaux, à l'enseignement, etc. », analyse Xarles Videgain.
3 : En Communauté Forale de Navarre
C'est la Loi Organique de Réintégration et Amélioration du Régime Foral de Navarre (LORAFNA) en 1982, qui officialisa l'espagnol sur tout le territoire de la Navarre et celle de la langue basque aux côtés de l'espagnol dans la zone bascophone. Ensuite la Loi Forale de 1986 du Basque ou « Ley del Vascuence » établissait une division de la Navarre en trois zones linguistiques, avec pour chacune ses propres niveaux d'officialité et de droits linguistiques. Les socialistes navarrais (Partido Socialista de Navarra PSN-PSOE) étant minoritaires, ils feront alliance avec les nationalistes basques pour gouverner, et mettront en place une discrimination positive envers l'euskara dans l'administration. En 1991, l'UPN (Unión del Pueblo Navarro) avec Juan Cruz Alli à sa tête, favorisa lui aussi les intérêts des bascophones par une meilleure protection légale en amendant considérablement la loi linguistique. L'ouverture envers les bascophones avait pour objectif d'intégrer la dimension basque à la nation navarraise et la singulariser de l'Espagne. Juan Cruz Alli sera désavoué par sa politique d'ouverture par son parti, il ira par conséquent créer de son côté le CDN ou Convergencia de Demócratas Navarros. En 1994, dans la zone bascophone, l'euskara était exigé pour certains poste et les points bonus ne devaient pas représenter moins de 10% de la note globale. Le gouvernement changea la loi en janvier 2001 et désormais les points ne peuvent pas représenter plus de 10% de la note totale. La problématique du gouvernement navarrais sur les références historiques et géographiques des manuels scolaires en Basque est toujours sujette à débat.
Langue transfrontalière
Une langue transfrontalière est une même langue parlée par un groupe ethnique, une tribu ou une nation, située dans une aire géographique répartie entre deux ou plusieurs pays reconnus internationalement. Une langue transfrontalière est toujours une langue internationale (entre deux nations) mais une langue dite internationale n'est pas forcement transfrontalière.
La continuité territoriale doit être prise en compte. Elle se différencie d'une langue parlée à l'intérieur d'une frontière et parfois d'une langue internationale. La langue transfrontalière se caractérise par son aire géographique et la répartition de son nombre de locuteurs. Elle peut avoir de nombreuses fonctions à travers des mécanismes sociaux culturels ou économiques, des fonctions politiques, de refuge, de trafic, assimilatrices ou de manipulations partisanes. Si une langue est parlée par deux pays sans continuité territoriale comme le français au Canada et en France, il est préférable de parler d'une « langue internationale » ou d'une « langue commune ».
Types
Les langues transfrontalières sont de quatre types. Elles sont soit mesurées suivant le critère de la taille même de l'aire géographique. Soit elles sont mesurées selon le critère de la taille même de la population linguistique.
|
Les langues transfrontalières sont de quatre types. Selon des critères de population, les langues transfrontalières sont « symétriques » ou « asymétriques ». |
Les types de langues transfrontalières |
Les langues frontalières « symétriques » sont des langues parlées par de petits ou de grands groupes linguistiques des deux côtés d'une frontière. Nombreuses sont les langues qui peuvent souvent sembler insignifiantes, mais qui jouent un rôle important dans l'interaction, l'intégration et les activités économiques. Les langues frontalières « asymétriques » sont parlées par de grands groupes d'un côté de la frontière et par de petits groupes de l'autre côté. Puisqu'elles sont dominantes dans au moins un pays, elles ont le potentiel d'être utilisées dans des domaines plus larges et suivant les moyens des locuteurs.
|
Changements de statut Par toutes sortes de circonstances politiques, des langues peuvent changer de statut. Le kurde, qui est une langue minoritaire en Turquie, Syrie, Iran et Irak, était classé comme langue « symétrique et limitée », mais grâce à la reconnaissance linguistique avec des changements dans la nouvelle constitution irakienne[Réf] sur le statut officiel du kurde au Kurdistan irakien, elle est devenue une langue transfrontalière « asymétrique et limitée » lors du référendum du 15 octobre 2005. Ce qui lui donne plus de poids à la langue quant à sa survivance et donne de l'espoir aux autres communautés limitrophes. Différence de population Il faut peut être noter, concernant les langues transfrontalières limitées asymétriques et symétriques, que la taille de la population d'un pays reste relativement importante et doit être prise en compte. Une langue minoritaire parmi de petits groupes linguistiques dans un petit pays peut être plus considérée qu'une langue parlée par de nombreux locuteurs dans un grand pays. Les gens parlant haoussa sont au total 25 millions dont 18 millions sur les 140 millions que compte le Nigeria. Ils sont un grand groupe linguistique toutefois minoritaires dans ce pays, puisqu'ils représentent seulement 13% des Nigérians. Par contre, les Haoussas du Niger ne sont que 5 millions sur 11 millions mais ils représentent une proportion linguistique plus imposante qu'au Nigeria, soit 45%, bien qu'ils y soient 3.5 fois moins nombreux. Le haoussa à en conséquence plus d'importance au Niger qu'au Nigeria. |
Statut officiel du Kurde avec l'arabe en rouge foncé au Kurdistan irakien |
Critères
La continuité territoriale fait partie intégrante de la définition. Les
langues internationales sont souvent des langues transfrontalières. Quand une
langue transfrontalière se recoupe sur plusieurs pays comme l'Arabe,
de la Mauritanie à l'Iraq, elle est aussi internationale. Il y a aussi les
langues non-transfrontalières, qui sont de 2 types, soient elles sont
internationales ou soient elles ne le sont pas, toutefois on les confond parfois avec
les langues transfrontalières. L'anglais est devenu langue internationale mondiale pour l'échange de biens et de services
dans les hautes sphères économiques, il est devenu une langue transfrontalière
suite à la conquête irlandaise puis nord américaine. Si une langue n'est pas
transfrontalière comme le vietnamien ou le Japonais, elle a peu de chance d'être utilisée dans les échanges transfrontaliers, et son
usage reste limité à l'intérieur même d'un pays. Une autre exception, celle de
la langue chinoise, langue officielle dans 3 pays, qui est une langue
internationale mais pas transfrontalière.
Singapour qui compte 77% de Chinois, Taiwan et la Chine n'ont pas de continuité territoriale.
Les langues transfrontalières n'ont rarement aucun locuteur de langue maternelle
dans la zone frontalière à l'exception des langues internationales. Le
swahili est
aussi une exception en soi, car langue maternelle pour seulement 5 millions de
personnes sur les côtes du Kenya et de la Tanzanie, il est utilisé comme
lingua franca et langue transfrontalière sur 11 frontières avec 55 millions
de locuteurs. Le swahili est utilisé entre le Burundi et la R.D. Congo comme
langue d'échange. Malgré son petit territoire et nombre de locuteurs unilingue
maternel, cette langue s'est métissée avec l'arabe pour devenir la langue de
communication entre les peuples.
Différence entre langue transfrontalière et internationale
|
Une langue transfrontalière est toujours une
langue internationale (entre deux nations) toutefois une langue dite
internationale n'est pas forcement transfrontalière. Exemple du portugais qui
est une langue internationale, parlé en Angola, Brésil, Guinée-Bissau,
Mozambique, Portugal, Timor oriental, Sao Tomé-et-Principe et Cap-Vert, n'a
aucune continuité territoriale entre ces différents pays, (sauf peut-être avec
le dialecte portugais qu'est le
galicien en
Espagne). En effet, tous les pays lusophones répartis sur 4 continents ne se
touchent aucunement. |
Le portugais est une langue internationale mais pas transfrontalière.
|
Langues transfrontalières et conséquences
Le contrôle frontalier d'une frontière rigide mis en place par les nations
(les douanes, la police, les postes militaires, etc.) comme symboles de la
souveraineté et le moyen de réguler la circulation des peuples et des biens et
marchandises sont perçus comme des lignes de séparation et d'aliénation par les
personnes vivant des deux côtés[Réf].
Il y a souvent une identité ethnolinguistique fondamentale à travers les
frontières arbitraires qui tend à être ignorée par des nations ou par des
fonctionnaires dans leurs tâches. Le ressentiment des personnes divisées par la
frontière de séparation est manifesté dans un renforcement des réseaux entre les
différents groupes ou intra-ethnico-linguistiques, et une volonté d'ignorer les frontières nationales.
En conséquence, là où existent aux frontières des nations, deux types de
nationalismes se manifestent : soit un nationalisme ethnolinguistique
fondamental facilité par le partage d'une langue (transfrontière) commune, le
symbole et la marque identitaire. Soit par les deux nationalismes politiques
manifestement identifiés comme nations.
Les conflits surgissent quand des anciens sentiments ou des intérêts communs
sont violés par l'un ou l'autre ou les deux nationalismes superposés et par
conséquent les populations doivent réagir conjointement. Les langues
transfrontières tendent à avoir différents systèmes de codification pour une
même langue à travers la frontière avec différentes normes orthographiques, etc.
et ce sont des conséquences défavorables de mutualisation des ressources en
matière d'instruction, de littérature et d'éducation. Ceci s'ajoute au coût du LP (language planning) et crée des problèmes artificiels entre les
peuples et les nations.
Rôles
|
Un rôle d'intermédiaire dans l'extension de religions. Les institutions utilisent la langue transfrontalière comme outil de propagande pour convertir des personnes. L'extension religieuse se fait à travers des institutions religieuses. Exemple : de nos jours, certaines églises chrétiennes, avec la traduction de la bible et l'aide de d'association comme le Summer Institute of Linguistics[Réf], évangélisent des populations en Afrique, comme celle que pratique l'église Kibangui dans la zone linguistique du kikongo[Réf] (18 millions de locuteurs répartis entre l'Angola, le Gabon et à l'ouest des deux Congo). Déjà, il y a plus d'un siècle, des missionnaires Oblats venus au Congo feront leur stage par l'apprentissage cette langue à Ipamu[Réf]. Les religions jouent un rôle décisif dans le processus de socialisation et d'intégration régionale, ce qui élargit le champ des conflits et aggrave les situations de crise. Le rôle économique de la langue transfrontalière est le plus couramment utilisé. L'économie d'un pays envers un autre oblige à l'utilisation d'une langue internationale et/ou transfrontalière car cela facilite les échanges. L'anglais joue un rôle majeur entre les relations des États-Unis avec le Canada, d'ailleurs, leurs liens économiques sont parmi les plus imbriqués au monde[Réf]. La langue transfrontalière est un refuge. Nombreux sont les Basques qui se sont réfugiés en France durant les répressions franquistes. Nombreux sont les locuteurs Pachtos[Réf] qui traversent de chaque côté de la ligne Durand[Réf], vont au Pakistan pour échapper à la misère, à la répression talibane ou américaine en Afghanistan. Toutes ces personnes parlant une langue transfrontalière échappent trop souvent aux recensements. Le milieu politique dans de nombreux pays utilise les langues internationales la majeur du temps toutefois des langues transfrontalières sont utilisées de façon informelle ou officielle. Dans la résolution du conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les deux pays se sont mis d'accord pour que le tigrinya et l'arabe soient les langues de travail. La culture est rarement dissociable du bagage linguistique qui l'accompagne. Il est facile pour un Belge flamand de pouvoir diffuser un livre ou film vers les Pays-Bas. Cette langue transfrontalière qu'est le néerlandais est un facilitateur d'échanges culturels et sociaux. Le trafic ou la contrebande est très répandue chez les minorités linguistiques transfrontalières qui y trouvent un moyen de subsistance par des moyens illégaux. Le mohawk s'utilise quand des autochtones du Québec ou de l'Ontario traversent la frontière américaine sans problème puisque leur réserve est à cheval sur deux pays. La manipulation des statistiques démographiques d'une langue transfrontalière menacée est chose courante. Il est intéressant de voir que certains pays ne prennent pas en compte de façon juste des populations ou un groupe linguistique différent pour les effacer du destin national. Le tibétain n'existe plus officiellement en chine, il doit être noyé au chinois mandarin. Actuellement au Tibet, il y a plus de chinois han que de tibétains de souche (7.5 millions versus 6 millions). Le chinois prend le dessus car le groupe ethnique des Hans de langue mandarine constitue 91% de la population. Peu de chance que le Tibétain survive dans son territoire linguistique actuel. Il est encore parlé au Cachemire indien. Le rôle d'assimilation linguistique par des langues transfrontalières, le plus souvent asymétriques et considérée importante par le reste la population du pays, poursuit son extension aux détriments d'autres langues moins prestigieuse. Au début du XXe siècle, la Belgique a subi un assez important recul du flamand occidental au profit du français à cause du statut international qu'avait cette langue. |
Distribution géographique des langues kongo et du kituba.
Le mohawk entre le Canada, au Québec et en Ontario, et les États-Unis.
Le néerlandais facilite les échanges culturels et sociaux. |
Avenir
Définir les langues transfrontalières suivant les lois d'un pays ou d'une nation reconnue internationalement est la norme dans presque tous les pays. Par exemple, parler le lunda, c'est en second lieu appartenir à une aire géographique précise de 3 pays tels que l'Angola, la Zambie et la République Démocratique du Congo, 3 pays reconnus internationalement, mais c'est en premier lieu appartenir à un territoire linguistique défini par la réalité de l'existence même du Lunda et de sa pratique avant tout. On fait trop souvent l'exercice inverse. On installe les frontières, puis on y place les langues transfrontalières. L'existence d'une langue transfrontalière préfigure aux desseins d'un pays et résulte d'une histoire linguistique passée. Quant à l'avenir des langues, la tendance à la considération d'un schéma frontalier définissant les langues qui y survivront, d'où la disparition des 90% des 6700 langues d'ici un siècle, est en accord avec les politiques linguistiques actuelles. Ces dernières détermineront la survie des langues transfrontalières dans la plupart des pays. Il existe quelques outils tels que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui protège les langues minoritaires et soutenue par la politique linguistique de l'Union européenne, qui doit faire face à l'impérialisme linguistique des langues internationales.
Références difficiles
Il existe peu de documentations sur le sujet, étant donné que la langue transfrontalière n'intéresse les États nations seulement quand cela fait leur affaire. Comme la reconnaissance linguistique de 90% des « petites » langues transfrontalières passe souvent par la reconnaissance de la nation qui la pratique, il est préférable pour les pays de l'ignorer, de la bannir ou de la noyer. De plus, le fait que qu'une langue se situe sur deux pays, cela pose un double problème.
Histoire des Basques
Le Pays Basque ne manque pas d'historiens d'ici et d'ailleurs pour raconter et décrire la singularité de ce territoire à travers les âges. En voici une petite liste : Lope Gartzia Salazar, Manex Goihenetxe, Pero Lopez Aiarakoa, José María Lakarra, Jeronimo Mendieta, Anakleto Ortueta, Mikel Sorauren, Pascual Tamburri, Jose Ignacio Telletxea, Txema Uriarte, Xabier Zabaltza. Quelques collectifs d'historiens et autres chercheurs se créent parfois avec pour objectif la publication de livres ou documents sur des sujets et des périodes précises. Mais ces dernières années, deux collectifs ont fait leurs apparitions dont l'objectif est de remettre sérieusement en compte l'histoire officielle promulguée par les États français et espagnol, plus proche parfois de l'endoctrinement que des faits et réalités historiques passées.
|
Fondation Euskal Memoria est un organisme dont l'objectif est de structurer un travail de recueil de la mémoire historique afin de faire front au «silence et la falsification» des États français et espagnol. Selon Grazi Etxebehere, «Bien que de générations différentes, de cultures politiques différentes et provenant de divers territoires, une chose nous unit : la falsification historique par laquelle les États abordent le passé et le présent du Pays Basque. Nous nous joignons dans une cause commune qui va plus loin que le cadre historique : le refus de la négation que les États font de la réalité du Pays Basque, de son existence et de sa raison d'être, ont-ils précisé. Pour nous, il est évident que l'Espagne et la France mentent sur notre passé afin que nous craignions le présent et que nous ne pensions pas au futur». Nabarralde est une association culturelle constituée par plusieurs historiens dont l'objectif est d'inventorier toute connaissance historique relative à l'histoire de la Navarre en tant qu'État politique qu'il fut en Europe. Pour cela la recherche se base, grâce à une vaste documentation, sur la culture, l'histoire, et de tout ce qui concerne son origine ou l'influence actuelle de la société basque. Cette association soutient que la Navarre a été et doit être à nouveau une entité politique de la société basque. |
|
L'histoire qui a été écrite sur le Pays Basque ou ses autres lieux basques autrefois nommés Vasconie, Novempopulanie, Royaume de Navarre est souvent biaisée. En effet, il est si facile de rééditer tranquillement ce qui se répète depuis des siècles sans que l'on y prête attention. L'histoire écrite du Pays Basque est assurément très riche, mais s'en faire le maître absolu dans les livres d'histoire après une simple bataille gagnée à mille lieux de son propre territoire reviendrait à dire, à titre de comparaison, que les États-Unis sont les maîtres d'Afghanistan en 2009. Militairement, c'est incontestable, mais la réalité n'est pas aussi simple. Les Visigoths de langue germanique, qui n'étaient que 100 000 dont 20 000 soldats sur une population totale de 6 millions d'habitants de langues latines, celtiques et euskariennes font l'histoire écrite à eux seuls au VIe siècle en Ibérie. La méthode chronologique d'énumérer les faits dans l'ordre de leur succession n'est pas suffisante, il est nécessaire que d'autres notions comme les mœurs, la langue et le mode de vie s'y ajoutent.
|
Mais l'histoire officielle s'écrit malheureusement trop souvent au bon gré des historiens complaisants aux gens de pouvoir. Un autre exemple simple est celui de Juan Sebastian Elkano, explorateur basque, était autrefois connu par tous pour avoir réalisé la première circumnavigation du globe de 1519 à 1522. Mais plusieurs siècles plus tard, quand le nationalisme basque a exacerbé les gouvernements espagnols, les historiens serviles ont fait table rase d'Elkano et n'ont plus parlé que de Magellan. De nos jours, de New-York à Shanghai, tout le monde connait Magellan comme étant le premier homme a avoir fait le tour du monde alors que ce dernier est mort aux Philippines à mi-parcours. L'Espagne ne voulait plus que l'on sache qu'un Basque ait été le premier à réaliser un tel exploit. Et un exemple comme celui-ci, il y en a des centaines des deux cotés des Pyrénées. Le mépris envers les Basques, qui est révélateur d'une société dominante et arrogante, ne date pas d'aujourd'hui. « La légende noire des Basques » commence avec les auteurs romains (Salluste, Valère-Maxime, Juvénal) ; elle continue avec les auteurs chrétiens de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Age (Ausone, Paulin), les chroniqueurs francs comme Grégoire de Tours ou Eginhard. Ça va d'Aymery Picaud en 1139 à François Cavanna en 1997[Réf], même dans les médias actuels, les mêmes reflexes tendancieux se répètent, un poseur de bombe est toujours « Basque » et un vainqueur d'étape appartenant l'équipe cycliste Euskaltel-Euskadi comme Mikel Astarloza est toujours « Espagnol ». La création de la Fondation Euskal Memoria, Nabarralde et autres collectifs ne sont donc pas le fruit du hasard. |
Cette carte historique est biaisée car elle nous montre les Bretons alors que les Vascons et la Vasconie n'existe tout simplement pas. Si ce n'est pas mentionné dans les livres d'histoire et de géographie que les ancêtres des Basques possédaient la Novempopulanie ou la Gascogne pendant plus d'un millénaire, alors les enfants sont endoctrinés au lieu d'avoir à leurs connaissances les réalités historiques. L'enseignement porte l'odieux des mensonges.
|
Voir en basque la Chronologie historique du Pays Basque et les cartes ***
Voir l'Euskal Herriko Historia ****
Voir l'article Histoire des Basques sur wiki *
Voir l'article Euskal Herriko historia sur wiki en basque ***
Voir l'article Histoire d'Euskal Herria sur euskosare.org**
Nationalisme
Voir l'article Nationalisme basque.
Les distinctions les plus marquées entre les Basques et leurs voisins traditionnels sont principalement sur le plan génétique, culturel et linguistique. Entourés de locuteurs parlant des langues indo-européennes romanes, les Basques, historiquement, parlent une langue qui n'est ni romane mais surtout non indo-européenne. La langue les distinguent en conséquence fortement de leurs voisins. S'il l'on devait résumer, le nationalisme moderne basque commença suite à une forte immigration d'Espagnols venus chercher du travail dans une Biscaye très industrialisée et avec la suppression des institutions juridiques ancestrales (Fueros ou Fors basques) après la seconde guerre carliste de 1876. Sabino Arana, fondateur du parti nationaliste basque, va professer le rejet virulent du libéralisme et encourager un catholicisme passionné dans une population autochtone basque qui se sent envahie. Il propagea aussi l'idée que les Basques étaient génétiquement distincts et par conséquents supérieurs. De tels arguments sont considérés racistes d'un point de vue moderne, mais à cette époque, Arana devait contrecarrer un racisme ambiant envers les Basques et une domination sans concession espagnole. Il partage les modes de pensée en vogue à l'époque, n'oublions pas la littérature d'expression française et sur les Français, de Gobineau à H. Chavée, théoriciens du racisme français à la même époque. Toutefois même si aujourd'hui cette idée ultra-minoritaire reste toujours présente dans certains milieux nationalistes basques, un bon nombre de jeunes basques, particulièrement en Espagne, s'identifient plus fermement comme Basques que de nationalité espagnole ou français.
Le nationalisme actuel prend différentes formes, il va du simple engagement citoyen (Batera, les Ikastola pour certains parents, CDDHPB, Behatokia), en passant par l'implication politique (EA ou Eusko Alkartasuna, Abertzale, PNV, Herri Batasuna, Ekaitza), par des liens informels (Liens entre nationalistes basques et bretons), à l'épreuve de force entre partis (ETA ou Euskadi ta Askatasuna, Kale borroka, Irrintzi). Pour contrer les anti-indépendantistes, il y a des organisations comme Basta Ya ou le terrorisme étatique du Batallón Vasco Español (1975-1981) qui sera remplacé par le GAL ou Groupes Antiterroristes de Libération.
Quant à l'épreuve de force entre l'E.T.A. et le gouvernement castillan, le problème est que les négociations n'aboutissent pas suite aux fins de non-recevoir des gouvernements face aux revendications des etarras (membres de l'ETA). Leurs demandes sont claires, ils veulent l'autodétermination suivant un processus démocratique mais surtout le Laurak Bat ou « Les 4 (provinces font) un », soit la rétrocession de la Navarre à la C.A. d'Euskadi. Le gouvernement central espagnol et une simple majorité des Navarrais y sont contre. Seulement l'idée fait tranquillement son chemin en Navarre comme l'ont montrées les dernières élections, étant donné que la « très riche » C.A. d'Euskadi a un pouvoir d'attraction qui est pour certains non négligeable, et peut reléguer au second plan les questions de revendications identitaires ou territoriales mises de l'avant par les Abertzale, les partis politiques et les médias.
|
En Euskadi, les nationalistes qui se placent à gauche représentent entre 8 et 12% du corps électoral, des chiffres comparables aux autres pays européens même si ces derniers sont le plus souvent à droite. Selon Euskobaromètre, en Euskadi, en début 2010, 63% des Basques s'opposent au groupe armé E.T.A, tandis que seulement 0,4% montre son soutien total explicite; la gauche abertzale (patriote) illégalisée est soutenu par 4% de l'électorat. Pourtant 39 % des votants abertzale disent soutenir leurs objectifs mais rejettent leurs méthodes violentes. Par ailleurs, l'emploi est la principale préoccupation pour 51% des Basques, suivi par la situation économique (19 %), et la violence et le terrorisme (8 %). La résolution du conflit et la paix sont des vœux chers pour 9 Basques sur 10 toutefois d'après Mariejo Béliveau : « En Euskal Herria, le climat répressif, qui inclut la torture des prisonniers politiques, a grandement participé à l'insatisfaction des Basques envers l'État espagnol et donné des munitions aux branches plus radicales du mouvement nationaliste. Ils demeurent nombreux en Euskal Herria à revendiquer la paix et une solution pacifique au conflit, mais ils exigent aussi que le terrorisme d'État cesse au Pays Basque ».[Réf] A présent, plus de 90% de population, de tous bords, dénonce la faillite des élites politiques qui n'arrivent pas à s'entendre avec l'ETA pour mettre fin à la violence. Donc, la question qui se pose est la suivante
: mais à qui profite le crime ? |
Unai Romano torturé par la Guardia civil espagnole en 2001.
Attentat proche d'une école militaire à Santoña (Cantabrie), tuant un militaire (Luis Conde de la Cruz), blessant six autres dont cinq légèrement (22/09/2008). |
Noam Chomsky pense que le mot « terrorisme » est une étiquette facile pour des gouvernements qui ont été incapables de reconnaître la dimension terroriste de leurs propres activités[Réf]. Ces dernières s'expriment donc insidieusement de nos jours par l'interdiction de partis comme Batasuna, l'ANV ou Segi (Gazteriak), des associations de soutien aux prisonniers, la fermeture d'Egunkaria (seul quotidien de langue basque), par un régime de détention au secret et prolongée, par des harcèlements judiciaires sous de faux prétextes ou l'interdiction de manifestations [Réf] entre autres. De plus il n'y a aucune impartialité et crédibilité quant aux informations, les journaux nationaux français ou espagnols et médias télévisuels répétant à satiété les « versions officielles » sur tout type de « terrorisme basque » et ignorant le terrorisme d'État de façon délibérée. Grâce au mot « terrorisme », n'importe quelle loi peut être votée sans que la population soit consultée. Il a même été prouvé dans les années 1980 que des terroristes n'ont pas été arrêtés par la direction de services anti-terroristes espagnols, ces derniers craignaient de ne plus avoir assez d'Etarra à arrêter et de voir certains budgets alloués coupés. L'existence d'l'E.T.A. est une justification essentielle et primordiale pour continuer le terrorisme étatique sous ses formes les plus insidieuses.
C'est par conséquent un « terrorisme versus terrorisme » qui perdure sans véritable recherche de paix durable, et surtout de la part des plus puissants : les États. Quant à l'implication de l'État français, « La démocratie s'arrête où commence la raison d'État » comme disait Charles Pasqua, bref la raison d'État bafoue les principes démocratiques et les médias ferment les yeux.
|
"Euskal Herriaren eskubideen alde. Egitasmo politiko guztiei aukera demokratikoa" (Pour les droits d'Euskal Herria. Possibilité de tous choix politiques démocratiques). Exprimer sa volonté indépendantiste à travers une association devient un délit et plusieurs sont en prison sans avoir commis de crime. |
Cette manifestation du 1 décembre 2007 n'a eu aucun écho, aucune ligne dans les médias français, qui n'oublient jamais de signaler les moindres manifestations anti-ETA. de Madrid ou d'ailleurs (deux poids, deux mesures). Cette manifestation à Bilbao dénonce les centaines de procédures qui ont été ouvertes contre les divers collectifs progressistes qui militent pour la défense des droits politiques, sociaux et culturels du Pays Basque. La société basque connaît ces dernières années de graves conséquences suite au procès de la Plateforme 18/98+ et des autres procès du même genre ouverts à l'Audience Nationale Espagnole. Fermeture de journaux, de locaux associatifs, détentions provisoires abusives, et plus de 250 inculpés sont inclus dans la procédure. Il s'agit d'une procédure pleine de mensonges et d'irrégularités juridiques : basée sur la thèse « tout est l'ETA. » sans y ajouter aucune preuve, sans spécifier de comportement délictuel. |
Si les médias nous rapportent au moindre article le chiffre affligeant et lourdement préjudiciable des 839 personnes tuées par ETA depuis sa création en 1959, ils oublient par contre de nous rapporter dans des articles analogues, que le franquisme à fait 400 000 victimes et la guerre d'Algérie au moins 500 000 morts, soit respectivement 500 et 625 fois plus que ce qu'a fait l'ETA en 50 années. Ce pilonnage médiatique spécifique de la presse, de la radio ou de la télévision a pour but de vilipender et calomnier une partie de la société basque proche des milieux nationalistes, alors que les nationalismes espagnols et français sont magnifiés, voire flagornés, louangés[Réf]. Dans la période allant de 1959 (année de naissance de l'ETA) à 2009, chez les Basques, il y a eu 465 morts consécutives à des actions de la police et/ou des forces paramilitaires, 55 000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques, dont 10 000 ont dénoncé la torture et 7 000 ont été emprisonnées. Et tout cela pour une population de seulement 3 millions.

Torture et impunité
La fondation Euskal Memoria aborde la question de la torture sous tous ses aspects dans le livre “Oso latza izan da”. Elle chiffre cette réalité entre 1960 et 1977, en recoupant diverses données et témoignages, elle estime que pour cette période il y aurait eu 10 000 arrestations et que 50 à 70 % des personnes arrêtées auraient été torturées. Quand la fondation a commencé son travail beaucoup de gens n’avaient encore jamais témoigné. D’autres ont aussi compris que les mauvais traitements qu’ils avaient reçus étaient synonymes de torture. “Battu, oui ils m’ont battu à Gasteiz et aussi à Donostia, mais par chance, pour ce qui est de la torture, non” affirme ainsi un témoin. Les témoignages recueillis mettent en lumière l’horreur de la pratique de la torture dans les commissariats espagnols. Mais pour la fondation le travail ne fait que commencer d’autant plus que jamais l’Etat n’a reconnu l’existence de ces pratiques. Quant aux tortionnaires, ils sont constamment graciés par des juges complices et complaisants à Madrid et jouissent par conséquent d'impunité.
|
Le rapport sur la torture de l'année 2003 selon Behatokia.
Comme on peut le constater, il n'y a pas seulement que la police espagnole et la Guardia civil qui font usage de la torture, la police basque Ertzaintza n'est pas en reste et aussi moindrement la police française. 839 Personnes tuées par l'ETA
|

Quelques chiffres de la répression étatique en 25 ans (chiffres de 1979
à 2004) |
Cependant, subsistent
Internet, la presse et les radios strictement locales comme plateforme où toutes
les opinions sont exprimées et où certaines divulgations, révélations sont non
filtrées. La presse en particulier, ainsi que tous les médias d'informations
régionaux ou nationaux sont depuis des décennies à mille lieues des réalités et
des aspirations qui touchent une population diversifiée et plurielle que
constitue l'ensemble de l'Euskal Herria.
Attendu que les clichés et autres allégories fourmillantes ne remettent
surtout pas en question l'État de droit et les institutions désuètes qui
s'y imputent. En France, la bourgeoisie, au commande des partis
politiques de droite comme de gauche, démontre un mépris affligeant envers la population
basque digne du Moyen-âge[Réf]. Xabier Arzalluz Antia, politicien et idéologue du
EAJ/PNV nous résume la situation en 2000 en affirmant que « notre premier
problème est d'obtenir la paix. Un compromis est possible. l'ETA et le
gouvernement espagnol ont le même problème. L'organisation terroriste doit
modérer ses militants les plus extrémistes alors que le Parti Populaire, au
pouvoir à Madrid, doit contenir ceux qui refusent toute négociation et rêvent
d'une Espagne forte et unie. Il y a des gens à Madrid qui ne veulent pas de
paix. Car si l'ETA disparait, la majorité au parlement basque sera pour
longtemps constituée des partis nationalistes. Nous devions auparavant nous
allier aux socialistes. Il était impossible de s'entendre avec des terroristes.
La paix pourrait en conséquence remettre en question l'unité de l'Espagne en
rendant enfin possible l'unité des nationalistes. C'est probablement pourquoi,
chaque jour à la radio et à la télévision de Madrid, on nous traite de racistes.
»[Réf]
Cette théorie s'est confirmée aux dernières élections dans la Communauté autonome
basque de 2009. Les électeurs proches des idées de l'E.T.A. qui représentent environ
150 000 voix (12% des suffrages) n'ont pas pu s'exprimer, ce qui a permis
aux socialistes
basques d'être
désormais au pouvoir et de constituer le nouveau gouvernement basque (Eusko
Jaurlaritza) grâce à une
coalition contre nature avec le Parti Populaire. Cela démontre encore une fois
la faillite des élites socialistes espagnoles qui préfèrent tourner le dos à
leurs idées progressistes et bafouer les aspirations d'une société basque en s'associant avec le PP. Par ailleurs, 65 % des citoyens disent être en désaccord avec le pacte entre le PSE et le PP. Leurs
objectifs communs sont de faire place
à la guerre contre le terrorisme et d'accentuer le clivage entre nationalistes
basques et constitutionnalistes. Malgré les discours
soi-disant gauchistes, réformistes et socialistes qui sont matraqués dans les médias espagnols
à longueur d'année, les faits, par contre, montrent un PSOE et sa branche basque du Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko
Ezkerra (PSE-EE) menée par Patxi Lopez et nouveau lehendakari, chinant à diviser la société
basque pour le dessein d'une Espagne plus forte, toujours irrespectueuse des enjeux démocratiques
en Euskadi et en Navarre. D'ailleurs, dans le même genre d'idée, les socialistes ont fait la même chose en Navarre puisqu'ils ont préféré laisser le
pouvoir à l'Union du Peuple Navarrais (branche du PP) plutôt que de former un gouvernement avec Nafarroa Bai.
Le PSOE avait en effet en 2007, court-circuité la direction du
Parti Socialiste Navarrais, lui objectant toute coalition possible avec le parti basque
Nafarroa Bai dans le but de former le nouveau gouvernement de Navarre pour 4 ans, et préférant
laisser encore la présidence à l'UPN. Cependant
les politiques d'alliances menées par le parti socialiste en Catalogne ou en Galice, où il gouverne en coalition avec
des indépendantistes, ne peut pas s'appliquer en Navarre car tout ce qui concerne ce territoire relève de la « Raison d'État
». Très récemment, le
chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, avait déclaré que « la Navarre appartient à tous
», sous entendu « à l'Espagne » et que par conséquent « les décisions la
concernant peuvent être prises dans le cadre des intérêts de l'État espagnol ». Le leader du PNV,
Juan Jose Ibarretxe, considère que le PP et le PSOE « ont trahi la parole de la
société basque ». L'enjeu premier et inavouable des élites socialistes, est sans
l'ombre d'un doute de marginaliser les Basques non-constitutionalistes quelques soient les moyens et la manière, soit en accédant au pouvoir en
2009 dans la CAB ou soit en le cédant en 2007 en Navarre. En conclusion, il
ne fait aucun doute que la violence d'ETA a profité exclusivement qu'aux États et se poser les questions « à qui
profite le crime » et « pourquoi tout référendum est balayé d'un revers de main ? » ne sont pas une économie à faire.
Le but ultime du terrorisme est de faire croire aux populations qui supportent de moins
en moins l'État (taxes, répression, précarité) que le terrorisme est un ennemi commun. L'histoire à démontré que
de nombreux États en crise avaient besoin d'actes meurtriers manipulés, pour se crédibiliser
au sein des populations afin de les soumettre insidieusement. Seul les initiés
aux services secrets et aux manipulations ont une compréhension de ce type mécanisme,
bien au point depuis deux siècles (cf. Orwel, Machiavel, Marx, Hegel ou Debord) Il y a 40 ans,
à la fin du franquisme, l'ETA bien infiltré aurait pu être totalement
démantelée. Mais c'est seulement maintenant, au début des années 2000, qu'ils n'en ont
plus besoin, comme de l'IRA ou du FLNC. Ils démantèlent tranquillement les
cellules infiltrées car désormais, ces fractions désarmées, à sec, n'ont
plus le choix que de mourir afin qu'un nouveau terrorisme de substitution voit
le jour, le terrorisme islamique. Tout aussi infiltré, sinon plus avec les
technologies actuelles, avec des
revendications de nature encore plus indistinctes, un territoire qui concerne
maintenant toute l'Europe, car la crise du capital est partout, ce terrorisme va
prospérer. Bientôt, nous
serons des millions, comme des moutons, bêlant ''abat le terrorisme'' et ce, au
côté de ceux qui l'ont créé et l'utilisent, de ceux qui mettent en faillite des populations entières. Plus la crise sera profonde, plus les attentats se multiplieront.
Un nouveau cycle de 50 ans vient de naître. Allez, Goazen, au suivant ! Selon
Jean-Pierre Massias, le conflit basque est complexe car il présente toute une série de caractéristiques :
a) du point de vue géographique, le conflit implique deux états, l'état français et l'état espagnol, opposés à trois « entités » : la Comunidad Vasca (Euskadi), la Navarre et le Pays Basque Nord (Iparralde).
b) du point de vue historique : le conflit, né sous la dictature franquiste, se poursuit après l'instauration de la démocratie. Habituellement, la transition d'un régime à l'autre permet de trouver des solutions pacifiques, ce qui n'est pas le cas pour Euskal Herria.
c) Il s'agit d'un conflit particulier, appelé « conflit asymétrique ». C'est ainsi que l'on qualifie les conflits dans lesquels le rapport de force entre les opposants est déséquilibré, entre un fort et un plus faible, ce qui signifie que les opérations militaires ne sont pas essentielles, le parti le plus faible ne pouvant espérer vaincre l'autre par les armes. L'objectif primordial est d'obtenir le soutien de l'opinion publique, c'est-à-dire l'appui de la société civile. Il s'agit de provoquer une réaction forte de l'opinion afin de déstabiliser l'adversaire. C'est un schéma tactique qui induit une certaine perversion puisque dans ce cas de figure les coups reçus, en « victimisant » celui qui les reçoit, sont plus porteurs que les coups reçus… Avec pour corollaire la difficulté de revenir en arrière, notamment concernant les associations de victimes dont la création a été sinon provoquée du moins encouragées et soutenues !
Ce conflit est sociétal.
Le conflit basque est devenu un instrument électoral. En 1996, le GAL a coûté sa réélection à Felipe Gonzàlez, en 2004, juste avant les élections, l'attentat de la gare de Atocha, que le gouvernement espagnol s'était empressé d'attribuer à ETA a coûté à José Maria Aznar une réélection qui semblait acquise. Or aujourd'hui, un des faits nouveaux est que le conflit basque n'a pas interféré sur les élections. Les enjeux de ce conflit sont considérables au niveau politique
car il touche au territoire espagnol, il ampute de son territoire une région riche et industrialisée,
il touche à la mémoire du franquisme et pose le problème de la transition, mettant en évidence le fait que la rupture avec le franquisme n'est pas terminée, comme le démontre l'utilisation de la torture avec les mêmes méthodes – à peine « améliorées » - et parfois les mêmes exécutants qu'à l'époque du Caudillo. Le conflit basque a
aussi permis de fédérer l'état espagnol contre un ennemi intérieur, permettant de mettre de côté une réflexion sur la période de la guerre civile et ses victimes.
Un processus en place qui semble réussir
Il y a eu par le passé plusieurs tentatives pour résoudre le conflit, qui jusqu'à présent ont toutes échoué. Des trois plus importantes, la première a été celle de 1986 à 1989, avec les négociations d'Alger, la seconde fut celle de Lizarra-Garazi (98). La troisième, celle de Loyola en mars 2006, a abouti à une trêve de ETA, rompue en 2007 par l'attentat de l'aéroport de Barajas.
La tentative actuelle présente trois caractéristiques :
1) le processus est construit politiquement par la société civile et imposé aux deux anciens protagonistes, l'état espagnol et l'ETA, entre novembre 2009 et 2011. En septembre 2010 est conclu un accord social, politique, démocratique et pacifique qui aboutit à la déclaration d'Aiete. Cet accord est un grand facteur de réussite car il remet la société au centre des débats, ce qui le crédibilise. Le conflit est d'abord un conflit politique.
2) le processus est conduit internationalement. Cette fois, des négociateurs de très haut niveau (députés européens, prix Nobel, etc.) interviennent au grand jour, avec la mise en place, par la Déclaration de Bruxelles du 29 mars 2010, d'un Groupe International de Contact pour la médiation (composé de Brian Currin, Silvia Casale, Alberto Spektorowski, Nuala O'Loan, Pierre Hazan et de Raymond Kendall) chargé de favoriser le processus de paix au Pays Basque.
Suite à la Conférence d'Aiete du 17 octobre 2011, Le Groupe international de contact (GIC) a décidé de créer un comité, afin de maintenir l'élan provoqué après la tenue de la conférence internationale à Donostia. Le GIC s'est réuni à Londres et a réalisé une évaluation de la situation après la tenue de la conférence. Les membres du GIC notent que seulement quelques jours après la déclaration d'Aiete, ETA annonçait, comme recommandé, un cessez-le-feu permanent de ses activités armées. En revanche, la deuxième préconisation de la déclaration du GIC n'a pas été respectée, puisque ni le gouvernement espagnol ni le gouvernement français n'ont pas répondu positivement à la déclaration d'ETA. Par ailleurs, le GIC fait mention de la reconnaissance par le chef de l'Etat espagnol, Mariano Rajoy, de la déclaration d'ETA la considérant “comme un pas important”. Le GIC souligne aussi la déclaration du président de la Commission européenne, se félicitant de la décision d'ETA.
Cet encadrement du processus lui donne une véritable crédibilité.
Pour la première fois depuis longtemps, le problème basque n'a pas été l'argument qui a induit un changement de gouvernement. Contrairement à Felipe Gonzalez empêtré dans les problèmes du GAL ou à Aznar trop prompt à imputer à l'ETA l'attentat de la gare d'Atocha, le problème basque n'a pas été une arme décisive aux mains d'un parti ou d'un autre dans les dernières élections en Espagne, et c'est la crise économique qui a coûté son poste à Zapatero, non sa gestion du conflit. Le processus de paix a été également validé par les dernières élections au Pays Basque sud qui ont vu la coalition abertzale de Bildu et Amaiur s'afficher comme la deuxième force politique de la communauté basque.
Mais le processus reste fragile car tout n'est pas fait. Dans la résolution d'un conflit, interviennent la paix négative, c'est-à-dire l'arrêt de la violence, et la paix positive qui recherche les causes ayant abouti à l'emploi de la violence sous ses différentes formes. A savoir :
la violence matérielle, qui consiste à se battre.
La violence structurelle, qui vise à rationaliser la première par la mise en place d'une logistique, le prélèvement d'impôts et le soutien des combattants.
La violence culturelle, qui consiste à fabriquer des valeurs pour soutenir la violence. Par exemple démontrer qu'il s'agit d'une guerre juste, pour laquelle on a besoin de martyrs, et sa corollaire, la dévalorisation de l'adversaire qui devient un monstre dépourvu d'humanité.
Ces différentes formes de violence sont intimement liées et interactives.
La Conférence d'Aiete a porté atteinte à la violence matérielle, et par voie de conséquence, à ses corollaires.
La paix positive vise à régler les questions qui ont causé le conflit en trois phases, dites « les trois R » :
la réduction des problèmes, la reconstruction, qui consiste à remplacer les forces de guerre par des forces de paix, la réconciliation.
Aujourd'hui, dans le processus de paix au Pays Basque, on en est à la moitié de la phase de réduction. Le premier point porte sur le règlement de la question des armes et sur le problème des prisonniers. Le second concerne le débat constitutionnel démocratique qui reste à établir. Le troisième point, enfin, est celui de la réconciliation nécessaire. Un point hautement difficile, voire impossible à réaliser pour un grand nombre de personnes impliquées dans le conflit. Mais pas pour Jean-Pierre Massias qui pense que si ça a été possible ailleurs, notamment en Afrique du Sud ou au sortir du conflit de la 2° guerre mondiale, pourquoi ne serait-ce pas possible ici ?
Qu'est-ce qu'une réconciliation dans ce cas précis ? Il s'agit bien évidemment d'une réconciliation sociale et non d'une réconciliation individuelle. Ce concept est indissociable de la recherche de la vérité qui va de pair avec une politique de mémoire qui implique pour les deux camps :
le droit de savoir la vérité,
le droit à la réparation pour toutes les victimes,
le droit au jugement (et non à l'amnistie sans procès, qui n'est qu'une forme d'amnésie imposée qui ne résout rien),
le principe de non récurrence (le désarmement entraîne la démobilisation puis la réinsertion, accompagnée d'un processus de contrôles spécifiques car des années d'implication directes dans la violence d'un conflit induisent des comportements qui ne changeront pas d'eux-mêmes).
Les deux grandes lacunes du processus actuel sont d'abord l'absence de négociations. Or négocier, c'est mettre en place une structure éducative à la paix. Ensuite, le temps qui passe entraîne une baisse de l'acuité sociale. Il est pourtant indispensable que toutes les sociétés basques s'impliquent dans la construction du processus, et la socialisation du processus est capitale. La vie culturelle est différente à bien des égards
mais le mode de vie est similaire, malgré tout, le concept d'appartenance à un
peuple est majoritaire dans la Communauté autonome du Pays Basque, en Iparralde
et légèrement minoritaire en Navarre avec environ 70% de la population
totale de tout l'Euskal Herria qui revendique une appartenance identitaire
basque. Même parmi de nombreux Basques qui ont émigré vers d'autres régions de
l'Espagne, de France ou du monde, on remarque un fort sentiment d'appartenance à
cette communauté.
Chefs d'l'ETA avec les 3 drapeaux : Ikurriña, Arrano Beltza
et le Nafarroako bandera (ou drapeau de la Navarre). Sa devise est « Bietan Jarrai
» et signifie « continuer dans les deux voies ». avec pour symbole, un
serpent (représentant la politique) enroulé autour d'une hache (représentant la
lutte armée)
« We are nations of Europe Good bye Spain! » Les Basques
constituent-il une nation, un peuple, un groupe ethnique? Il n'y a aucun doute
chez tous les ethnologues, les Basques constituent bel et bien un groupe humain
distinct et figurent d'ailleurs dans toutes les encyclopédies des peuples. En effet,
la question semblerait de savoir si le terme de « groupe ethnique » est trop
faible, ou si on ne devrait pas plutôt favoriser le terme de « nation ». Les
notions de peuple et de nation sont interchangeables, cependant la nuance se
joue au fait que le peuple fait référence à la population qui compose la nation
alors que la nation fait intervenir le peuple dans son organisation. La nation
basque est en conséquence divisée en trois dans son organisation même si de nos
jours, en tant qu'Européens vivant dans un secteur fortement industrialisé, les
singularités culturelles des Basques avec le reste de l'Europe sont parfois brouillées.
Le concept de nation peut se recouper parfois avec
l'inscription identitaire, toutefois le sentiment d'appartenance est plutôt une notion à
caractère individuel propre, ne faisant pas forcement référence à un groupe, et dont les approches sociales permettent
à chacun de pouvoir identifier le cadre national qui lui correspond. Selon
Michel
Seymour, le concept de nation est intimement lié à celui de culture
sociétale (= structure de culture est inscrite dans un carrefour d'influences et
se compose essentiellement de 3 éléments dans la sphère publique commune : la
langue, les institutions et l'histoire). Cependant, la conception majoritaire
d'une population sur un territoire donné (pays, réserves, provinces...) n'en
fait pas pour autant un concept légitime. Par exemple, dans la Communauté
autonome basque, la conception de nation sociopolitique que ce fait une majorité
de Basques inclut-elle la minorité espagnole et les immigrants ? Ces derniers
n'ont-il pas plutôt une conception multi sociétale de la nation ? Par les
descriptions ci-dessous, voici quelques éclaircissements : 5 concepts de nation se chevauchent mais le concept
sociopolitique basque et navarrais domine au sud tandis que le concept de
nation civique domine en Iparralde.
Définitions des sept concepts de
nation Concepts de nation au Pays Basque -
Nation ethnique : les personnes se représentent comme partageant la même
origine ancestrale. Exemple : les Autochtones,
les Basques, les Japonais, les Aïnus. - Ce concept n'est pas absent, car d'un point de vue génétique,
linguistique et historique, certaines personnes peuvent facilement avoir le
sentiment d'appartenance à une nation ethniquement basque. La nation
ethnique pourrait aller au delà des frontières de l'Euskal Herria, car
les études génétiques allaient de la Rioja à la Bigorre. C'est un
concept à géométrie variable au vue de son histoire plus que millénaire.
La nation ethnique basque d'un point de vue patronymique inclurait
sûrement la Navarre. Des contours linguistiques donnent le plus de perspectives
d'avenir ou de survivance à une telle approche. -
Nation culturelle : les personnes se conçoivent comme ayant différentes
origines ancestrales mais rassemblé autour d'une même langue, d'un même
ensemble d'institution et d'une même histoire. Exemple
: les Acadiens, les Métis au Canada - Rien de tel
dans l'histoire des Basques ne s'est créé ailleurs sauf quelques traces
linguistiques. Le basco-islandais
était un pidgin parlé en
Islande au XVIIe siècle ou le
basco-algonquin. Ils
se sont développés avec le contact que les
pécheurs basques ont eu avec les populations locales islandaises et
amérindiennes,
probablement dans le Vestfirðir
et les côtes du golfe du Saint-Laurent. Le vocabulaire du basco-islandais a été fortement basé
sur le Labourdin avec des influences romanes et anglaises. De plus au Canada,
le contact linguistique avec les tribus
algonquiennes fut prouvé et de nombreux mots, nés de
l'échange des Micmacs et des Montagnais avec les Basques, s'utilisent
encore présentement. Exemples algonquin/basque/français : makia/makila/bâton
- echpada/ezpata/épée -
Nation civique : les personnes se représentent comme membre d'une même
nation civique et partage le même pays qui se défini comme un État mono
national. Exemple :
France, Italie, Japon - Ce
concept est mis de l'avant en Iparralde par la France. Enseigné et
imposé comme
seul model viable de concept national, il n'offre aucune alternative
possible à l'existence d'autres concepts sur la place publique,
toutefois depuis une décennie, une remise en question profonde de ce dernier introduit
d'autres
alternatives. Depuis la révolution, l'État-nation met l'accent sur le concept et l'institution
de la citoyenneté alors que dans le cas de la nation ethnique, on
insiste sur des questions de langage, d'histoire, de folklore, etc.
Questions qui sont occultées mais qui ressurgissent tant le peuple
s'auto-identifie. En ne reconnaissant pas les minorités ethniques qui
composent l'État français ou en
rejetant la charte des langues minoritaires basés sur des principes
jacobins, les sénateurs et politiciens invoquent que cela irait à l'encontre de
l'unicité du peuple français, mais en fait ils se font complice d'une construction
nationale et donc du nationalisme français uniquement. De plus, le
paradoxe libéral qui veut que l'universalité des droits et libertés aille au
delà des considérations ethniques et historiques ou d'une quelconque
reconnaissance, en fait, se fait complice d'une destruction
progressive des cultures et des langues minoritaires au profit de la
majorité, d'où l'ambigüité et paradoxe du libéralisme. Selon ce concept
civique, toute forme de nationalisme étatique est acceptable, toute
forme de nationalisme minoritaire est à rejeter ou rétrograde. -
Nation sociopolitique : les personnes se représentent comme participants
d'une même communauté politique mais qui n'est pas souveraine et
partageant à la fois une même langue, les mêmes institutions et la même
histoire. Exemple
: Québec, Écosse, Catalogne et Communauté autonome basque. - Voici un concept qui s'affiche formellement et
qui est institutionnalisé parmi
toute la population de la Communauté autonome basque. Depuis la fin du franquisme, le
nationalisme basque à travers les partis politiques basques gère et met de l'avant un concept sociétale principalement basé sur la
langue, le territoire composé des seules 3 provinces (l'Alava, Guipuscoa et de
Biscaye) et les institutions indépendantes de l'Espagne. Pour cela, il
faut qu'elle rejette partiellement le concept de nation ethnique avec
comme objectif l'intégration de tous les autres peuples nouvellement arrivés
(Espagnols et immigrants). Toute la population est considérée comme
« basque » car elle appartient au Pays Basque (Communauté autonome du Pays
Basque). -
Nation diasporique : les personnes se représentent comme membre d'un
groupe ayant la même langue, la même culture et la même histoire dans
des territoires discontinues où ils sont minoritaires dans chacun de ces territoires. Exemple
: ancienne diaspora juive, les Autochtones, les
Dounganes, les
Gagaouzes. - La diaspora, dont je fais personnellement partie, se
réfère inclusivement sur les Euskal Etxeak du monde entier. Donc cela concerne l'organisation
d'activités culturelles. Le terme de nation diasporique n'est applicable
qu'au domaine culturel et l'apprentissage du basque langue seconde, ce qui limite fortement le champ sociétal.
Il faut faire une distinction entre les peuples et les diasporas contigus que sont les extensions de majorités nationales voisines
(les Russes dans les pays baltes, les palestiniens vivant en Israël, les Serbes de Bosnie, les Kosovars Albanais, les Hongrois de
Slovaquie, etc.). -
Nation multi sociétale : les personnes se représentent comme
membre d'un État souverain apparaissant aux yeux de la majorité comme composée
de plusieurs cultures sociétales nationales. Exemple : la Grande-Bretagne,
Espagne, Belgique, Canada - La Constitution espagnole est fondée sur
l'unité indissoluble de la nation
espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle
reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des
régions qui la composent et la solidarité entre elles. -
Nation multi territoriale : les personnes se représentent comme membre
d'un groupe qui se trouve sur un territoire continu mais n'ayant aucune
frontière juridique reconnues mais qui débordent des frontières
officielles des États existants. Exemple : le Kurdistan,
Euskal Herria, les Mohawks, les Lundas - Ce type de nation est train de se faire distancer par le concept de
nation sociopolitique. En effet, la Communauté autonome basque qui représente 72% de la
population totale de l'Euskal Herria, se base sur ses institutions
pour garantir la pérennité d'un model sociétal basque, et évite dans la mesure
du possible toute
polémique ou revendication avec la Navarre ou l'Aquitaine. Cependant, dans le cadre de
certaines lois européennes, elle gère en co-association des projets
privées et la promotion de certaines composantes culturelles,
éducatives, économiques et surtout linguistiques. C'est aussi l'espoir d'un
model futur pour les nationalistes. C'est aussi avec l'Aquitaine une
euro-région nouvellement créée. Le respect de l'autoreprésentation de chacun est problématique
toutefois nécessaire dans toutes sociétés multiethniques, car si présentement les
Basques d'Euskadi se conçoivent comme une nation sociopolitique basque et
reconnaissent le statut de la minorité espagnole, cela ne la rend pas légitime
pour autant puisque la minorité espagnole s'auto identifie comme un « nous »
prioritaire espagnol. Si la majorité espagnole (Espagne) ne peut dicter à la
minorité basque comment celle-ci peut se voir elle-même, et lui interdire son
auto-détermination, à son tour la majorité basque ne peut dicter à la minorité
espagnole en Euskadi son autoreprésentation. En ne reconnaissant pas les
minorités qui forment la société basque (Communauté autonome du Pays Basque), la construction d'intérêts
communs grâce aux outils institutionnels légitimés par les élections se fait aux dépends des
minorités. Les Basques construisent donc une nation sociopolitique dans ces 3 territoires, de
la même façon que s'est construit la France et l'Espagne sur le dos de « ses »
minorités, tout en affirmant et pensant qu'elles les assimileraient tôt ou tard.
Le problème reste entier, car même après des siècles d'instauration et de
promotion forcée d'un concept multi-nationaliste espagnol (ou civique français
en France), on constate l'échec d'une telle politique et il en serait exactement
de même dans un futur État basque. Il ne faut pas aussi négliger
l'auto représentation culturelle que les Basques se font d'eux-mêmes et qui
dépasse les frontières de la communauté car le nord de la Navarre et le Pays
Basque français concentrent des populations non négligeables de personnes dont
l'auto représentation basque est permanente. Ce concept est plus ou moins le même que dans la Communauté
autonome du Pays Basque à la différence près que l'identité basque est seulement une composante minoritaire et marginalisée de la
construction sociopolitique navarraise. Les prédominances identitaires que les
gens se font d'eux-mêmes sont « navarraises » (38%), « navarro-espagnols » (19%) ou
« basco-navarraises » (15%), et ont donc pour plus petit dénominateur commun
l'identité « navarraise » qui correspond à 72% de la population, et qui relègue au
second plan l'identification personnelle uniquement « basque » (10%), « espagnole
»
(5%) et autres (13%). Les principaux acteurs politiques de cette communauté développent un
concept sociopolitique (régionalisme navarrais) plus ou moins en adéquation avec
le concept multi sociétale espagnol, rejetant majoritairement le concept
sociopolitique basque même si un quart de la population y est favorable et/ou
attachée. La Navarre fait face à des contradictions identitaires énormes, sa
politique majoritaire tend à marginaliser une partie bascophile de sa population
et en même temps essaye de créer un model sociétale multiple, unique, qui la différencie à la
fois de l'Espagne avec sa composante historique forale et culturelle
basque. Elle se différencie aussi de la Communauté autonome du Pays Basque et sa composante basque du
Laurak Bat (union des 4
provinces basques espagnole) par une affirmation de son appartenance culturelle
et historique à l'Espagne. Ce concept a peu ou pas de chance d'aboutir à long
terme car il ne repose au départ ni sur une langue ou une culture commune mais
seulement sur un territoire commun et une histoire très discutable et discutée
(voir Nabarralde). C'est
en conséquence un concept sociopolitique avec l'ajout d'un contexte multi sociétale, d'où la
complexité d'un problème identitaire presque insolvable (à comparer avec des
pays ayant une forte dualité culturelle et la présence de deux peuples tels que la
Belgique, le Canada, Israël, le
Nouveau-Brunswick,
Fidji, Sri-Lanka ou autres). Les
fors ou fueros en castillan, sont des chartes conclues entre les Basques et le roi. Ces contrats déterminaient avec une
grande précision toutes les libertés individuelles auxquelles les Basques
pouvaient jouir sans que le roi intervienne. Cela concernait le quotidien de
chacun, tels que les marchés, les foires, les impôts et les obligations
militaires. Quant au roi, lors de son couronnement, il jurait de respecter les
différents fors et se devait de le refaire en présence des Basques en faisant
le tour des vallées et villages. Les diverses provinces basques ont généralement
considéré leurs fors comme équivalents à une constitution,
comme des droits acquis ou de reconnaissances. Ces lois ont été maintenues par
des assemblées démocratiquement élues («
juntes
ou juntas »), et un grand soin était pris pour s'assurer de l'honnêteté
du scrutin. Il n'était pas rare qu'un pêcheur préside des réunions dans
lesquelles des nobles espagnols prenaient part. La
participation à des associations, coopératives d'entreprises, txokos, groupes de revendication, les cuadrillas est bien
d'autres est un phénomène est une implication remarquable et remarquée à
tous les niveaux de la société basque. Le nombre d'associations par nombre d'habitants est élevé. Selon Eustat, aux 16 128 associations recensées en 2006
en Euskadi, il faut ajouter 6 533 autres associations sportives,
qui totalisent 22 661. Il y en a 2 428 de caractère politique
et socio-économique et 5 035 de type strictement culturel
(artistiques, promotion culturelle, scientifiques…sans compter
les gastronomiques, récréatives, sportives, taurines, …).
Voir l'article Histoire de la ferme basque.
La ferme de mes grands-parents, Barrico Baïta à Akotz en 1956. « Au lieu des barriques
» de
Barrika (barrique) et Baita (maison). C'était un ancien chais du domaine de Beraun. Avant même que les fors soient signés,
les Basques géraient leurs affaires internes en vertu de codes bien précis : - Le
droit d'aînesse,
qui sera pratiqué jusqu'à l'âge industriel,
forçait les pauvres paysans basques, habituellement les plus jeunes, à émigrer
vers l'Espagne, la France ou les Amériques. Comme l'aîné héritait de
tout, les plus jeunes n'avaient que le choix de s'exiler pour subvenir à
leurs besoins (tels que Saint Francis Xavier et conquistadores comme
Lope de Aguirre).
Ces règles successorales mettaient sur le même pied d'égalité autant les
hommes que les femmes car si l'aîné était une femme, elle héritait de
tout. Il n'y avait aucune différence entre les deux sexes du point de vue
juridique. En 1804, Le Code civil français consacre "l'incapacité juridique
de la femme mariée » et ce Principe commun à toutes les coutumes en France depuis le
XVIe siècle ne va être supprimé qu'en 1938.- Le droit familial était indivisible puisque le couple héritier
devait vivre à égalité avec le couple des parents, et chaque enfant pouvait
rester sur la ferme à condition d'y travailler. Actuellement, la vie d'une
famille basque n'est pas différente d'une famille européenne.
Maite Lafourcade, spécialiste en droit basque,
nous dit que « le droit n'était pas individualiste. Par exemple, le droit de
propriété au Pays basque était collectif, se qui explique le succès des
coopératives. Le patrimoine familial, le respect de la maison ancestrale
expliquerait pourquoi le Pays basque est demeuré lui-même pendant des siècles,
qu'il a survécu. » Son usage est existe toujours à l'état d'usages en
Iparralde, et en Hegoalde (zonas aforadas del País Vasco y Navarra),
il est légalisé et on ne peut pas vendre la maison ou ces terres puisqu'elles sont soumises aux Fors.
Etxerakoa, (se traduit par « celui qui est
pour la maison ») ou l'héritier ne pouvait pas vendre car il était seulement le
gestionnaire des biens, il représentait la famille. De même pour les terres
communales dans tout le Pays Basque, la propriété était collective et elles
appartenaient à tous les habitants du village. - Le droit public était
démocratique avec la réunion du « Biltzar
» au Labourd ou « Elizate » en Biscaye traduit littéralement par
« porte d'église » (« église » signifie
eliza + ate signifie la « porte », en espagnol, cela se nomme anteiglesia (« avant l'église
»)). Les Basques vivent sous 5 systèmes
institutionnels, ceux de la Communauté autonome d'Euskadi, la Communauté forale de Navarre, l'Union européenne, l'Espagne et la France. Les
principaux partis politiques sont nombreux et différents selon si on est en Iparralde
(Euskal
Herria Bai est une coalition créée par les partis politiques basques français
de Abertzaleen
Batasuna, Eusko
Alkartasuna et Batasuna,
qui a obtenu aux élections législatives de 2007 dans les
quatrième,
cinquième
et
sixième
circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques entre 4.50% et 9.09% des voix, Eusko
Abertzale Ekintza,
PS,
UDF,
UMP
et Zutik), en Navarre (Nafarroa Bai
est une coalition des partis nationalistes basques
Aralar,
Eusko Alkartasuna, Batzarre (Zutik) et
EAJ/PNV.
A noter que Batasuna
n'a pas été admis dans cette coalition, CDN ou Convergence de Démocrates
Navarrais, IUN-NEB ou Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua (Gauche
Unie de Navarre), Parti Carliste EKA,
PSN-PSOE
ou Parti socialiste Navarrais, l'UPN ou Union du Peuple Navarrais et RCN-NOK
ou Representación Cannabica Navarra-Nafarroako Ordezkaritza Kanabikoa) ou dans
la Communauté autonome d'Euskadi (EB-B, Aralar, EAE-ANV (Eusko
Abertzale Ekintza), EA ou Eusko Alkartasuna, IU-EB-Berdeak, EKA, EAJ-PNV avec
son mouvement de jeunes EGI-Eusko
Gaztedi Indarra, PSE-EE Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra,
Parti Populaire
ou Alderdi Popularra, EHAK-PCTVou Parti Communiste des Terres
Basques et Zutik). Batasuna étant la fenêtre politique de l'E.T.A, l'État
espagnol l'a déclaré illégal en 2003 et ce parti obtenait toujours entre 8
et 12% des voix aux élections sous différents noms : Herri Batasuna, Euskal
Herritarrok, Sozialista Abertzaleak, Ezker Abertzaleak, AUB, Aukera Guztiak. Elections au Parlement basque de 2009 Lehendakari : Patxi López Recensé : 1 776 052 Votes : 1 141 219 Participation : 64,26% Abstention : 634 833 35,74% Elections au Parlement navarrais de 2007
Euskal Herritarrok (EH, "les citoyens basques") crée en octobre 1998
la gauche nationaliste Herri Batasuna (HB, "Union populaire") et les extrêmes gauches Zutik ("debout") et Batzarre ("Junte").
Herri Batasuna (HB, 1978-1998), Euskal Herritarrok (EH, 1998-2001), Batasuna (2001-2003), Sozialista
Abertzaleak (SA, 2002-2003), Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB, 2003), Herritarren Zerrenda (HZ, 2004), Aukera Guztiak (AG, 2005), Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB 2007), Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (EHAK 2002-2008),
Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV 1930-2008), Askatasuna (1998-2009)
- Dans la
Communauté autonome basque Suite au
référendum de 1979, le système
politique en vigueur est basé sur le
Statut d'autonomie ou Statut de Gernika
qui régit le système politique basque en Euskadi et qui entrevoit la possibilité d'incorporer
la Navarre : “Le Peuple Basque ou Euskal Herria, comme expression de sa
nationalité, se constitue en Communauté Autonome au sein de
l'État espagnol sous la dénomination d'Euskadi ou Pays Basque,
conformément à la Constitution et au présent Statut, qui constitue
sa norme institutionnelle de base”. L'Euskadi cherche depuis lors, à la majorité absolue de
ses représentants, à renégocier le Statut afin de formaliser un
nouveau pacte politique de “libre association avec l'État Espagnol” et
d'obtenir plus d'autonomie. Il est bon de souligner que dans ce paysage
politique, certaines
particularités historiques continuent aujourd'hui d'influencer la structure formelle comme
celle des contrées (consejos) regroupés au sein d'une municipalité qui dans la vallée du Baztan ou d'Ulzama
sont à la base des élections à l'Assemblé de Navarre. À Berriatua et Zerain, on perpétue la tradition du
Biltzar ou réunion de quartier dans but de choisir une liste commune aux
élections. Biltzar qui signifie assemblée, provient de la racine Bil - Zahar, réunion
des vieux. La pratique de l'auzolan (auzoa signifie quartier) met en
place le travail communautaire entre voisins, l'entretient des chemins, maisons,
l'économie sociale et tout autre coopérativisme. La vie politique
s'orchestre principalement autour des 4 organes : organes d'administration
autonomique (Parlement et Gouvernement basque (Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza)), organes de gouvernements
(Assemblées provinciales (Batzar Nagusia)
et conseils généraux de chacune des provinces (Gipuzkoako
Foru / Diputación Foral)), organes de gouvernement municipal (Municipalités
régit par EUDEL : Euskadiko Udalen Elkarte)
et le concert économique qui réglemente tout ce qui a trait aux impôts et leurs relations entre Euskadi
et l'État espagnol.
- Dans la
Communauté forale de Navarre Le système politique ressemble à celui de la Communauté autonome basque avec son Parlement ou Cortes et son Gouvernement de Navarre - En Iparralde Les provinces d'Iparralde ne jouissent d'aucune autonomie, les compétences d'exécution et législatives sont
concentrées à Paris, la Préfecture représentant l'État dans le Département des Pyrénées Atlantiques. Pour la région de Bayonne, il existe une Sous-Préfecture, avec ses Délégués du Préfet. La suppression des frontières, dans le cadre de
l'Union européenne offre une nouvelle opportunité aux régions pour créer
des espaces de coopération pour des initiatives et des projets d'intérêt
commun. L'Eurorégion
[Réf]
comprend la région de l'Aquitaine, C.A. d'Euskadi et C.F. de
Navarre. Avec ses 5.6 millions d'habitants, soit 1.5% de la population de
l'Europe des 15, elle représente 1.5% du territoire de l'Europe des 25 répartis
sur 2 814 municipalités, soit 93 habitants au km2.
Il existe 7
universités dont 2 en Navarre et 5 dans la Communauté autonome basque. Dans La communauté autonome basque, les universités sont primordiales
quant à la diffusion du savoir en basque. 1-
Université
du Pays Basque (EHU-UPV Euskal Herriko Unibertsitatea
- Universidad del País Vasco) est située à Bilbao,
Portugalete,
Barakaldo, Leoia,
Eibar, Vitoria-Gasteiz et
Donostia-San Sebastián. L'« euskerisation » de l'Université du Pays Basque
pose des problèmes puisque les étudiants et les professeurs doivent connaître suffisamment le basque. 2-
Université
Deusto (Universidad de Deusto - Deustuko Unibertsitatea) à Bilbao
et Saint Sébastien. 3-
Université
privée de Mondragón (Mondragón Unibertsitatea) ou MU avec 4 000 étudiants intègre une
École Polytechnique Supérieure (Mondragón Eskola Politeknikoa), une Faculté
des Sciences Économiques (Enpresa Zientzien Fakultatea) et une Faculté des
Sciences Humaines et de l'Éducation (Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea).
Fondé à Arrasate par l'un des plus grands groupes coopératifs du monde,
Mondragón
Corporación Cooperativa.
C'est aussi la première fois
qu'un parti non nationaliste basque arrive au pouvoir depuis la fin du
franquisme et cela, en pleine crise financière internationale mais aussi avec
un bien-fondé et une équitabilité basée sur un processus électoral biaisé et antidémocratique, puisqu'une
partie de la population fut ostracisée. S'il n'y a pas de démocratie sans alternance, et il est
très sain que le PNB
alterne le pouvoir, il n'y a pas de réelle démocratie sans compromis. Le PSE-EE
n'en fera sûrement aucun malgré ses discours, et le risque de se retrouver dans
une société figée est grand puisque plus de 80% des élus municipaux sont issus
des partis nationalistes tous confondus (1725 élus sur un total de 2138), 90% des mairies
sont gérées par des nationalistes et qu'un sentiment d'illégitimité et de forfaiture est ressentie par une
large partie de la
population (voir la carte dans la section Organisation politique) et 30% du
budget total va directement aux mairies. Le Procureur général de l'État espagnol, Cándido Conde-Pumpido, à l'origine des demandes d'interdiction de 133 candidatures du parti ANV,
a exprimé ses doutes quant à la façon d'agir du ministère public qu'il dirige.
Le parquet “est peut-être allé trop loin”, a-t-il avoué tout en ajoutant, “mais c'est passé”.
Même Sortu (Créer), fondé en Février 2011 et premier parti politique appartenant à la « gauche abertzale
» nationaliste basque qui rejette ouvertement la violence de l'ETA est exclus
des élections par le Tribunal suprême d'Espagne. Le mot démocratie est donc
assurément un vain mot pour l'État espagnol.
Les
Basques sont avant tout, et ce depuis 350 ans (7 novembre 1659)[Réf] les victimes de deux États puissants
que sont la France et l'Espagne, même si les endoctrinements ou toutes sortes de prosélytisme nous en certifient le contraire.
En effet, quelles que soient les stratégies étatiques de répression, insidieuses ou manifestes, illicites ou légales, ces dernières sont précisément au fondement,
à l'origine du terrorisme d'ETA. D'ailleurs, l'étymologie et la notion
même de « terrorisme », n'est-elle pas issue de l'Histoire révolutionnaire
française et du régime de la Terreur ? De plus, l'impérialisme culturel
qu'ils subissent semble faire « partie de la trajectoire historique de la
modernité occidentale ». Conflit basque
Concept de nation



13 mai 2009, 50 000 spectateurs venus suivre la finale de la Coupe d'Espagne de football entre l'Athletic
de Bilbao et le Barça FC Barcelone au stade Mestalla de Valence ont sifflé l'hymne national espagnol ainsi que couple
royal.

Concept de nation dans la Communauté autonome basque
Concept de nation dans la Communauté forale de Navarre
Institutions
Historiques
- La démocratie basque ou
démocratie participative
fut appliquée de facto bien longtemps avant ses voisins limitrophes. Cette
démocratie était coutumière puisqu'elle venait du peuple alors que la loi est autoritaire, imposée par un pouvoir. Les terres
appartenaient à la collectivité et étaient gérées par les ancêtres et non
sous la tutelle d'un suzerain.
Un syndic s'occupait de gérer les terres incultivables en donnant le droit
aux paroisses de les utiliser suivant un mode de gestion juste et équitable
pour tous. Quant aux terres cultivables, leur usage était privé (avec un droit
de propriété) toutefois elles étaient gérées par toute la famille, symbolisée
par la maison, et pas seulement par le maître de maison. Tous les dimanches,
après la messe, les assemblées paroissiales regroupant tous les maîtres de
maison, répartissaient entre eux les droits d'usage sur les terres communes
et décidaient collectivement des divers droits appartenant à la communauté,
des dépenses des communes de la paroisse, des emprunts, des taxes à payer.
Après avoir choisi un représentant pour l'Assemblée Générale ou
Biltzar, le
Syndic exposait les propositions avec explications et commentaires aux
différents représentants qui retournaient ensuite dans leurs villages pour
voter. Chaque maison avait une voix, quelle que soit son importance puis chaque
paroisse avait une voix. Les maîtres de maison décidaient de tout ce qui
concerne la communauté, toujours à la majorité. Cette démocratie participative a prouvé son efficacité durant des siècles.
Mais c'est au sein même de l'unité familiale que cette dynamique démocratique
prenait forme. L'etxeko-jaun ou maître de maison avait le privilège
de participer à l'administration de toute la communauté paroissiale dans un
système de démocratie directe. Chaque paroisse déléguait par la suite des
représentants à l'assemblée générale (juntas) de la vallée ou de la
province qui avait une compétence politique, législative, administrative et
financière. Sous la présidence d'un
bailli,
les rapports du pays avec la royauté, les
doléances
à présenter au roi étaient discutées.
Pour faire une comparaison avec aujourd'hui, ce n'était pas une démocratie à base individuelle
comme maintenant, mais une démocratie à base familiale où chaque maison avait
une seule voix, et non chaque individu.
Les députés qui ramenaient les réponses à une seconde session du Biltzar,
étaient de simples porte-paroles qui parlaient au nom des paroisses et non à la
place des gens comme actuellement. De nos jours, les députés ne demandent pas au
peuple de décider de ses priorités, mais fonctionnent plutôt comme l'ancienne
bourgeoisie sans roi divin. On peut parler d'un stade avancé de réelle
démocratie, mais malheureusement les fors en Hegoalde furent perdus à la fin de la troisième
guerre carliste
en 1876 et en Iparralde, à la
Révolution
française en 1789. Preuve étant faite, la Révolution
française fut un véritable recul pour la démocratie participative au Pays basque et ce jusqu'à
maintenant.
- C'est dans le droit et dans la mythologie qu'on devine l'ancien "matriarcalisme
basque" défini en tant que réalité objective, ou réalité intersubjective
structurée à différents niveaux. On parlera plutôt comme définition de structure
psycho-sociale pré-indo-européenne. A la base,
Mari qui est la déesse
principale de la
mythologie basque, et parmi les déesses-mères primitives européennes,
est la seule qui soit arrivée jusqu'à nos jours. Autre symbole fort, la Terre est mère du Soleil et de la Lune,
face aux conceptions patriarcalistes indo-européennes, où le soleil est reflété comme un Dieu,
Numen ou esprit masculin. La
survivance du "matriarcat basque" est en fait une combinaison de plusieurs
facteurs, dont la christianisation tardive, une Vasconie hors du contexte
indo-européen de type patriarcal-rationaliste et finalement autre point vital,
la base de l'économie d'Euskal Herria qui fut, comme le mentionne Barandiaran,
pendant des siècles le
pacage, la
pêche et l'agriculture. Dans ces deux premiers cas, les femmes, mères et
grands-mères étaient celles qui devaient diriger la famille tandis que le maris
et les fils partaient de longues saisons en dehors, et cela s'est perpétué
jusqu'à la
Révolution industrielle. Les règles successorales égalitaires ont aussi aidé
à maintenir système partiel de parenté
matrilinéaire.Structures et participations
sociales


Parti
Candidats
Votes
%
S
+/-
EAJ-PNV
J. J. Ibarretxe
396 557
38,56
30
+8
PSE-EE
P.Lopez
315 893
30,71
25
+7
PP
A. Basagoiti
144 944
14,09
13
-2
Aralar
Aucun
62 214
6,05
4
+3
EA
U. Ziarreta
37 820
3,68
1
-6
EB-B
J. Madrazo
36 134
3,51
1
-2
UPyD
Aucun
22 002
2,14
1
+1
Berdeak - Los Verdes
5 531
0,54
0
=
PUM+J
3 069
0,30
0
=
PACMA
1 446
0,14
0
=
POSI
1 143
0,11
0
=
Partido Familia y Vida
1 050
0,10
0
=
Partido Humanista
450
0,04
0
=
Partido Carlista de Euskalherria
302
0,03
0
=
EHAK-PCTV
Interdit
-
-
0
-9
Blanc
N/A
11 740
1,03
N/A
N/A
Nuls
N/A
100 924
8,84
N/A
N/A
Parti
Votes
%
Sièges
UPN
138 031
42,80
22
Nafarroa Bai
77 625
24,07
12
PSN-PSOE
77 135
22,65
12
CDN
14 259
4,42
2
IU-EBN
14 244
4,42
2
RCN-NOK
1 290
0,42
0
EKA
541
0,02
0

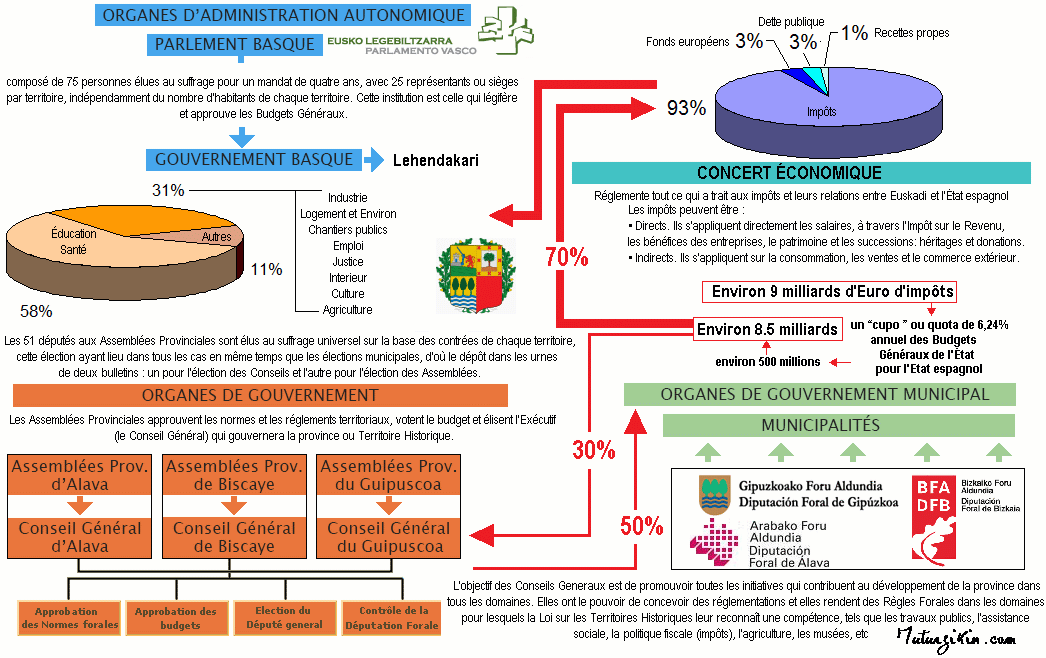
4-IMH Ingeniaritza Eskola (Instituto Máquina Herramienta) est une école d'ingénieurs située à Elgoibar dans un centre de Formation et d'Innovation technologique au service de l'industrie et de la communauté.
5-Lea Artibai Ikastetxea est une école technique coopérative sans but lucratif à Markina-Xemein. Ses activités sont la formation technique et universitaire, le développement des professionnels et des entreprises, cherchant toujours à encourager la création et le développement de nouvelles entreprises.
En Navarre
1-Université Publique de Navarre (Universidad Pública de Navarra -Nafarroako Unibertsitate Publikoa) située à Pamplona et Tudela compte 10 000 étudiants.
2-Université de Navarre (Universidad de Navarra), institution privée fondée à Pampelune en 1952 par Josemaría Escrivá de Balaguer, est une œuvre apostolique corporative de l'Opus Dei, qui compte 15 000 élèves.
En Iparralde
L'Université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA) a plusieurs composantes dont deux UFR (Unités de Formation et de Recherche) UFR Pluridisciplinaire de Bayonne Anglet Biarritz avec un département inter universitaire d'études basques (DIEB) qui prépare à une Licence d'Études Basques et un Master d'Études Basques, seuls diplômes français offrant une haute spécialisation en langue, littérature et civilisation, UFR Sciences et Techniques de la Côte Basque avec 550 étudiants, IUT de Bayonne et du Pays Basque. Seulement 2 500 étudiants universitaires, la plupart partent de la région.
Aux États-Unis
La langue et la culture basque sont aussi enseignées au Center of Basque Studies qui est une Université située à Reno. Crée par Robert Laxalt en 1961, ce centre possède la plus grande bibliothèque basque au monde avec plus de 20 000 ouvrages. 212 Euskal Etxeak diffusent la culture basque à travers le monde. Le NABO ou « North American Basque Organizations » réunit 41 associations aux États-Unis depuis 1973. Tous les ans, les Basco-américains se réunissent pour fêter dans une ville où la diaspora est encore vivante.
Autres
IKER est une unité mixte de recherche (UMR5478) qui se spécialise dans l'étude de la langue et des textes basques, membre de la fédération Typologie et Universaux linguistiques du CNRS. Situé à Bayonne, il regroupe une vingtaine de membres (enseignants-chercheurs et doctorants) et une dizaine de chercheurs étrangers de l'EHU-UPV principalement. C'est le seul centre de recherche publique en France spécialisé dans les études relatives à la linguistique et aux textes basques. Le projet HIPVAL (Histoire de populations et variation linguistique et génétique dans l'Ouest pyrénéen) et Artxiker (bibliothèque numérique recevant et diffusant les productions intellectuelles de la recherche internationale dans le domaine de la langue basque) ont été mis en place par Iker.
UEU-Udako Euskal Unibertsitatea ou Université Basque d'Été propose une trentaine de formations aux jeunes dont la seule condition est d'être bascophone puisque tout se déroule en euskara.
En Hegoalde, les journaux locaux en Euskadi sont El Diario Vasco, Berria, GARA - Euskal Herriko Egunkaria (bilingue), Deia, Noticias de Gipuzkoa, en Navarre sont Diario de Noticias, Diario de Navarra, et les journaux nationaux El Mundo, El País, El Correo Español, ABC Spain. En Iparralde, les journaux locaux sont Le Journal du Pays Basque qui appartient à Gara, Sud-Ouest ainsi qu'une dizaine de quotidiens nationaux et La semaine du Pays Basque. Berria qui signifie Nouvelle en basque, est le seul quotidien édité complètement dans la langue basque et qui peut être lu dans l'intégralité du Pays Basque. Il a été créé après la fermeture du journal basque Egunkaria par les autorités espagnoles. Édité tous les jours, excepté le lundi, sa première parution fut éditée le 21 juin 2003. Le siège social du journal est à Andoain et des bureaux de presse sont situés à Vitoria-Gasteiz, Pampelune, Bilbao et Bayonne.
Il existe plusieurs formes d'engagements associatifs ou de mouvement. Les plus nombreuses sont des associations culturelles dont la défense de l'Euskara telles que Batera (voir linguistique), les Ikastola (voir enseignement), Euskal Herrian Euskaraz, Euskal konfederazioa, Herri Urrats, Hiruki, Sü Azia, Behatokia qui cherche socialiser le contenu des droits linguistiques et défend, à de nombreuses occasions, les citoyens qui sentent que leurs droits linguistiques ne sont pas respectés ou le Téléphone de l´euskara permet au gens de porter plainte, de se renseigner sur les droits linguistiques ou de féliciter un autre organisme. Il y a aussi des associations sportives, gastronomiques comme les Txokos, folkloriques, musicales, de chorales ou même de défense de droits humains comme CDDHPB (Comité pour la Défense des Droits de l'Homme en Pays Basque) essaye d'intenter toute action non-violente en vue de défendre les citoyens contre les violences policières, discriminations, abus de pouvoir, injustices, contre-vérités dans la presse ou recours trop systématiques à la législation anti-terroriste.
Il existe 1 607 coopératives et 1 058 dʼentreprises de travail associé ou Sociétés Anonymes Professionnelles (SAL) et 1 116 Sociétés Limitées Professionnelles (SLL) sont une partie non négligeable du tissu social et professionnel avec 6.4% de la population active, soit 61 000 personnes.
La Confédération des coopératives en Euskadi (KONFEKOOP) est une organisation patronale qui regroupe toutes les fédérations qui existent dans la Communauté autonome basque, intègre plus de 13 000 entreprises privées et est membre de la Confédération Espagnole des Organisations Patronales (CEOE). Elle a été créée en 1996 par la nécessité d'essayer de renforcer le mouvement coopératif en raison de son importance tant sur le plan économique que social. KONFEKOOP représente aussi 650 coopératives qui emploient plus de 70 000 travailleurs, dont 39 000 sont des partenaires, dont les quatre fédérations suivantes : ERKIDE (Fédération des coopératives de travail associé, de l'éducation et de crédit en Euskadi) qui représente 590 coopératives qui emploient plus de 41 000 travailleurs, dont 27 000 en sont membres. FCAE-ENKF Fédération des coopératives agricoles du Pays basque représente 70 coopératives fédérées qui emploient 535 travailleurs. EKKF-FECOE Fédération des coopératives de consommation au Pays Basque intègre 9 coopératives qui emploient plus de 30 000 personnes dont plus de 12 000 membres et la Fédération des coopératives de transporteurs du Pays Basque qui a actuellement 6 coopératives et emploi environ 683 travailleurs.
Le syndicat le plus influent en Hegoalde est ELA (Eusko Langileen Alkartasuna ou Solidarité des Ouvriers Basques), nationaliste et opérationnel seulement en Euskadi et en Navarre, avec 105.000 affiliés ; il est suivi de loin par CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras), non nationaliste et représent une section d'un syndicat national espagnol, lui-même suivi de près par LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak ou Comités de travailleurs nationalistes) présent en Euskal Herria et également nationaliste et UGT (Unión General de Trabajadores) actif au niveau espagnol. On existe aussi d'autres syndicats moins importants tels que USO, ESK (Ezker Sindikalaren Konbergentzia), STEE-EILAS, EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) et Hiru.
EUSTAT (Euskal Estatistika Erakundea) situé à Vitoria-Gasteiz est l'institut basque de statistique le plus complet et le plus ciblé en Euskal Herria. INE (Estatistika Institutu Nazionala) et INSEE (Estatistika Institutu Nazionala eta Ekonomia Azterketetakoa) sont les instituts nationaux espagnol et français, IEN, (Nafarroako Estatistika Institutua) à Iruñea (Nafarroa), Euskal Herriko Datu Talaia (Gaindegia), Nekanet (EAEko Nekazaritza estatistikak jasotzen dituen zerbitzua), GAINDEGIA (Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia), EUROSTAT (Europako Estatistika Institutua) et Agreste, la statistique agricole (Frantziako Estatuko Nekazaritza Estatistikak biltzen dituen eragilea).
Linguistiques
On distingue 5 territoires où le statut linguistique sur une reconnaissance de la langue basque diffère :
Démographie
Statistiques actuelles
Un des instruments de base pour étudier la composition démographique est la pyramide des âges ; bien évidemment en l'absence de recensements ethniques en France et en Espagne il s'agira de la pyramide des âges de la population du Pays Basque et non de sa composante ethnique basque. Ce graphique ne ressemble pas à une pyramide, mais un losange élargi. Les plus de 65 ans dépassent de loin les moins de 15 ans. Les Basques sont non seulement le peuple le plus vieux d'Europe, mais après l'Italie, a la population la plus vieille de toute l'Europe. Durant les 30 dernières années, la pyramide des âges a subi un grand changement. Si en 1975 les moins de 19 ans représentaient 35.4% de la population, en 1999 ce chiffre a été réduit de moitié à 18.9%. Par province, le Labourdin est le plus jeune et Souletin le plus vieux. (37% des Labourdins sont nés hors du Pays Basque). Dans les années 1990, on a constaté pour les 7 provinces, un solde négatif de 13 695 personnes entre les décès et les naissances avec un taux de naissances de 8.1 par 1 000 habitants. Il y a eu une légère remonté durant ces dernières années mais pas assez pour assurer le renouvellement démographique, chaque femme devant avoir 2.1 enfants. C'est une faible immigration récente (depuis 1998) qui empêche la population totale de baisser.

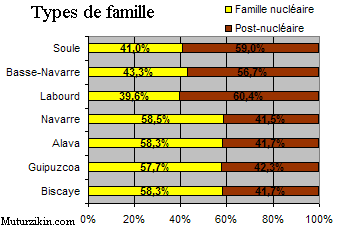 |
Les graphiques montrent une différence entre l'Hegoalde et l'Iparralde où le modèle de famille post-nucléaire, ou familles sans enfant ou monoparentales, concerne 6 couples sur 10. En Hegoalde, la famille nucléaire, ou avec enfant, concerne presque 6 couples sur 10 et c'est un modèle des plus fort en Europe où la moyenne est de 50%. Dans les dix prochaines années, la Communauté autonome basque va souffrir dans le secteur industriel d'un déficit de main-d'œuvre qualifiée, puisque entre 2017 et 2019, 66 294 personnes partiront à la retraite et seulement 40 320 jeunes intégreront le marché du travail. Comme solutions recherchées par les syndicats, outre l'immigration, une augmentation du taux de natalité, l'intégration des femmes au travail doit s'accélérer car elles n'occupent que 20.6% des emplois industriels, un taux de chômage actuel de 3.5%, la Communauté autonome et 8% au Pays Basque français ainsi qu'une moyenne de 1 900 € au sud (source Eustat) pour 1 680 € au nord (source Urssaf), pourrait pousser les jeunes d'Iparralde à aller travailler au sud. Voila les pistes privilégiées. |
Immigration
L'évolution de la population a fortement changé
le visage ethnique du Pays Basque. Les chantiers navals et les industries métallurgiques
avaient besoin de beaucoup de main d'œuvre au milieu du XIXe siècle alors pour y remédier, on fit appel aux travailleurs espagnols. Le
Pays Basque qui avait tout au long de son histoire vu passer les peuples sur
son territoire, et voir les siens partir vers le nouveau monde, vit pour la
première fois un grand afflux migratoire sur son territoire.
En 1877, la Biscaye qui comptait 190 000 habitants va augmenter de 48% à
311 000 en moins de 25 ans alors que l'Alava augmentera de seulement 3 000
personnes. Cette émigration espagnole vivait des conditions de travail
difficiles et s'entassait dans des txabolak (« cabanes » en basque),
sortes de bidonvilles nouvellement créés. Ils étaient discriminés et appelés
péjorativement les Maketos.
Nonobstant, ces travailleurs immigrants furent si nombreux qu'un clivage rural
nationaliste conservateur basque confronta celui d'une industrialisation
urbaine socialiste espagnole et c'est ainsi que la donne politique, démographique
et linguistique du Pays Basque changea. Ce flux migratoire va se poursuivre et
une partie des ouvriers basques vont rejoindre le socialisme créant un nouveau
clivage entre Basques. Malgré tous ces changements, les patrons des
institutions financières et des grandes industries seront toujours très
majoritairement basques.
De 1950 à 1975, la population biscayenne va cette fois-ci doubler passant de
570 000 à 1 140 000 habitants et au Guipuscoa de 375 000
à 675 000. De 1955 à 1965, l'arrivée d'immigrés est égale à
celle durant le siècle antérieur et le taux d'urbanisation devint supérieur à
80% dans les années 1980.
Le visage ethnique se diversifie et l'hispanisme continue de grandir sous
Franco.
En 1975, les descendants directs des Basques avant l'industrialisation de 1880
représentent moins de la moitié de la population totale du Pays Basque.
Avec l'arrivée au pouvoir du PNV en 1978, une nouvelle loi pragmatique
surgit avec l'article 7 du statut d'autonomie qui stipule : « que
toute personne ayant établi sa résidence administrative dans la région
jouira de la qualité de Basque ». Cette redéfinition sera à l'origine de
l'intégration
des populations immigrantes dans la CAB, étant donné qu'aujourd'hui 38% des fils
d'immigrants espagnols se disent basques d'abord contre 92% pour les
descendants basques. Par contre seulement 43% se considère basque au Labourd
et 34% en Navarre où respectivement on se sent d'abord plus français et
navarrais (espagnol ou basque ensuite). La migration au Pays Basque français
fut négative, beaucoup de basques vont faire leur vie ailleurs comme à
Bordeaux ou Paris tandis que de nombreux retraités français s'installent
depuis 25 ans sur la côte. Quant à la Communauté forale de Navarre, elle a
plutôt subit une migration des régions rurales vers ces centres urbains.
L'Alava et la Navarre ont rattrapé leur retard économique dans les années 1960 à
1980.
Un tiers des immigrants après 15 ans de vie dans la CAB se considère plus
basque qu'espagnol (Statistiques similaires que l'on retrouve chez les
immigrants canadiens). 38% des immigrants sont déjà en faveur d'une quasi
ou complète indépendance après 5 ans et 35% disent apprendre le basque.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette intégration mesurée par l'Ikuspegi,
Observatoire basque d'immigration.
Cependant, les problèmes inhérents pour les
immigrants au Pays Basque sont les mêmes qu'ailleurs. Depuis 5 ans, de
nouveaux immigrants venus d'Amérique latine et d'Afrique s'installent
principalement en Biscaye et au Guipuscoa et la
crise économique argentine
a poussé de nombreux membres de la diaspora basque à revenir au Pays. La
population immigrante dans la Communauté autonome basque avoisine 5% (106 000)
et elle est constituée pour la plupart de latino-américains, mais aussi de
maghrébins et d'africains subsahariens, ces derniers sont plus touchés par le
chômage. (Algérie (37.7%), Maroc (31.7%), Africain (46.7%)). Les immigrants
touchent en moyenne 810 €, 22.8% d'entre eux sont en situation irrégulière, 8.9%
ne sont pas recensés et 52% reçoivent un revenu mensuel inférieur à mille euros.
Le taux de chômage parmi les étrangers est de 17.8%, beaucoup plus élevé que
pour l'ensemble de la population, qui oscille entre 3 et 6% selon différentes
statistiques. 75.6% ne se regrettent pas leur venue en Euskadi « malgré tout »
Culture
Symboles
Nationalistes ou culturels
|
4 symboles basques
Euskal presoak euskal herrira
Défilé de géants au Nafarroaren Eguna
L'Ardi latxa
Arbre de Guernica (2006) |
Il existe un grand nombre de symboles. Le Lauburu ou la croix basque qui signifie en basque « quatre têtes » est un symbole mythologique pré-indo-européen, qui indique le mouvement des 4 éléments de la création : l'eau, la terre, l'air et le feu, ou des deux sexes, ou des énergies qui forment l'univers ou de la lutte de la lumière contre les ténèbres. Il fréquemment utilisé comme symbole identificateur basque. Le drapeau basque ou Ikurriña qui signifie « le drapeau », fut créé en 1894 par Sabino Arana, est considéré comme le drapeau unique national du Pays Basque. On le trouve des deux côtés de la frontière. Créé au départ uniquement pour la Bizkaia. En 1936 est créé le premier Gouvernement Autonome Basque, dont le Lehendakari était José Antonio Aguirre, et l'Ikurriña y est déclaré, par loi, drapeau du Pays Basque. Le Zazpiak Bat qui signifie « les 7 (provinces font) un », crée en 1876, constitue les armoiries du Pays Basque. Il est formé de 6 parties représentant chaque province. (La Communauté forale de Navarre et la Basse-Navarre ayant le même blason). L'Arrano beltza qui signifie « l'aigle noir », est un symbole basco-navarrais, représentant la puissance et la victoire du peuple basque. Considéré comme le roi des oiseaux, il est utilisé par de nombreuses nations comme animal emblématique. Euskal presoak euskal herrira signifie Les prisonniers basques (doivent être dans les prisons) au Pays Basque. C'est la revendication d'un droit légitime qui demande que tout prisonnier doit être incarcéré au plus près de son lieu de résidence ; ce qui n'est absolument pas le cas des prisonniers politiques Basques qui subissent dispersion et éloignement. Cela pénalise les familles ainsi que les prisonniers de visites, la distance étant un obstacle majeur. C'est de loin le drapeau ou l'affiche la plus nombreuse en Hegoalde. Le drapeau de la Navarre et de la Basse-Navarre ou Nafarroako banderea vient des armoiries que le Roi navarrais Sancho VII le Fort (Santxo Handia) adopta en 1212. Les chaînes représentent celles qui entouraient la tente du Roi maure Miramamolin le Vert et que Sancho le Fort brisa de sa propre épée. Et l'émeraude centrale représente celle que le Roi maure vaincu portait sur son turban après la bataille de Las Navas de Tolosa. Nafarroaren Eguna est le premier grand rassemblement de la saison en faveur de la culture basque, avant Herri Urrats. Le « jour de la Navarre » célèbre aussi les traditions basques autour de la danse, des chants, des défilés des géants. Il y a aussi un grand repas, des animations toute la journée, des concerts jusqu'au bout de la nuit, sans oublier les buvettes. La brebis latxa ou Ardi latxa est l'animal qui symbolise le Pays Basque. Cette idée de coller cette brebis autocollante date de la fin 2004 et se retrouve aujourd'hui sur plus de 200 000 véhicules en 2007 à travers les 7 provinces. Les bénéfices liés à l'achat d'autocollants sont dirigés vers des projets au développement de la culture basque, par le biais d'Ardi Latxa Kultur Elkartea (Association Culturelle Ardi latxa). Le Gernikako Arbola est l'arbre antique, un chêne qui se situe dans la ville de Gernika devant la « Casa de Juntas ». Les souverains espagnols juraient sous l'arbre et y confirmaient les libertés basques (fors). L'arbre a longtemps été considéré comme le symbole et l'incarnation physique de ces libertés. C'est aussi le titre de l'hymne non-officiel des Basques, à côté de l'hymne national officiel de la Communauté autonome du Pays Basque qu'est l'Euzko Abendaren Ereserkia.. Il ne doit pas être confondu avec l'Eusko Gudariak (« Les soldats basques ») qui est l'hymne de l'Armée basque (Eusko Gudarostea)L'hymne de la Navarre est le Nafarroako Gorteen Ereserkia ou Himno de las Cortes. La fête nationale basque n'est pas une date fixe étant donné qu'elle se fête généralement le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe vernal (du printemps) de l'hémisphère nord, le jour de Pâques. C'est l'Aberri Eguna ou le « Jour de la Patrie basque ». Elle fut crée à 1932, lors d'une grande manifestation des Bilbotars, suite au refus espagnol de rétablir les fors. Aujourd'hui, diverses initiatives sont organisées par les partis abertzale des deux côtés de la frontière. |
| Gernikako Arbola (de José María de Iparragirre) | L'Arbre de Guernica | Eusko Abendaren Ereserkia | Hymne à l'appartenance ethnique basque | Nafarroako Gorteen Ereserkia |
Hymne navarrais des Cortes |
|
Gernikako
arbola da bedeinkatua, Adoratzen zaitugu arbola santua.
Mila urte inguru da esaten
dutera Ez zera
eroriko arbola maitea,
Betiko bizi
dedin Jaunari eskatzeko, |
Arbre béni de
Guernica,
Mais tu ne tomberas pas,
ô arbre bien-aimé, Demandons au Seigneur qu'il
vive pour toujours |
Gora ta Gora Euzkadi aintza ta aintza bere goiko Jaun Onari. Areitz bat Bizkaian da Zar sendo sindo bera ta bere lagia lakua Areitz gainean dogu gurutza deuna beti geure goi buru Abestu gora Euzkadi aintza ta aintza bere goiko Jaun Onari |
Vive et vive le Pays Basque gloire et gloire à son bon seigneur d'en haut. Il y a un arbre de chêne en Biscaye vieux, fort, sain comme sa loi Au dessus de l'arbre nous trouvons la sainte croix toujours au dessus de nous Chantes "Vive le Pays Basque" gloire et gloire à son bon seigneur d'en haut |
Nafarroa, lur haundi ta azkar, beti leial, zure ospea da, antzinako lege zaharra, Nafarroa, gizon askatuen sorlekua, zuri nahi dizugu gaur, kanta. Gaiten denok bat, denok gogo bat, behin betiko iritsi dezagun, aintza, bake eta, maitasuna. |
Navarre, vaillante et noble terre, toujours fidèle, qui prend pour blason, la vieille loi traditionnelle, Navarre, peuple à l'âme libre, proclamons tous ensemble, notre ardeur universelle. En cordiale union, loyaux et résolus, œuvrons et fraternels, nous ferons triompher, honneur, paix et amour. |
Artisanaux
Le
linge basque servait soit de linge vestimentaire, draps et nappes,
soit de « marègue » ou mante à bœuf (une épaisse toile contre les mouches).
Grâce à la culture du lin
sur leurs parcelles de terre, des centaines de familles basques confectionnaient
depuis le Moyen Âge,
des tissus à 7 bandes bleues et rouges. Le motif rayé proviendrait peut-être
des milliers de Juifs fuyant l'Espagne et qui se sont réfugiés au Labourd. Dans les
années 1950, le coton anglais a mis à mal toute l'industrie souletine. |
|
Patrimoniaux
|
Etxea de Basse-Navarre.
Orientation vers l'Est des Trikuharri, Hilarri (du basque hil « mort » et harri « pierre ») et etxea |
Voir l'article Maison basque. La maison basque ou etxea : de tout temps, les Basques ont eu un attachement exceptionnellement étroit à leurs maisons. D'ailleurs le mot « famille » (etxekoak) signifie littéralement « ceux qui possèdent la maison », le mot « compagnon » (etxelagun) se traduit par « ami de la maison ». La grande majorité des maisons portent un nom qui leurs sont propres et qui reflète le lieu ou la situation familiale. Plusieurs noms parmi les plus communs peuvent être traduits comme ceux-ci : Bordagaina « au-dessus de la bergerie », Mendi Eder « belle montagne » ou Dendariarena « la maison du tailleur », ils correspondent et sont en phase avec l'endroit où se trouve leur maison héréditaire. Avec le climat rude des montagnes, les Basques ont construit de grandes maisons, la façade principale au Sud, Sud-Est, Est avec la grange au rez-de-chaussée. Les animaux réchauffaient par leurs chaleurs naturelles le premier étage dans lequel la famille vivait. Comme on peut le voir sur la photo, la grande porte d'entrée est une ancienne porte d'étable aujourd'hui rénovée. Autrefois, les basques vénéraient le soleil ou Iguzki, et cela s'est concrétisé par un grand nombre de symbole. L'Iguzki Lore (soleil fleur) ou tournesol est un porte bonheur que l'on retrouve souvent sur les portes d'entrée, il servait à faire fuir les laminak et autres démons qui y voyaient un soleil durant la nuit. Les maisons, les stèles et les dolmens sont orientés vers l'Est, tournés vers le soleil. Cela chauffe aussi les maisons, le vent et les pluies venant pour la plupart de l'Ouest et du Nord. Le fronton est un symbole très connu et indissociable du Pays Basque. Chaque municipalité a le sien en son centre, souvent près de la mairie (Herriko-Etxea ou Udal-Etxeade) ou de l'église. Les premiers frontons ont été construit au début du XVIe siècle et son introduction correspond à la redécouverte par les européens des jeux de balle. |
Manifestations populaires
Il existe un grand nombre de fêtes en Euskal Herria,
elles sont traditionnelles, religieuses, folkloriques, paganisés, sociales,
participatives et même sportives. Bref de quoi satisfaire toutes les couches de
la société. Sans parler des festivals et autres activités de la vie moderne.
D'origine basque
|
- De Noël à Pâques, c'est le temps des Ihauteriak ou carnavals ruraux en basque dont l'Ours est le roi. Il est l'ancêtre des hommes et le personnage central qu'il faut réveiller à coup de bâtons et de cloches à la fin de l'hiver. Ces fêtes sont un moteur de la culture populaire basque où chaque village y va de sa stratégie pour chasser les mauvais esprits. En Soule et en Navarre, les jeunes organisent des mascarades et des spectacles de rue avec des cloches dans le dos (Yoaldunak) suivant des rites dérivés du paganisme. Les Ziripots, hommes en sac, sont les porteurs d'âmes. Ils imitent l'ours qui pète, son ventre ayant gonflé avec les âmes des personnes mortes durant l'hibernation. Il existe des dizaines d'autres personnages. C'est festif et les enfants ont leur place, certains personnages déguisés leurs font peur, leurs jettent de la cendres et de la sciure de bois. Les Ihauteriak sont très différents des carnavals modernes, étant donné qu'ils se font certains jours, avec quelques secrets et même parfois ils sont interdits aux étrangers du village. D'ailleurs, des anthropologues s'y intéressent en tant que phénomène social européen unique. Les carnavals comme celui de Lantz, Ituren, Alsasua ou Zalduondo sont les plus réputés. Ils attirent de plus en plus de touristes. - La mascarade souletine ou
Zuberoako maskaradak représente
une lutte symbolique entre villages et se divisent en deux grands groupes que
sont les noirs ou beltzak
(Buhameak ou bohémiens, Kauterak ou chaudronniers accompagné
de Pupu et de Pitxu, Xorrotxak ou rémouleurs ou
gagne-petit, kherestuak ou hongreurs (châtreur de chevaux) et de
Bedezia eta bedezi lagunak ou les guérisseur et ses aide) qui bafouent
l'ordre et la morale, sont sans vergogne et les rouges ou gorriak,
personnages muets et à la fois danseurs, qui représentent la société rurale
(Txerreroa, Kantiniersa ou cantinière, Zamalzaina ou homme cheval,
Gatüzaina
ou homme chat, Jaun eta anderea ou Seigneur et sa femme, Ensenaria
ou porte drapeau, Marexalak ou maréchaux-ferrants, Kükülleroak, Marexalak
ou les maréchaux-ferrants. |
Joaldunak ou Zanpantzarrak le 30 Janvier 2007 à Zubieta en Nafarroa (Navarre) |
|
- Au
solstice
d'hiver, c'est l'Egun berriak ou le Noël basque. Olentzero,
le charbonnier, descend de la montagne pour offrir des cadeaux aux enfants, les
villageois l'accompagnent en chantant dans les rues avant qu'il reparte.
Quant à la
Korrika,
« en courant » en français,
c'est une course populaire et qui se réalise en parcourant tout
le Pays Basque. Elle est organisée tous les 2 ans et dure 2 semaines par l'association AEK (Alfabetatze
Euskalduntze Koordinakundea) Coordination pour l'Alphabétisation et
l'Euskarisation des adultes. Le parcours
fait à peu près 2 300 km et change à chaque édition. La particularité de
cette course est qu'elle ne s'arrête pas la nuit. Du début à la fin, le témoin
passe de main en main, de ville en village, sans s'arrêter un instant. La
première Korrika eu lieu en 1980 avec une grande couverture médiatique. C'est l'événement en faveur de la langue basque qui rassemble le plus de monde. |
Korrika 2011 de Trebiñu à Donostia
La Gazte Martxa de 2009
Hondarribiko Alardea tous les 8 Septembre depuis 1639
Un Ziripot entouré par des Txatxoak au Carnaval de Lantz le Mercredi des Cendres. |
Autres festivités
- Tous les villages au Pays Basque, organisent
au moins une Fête ou Feria patronale annuelle en l'honneur de son
saint patron, regroupant diverses activités qui reflètent le village comme
la « fête du thon » à Saint-Jean-de-Luz.
D'autres fêtes, plus connues, rassemblent des millions de gens comme les
fêtes de Bayonne
en l'honneur de saint Léon ou de
San fermin
à Pampelune en l'honneur de San Saturnin. San Fermin rassemble entre 3 et
3.5 millions de personnes qui défilent de la Calle Estafeta à la Plaza del
Castillo. Toutes ces fêtes sont les plus grands mouvements migratoires qui
permettent aux populations locales des deux pays de se rencontrer et de fêter
ensemble sur les mêmes chansons.
- Les corridas sont surtout populaires en Navarre, soit dans le sud
de la Sierra Gorbeia et dans les grands centres urbains. En Navarre chaque
village à sa « plaza de toros » ou arène
et c'est dans cette province que la corrida formelle et moderne fut inventée
au XVIe siècle. La
tauromachie
se pratiquait autrefois à cheval toutefois les paysans navarrais étaient trop
pauvres pour en posséder. En Iparralde, la première corrida eu lieu
seulement qu'en 1852.
|
- Les courses de taureaux ou encierros et de vaches existent depuis
fort longtemps au Pays Basque. D'ailleurs Bayonne fut l'une des toutes
premières villes à lâcher les « toros » ou zezenak dans ses rues dès
1289. La tradition voulait qu'autrefois les jeunes hommes défient les
toros quand les éleveurs les emmenaient vers l'arène. Les encierros de
San Fermin sont connus mondialement. Certains se pratiquent la nuit comme
à Mendigorria pour le danger et le plaisir qu'ils procurent. Les
blessures sont très fréquentes, voir des morts. |
|
- Quelques fêtes locales en Iparralde : la foire aux pottocks
à Ezpeleta, la Bixintxo,
Vincent
en basque, à Ziburu et la Fête du Chipiron à
Hendaia, la fêtes de la Saint Léon, le
marché médieval, les journées du chocolat, la coupe du monde de pelote en
trinquet, la foire aux jambons et Olentzero (rite du charbonnier)
à Baiona, le Biltzar (Assemblée en basque) ou le
rendez-vous des écrivains, la foire gastronomique, le cross des
contrebandiers et la fête de la palombe de
Sara, la foire aux chevaux de
Donapaleu,
Lehengo
Hazparne ou Hasparren d'autrefois, les
internationaux de Cesta Punta et la nuit de la sardine à
Donibane
Lohizune, le concours de chiens de bergers et le festival de la
force basque à
Baigorri, la fête de la cerise à
Itsasu...
et autres.
- Autres fêtes : les
fêtes
et pèlerinages (Romería) en Navarre sont nombreuses, les
danses
basques, les
festivals du cinéma (Donostia
Zinemaldia-Festival San Sebastian,
Festival Internacional de Cine de Vitoria-Gasteiz, Festival International de
documentaires et courts métrages de Bilbao ou Zinebi,
Fantasiazko eta Beldurrezko Zinema
ou Semaine de Ciné Fantastique et de Terreur de Donotia,
Festival de Cine Latino-americano de Biarritz,
Festival
Internacional de cine gay/lesbo/trans de Bilbao et Festival Publicitario de Donostia-San Sebastian), les
rencontres théâtrales,
festivals
et concours de musique contribuent à enrichir la diversité des
activités culturelles du Pays Basque ainsi que leurs rayonnements.
- Autres rassemblements et festival :
Errobiko
Festibala ou Festival de la Nive mélange des moments de fête, de débats,
de concerts, d'expositions et principalement de transmission orale, élément
essentiel de la culture basque. Euskal
Encounter est une édition annuelle qui accueille 6 000 jeunes mordus de
l'informatique et 4 000 ordinateurs qui sont connectés en ligne pendant 4
jours consécutifs dans le but de jouer, assister à des conférences,
concourir, télécharger...Le festival Euskal
Herria Zuzenean ou Pays Basque en direct, l'Azkena Rock Festival.
Lapurtarren Biltzarra
(Rassemblement des Labourdins) à Ustaritz, capitale historique du Labourd, où à chaque premier dimanche du mois d'octobre, des doléances de jeunes s'étalent
sur la place publique, défilé de chars et autres revendications. Même si
l'événement fait écho aux « Biltzar » d'autrefois,
l'officialisation de l'euskara reste la première exigence et ce depuis 1979, dont la
campagne Bai Euskarari est à
l'origine de sa création. C'est «un véritable outil d'expression de revendications plus larges, touchant au Pays Basque ou au monde, sous fond d'humour et de satire».
Sports
Sports basques
|
Joueur de xistera et pilotari au club de l'Olharroa (La pieuvre) à Guéthary. (1959) Mon défunt père
Joueurs de pelote à main-nue |
Les sports basques : de nombreux jeux sont originaires et vivent qu'au Pays Basque. L'origine de la pelote basque est le jeu de paume, pratiqué en France, il fut délaissé sauf en Euskal Herria. On classe les jeux d'après le terrain. Le trinquet, qui se joue partout dans le monde, est un fronton couvert utilisant 4 murs. On y joue la main nue, la paletta cuir, le xare et la pasaka. Le Jaï-Alaï qui signifie « heureuses vacances » est d'origine espagnole, il se joue aussi à Cuba et en Floride, sur un fronton couvert avec un mur à gauche et arrière. On y joue la cesta punta. De nombreux joueurs professionnels basques et cubains s'expatrient en Floride ou les paris sur les joueurs sont très populaires tout comme en Euskal Herria. La place libre est le fronton municipal situé en plein air où se joue la pala, la paletta cuir, le joko garbi, la main nue et la chistéra. Cette dernière a été inventé en 1857 un jeune fermier à Saint-Pée par Gantxiki Harotxa, jetant des pommes de terre dans un panier, a eu l'idée de les propulser avec un long panier en forme de godet attaché à une main. Sur le fronton avec un mur à gauche, couvert ou découvert, se dispute la main nue, la pala corta, la paletta cuir, le joko garbi et le frontenis. - La force basque : depuis des siècles, les villages s'affrontent avec diverses compétitions telles que : * Le Soka Tira, jeu très populaire, ou le tir à la corde avec des équipes de huit à dix personnes. * L'Orga joko où une personne soulève une charrette et la fait pivoter. * L'Aizkolariak est un défi de bûcherons qui coupent des troncs couchés à la hache et l'Arpanariak où les scieurs de long doivent scier dix disques de bois, et le Zalulariak ou une dizaine de troncs doivent être sciés en temps record par deux bûcherons. * Le Lasto Botatze où l'on lance une botte de paille de 13 kg le plus haut possible ou le Lasto Altxari qui consiste à lever une botte de paille de 45 kg que l'on hisse le plus possible en 2 minutes. * Le Harri Altxatzea ou Harrijasotzaleak où l'on soulève des pierres de 300 kg et le Gizon Proba, soit la traction de pierre. * L'Esneketariak ou Ontzi Eramatea où l'on court le plus longtemps possible avec dans chaque main un bidon de lait de 41 kg. * Le Zakulariak ou « porteur de sac » où l'on porte en courant un sac de 80 kg sur les épaules. * L'Ukundia edo Ingude qui est un lever d'enclume, le zakulariak où l'on porte un sac de 81 kg sur l'épaule. * Le Lokotxa ou la course aux épis de maïs. * La Segalaritza où l'on coupe l'herbe à la faux. * Le Palankari
est pratiqué par les bergers souletins, était l'un des outils des plus utilisés
dans les carrières. Elle servait à faire un trou afin de placer le TNT à
l'intérieur pour casser les roches. Le poids du palanka ou levier en basque,
varie entre 8 et 25 livres et le gagnant est celui qui le jette le plus loin. Ce
peut être lancé de plusieurs manières : Bularretik : du coffre.
Hankartetik : Entre les jambes. Bueltaerdiz : demi de tour. |
* Le Tokalari ou
Toka consiste à toucher une barre de fer verticale avec des
jetons métalliques.
A cela il faut ajouter parfois des jeux avec des animaux comme l'Asto Probak
(traction de pierre par des ânes), L'Idi Probak (traction de pierre par des
bœufs),
l'Artzain Txakurrak (épreuve de dressage de chiens de berger), l'Aharitalka
(combats de béliers).
|
Les estropadak, courses de traînières (trainura) ou aviron de mer, sont une longue tradition basque de 130 ans issue des anciennes barques qui servaient à la chasse aux baleines dans le golfe de Biscaye depuis des siècles. La coutume voulait que le premier qui arrivait au port, pouvait vendre le plus cher son poisson. La première course officielle eu lieu à Donostia en 1878. De nos jours, les régates se font avec des traînières pesant 200 kg et faites de fibres de carbone. C'est un sport de compétition de haut niveau. Il existe de 8 à 10 équipages, un seul d'Iparralde, formés de 14 personnes soit 13 rameurs et le « patron » (barreur) sur la poupe, qui font la course de façon intense pendant 20 à 25 minutes sur une distance de 3 milles nautiques (5.5 km) en deux allers-retours. Il existe aussi les courses de battel handi avec 6 rameurs et de batteleku avec 3 rameurs. La course de « la Bandera de La Concha » à Saint-Sébastien réunit une vingtaine d'embarcations tous les ans avec plus de 100 000 spectateurs. Les paris d'argent sont populaires durant tout le championnat des mois de juillet et août et les « play-offs », en septembre. Il existe de nombreuses variantes du jeu de quille basque ou Birla-Bola Jokoa (el juego de bolos) qui se pratique généralement en milieu rural. Ce jeu est très populaire en Alava et au sud du Bizkaia, et presque tous les villages possèdent un abri couvert où se jouent des tournois et aussi des paris d'argent. Contrairement au Béarn, où l'on joue seulement avec 3 ou 6 boules, dans les règles traditionnelles, il est joué avec 9 boules. Les joueurs lancent une boule de bois de 3 à 4 kg depuis un point à 15 mètres du « bolo central ». La bola jokoa se divise en 12 modalités de jeu dont entre autres l'Alavaise, l'Hiru Txirlo, Toka, Tres tablones ou le Bola Toki. Une forme de chasse à la palombe d'origine basque se pratique encore à Sare et Etxalar, elle consiste à installer des filets de 12 mètres de haut ou pantières inclinés qui sont relâchés de leurs extrémités supérieures pour tomber sur les oiseaux. Par des mouvements de drapeaux blancs et de cris, les rabatteurs, situés sur la cime des arbres qui se situent vers le haut des collines, imitent un prédateur venant d'en haut, comme l'épervier, et par réflexe les palombes plongent vers le sol où des filets les attendent. Grâce aux archives navarraises, cette pratique remonterait bien avant 1487. |
L'Ama Guadalupekoa est la trainière d'Hondarribia.
La bola jokoa ou jeu de boule en Alava. |
Sports basques disparus
Lutte ou art martial. Des recherches récentes ont fait apparaître l'existence, quasi-inconnue dans beaucoup de domaines historiques, d'un art martial purement basque. De nos jours, dans la vallée d'Arratia, des recherches sur les origines de ce système martial donnent peu d'indices mais ce qui a pu être examinée pour l'instant est pour le moins très curieux. Ce système martial est en outre en relation avec la mythologie ou la religion basque. D'après les objets trouvés prés d'un site romain à Forua, ces derniers nous montrent des images de lutteurs portant différentes types armes, ou combattant à main nue. On fait référence au pouvoir de Mari (Déesse principale au panthéon basque) et aux offrandes qui lui étaient offertes avant chaque combat. L'oppidum romain d'Iruña-Veleia, près de Vitoria, nous révèlent la mairiren dantza ou la danse de Mari, et les chercheurs arrivent à la conclusion qu'il pourrait bien s'agir d'un système de lutte à main nue, avec son système de codes propres (c'est pourquoi certains ont pensé que la lutte de Léon, ou y compris la lutte canarienne pourrait être en partie héritière de ce système martial). Parmi les hypothèses, les scientifiques croient que ces luttes n'étaient pas codifiées, que la transmission était directe de pères en fils, tout comme dans le droit privé. La baserri ou ferme familiale allait à seulement un seul héritier. En fait, le père choisissait celui qui serait préparé à recevoir les connaissances pour combattre. Les chercheurs sont enfin arrivés à la conclusion que la disparition progressive de ce système martial. D'après les constatations faites sur les documents portant sur les actions de la Sainte Inquisition au Pays Basque, les akelarre (aker larre ou pré du bouc, en référence aux mythes purement basques) étaient des réunions où l'on continuait à pratiquer ces luttes et l'on offrait des sacrifices aux Dieux. Comme ceci allait à l'encontre des croyances chrétiennes, on les supprima. Le tribunal de l'inquisition ne sachant pas le pourquoi de ces pratiques, des accusations de sorcellerie et de mauvais œil furent prononcées.
Sports populaires
Il existe deux sports très populaires suivant si
l'on vit du côté français ou espagnol.
Le
rugby à XV
est pratiqué en Iparralde avec par exemple les clubs pro du Top 14 comme le
Biarritz Olympique
ou celui de l'Aviron Bayonnais,
respectivement champion de France à 5 et 3 reprises, et en Fédérale 1 avec le Saint-Jean-de-Luz Olympique.
Le football est pratiqué en Hegoalde avec par exemple
le club de l'Athletic Bilbao,
en première division depuis 1912.
La particularité de ce dernier, ainsi que du club de la
Real Sociedad, est que
tous les joueurs, peu importe leurs origines, se font imposer une des deux
conditions suivantes : - soit être né au Pays Basque comme Bixente Lizarazu - soit avoir été formé dans
un club basque. Il y a eu quelques exceptions, comme le brésilien Biurrun
faisant état d'une solide ascendance basque. 34 000 petits actionnaires
propriétaires encouragent la politique de recrutement local du club qui est lié
à près de 500 petits clubs du Pays Basque (y compris du côté français).
Ceux-ci lui fournissent année après année leurs meilleurs éléments. Une sélection basque
soutenue par ESAIT
participe à des matches amicaux et joue contre des équipes
internationales. ESAIT travail à la création d'une institution nationale
sportive des fédérations d'Euskal Herria, en vue d'obtenir
l'officialisation d'une licence basque, à créer un Comité Olympique
Basque et à organiser les ligues et les championnats officieux dans toutes
les catégories sportives.
Les loisirs sont nombreux et très populaires grâce à la variété des
paysages.
En montagne, les Basques, mais aussi les touristes, pratiquent la randonnée
pédestre dans la réserve écologique d'Urdaibai ou sur les chemins
de Compostelle,
les ballades en vélo de montagne à
Lekunberri,
les ballades à cheval sur des pottoks
ou du parapente dans les environs de
Mendionde,
du ski de fond dans la vallée d'Iraty,
du rafting à Bidarray,
de l'escalade sur le pic d'Aralar en Navarre, de la spéléologie dans
la forêt des Arbailles,
de la pêche en eau douce à Montory.
Les courses en montagne sont de plus en plus appréciée avec l'Euskal Trail, Les
délices d'Ursu Mendi,
Sara Korrika,
course du Laka.
Autre sport populaire des deux cotés de la frontière, le cyclisme. Tous
les ans, le Tour de France montre à des millions de téléspectateurs, la
ferveur des Basques qui brandissent des centaines d'Ikurriña le long de
chaque étape. Composée aussi exclusivement de coureurs cyclistes basques,
l'équipe cycliste Euskaltel-Euskadi
est composée des cyclistes professionnels considérés comme étant représentatif
de l'équipe nationale au Pays Basque. Le Tour du Pays Basque (« Vuelta
Ciclista al País Vasco » ou Euskal Herriko txirrindulari itzulia)
est une course à étapes se disputant au début du mois d'avril, créé
en 1924 sous le nom de « Circuit du Nord », il est inscrit au programme
du Pro-Tour,
système d'élite qui contraint toutes les équipes à participer à
toutes les épreuves du calendrier.
Les loisirs en mer tels que les sports nautiques à Zarautz,
le canoë à Ibarranguelua, la pêche à Getaria, la pêche à la
pibale
de nuit, la plongée sous-marine au pied du Jaizkibel à
Hondarribia
sans oublier la baignade à la plage.
Un sport qui a fait connaître le Pays
Basque dans le monde est le surf. La
conjonction d'une forte houle
venue du large et d'un fond abrupt, fait jaillir de belles vagues lorsque
la lame heurte le fond. Biarritz et
Mundaka
sont deux villes connues mondialement dans le circuit du championnat de surf
professionnel. Ces 20 dernières années, des industries, des associations
environnementales et des écoles de surf ont changé la dynamique sportive
des jeunes sur la côte basque. Actuellement, le surf attire autant les
jeunes que le rugby en Iparralde.
Outre le rugby, autre héritage de la domination anglaise durant trois siècles
en Aquitaine, le golf fut un sport fortement développé par
l'aristocratie européenne. Le
golf du Phare,
inauguré en 1888, avec les 10 autres terrains de golf qui longent la côte
basque sont des preuves de l'engouement pour ce sport. Ilbarritz, avec son
spot de surf
bien connu, a aussi une grande école d'entraînement faiseuse de
champions basques.
Chants, musique et danse
Voir l'article Musique basque.
La musique moderne est aussi variée qu'ailleurs
nonobstant quelques instruments traditionnels lui donnent un son particulier tels
que les flûtes Txistu et Txilibito,
l'accordéon diatonique
(trikitixa), la
tambourine (pandero),
le hautbois (dultzaina),
des percussions (txalaparta), des tambourins (tamboril ou
ttun-ttun),
le supriñu, le musukitara et la clarinette (alboka). L'Institut
Supérieur de Musique du Pays Basque et
Eresbil (Archives Basques de la Musique) sont des référents d'informations en la
matière.
Voir l'article Danse basque.
Les Euskal dantzak existent sous 200 formes
différentes. La plus célèbre est le
fandango
toutefois chaque province à ses danses. La Biscaye a le Kaxarranka, Dantzari Dantza,
Xemeingo Dantza
(danza de Jeméin) et l' ezpata dantza ou danse de l'épée. Le Guipuscoa
a l' Arku Dantza (des arcs), Zinta Dantza (du ruban), Kontrapas
et la Sorgin Dantza (des sorcières). La Navarre a l' Otsagiko Dantzak
(d'Ochogavía), Axuri Beltza, Luzaideko Ihauteria (carnaval de
Lazaide), Sagar Dantza (de la pomme), Iribasko Ingurutxoa et Larrain Dantza.
Et en Iparralde, il y a le Lapurdiko Ihauteria (carnaval du Labourd), Zuberoako Maskarada
(mascarade souletine), les kaskarotak qui sont costumés avec des grelots,
banderriak
ou les porteurs d'Ikurriña, aurresku, ariñ-ariñ,
joaldunak
couverts d'une peau de mouton, brokel dantza, ziganteak ou les
géants et bien d'autres. L'aurresku est une danse typique qui commence par une représentation lente, exécutée
uniquement par les hommes. Elle est accompagnée par le txistu et le
tambourin. Elle est dansée en signe de respect à l'égard des invités ou
des spectateurs.
Littérature basque et bertsulari
Voir l'article Euskara, la langue des Basques. (Histoire complète de la langue basque)
La littérature orale basque avec ses contes
traditionnels, son théâtre populaire, ses ballades et poésies lyriques ainsi
que le Bertsolarisme,
phénomène d'improvisation de chants poétiques sur la place publique sont
les prémices de cet art dont Mattin
Treku et Xalbador furent d'illustres improvisateurs. Un Championnat du Pays Basque des bertsularis (Bertsolari Txapelketa Nagusia),
se déroule tous les quatre ans pendant deux mois. En finale, les sept meilleurs improvisateurs se mesurent à l'ancien champion. Le premier livre basque fut
écrit par un curé, le père Beñat Etxepare qui écrivit un recueil de poésies en
1545 avec « Linguae basquenum primitiae » et en 1571, J. Leizarraga traduisit la
première bible en basque. La littérature basque était fondamentalement
religieuse jusqu'à la moitié du XXe siècle. En 1957, Txillardegi fut considéré comme le premier auteur à avoir
écrit le premier roman moderne Leturiaren egunkari ezkutua.
Présentement 1500 livres sont produits chaque année, du conte pour enfants à
l'essai politique. Les grands écrivains sont entre autres Axular,
Miguel
de Unamuno, Pío
Baroja, Iribarren Rodríguez, Campión, Urretabizkaia... etc.
Art de la Table
|
Les Basques sont toujours très fiers des produits qu'ils produisent ainsi que de leurs plats. Ils en font si fortement la promotion que même des étals entiers des grandes surfaces en sont remplis. Les marchés sont très populaire, d'ailleurs Bilbao et Saint-Sébastien accueillent tous les 21 décembre la célèbre foire de la San Tomas. Les produits traditionnels des agriculteurs basques, des fruits, des légumes, des produits artisanaux, des pâtisseries et des plats typiques sont à déguster comme le "talo con chorizo" avec du txakoli. La journée se termine avec un concert traditionnel. Outre les marchés, les foires aux fromages de Roncal à Burgi ou du jambon à Bayonne sont très prisées.
Un Txoko est une confrérie gastronomique basque. Txoko, forme diminutive de zoko, signifie littéralement le « recoin », le « coin confortable ». Dans certaines régions, xoko est une variante employée. Traditionnellement, les Txokoak sont seulement ouverts aux hommes qui désirent faire une cuisine gastronomique et traditionnelle basque, expérimenter de nouvelles recettes, pour ensuite manger, boire, chanter et parler, en bref agrémenter une vie sociale. Ce sont des établissements très populaires, la ville de Gernika par exemple, avec approximativement 15 000 habitants a neuf Txokos avec environ 700 membres au total. Curieusement, la plupart des Txokos traditionnels ont une clause dans leurs règlements qui interdit toute discussion politique sur les lieux. C'est pour cette raison que durant les années du Franquisme, les Txokos sont devenus de plus en plus populaires car ils étaient l'un des quelques endroits où les Basques pouvaient légalement se réunir et parler l'euskara. Quelques Txokos très conservateurs ont aussi des clauses qui ne permettent pas l'accès de femmes, mais la plupart des Txokos permettent aujourd'hui l'accès aux femmes pour y manger, boire mais pas pour y faire la cuisine. Parfois, un membre peut se charger d'un repas pour un plus petit groupe d'amis qui veulent se réunir, faire un dîner pour eux-mêmes, leurs familles ou des invités. |
|
Le développement des Txokos a toujours eu un
impact significatif sur la cuisine Basque, en effet, beaucoup de plats
traditionnels ont été sauvés ou ressuscités grâce à ces confréries. Ils ont
également influencé le développement de nouveaux plats raffinés et accessibles.
Ils sont également de bons endroits où l'information sur les meilleurs produits
disponibles et les meilleurs marchés est échangée.
Spécialités gastronomiques
Voir l'article Cuisine basque.
La réputation de la cuisine basque en Espagne
reste « la » référence, et tous les grands chefs espagnols sont pour la
plupart du Pays. Ce qui fait sa richesse, c'est qu'il existe deux cuisines
basques, une cuisine côtière à base de produits marins, une cuisine des
montagnes à base de porc de d'agneau et des spécialités du
terroir.
- Spécialités maritimes.
Le
Ttoro est une soupe à base de
lotte
et de merlu, le Marmitako qui est un ragoût de thon, le Txanguro
qui est un crabe farci, l'Ajoarriero qui est une
morue
à la biscayenne salée cuite dans l'huile d'olive avec de l'ail et des
piments, le koskotxak de merlu cuit avec des légumes et bien
d'autres mets faits de sardines, de
calamars
comme le begi haundia (le gros œil) et les chipirons,
daurades,
pibales,
moules, homards, langoustines...et tout ce que la mer offre.
- Spécialités de l'intérieur.
|
Fromage Idiazabal
Affiche de publicité extérieure du fromage Etorki qui signifie « origine » |
L'utilisation du porc de pie est abondante. Il donne du « chichon » ou xixon (rillon ou rillettes mais en moins gras), de la xingar (bacon), du chorizo de pamplona, du jambon de Bayonne, du boudin de Biriatou et autres cochonnailles. Il existe aussi des mets basques comme la piperade, l'axoa, le poulet basquaise qui se préparent tous avec des piments d'Espelette. Importé des marins basques, le Zikiro est une forme de méchoui où un quart d'agneau est cuit à la mode Amérindienne. On y mange aussi la palombe des filets d'Etxalar ou le lapin au cidre. La Navarre a des produits renommés tels que les poivrons ou piments (Pimientos del piquillo de Lodosa), les asperges (Espárrago de Navarra), l'artichaut de Tudèle ou le veau (Ternera de Navarra). Les Pintxos, sont des tapas basques. - Les fromages. - Une touche sucrée.
|
Boissons alcoolisées
La boisson artisanale est un bon complément dans les regroupements sociaux et une autre occasion pour les Basques de fêter.
|
Le vignoble euzkadien ou Euskal_Herriko ardoak, situé à cheval sur les deux versants des Pyrénées, réunit plusieurs spécificités qui lui donne une place à part dans la viticulture européenne. Les vins basques ou ardoak aurait été introduits avant la conquête Romaine et se divisent en 4 appellations contrôlées. L'existence de lambrusques dans les vallées des Pyrénées permit la sélection de nouvelles variétés issues de semis et d'hybridations spontanées ou contrôlées. Les moines des abbayes les plus riches, en particulier les cisterciens, ont probablement joué un grand rôle dans ce travail de création et de sélection variétale. Cet encépagement typique des vignobles du Pays basque, avec un mode de conduite des vignes en hautains ou semi-hautains donne aujourd'hui une spécificité à ses vins qui ne se différencient que par les variétés de leurs terroirs. |
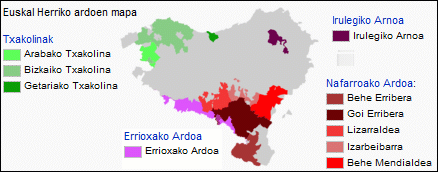 |
Ces spécificités sont les variétés de vignes issues de la famille des Cabernet-sauvignon et auraient eu pour ancêtre le fameux Biturica, mais surtout les vignes sauvages qui ont été à l'origine de leurs cépages furent préservées du phylloxéra ampélographes un matériel végétal unique.
- L'A.O.C Irouléguy
ou Irulegiko arnoak
est un vin de 5 cépages sur les bords de la Nive,
autour d'Ispoure
introduit par les moines de Roncevaux au XIe siècle. Le
Txakolina avec 3 D.O. (Denominación de Origen) (Getariako Txakolina,
Arabako Txakolina et Bizkaiko Txakolina), est un vin blanc ou hondarrabi zuri et un vin rouge ou
hondarrabi beltza
léger et fruité produit sur des terrains de calcaires près de Bakio et Saint
Sébastien. Le D.O.
Navarra
est un vin rosé fruité et parfois particulièrement corsé, un vin blanc ou vin
rouge produit au sud de la Navarre. Il se divise en 5 sous-appellations : le Valdizarbe ou Izarbeibarra, Lizarraldea ou Tierra Estella, le Baja Montaña ou
Behe Mendialdea, le Ribeja Alta et Baja ou Behe eta Goi Erriberra. La
D.O.C. Rioja ou Errioxako Ardoa, vin fruité produit dans le sud de l'Alava
et aussi en Navarre, est le plus connu et le plus réputé pour sa qualité, en
rouge, blanc et rosé. Le cépage
tempranillo
offre une saveur fruitée particulière.
- Nombreux sont les
spiritueux
basques
produits en Euskal Herria. L'Izarra
une liqueur faite à base de menthe ou d'amandes, la patxaka
est une liqueur anisée de pomme, le
patxaran ou anis rouge des Navarrais (Pacharán Navarro) est à base de prunelles et
d'alcool anisé, l'eau-de-vie
des montagnes à base de poire Williams et aussi la
sangria.
- Les cidres basques ou
sagardoak fabriqués dès l'Antiquité
en Biscaye sont présentement produits principalement au Guipuscoa avec des
pommes acides à 50%, amères à 30% et douces. Vers la mi-janvier, les
Basques se livrent au rituel du Txotx où un petit et long jet de cidre
sort des immenses barriques. Longtemps, le sagardoa fut une boisson artisanale
populaire avant d'être délaissée, toutefois un renouveau et un véritable
engouement populaire regroupe présentement les familles vers les cidreries ou sagardotegia,
surtout durant les dégustations de janvier à mai.
- Le kalimotxo est un mélange à parts égales de vin et de Coca-Cola.
Autres particularités
|
« La trampita » peinture de Mauricio Flores Kaperotxipi montre des joueurs de Mus.
Nom donné à une maison
Coupes de cheveux des Cantineras à la San Marciales 2006.
« Olentzero y el tronco mágico » dessin animé de 2005
Panneau de signalisation raturé
Dessin de Kukuxumusu prononcé Koukouchoumouchou
Deux eguzkilore sur une porte |
Le Mus (se prononce Mouche) est un jeu de carte populaire qui ressemble au Poker auquel s'adonnent les Basques, soit dans des championnats officiels et locaux, soit entre amis. C'est un jeu tout à fait rapide et franc, avec beaucoup de place pour le bluff et les plaisanteries. Races animales : Il existe des espèces animales dites de « race basque » qui font l'objet d'études et de conservation de la part d'une vingtaine de sociétés sous la tutelle de l'association Euskal abereak (Animaux basques). Les races autochtones sont variées, on dénombre des bovins (Betizu, Monchina, Pirenaica et Terreña), un âne (ou Asno de las Encartaciones), des chevaux (Caballo de monte del País Vasco et le célèbre Pottoka), des moutons (Carranzana à tête noire et blanche, Latxa à tête noire et blanche et Sasi ardi), un caprinae (ou la chèvre Azpi gorri), des porcins (Chato vitoriano et Euskal txerria), des chiens bergers ou artzain littéralement brebis-gardien (Erbi txakurra et Euskal artzain txakurra avec deux variétés dont le Gorbeiakoa et l'Iletsua), un chien de bétail (Villano de las Encartaciones), un chien (Villanuco de las Encartaciones), un anatidés (ou une oie Euskal antzara) et cinq variétés de poulets basques (Beltza, Gorria, Lepasoila, Marraduna et Zilarra). L'Irrintzina qui signifie « hennissement » en basque est un cri. Selon Lionel Cassiede dans les Traditions Basques, « ...à partir de la racine " irri ", le rire, donc un compromis parfait entre le cri de l'animal (cri du milan ou le hurlement du loup) et l'expression d'un sentiment humain. Les bergers et tous ceux qui pratiquent la montagne ont utilisé cette forme d'expression pour extérioriser un sentiment. Ce pouvait être la joie à la vue de la maison abandonnée depuis le début de l'estive, la douleur de la perte d'une brebis, la manifestation d'un sentiment amoureux ou un hurlement de colère et de haine« ». Il existe à Hazparne tous les ans un concours d'Irrintzina. Coiffure : La mode qui perdure en Hegoalde chez les jeunes filles plus fréquemment et jeunes garçons, est la coupe de cheveux dite « coupe de Bilbao » ou aussi le « style Eskualdún ». On parle en fait de la coupe « nuque longue », cette coiffure consiste à porter les cheveux longs, de manière assez désordonnée, sauf sur les tempes où ils sont beaucoup plus courts, avec une frange simple. Cette coupe est quasiment absente en Iparralde. Frange extra-courte, mèches longues ou rastas dans la nuque, la coupe « mixto » arborée par certains Bilbainos a de quoi surprendre. Mais au-delà de la simple apparence, cette coiffure typiquement « Basque » avec les boucles d'oreille sont un véritable révélateur culturel. Olentzero, qui fait sérieusement concurrence au Père Noël, est un charbonnier qui descend de la montagne pour annoncer à la population le renouveau des beaux jours et la naissance de « Kixmi » (nom que les gentils donnaient au Christ). Originaire de la vallée de la Bidassoa, il a traversé les âges, s'adaptant sans cesse. Il reprend la tradition païenne préchrétienne de la célébration du solstice d'hiver, qui est en relation avec le feu. A l'origine, on appelait « Olentzero », la bûche avec laquelle on maintenait le feu de la cheminée durant la nuit de Noël. Le lendemain, on répandait les cendres devant la porte d'entrée, afin de protéger la maison et ses habitants pour la nouvelle année. Traditionnellement, des groupes de chanteurs font la quête la nuit de Noël en chantant des chansons traditionnelles et le promènent de maison en maison sous la forme d'un mannequin. De nombreux villages ont maintenu cette tradition, grâce au travail des associations. qui font tout leur possible pour que les gens ne confondent pas Olentzero avec le Père Noël. Selon Claude Labat "Olentzero n'est pas un simple charbonnier mais un charbonnier au service de quelque chose. Son mythe est resté lié à des valeurs universelles"[Réf]. Ces dernières années, sa popularité n'a fait que croitre dans l'ensemble du Pays Basque et « lors de fêtes pour les enfants, il vient distribuer dans les villes et villages des cadeaux et friandises et aussi du charbon à ceux qui n'ont pas su rester sage durant l'année écoulée. Il est parfois accompagné de laminak, esprits espiègles de la forêt. Son image a été remodelée de nos jours car il est plus présentable, désormais, il ne boit plus, ne fume plus et n'est plus tapé par sa femme mais il reste tout de même sale et couvert de charbon.
Kukuxumusu signifie « Petit baiser de puce » en basque, est une petite entreprise de Pampelune qui s'est fait connaître en Europe de l'Ouest pour ses dessins amusants sur les encierros de Pampelune, la fabrication de vêtements, cartes postales et autres objets de souvenirs. Étant une des images principales des fêtes de San Fermín et de Pampelune, elle s'est développée et aujourd'hui, la marque est également vendue dans plus de soixante pays. Qui n'a pas vu aujourd'hui cette fleur porte-bonheur ornée les portes d'entrée des maisons de Navarre? Le concept de la Terre comme Mère, loin d'être isolée, s'est concrétisée dans un des mythes cosmogoniques basques, c'est-à-dire celui de l'Eguzkilorea (fleur du soleil ou carlina acaulis). À travers elle, les femmes et les hommes sollicitaient il y a longtemps l'aide d'Amalur (Mère Terre) afin qu'elle les protège des esprits malins, Amalur répondit en créant deux filles, Ilargi (la Lune) et Eguzki (le Soleil). Rapidement, ces esprits ont appris à éviter la lumière, alors Amalur est intervenue pour une dernière fois dans des affaires humaines, en faisant naitre en son sein une Eguzkilorea, plante protectrice depuis lors contre sorcières, laminak et autres mauvais esprits. Actuellement, cette plante vivace montagneuse, est une sorte de porte-bonheur qui peut se manger à la façon des artichauts et qui porte différents noms : astalarra, basalarra ou kardalora. |
Religion
Autrefois : la récente découverte d'inscriptions
basques à caractère chrétien ainsi qu'un calvaire du IIIe siècle à l'oppidum
romain d'Iruña-Veleia semble penser que certaines vallées conjuguaient la
religion locale et chrétienne, les grands axes se christianisaient alors que le
paganisme continuait dans les montagnes. De petites phrases en euskara parlent
de la religion chrétienne dans un ensemble épigraphique : IESVS IOSE ATA TA MIRIAN AMA « Jésus,
de père Joseph et de mère Marie » et GEVRE ATA ZVTAN « Notre Père
en vous ». L'évangélisation commence IIIe siècle en Navarre
avec Saint Saturnin, mais c'est lors de l'implication du religieux dans la réorganisation
du duché de Vasconie et l'évangélisation des rives de l'Adour par
Saint-Armant que le christianisme s'implante petit à petit durant le Moyen Âge.
L'ordre
de Cluny s'instaura dans la monarchie navarraise et l'ordre
mendiant dans les villes et des prieurés feront leurs apparitions le long du
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Protestantisme a eu une petite place quand
Aliénor
d'Aquitaine épousa Henri II Plantagenêt, et mis l'Aquitaine dans les
mains du Roi d'Angleterre, en 1152, seuls résisteront les vicomtes de la
Soule et du Labourd toutefois ces régions resteront vassales de l'Angleterre
jusqu'en 1449. Une poussée du protestantisme
est à l'origine de la première traduction du nouveau testament en basque
par Joannes Leyçarraga. Après que le roi de Navarre se soit converti en
catholicisme pour être roi de France, le protestantisme a presque disparu.
Bayonne a accueillit une importante communauté juive Sépharades qui fuyaient
les inquisitions espagnoles
et portugaises, un cimetière juif existe toujours à
La
Bastide-Clairence. Il y avait également les communautés juives et
musulmanes importantes en Navarre avant la reconquête castillane de 1512-21. Depuis la période révolutionnaire quand beaucoup d'autonomie a été ôtée
aux Basques dans les années 1793-1794, plusieurs prêtres basques se sont
impliqués dans des débats politisés et certains furent suspendus par le
gouvernement, étant réfractaires à la politique de sécularisation et à
l'idée républicaine. Le clergé basque, de par sa situation géopolitique,
a toujours eu de nombreux prêtres actifs et activistes qui s'impliquaient
politiquement, mais un peu moins à ce jour, pour défendre et représenter
leurs paroissiens. En Hegoalde, plusieurs sont farouchement nationalistes. Le
monastère d'Arantzazu est à l'origine du combat linguistique. Le clergé basque a eu d'illustres personnages comme
Ignace de Loyola
fondateur des Jésuites,
des missionnaires comme Francis Xavier et Michel Garicoïts, le cardinal
Etchegaray ou Xabier Arzalluz, un ancien Jésuite et ancien président du PNB ou EAJ-PNV.
Les églises basques ont joué un rôle primordial dans le soutien à la langue
basque et le développement des Ikastolak.
Actuellement : la
christianisation tardive que signalait le Père
José Miguel Barandiarán dans son œuvre
l'homme primitif au Pays Basque,
dans les parties éloignées des voies d'accès romaines, a pu surtout être la
cause de la survivance de la religion basque primitive jusqu'à des stades très
tardifs en comparaison avec le reste de l'Europe. Si ce fut l'un des derniers peuples européens
à se convertir totalement au christianisme
(XIIe siècle), c'est un des peuples qui affichent une
bonne pratique Catholique lors de certaines dates.
Les églises rassemblent un grand nombre de personnes qui viennent écouter la chorale paroissiale
chanter en basque ou le curé, elles sont encore des lieux de
rencontre et de tradition pour certains.
De nos jours seulement un peu plus de 50% de la population montrent une
certaine croyance en Dieu, alors que le reste de la population est
agnostique
ou athée. Le nombre de sceptiques envers la religion augmente sensiblement
pour les générations plus jeunes, alors que les plus anciens sont plus
pratiquants. Au Pays Basque, la religion fait surtout partie entière du
calendrier des festivités. La
Semaine Sainte
(Asta Santua ou Asta Saindua en basque) qui commence au
dimanche des Rameaux et se termine le Jeudi saint, est processionnée avec les
fameux « capuchinos » et invite les catholiques basques à la messe en Hegoalde
alors que la Fête-Dieu
ou Pesta Berri se souligne en Iparralde.
La population musulmane en
Iparralde est très faible, soit 1 300 personnes surtout regroupée dans Bayonne
nord et de 35 588 personnes en Hegoalde (10 884 en Navarre, 6 230 au Gipuzkoa, 10 494 en Biscaye et 7 980 en Alava). La population de confession musulmane est
extrêmement faible, soit 1.2% (Espagne 2.4%, France 9.8%).
Les églises basques, principalement en Iparralde, se distinguent par une disposition particulière et unique, le chœur et l'autel sont largement surélevés dans la nef et des galeries l'entourent. La particularité principale est que les hommes, qui se placent dans les galeries en hauteur, sont séparés des femmes qui se placent dans la nef. Si une partie de la messe est en erdara, la grande majorité des chants liturgiques sont toujours en basque, et toute la ferveur de la foi basque s'exprime quand, aux voix des femmes rassemblées dans la nef, se mêlent les voix puissantes des hommes groupés dans les galeries. Dans des églises sans galerie, les hommes vont à droite et les femmes à gauche pour faire face à l'autel. Ces galeries ont été construites lors de l'explosion démographique du XVIe siècle. L'origine de la séparation entre hommes et femmes remonte à l'époque où l'on enterrait les morts dans la nef de l'église et où les rites funéraires étaient exclusivement réservés aux femmes. Les curés étaient enterrés près du chœur et le notables sous le porche. Le sépulcre ou Jarleku (tombe familiale ou littéralement « endroit où l'on s'assied ») représentait une maison du village, l'enracinement de cette dernière dans la sphère du sacré. Durant la vente d'une maison, le Jarleku y était inclus. Lors de l'office, la maîtresse de maison se plaçait sur son Jarleku et y faisait brûler la cire en mémoire de tous les défunts de la maison. Il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle avant de voir les derniers habitants de petits villages, contraints et forcés d'enterrer leurs défunts à l'extérieur de l'église. Au XIXe siècle, comme transition, on mettra des chaises avec le nom des maisons. Puis les bancs au XIXe siècle à leur tour remplaceront les chaises mais la séparation des sexes se perpétuera.
On distingue 4 périodes dans l'art funéraire. À l'âge de bronze et de fer, l'inhumation ressemblait à ce qui se faisait partout en Europe avec des sépultures en pierre (les cendres se posaient dans les Cromlechs ou les corps dans les dolmens). Puis la seconde période part de l'antiquité jusqu'au XVIe siècle, quand la mythologie basque se vivait comme religion. Elle entretenait de nombreuses croyances dont la peur de se faire dévorer par le soleil (Eguzki) lors du passage vers l'au-delà. Les Basques, entre autres, sculptèrent donc des cercles de pierre à l'image du soleil, d'où la naissance des stèles discoïdales à travers l'Europe. Lors du rite funéraire, douze nuits après le décès, tous se réunissaient à la pleine lune sur le point le plus élevé et le plus proche de l'etxea.

Après avoir chanté des
louanges, insulté l'astre de la nuit (ennemi du soleil) jusque tard dans la
nuit, le lendemain, la personne la plus âgée poussait la pierre du défunt sculptée
en forme de
roue dans la pente puis on enterrait le corps là où la pierre s'arrêtait,
c'est donc pour cette raison que l'on trouve des sépultures disséminées un
peu n'importe où. Une personne fut d'ailleurs enterrée à 38 km de chez
elle[Réf]
en 1560 et on détourna même un petit cours d'eau pour un autre. Subséquemment, on
utilisa des enclos entourés de murets d'où on lançait la pierre. Ensuite
les mentalités changèrent au fur et à mesure que le rite chrétien s'imposait. Avec la pratique catholique, les Basques vont
vivre un bouleversement avec un décentrage de leurs traditions et de leur
religion. La religion catholique, terre promise de la misogynie, va reléguer la
maîtresse de maison au second rôle après le prêtre, non sans mal. Les
Basques vont désormais
suivre un nouveau code funéraire du XIIe au XIXe siècle
dont la maison et les voisins proches
joueront encore un rôle non négligeable. La
maison fut le plus souvent le lien vers le cimetière familial car chaque etxea
possédait un jarleku nominatif à l'église, sorte de pierre tombale à
l'intérieure de l'église où était inscrit le nom de la maison et sur
laquelle la maîtresse de maison s'assoyait directement dessus lors de l'office
(Il n'y avait pas de bancs à cette époque). Lors du cortège funèbre, chacun
y avait une place bien précise (voir dessin), les anciennes traditions[Réf]
étaient omniprésentes et le chemin (hibidea), qui part de la maison familiale à l'église,
sera en quelque sorte le chemin de la transition entre des rites anciens et le
nouveau.
Les croix ne firent leurs
apparitions que récemment dans les cimetières. Jusqu'au XIXe siècle, les
cimetières étaient verdoyants avec peu de croix de pierre et des stèles
discoïdales et qui charmaient souvent les visiteurs avant que les immenses pierres tombales
fassent leurs apparitions. Présentement, les Basques essayent de renouer avec la
tradition des cimetières
simples, avec juste un parterre vert et de simple stèle ou croix, toutefois les
lobbies s'insurgent.
Il existe différents types de pierres tombales : la croix ou stèle discoïdale (Hilharri) reste populaire dans les milieux ruraux, discoïdales avec des symboles solaires, IHS et Marie, le lauburu (croix basque) et des virgules, des plaques-stèles et des symboles végétaux-arbres. Vieille tradition à travers toute l'Europe et l'Afrique du Nord qui s'est perdue, sauf présentement en Euskal Herria. D'une certaine manière, les stèles peuvent être considérées comme un prolongement moderne de rite funéraire mégalithique.
Mythologie
Voir l'article Mythologie basque ou Abarka
La religion que les Basques pratiquaient avant le christianisme
était faite de légendes innombrables et de quelques traditions encore présentes.
Cette religion était apparemment centrée sur un génie féminin supérieur
nommé Mari,
accompagnée de nombreuses divinités de forme animale. De nombreuses
mythologies avaient comme être supérieur une déesse car la méconnaissance
de la fécondité, donc de la vie, prêtaient à la femme des pouvoirs « surnaturels
».
Des mythes solaires et lunaires ainsi que la relation au ciel étaient aussi très
présents dans tout le Pays Basque. Pour introduire le christianisme, il fallut
concilier beaucoup de légendes avec l'annonce de la naissance de Kismi (le
Christ) et le suicide collectif des Jentilaks (Géants) qui possédaient
de grandes capacités physiques et intellectuelles. Actuellement la vierge Marie
est toujours chantée à la fin de chaque messe et reste vénéré plus
qu'ailleurs, sûrement en référence à Mari.
Saint-Jacques-de-Compostelle
|
Done Jakue bidea ou El Camino de Santiago est un pèlerinage chrétien, dont le but est le tombeau présumé de l'apôtre Jacques de Zébédée, frère de l'apôtre Jean, dans la crypte de la cathédrale la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice. Au cours des Xe et XIe siècle, le culte de Saint Jacques étroitement lié en Espagne à la Reconquista commence de se répandre pour devenir l'un des plus importants du Moyen Âge. Huit chemins différents se recoupent à travers le Pays Basque et une grande majorité des 180 000 pèlerins les parcourent chaque année. C'est une vitrine internationale qui permet à des milliers de gens de tous horizons de faire connaissance pendant plusieurs jours avec le peuple basque, et ceci depuis plus de mille ans. Cet apport est devenu l'un des joyaux de l'industrie touristique. Le Camino Francés est le chemin le plus fréquenté, puis celui de la côte est tout aussi connu. |
Carte des 8 chemins de Done Jakue |
Bibliographie
Références
Revues d'études basques
Liens externes utiles
Ma citation préférée
« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Albert Einstein.
OPINION : Mutur Zikin qui est à l'origine de 90% du contenu ci-dessus à partir de plusieurs traductions, de reformulation, de sources bibliographiques et d'internet. J'en ai fait profité wikipédia à « http://fr.wikipedia.org/wiki/Basques » jusqu'en date du 1er Novembre 2006. Les encadrements orthographiques, grammaticaux et de neutralité m'ont été très prolifiques. DU NOUVEAU CONTENU S'EST RAJOUTÉ.... à l'écart du nombrilisme franco-français franchouillard de certains wikipédiens, qui n'ont pas assez de recul vis à vis de la politique linguistique et du concept d'État nation de leur pays, puisqu'ils y baignent depuis l'enfance. Même si cela concernait qu'une dizaine de lignes de toute cette page, je tiens à ma liberté d'exprimer des faits sur la politique linguistique de France.
Iluna Ehulea